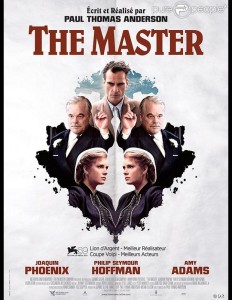20131231 – Retour sur l’année 2013 au cinéma
Bonjour à tous! Retour sur l’année 2013 au cinéma. Une année tellement riche en films beaux et passionnants que je ne peux pas me limiter à dix titres! Voici donc mes 25 films préférés de cette année qui s’achève, 25 films qui m’ont donné du bonheur, ou qui m’ont fait frémir, qui m’ont ému, qui m’ont fait vibrer de passion (et qui ont encore conforté, si besoin était, mon amour du cinéma!): 1. A la Merveille (Terrence Malick) 2. The Immigrant (James Gray) 3. Mud – Sur les rives du Mississippi (Jeff Nichols) 4. La grande Bellezza (Paolo Sorrentino) 5. La danza de la realidad (Alejandro Jodorowsky) 6. The Master (Paul Thomas Anderson) 7. Blancanieves (Pablo Berger) 8. Une Vie simple (Ann Hui) 9. Elefante blanco (Pablo Trapero) 10. Renoir (Gilles Bourdos) 11. Le Passé (Asghar Farhadi) 12. Michael Kohlhaas (Arnaud des Pallières) 13. Violette (Martin Provost) 14. Dans la Brume (Sergueï Loznitsa) 15. Rêves d’or (Diego Quemada-Diez) 16. 2 automnes 3 hivers (Sébastien Betbeder) 17. Snowpiercer – Le Transperceneige (Bong Joon-ho) 18. Tel Père tel Fils (Hirokazu Kore-Eda) 19. Le Géant égoïste (Clio Barnard) 20. Suzanne (Katell Quillévéré) 21. A touch of sin (Jia Zhang-Ke) 22. Wadjda (Haifaa Al-Mansour) 23. Le Temps de l’Aventure (Jérôme Bonnell) 24. Lettre à Momo (Hiroyuki Okiura) 25. Tirez la langue,mademoiselle (Axelle Ropert)
Bonne année 2014 à tous (et à bientôt pour de nouvelles critiques!)
Luc Schweitzer,sscc
20131230 –Cinéma
TEL PÈRE TEL FILS
un film de Hirokazu Kore-Eda
Deux nouveaux-nés échangés à la maternité, l’un aboutissant dans une famille aisée l’autre dans une famille modeste…Impossible de ne pas songer au film d’Etienne Chatiliez, « La vie est un long fleuve tranquille ». Mais la comparaison s’arrête là, car au lieu d’une comédie assez lourdaude et caricaturale, nous avons affaire, avec ce film du japonais Hirokazu Kore-Eda, à une oeuvre d’une grande finesse et d’une grande sensibilité. Plutôt que de s’engager tête baissée dans le registre de la farce, c’est ici l’émotion qui domine, mais l’émotion associée à une réflexion fine et intelligente sur ce que sont la paternité et la maternité.
Qu’est-ce qu’un père? Qu’est-ce qu’une mère? Quand les parents des deux enfants qui ont été mal intentionnellement échangés par le fait d’une infirmière jalouse sont avertis de cette erreur, six ans se sont écoulés. Autrement dit, pendant six ans, ils ont été élevés, éduqués, par leurs parents de substitution. Or la paternité et la maternité s’inscrivent probablement davantage dans la durée que dans le seul fait d’engendrer; on est parent quand on a accompagné un enfant au fur et à mesure qu’il grandit, en lui inculquant une éducation, en lui transmettant des valeurs, des manières, une histoire, etc.
Rien n’est simple, par conséquent, pour les deux familles mises devant le fait accompli. Il est impensable que, du jour au lendemain, les deux enfants soient rendus à leurs géniteurs et qu’on en reste là. Les enfants ne le comprendraient pas car, pour eux, leurs parents sont ceux qui les ont éduqués. Comment sortir de cet imbroglio? Comment se comporter vis-à-vis de l’autre famille? Les mères sont plus sensibles, plus droites, mais les pères ont un comportement ambigu, voulant le bien des enfants sans nul doute, mais avec des arrière-pensées intéressées et pas toujours très avouables. C’est sur eux que se focalise davantage le réalisateur, comme l’indique le titre du film.
Avec un tel sujet, il était facile de déraper, mais Kore-Eda et ses remarquables acteurs (mention spéciale aux enfants) gardent toujours le ton juste et nous passionnent jusqu’au dénouement.
8/10
Luc Schweitzer,sscc
2 AUTOMNES 3 HIVERS
un film de Sébastien Betbeder.
Ce film pourrait également avoir pour titre:« Histoire d’amour (et histoires annexes) ». Rien de très original, en effet, dans le sujet ici abordé:la rencontre d’un homme et d’une femme, en l’occurrence Arman (Vincent Macaigne) et Amélie (Maud Wyler), la naissance de leur amour, leur vie commune avec ses hauts et ses bas. Sur cette trame ultra classique se greffent d’autres histoires, d’autres personnages, d’autres évocations:Benjamin, le meilleur ami d’Arman, la soeur de ce dernier, son père, la petite amie de Benjamin, etc.
Pas de quoi s’enthousiasmer, dira-t-on. Eh bien, si! Car si le sujet a certes des airs de déjà vu, le traitement, lui, est des plus inventifs et emporte irrépressiblement non seulement l’adhésion du spectateur, mais sa plus grande sympathie. Sébastien Betbeder, le réalisateur, a choisi de séquencer le film en courts chapitres et surtout de faire commenter les actions et les péripéties par les personnages eux-mêmes. Tout au long de l’oeuvre donc, ceux-ci interviennent, face à la caméra, livrant leurs impressions, leurs appréciations, leurs réflexions sur les événements passés ou les événements en cours. Ce procédé pourrait vite tourner en rond et devenir lassant, mais ce n’est pas le cas:l’excellence des acteurs et le choix de personnages pour qui l’on ressent une forte empathie font que l’on ne se fatigue jamais de les voir s’exprimer.
De plus, s’il s’agit bien d’une histoire d’amour (on pourrait même dire de deux histoires d’amour), cette histoire (ou ces histoires) naît, grandit, se développe (naissent, grandissent, se développent) dans des circonstances qui ne manquent pas de piquant. De Paris en Suisse, puis de nouveau à Paris, on s’amuse, on se passionne, on rit, on pleure, on tremble, on s’étonne sans une minute de répit. Sébastien Betbeder a conçu un film qui mêle finement la drôlerie, l’émotion et la poésie. Une chanson de Michel Delpech par çi, une chanson de Georges Moustaki par là, l’évocation des thèmes les plus graves (la maladie, la mort), les clins d’oeil au cinéma de Jacques Demy, de Judd Apatow, d’Eric Rohmer, la visite de l’exposition « Munch »au Centre Pompidou, etc. :que d’inventivité, que d’imagination dans le scénario! Et quand le film s’achève, on se dit, le sourire en coin et la larme à l’oeil, que ce qu’on vient de voir est irrésistiblement séduisant!
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20131224 –Cinéma
SUZANNE
un film de Katell Quillévéré.
C’est toujours une gageure que d’évoquer, au cinéma, des destinées en les accompagnant dans la durée, c’est-à-dire pendant plusieurs dizaines d’années. Pour son deuxième film (après « Un poison violent, film déjà très réussi), c’est ce défi qu’a choisi de relever la réalisatrice Katell Quillévéré, et elle y excelle de manière totale.
Ce sont les destinées d’un père et de ses deux filles que nous suivons tout au long de ce film, sur une période d’à peu près vingt-cinq ans. Le père, Nicolas (François Damiens), est un chauffeur routier dont on saura rapidement qu’il est veuf et qu’il élève seul ses deux filles:Maria (Adèle Haenel), son aînée, et Suzanne (Sara Forestier), la cadette.
La belle harmonie qui semble régner dans cette famille sera mise à mal, chahutée, voire brisée de manière temporaire, au fil des événements, et ce dès le moment où Suzanne révèle qu’elle est enceinte et qu’elle met au monde un fils prénommé Charlie. On ne saura pas qui est le père. Suzanne aura, par la suite, à faire des choix ou à se laisser emporter par les circonstances:dans tous les cas, il y aura, dans sa vie, des rencontres et des décisions qui seront lourdes de conséquences. La rencontre la plus déterminante sera celle de Julien, un jeune type dont elle tombe follement amoureuse et qui lui fera tout larguer pour mener avec lui une vie aventureuse et chaotique. Les délits, la prison, le deuil, mais aussi la naissance d’une fille:c’est une vie malmenée que celle de Suzanne, mais une vie qu’il faut construire encore et encore, malgré les coups du sort. Et c’est bien, en fin de compte, la vie qui est la plus forte!
Pour évoquer vingt-cinq années de la vie ou des vies de ses personnages en à peine une heure trente de film, Katell Quillévéré, la réalisatrice, a été conduite à faire des choix de scénario assez radicaux. Il a fallu, bien évidemment, procéder à de nombreuses ellipses, laisser hors caméra beaucoup d’événements, et y compris parmi les événements les plus lourds de conséquences. Ces choix, au lieu d’amoindrir le film, l’enrichissent et ravissent le spectateur exigeant. Je l’ai déjà dit et je le redis:je n’aime rien tant que ce cinéma-là, ce cinéma qui mise sur l’intelligence du spectateur et qui l’invite, en quelque sorte, à combler les manques! Je déteste les réalisateurs qui n’ont pas de meilleure idée de mise en scène que de tout nous mettre sous les yeux (y compris le pire, comme les abominables séances de torture dans « Prisoners »!). Pas besoin de montrer les actes délictueux commis par Suzanne:ce que choisit de montrer Katell Quillévéré, ce sont les conséquences des actes, plus que les actes eux-mêmes. Conséquences sur elle-même, sur son père, sur sa soeur. Et c’est passionnant, bien plus que si nous étaient montrés Suzanne et Julien cambriolant une maison, par exemple.
Servis par des comédiens de grand talent (car, malgré son titre, ce film ne se concentre pas uniquement sur le sort de Suzanne), ce long-métrage est sans aucun doute l’une des meilleures surprises de cette fin d’année 2013 (une année pourtant fertile en beaux événements cinématographiques).
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20131223 –Cinéma
LE GÉANT ÉGOÏSTE
un film de Clio Barnard.
Certes ce premier film de film de fiction d’une jeune cinéaste anglaise, Clio Barnard, n’est pas sans rappeler certaines oeuvres de Ken Loach et, plus largement, ce qu’on peut appeler le cinéma social du Royaume-Uni. Les personnages, les thèmes, l’environnement, tout nous est presque familier. Et pourtant, très vite, on a le sentiment d’avoir affaire à un film qui ne manque pas d’originalité et à une cinéaste qui n’est pas simplement l’épigone de ses illustres prédécesseurs. Il y a, dans « Le Géant égoïste », récit inspiré d’une nouvelle d’Oscar Wilde, un ton et une atmosphère qui lui confèrent des particularités, qui orientent le film vers autre chose que le seul naturalisme.
Bien sûr, le constat qu’on peut dresser en voyant ce film est des plus désolants. Constat d’échec du côté du système scolaire, incapable de trouver d’autre solution que le renvoi quand elle a affaire à des gamins turbulents, insolents et déjà presque asociaux. Constat d’échec également du côté des familles. Voilà donc Arbor et Swifty, les deux gamins de ce film, livrés à eux-mêmes et pas mécontents d’échapper à la contrainte scolaire. Une relation étrange et dangereuse se noue bientôt entre eux et un ferrailleur nommé Kitten. L’honnêteté et la droiture n’étant pas les points forts de ce dernier, les deux gamins sont amenés non seulement à récupérer, mais à voler toutes sortes de métaux, y compris du côté d’une centrale électrique où, bien évidemment, les câbles ne manquent pas. Kitten accepte tout, du moment qu’on a pris soin d’effacer toute marque de provenance des matériaux.
Mais l’un des éléments qui donnent une couleur particulière à ce film, c’est que Kitten, en dehors de son travail de ferrailleur, est également un amateur de courses de chevaux clandestines. Or Swifty, l’un des deux gamins, est également un passionné de cheval. Entre Arbor, qui ne songe qu’à gagner beaucoup d’argent en récupérant le plus possible de métaux, et Swifty, pour qui conduire un sulky et gagner une course l’emporte sur toute autre considération, une distance se creuse. Mais la camaraderie, sinon l’amitié, ne se perd pas si facilement, et quand Arbor se trouvera dans une position difficile, que fera Swifty sinon de lui venir en aide ? Et l’inéluctable risque de se produire…
Clio Barnard a pris soin d’éviter les clichés, les points de vue simplistes, les personnages caricaturaux. On est surpris, à plusieurs reprises, par le comportement inattendu de tel ou tel protagoniste. Le ferrailleur ne se réduit pas à un salaud et à un profiteur. Swifty le tendre peut aussi faire preuve de dureté. Quant à Arbor, qui a l’air de se fabriquer une carapace, de se protéger ainsi de son environnement, de la misère et des violences, il a soudain de ces exigences ou même de ces accès de tendresse qui prouvent que, malgré les apparences, il y a bien, dans sa poitrine, un cœur qui bat. Il faut le voir exiger des policiers qui viennent chez lui l’interroger qu’ils ôtent leurs chaussures ! Et quand survient le drame, il n’est pas le dernier à être bouleversé.
Ce film poignant, tourné dans le nord de l’Angleterre, dans une région dévastée par le chômage et la précarité, a été réalisé avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité. Même les paysages sans charme prennent parfois des allures quasi fantastiques qui leur donnent de la beauté :des tours de centrale nucléaire dans la brume, des chevaux qui s’ébrouent entre des pylônes…Et l’on se dit que, peut-être, il y a un chemin qui conduit au mieux-vivre, même pour ceux qui semblent abandonnés de tous.
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20131218 –Cinéma
A TOUCH OF SIN
un film de Jia Zhang-Ke.
Le ton est donné dès le début:un homme circulant à motocyclette tombe dans une embuscade, il sort une arme et abat froidement les individus qui avaient entrepris de le dépouiller. C’est une Chine sans concession que filme Jia Zhang-Ke, une Chine où la violence sourd de partout et où elle finit par éclater au grand jour. La violence, ce sont d’abord les rapports humains:dans la Chine d’aujourd’hui, livrée au capitalisme le plus brutal, les uns s’enrichissent éhontément sur le dos des autres, se payant des avions pendant que les autres vivotent. La condescendance, le mépris, le rejet, les injustices sont partout. Et pas moyen de se faire entendre, pas moyen d’obtenir justice par des moyens légaux.
Broyés par ce système inique, des travailleurs bafoués en arrivent au pire:à la violence qu’ils ont subi, ils vont répondre par d’autres formes de violence, plus radicales, plus définitives, le meurtre, les tueries ou le suicide! Jia Zhang-Ke, le réalisateur, s’est inspiré de faits réels survenus récemment dans son pays pour brosser le portrait de quatre individus qui, épuisés, à bout, n’en pouvant plus, en sont arrivés au pire. Quatre itinéraires:quatre humiliés, quatre offensés qui ne supportent plus ce qu’ils ont à subir.
Filmées avec force, avec passion, mais non sans un certain lyrisme, ces quatre histoires ne peuvent laisser indifférent. Elles interrogent non seulement la Chine et ses inquiétantes dérives, mais tous ceux qui, de par le monde, gagnés par l’ivresse du pouvoir et de l’argent facile, n’éprouvent plus que mépris pour leurs semblables moins favorisés. Les laissés-pour-compte peuvent avoir la fâcheuse idée de se révolter…
8/10
Luc Schweitzer ,sscc.
20131209 –Cinéma
RÊVES D’OR
un film de Diego Quemada-Diez
En deux ou trois plans, le décor est planté. Une jeune fille s’isole dans un endroit discret, se coupe les cheveux, puis comprime sa poitrine dans un bandage. Une casquette sur la tête et voilà :elle ressemble à s’y méprendre à un garçon. Un autre plan nous montre un jeune garçon préparant son sac à dos pour un voyage. Enfin un autre plan sur une immense décharge à ciel ouvert et sur ceux qui cherchent à y récupérer ce qu’ils peuvent et l’on comprend :les deux personnages que le réalisateur nous a rapidement fait découvrir ont pris la décision de partir, de fuir la misère, de vivre une autre vie, d’aller vers le Nord, loin de leur ville du Guatemala, aux Etats-Unis, à Los Angeles.
Juan, Sara, et un troisième comparse qui n’aura pas le courage d’aller jusqu’au bout du voyage, entreprennent donc ce long périple, incapables d’imaginer à quoi ils vont s’exposer. Ils trouveront sur leur chemin un compagnon inattendu, un Indien du Chiapas nommé Chauk qui s’attachera si fort à eux qu’il ne voudra plus les lâcher. Pourtant, si Sara accepte volontiers sa présence, il n’en est pas de même du côté de Juan qui n’éprouve que mépris pour ce « sale Indien » qui ne parle pas un mot d’espagnol. A plusieurs reprises, Juan essaie de se débarrasser de ce gêneur, mais en vain.
Les voilà donc emportés dans un voyage semé de multiples embûches. Semblables à tous les migrants, ils empruntent des trains de marchandises déjà surchargés de squatteurs. Et comme tous les autres, ils vont être en butte aux pires dangers :quand ce ne sont pas des policiers corrompus qui les volent, ce sont des bandes armées qui brutalisent et dérobent aux migrants le peu qu’ils possèdent. Heureusement, le scénario ménage aussi quelques moments de répit, ainsi quand nos comparses affamés volent une poule mais se trouvent bien embarrassés quand il s’agit de la tuer, ou quand, dans une bourgade, les migrants sont accueillis par un prêtre qui les nourrit et leur offre un gîte pour la nuit.
Le danger, cependant, n’est jamais loin :il faut poursuivre le voyage au milieu d’un paysage qui, s’il est de toute beauté, cache néanmoins de nombreux êtres sans scrupule. Juan, Sara et Chauk, parviendront-ils à traverser le Guatemala, puis le Mexique, et enfin à franchir la frontière des Etats-Unis ? Comment évolueront les relations tendues entre Juan et Chauk ? Quand on affronte les mêmes périls, les préjugés raciaux ne finissent-ils pas par tomber ? Et qu’adviendra-t-il de Sara déguisée en garçon ? Autant de questions auxquelles le film répond, entraînant le spectateur dans une suite de scènes toujours justes et parfois inattendues. La violence est extrême, mais ce monde de violence génère des surprises, des solidarités étonnantes et même des conversions. Le salut, s’il y a un salut, ne peut venir que de la fraternité.
Ancien assistant de Ken Loach, Diego Quemada-Diez a conçu un film à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, une œuvre rude, âpre et bouleversante. On ne peut oublier ces jeunes gens fuyant la misère de leur pays, rêvant des Etats-Unis et de la vie meilleure qu’ils sont sûrs d’y trouver, parcourant des centaines de kilomètres entassés sur des trains et subissant les pires tribulations. Quant au dénouement, il risque d’être aussi implacable que ce qu’ils ont connu au cours de leur périple. Pour son premier long-métrage en tout cas, Diego Quemada-Diez a réussi un coup de maître. Remarquablement filmé et superbement mis en scène, son film nous prend littéralement aux tripes !
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20131129 –Cinéma
THE IMMIGRANT
un film de James Gray.
Quand, un jour de janvier 1921, venues de leur lointaine Pologne, Ewa et Magda débarquent à Ellis Island, elles ont la tête farcie de projets et de rêves. Oh ! Rien d’ivraisemblable :elles comptent sur l’aide d’un oncle et d’une tante déjà installés à New-York et elles imaginent qu’elles prendront racine dans ce nouveau pays en s’y mariant et en y ayant plein d’enfants ! Cette terre qu’elles découvrent et qu’elles imaginent, cette terre dominée par l’imposante statue de la liberté n’offre-t-elle pas la garantie d’un bonheur simple et durable ?
Mais il va falloir très vite déchanter :Magda, soupçonnée d’être tuberculeuse, est retenue en quarantaine à Ellis Island, tandis qu’Ewa, à qui il est arrivée une sombre aventure durant le voyage en bateau, est désignée pour être rapatriée de force dans son pays d’origine. A peine sont-ils prononcés que tous les rêves s’effondrent ! Peut-être pas cependant, à cause d’un homme providentiel, un certain Bruno, qui parvient à la délivrer, la faisant embarquer pour New-York.
Mais, une fois de plus, les illusions s’effondrent :l’homme providentiel n’est qu’un souteneur qui exhibe « ses filles » sur la scène d’un boui-boui des plus glauques et les contraint à se prostituer !
Que peut faire Ewa dans cette ville inconnue, elle dont le seul objectif est à présent de faire soigner et délivrer sa sœur Magda ? Pour ce faire, il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Pourra-t-elle compter sur le secours de sa tante et de son oncle ? Ce dernier, déjà bien installé, ne veut pas s’encombrer d’une parente aux mœurs douteuses. Voilà donc Ewa prisonnière de son « sauveur » Bruno et contrainte de s’exhiber sur la scène de l’infâme gargote en tenant le rôle (ô ironie!) de la statue de la liberté et de se prostituer comme les autres filles.
Mais il ne faut pas se contenter des apparences :tout n’est pas aussi simple qu’on pourrait l’imaginer. Bruno n’est pas uniquement un « salaud » et l’on se rend compte, au fur et à mesure du récit, que, pour la première fois de sa vie probablement, naît en lui ce sentiment inconnu et fort encombrant qui s’appelle l’amour. D’autant plus encombrant et douloureux qu’apparaît un rival en la personne d’Orlando, un magicien ! Nous voilà rassurés, en quelque sorte :si l’on craignait d’avoir affaire à une histoire un rien simplette, on se rend vite compte qu’au contraire les personnages dont il est ici question sont habités de sentiments complexes et contradictoires. Et le film prend toute son épaisseur :il intrigue, il passionne, il fascine…
Oui, la vie intérieure de ces personnages se laisse deviner et celle d’Ewa nous conduit même jusqu’à des sommets de beauté. Que lui reste-t-il, quelle noblesse peut-elle encore revendiquer, à qui peut-elle se fier ? Il lui reste la foi, il lui reste la prière et la confiance en Dieu ! Une des plus sublimes scènes nous la montre, suivie et épiée par son jaloux de souteneur, allant à l’église pour y entendre la messe. Celle-ci terminée, les pas d’Ewa la conduisent tout naturellement au confessionnal. C’est vrai, au prêtre qui lui demande de quitter Bruno, elle répond qu’elle ne le peut pas, que, toute à son projet de guérir et de délivrer sa sœur, elle va devoir rester en enfer ! Mais ce qui est vrai aussi, c’est que, même en enfer, même en vendant son corps, même en étant une femme avilie, Ewa n’est pas atteinte dans son cœur. Son corps est souillée, son cœur est pur.
Récemment, en revoyant « La Porte du Paradis », la splendide fresque de Michael Cimino, je songeais irrésistiblement aux romans russes, et le personnage de prostituée interprétée par Isabelle Huppert me rappelait une autre prostituée, celle que Dostoïevski avait imaginé pour « Crime et Châtiment » et qui se prénomme Sonia. Mais cette comparaison avec Sonia est encore plus juste à propos du personnage d’Ewa. Comme la prostituée de Dostoïevski, cette dernière, malgré les apparences, incarne l’être le plus noble, le plus digne et le plus pur qui soit.
Avec subtilité, sans la moindre trace de prosélytisme, James Gray, dans ce film, nous donne à voir ou à entrevoir la grandeur de la foi, la beauté de la prière et la noblesse du pardon. Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’être croyant pour apprécier :tout le monde pourra y trouver son compte car le réalisateur nous propose l’un des plus bouleversants portraits de femme qu’on ait vu au cinéma depuis longue date. Marion Cotillard en Ewa a trouvé là l’un de ses meilleurs rôles :elle excelle en tout point, de même d’ailleurs que Joaquin Phoenix en Bruno ! Ce film magnifique est, sans aucun doute, l’un de mes préférés de l’année 2013 (une année pourtant très riche en beaux événements cinématographiques!).
9,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20131117 –Cinéma
IL ÉTAIT UNE FORÊT
un film de Luc Jacquet.
Plutôt que de m’abrutir avec les « sacher-masocheries » de Roman Polanski dont je n’ai que faire, j’ai préféré m’émerveiller au spectacle de la forêt primaire telle que la présente Luc Jacquet dans ce superbe film. Bien m’en a pris, d’autant plus que si les amateurs de Sacher-Masoch ne sont nullement des espèces en voie de disparition, les forêts primaires, elles, le sont. De ce que montre ce film, il ne restera peut-être rien d’ici quelques dizaines d’années. Peut-être est-il encore temps de tirer le signal d’alarme et de sauver ce qu’il est encore possible de sauver…Si ce film y contribue, c’est tant mieux.
Luc Jacquet a choisi de s’appuyer sur l’expérience, sur la science, sur la passion du botaniste Francis Hallé. Cela rend son film à la fois pédagogique, savant sans être pédant, poétique et captivant. Autre choix qui déplaira sans doute à certains:des images d’animation s’invitent dans les prises de vue réelles. Mais ces images sont pleinement au service d’un projet pédagogique et elles sont d’autant moins gênantes que l’on voit, tout au long du film, le botaniste Francis Hallé dessiner ce qui se présente sous ses yeux. Ce qui reste, c’est la fascination que l’on éprouve pour la forêt. Je n’imaginais pas être autant ému par des arbres. Eh bien si! Luc Jacquet et son complice Francis Hallé nous les présentent comme des êtres qui vivent et qui meurent, en somme un peu comme des frères. Et en vérité ils le sont. Mais ces forêts qui mettent des siècles à s’inventer, à se construire, l’homme peut les détruire en un rien de temps. Et là où l’homme a rasé la forêt, laissera-t-il la forêt se réinventer, patientera-t-il durant des siècles pour en voir à nouveau la splendeur? Pas si sûr malheureusement…
Bravo en tout cas à Luc Jacquet pour cette oeuvre pleinement aboutie et réellement splendide!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20131111 –Cinéma
VIOLETTE
un film de Martin Provost.
« Louons les actrices françaises », s’exclamait ces jours-ci Bertrand Tavernier sur son blog, avant de dresser une liste (non exhaustive) de celles-ci et de vanter leurs nombreux talents. Comme Bertrand Tavernier a raison! Et ce n’est certes pas ce film-ci qui donnera la preuve du contraire. Emmanuelle Devos incarnant Violette Leduc comme Sandrine Kiberlain revêtant l’apparence et les manières de Simone de Beauvoir sont toutes deux extraordinaires!
De Violette Leduc je ne connaissais pas grand chose, je l’avoue, avant de la découvrir telle qu’elle nous est montrée dans ce film et de me mettre à lire « La Bâtarde », l’un de ses ouvrages les plus fameux. Elle s’y raconte sans détours, usant d’un style très personnel, reconnaissable entre mille, un style fait de phrases très courtes, presque sèches et cependant jamais banales. On comprend, à la lire, ce qui a séduit Simone de Beauvoir et pourquoi cette dernière a tout mis en oeuvre pour la faire éditer et célébrer à sa juste valeur. Il a fallu du temps et de l’énergie, comme le raconte le film, il a même fallu que le Castor y aille de son argent pour venir en aide à sa cadette en littérature.
Et il a fallu, aussi et surtout, supporter tant bien que mal les assauts et les crises d’une femme amoureuse et presque constamment déçue. Car Violette Leduc fait partie de ces gens qui, même sachant qu’ils vont droit à l’échec, ne peuvent faire autrement que continuer d’avancer, quitte à finir la tête fracassée contre un mur. Et des échecs, l’auteure de « La Bâtarde »ne connaît quasiment rien d’autre. Chaque fois qu’elle tombe amoureuse d’un homme (Maurice Sachs ou Jacques Guérin) elle a affaire à un homosexuel, et quand elle s’entiche d’une femme (Simone de Beauvoir en l’occurrence) il s’agit d’une femme qui n’est nullement tentée par des amours lesbiennes! Non seulement Simone de Beauvoir rejette toute complicité amoureuse mais elle va jusqu’à affirmer que toute véritable amitié avec Violette Leduc est impossible!
Qui donc est-elle, cette Violette Leduc?, se demande-t-on tout au long du film. Martin Provost a su préserver la part de mystère d’une femme douée certes d’un indéniable talent littéraire mais ayant les comportements d’une personne psychiquement fragile voire carrément malade. Certaines scènes donnent le sentiment qu’on a affaire à quelqu’un qui est au bord de la folie. Ce qui la retient, ce qui lui permet de ne jamais totalement sombrer, c’est probablement d’avoir la capacité de se raconter:jamais peut-être on n’aura eu autant raison de dire que l’écriture agit, au moins en partie, comme un exorcisme ou comme le fil qui permet au funambule chancelant de se maintenir entre ciel et terre.
On pardonnera volontiers au réalisateur quelques afféteries de mise en scène ; le film est passionnant de bout en bout et parfaitement servi non seulement par les actrices dont on ne dira jamais assez le talent mais par des acteurs (Olivier Py, Olivier Gourmet) eux aussi excellents. Le fervent admirateur de Julien Green que je n’ai jamais cessé d’être depuis de nombreuses années pardonnera aussi volontiers à Martin Provost d’avoir mis en scène Violette Leduc qui, ne trouvant pas le moindre exemplaire d’un de ses livres dans une librairie, se saisit, de rage, d’un volume du « Journal » de l’auteur de « Moïra » pour le jeter à terre en s’écriant :« Mais il n’y en a que pour Julien Green ici ! ».
Il n’est pas facile, il faut le dire, de mettre en scène des personnalités du monde littéraire sans être soit pédant soit ennuyeux soit superficiel. Ici au contraire tout est convaincant, tout est captivant, tout est émouvant. Et l’on n’a qu’une envie au sortir de ce film :lire les œuvres de Violette Leduc (et peut-être aussi, pourquoi pas, celles de Simone de Beauvoir) !
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20131106 –Cinéma
QUAI D’ORSAY
un film de Bertrand Tavernier.
Après « La Vie d’Adèle »et « Snowpiercer », voici donc encore un film dont le scénario s’inspire d’une bande dessinée. Peut-être est-ce là une nouvelle source d’inspiration pour les cinéastes…
Ceux qui ont lu les BD en question feront sans doute des comparaisons. Personnellement, n’ayant parcouru aucune de ces BD, je me contente de ce que m’offrent les films et, pour ce qui concerne ce long-métrage de Bertrand Tavernier, j’ai été favorablement impresssionné. L’esprit BD a été parfaitement conservé, me semble-t-il. Autrement dit, au lieu de nous assommer avec un film pesant et didactique sur les arcanes de la vie politique, Tavernier s’est lancé, pour la première fois de sa carrière, dans une vraie comédie, dans un film burlesque et réjouissant que j’ai trouvé plutôt réussi.
Nous voici donc au ministère des affaires étrangères, à l’époque de Dominique de Villepin rebaptisé ici Alexandre Taillard de Worms et ayant adopté les traits de Thierry Lhermitte. Virevoltant, faisant claquer les portes et s’envoler les feuilles de papier à chacun de ses passages, se référant à Héraclite et aux poètes, homme de langage qui fait refaire dix fois, vingt fois ses discours, tel apparaît le ministre campé brillamment par Lhermitte, incontestablement dans l’un de ses meilleurs rôles. Autour de lui grouille tout un aréopage de conseillers, de rédacteurs, d’hommes de l’ombre, tous parfaitement incarnés par des acteurs de grand talent. Il faut mentionner en particulier Niels Arestrup qui campe un remarquable directeur de cabinet et Raphaël Personnaz qui incarne Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA chargé de la rédaction des discours du ministre, ainsi que la compagne de ce dernier à qui la talentueuse Anaïs Demoustier prête ses traits.
Dans un film qui accorde une si grande importance au langage, il faut saluer aussi l’inventivité, la pertinence et la drôlerie des dialogues. Grâce à eux et grâce au talent de Thierry Lhermitte, et bien sûr à la direction d’acteurs de Tavernier, le film est, à de nombreuses reprises, très amusant et on ne s’en plaindra pas. Autant montrer la vie politique sous cet aspect-là sans négliger bien entendu d’autres aspects également présents dans « Quai d’Orsay »:ainsi le stress des employés du ministère ou les morceaux de bravoure du ministre énonçant ses discours.
Au début du film, quand Arthur Vlaminck se présente au ministère pour briguer son emploi, lorsqu’il patiente avec ses souliers crottés, lorsqu’un huissier lui fait parcourir des enfilades de couloirs, on songe à un roman de Kafka. Cette impression perdure d’ailleurs au cours du film:ainsi quand il est question d’Internet ou de stabilos. Il y a de l’absurde, oui, dans l’univers ministériel tel qu’il nous est présenté, mais il y a aussi, bien évidemment, de la grandeur et du prestige. Tout cela s’allie pour nous donner un film fort agréable.
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20131031 –Cinéma
SNOWPIERCER :LE TRANSPERCENEIGE
un film de Bong Joon-Ho.
Dans la jungle des blockbusters, c’est-à-dire des films à grand spectacle le plus souvent formatés pour plaire au public le plus large possible, dans cette jungle surgit parfois l’exception, autrement dit un film qui échappe à la médiocrité et qui, de ce fait, peut réellement satisfaire tous les appétits cinéphiliques et pas seulement ceux qui ne vont au cinéma que pour se divertir. Le spectacle est au rendez-vous certes, la cavalcade des effets spéciaux fait son œuvre bien sûr, mais il y a bien davantage que ce qui saute aux yeux, il y en a aussi pour l’esprit, pour l’intelligence, pour la sensibilité, pour l’imagination…
Ce film du réalisateur coréen Bong Joon-Ho se place indéniablement parmi ces exceptions :il excelle sur tous les plans, il en met certes plein les yeux, mais il offre aussi et surtout une multitude de lectures possibles et peut donc satisfaire, voire fasciner même les spectateurs les plus exigeants. Pour tout dire en quelques mots et contrairement aux autres blockbusters post-apocalyptiques parus cette année, celui-ci tient la route (ou plutôt les rails) !
Nous sommes en 2031 et, par la faute de l’homme, la Terre est entrée depuis 2014 (!) dans une nouvelle ère de glaciation qui a anéanti toute possibilité de vie à sa surface. Les seuls rescapés sont ceux qui ont pu prendre place dans un train lancé à toute allure et faisant le tour de la planète sans jamais pouvoir s’arrêter. L’image de ce train circulant à pleine vitesse dans un océan de glace ne peut que fasciner l’imagination des plus rétifs. Mais ce n’est que le décor car, à l’intérieur du train, les rescapés n’ont pas tardé à reproduire soigneusement le schéma vieux comme le monde du maître et de l’esclave. En 1927 déjà, dans son fameux « Metropolis », Fritz Lang imaginait une cité futuriste régie sur une base identique :dans les hauteurs s’ébattait la classe dirigeante tandis que les masses serviles croupissaient dans les bas-fonds. Il en est de même dans ce film de Bong Joon-Ho, sauf qu’au lieu de la verticalité des gratte-ciel on a affaire à l’horizontalité d’un train fou :les maîtres profitent de la vie à l’avant tandis qu’à l’arrière végètent les pauvres, condamnés à ne survivre qu’en ingurgitant une nourriture des plus douteuses.
Il va de soi que, comme dans le film de Fritz Lang, de telles injustices ne peuvent que générer des révoltes. Plusieurs ont déjà échoué et ont été réprimées dans le sang quand survient celle que rapporte le film de Bong Joon-Ho, révolte menée par un petit groupe d’hommes déterminés, capables de déjouer les pièges et de progresser de wagon en wagon jusqu’à l’avant du train. En somme le film raconte cela :l’avancée de ces hommes, leurs combats, et les découvertes invraisemblables qu’ils font. Car chaque wagon traversé amène son lot de surprises, ici un jardin qu’on dirait surgi de l’Eden, là un aquarium géant, etc. On a affaire à une arche des temps modernes, conçue pour la survie de quelques privilégiés. L’aventure fascine et apporte son lot de révélations et de questionnements. Et là où Fritz Lang avait échoué (sans que cela n’enlève rien à la magnificence de son film), ne sachant achever autrement son récit qu’avec un prêchi-prêcha peu convaincant, Bong Joon-Ho, lui, réussit un final éblouissant et intrigant qui semble à la fois signifier la fin de l’humanité et son éventuel recommencement.
Malgré sa structure assez simple et somme toute quelque peu convenue, ce film recèle de grandes richesses d’interprétation. On peut le voir comme la parabole de l’absurdité de la condition de l’homme livré à lui-même. Quel recours possible pour ce concentré d’humanité parcourant la Terre gelée à l’intérieur d’un train dément qui ne sait que tourner en rond ? Il est à remarquer que pas une seule fois au cours du film il n’est fait mention de prières, sans parler de la foi en un Dieu qui pourrait sauver ce reste d’humanité en perdition. Le seul dieu qui reste à ces hommes semble être le concepteur du train, celui dont on parle et qu’on ne voit pas parce qu’il reste cantonné à l’avant de sa machine. Mais quand les révoltés parviennent jusqu’à lui, qui trouve-t-il ? En fait de dieu, on a affaire à un homme vieillissant qui n’a su que retarder de quelques années l’inéluctable :une humanité qui court à sa perte !
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20131024 –Cinéma
GRAVITY
un film d’Alfonso Cuarón
L’engouement suscité par ce film, les critiques dithyrambiques qui tombent comme à Gravelotte, les éloges à n’en plus finir, tout cela me semble très excessif et je vais essayer d’expliquer pourquoi. Ne crions pas trop vite au chef d’oeuvre car, si l’on y regarde de près, si l’on résiste tant soit peu à l’enthousiasme quasi unanime des critiques, on est bien forcé d’admettre que « Gravity » n’est pas si extraordinaire qu’on veut nous le faire croire.
Ce qui mérite tous les éloges, c’est ce que tout le monde souligne :les prouesses technologiques, les effets spéciaux bluffants, le spectacle incomparable qui nous est offert. Je n’ai nul besoin d’insister davantage sur ce point, il a été décrit et commenté ad nauseam par tous les critiques (et à juste titre, je le reconnais volontiers) !
Mais faut-il donc que l’arbre cache la forêt ou que le spectacle soit tel qu’il dissimule l’inconsistance du scénario ? Car le premier gros défaut de « Gravity » est là :nous avons affaire en somme, malgré toutes les innovations technologiques, à un film d’aventures des plus classiques, c’est-à-dire à une série d’événements et de péripéties à la fois terrifiants et distrayants mais qui relèvent de l’invraisemblance. Pris isolément, chacun des rebondissement qui composent le scénario est probablement plausible, mais mis bout à bout tous ces événements forment une aventure totalement ahurissante et dont on n’imagine pas que quelqu’un puisse en réchapper. Eh bien si ! Puisque nous demeurons dans le registre du film d’aventures à la sauce hollywoodienne, il n’est pas concevable qu’au moins un des personnages ne s’en sorte pas indemne ! L’une des spationautes parvient donc à déjouer tous les dangers, à échapper aux débris, à se balader tant bien que mal dans l’espace et à passer d’une station à une autre, à ne pas mourir carbonisée dans l’incendie qui ravage l’une d’elles, etc. Le cumul de tant d’aventures n’a ni queue ni tête, mais puisque ce qui nous est proposé n’est en somme rien d’autre que du divertissement, il ne convient pas d’en demander davantage !
Certes, certes, mais le problème, c’est que le réalisateur cherche tout de même, bien timidement, à donner un peu de sens aux aventures dont il nous régale les mirettes. Malheureusement, toutes ces tentatives ne mènent à rien de très intéressant et l’on en reste à quelque chose de superficiel. Le plus intéressant, ce sont les évocations que fait le personnage joué par Sandra Bullock, évocations de son Illinois, de sa famille, de sa fille décédée…Mais tout ça reste très sommaire. Quant aux indices métaphysiques relevés par certains critiques, ils ne sont qu’anecdotiques :il ne suffit pas d’un petit couplet sur la prière (ou sur l’impossibilité de la prière), il ne suffit pas de montrer une icône de saint Christophe dans la station russe et un bouddha dans la station chinoise pour nous transporter (c’est le cas de le dire) au septième ciel. Il faut croire qu’Alfonso Cuarón n’était pas de taille à approfondir ces thèmes et qu’il a préféré se cantonner au film de divertissement !
Reste un troisième et dernier gros défaut de « Gravity » :la musique ! Pourquoi donc infliger aux spectateurs, à de nombreuses reprises au cours du film, une musique sirupeuse et indigeste qui non seulement n’apporte rien mais qui dérange et qui perturbe? Ce qui est ironique d’ailleurs, c’est que cette musique commence d’intervenir au moment précis où George Clooney demande à Sandra Bullock ce qu’elle préfère dans l’espace. « Le silence ! », répond-elle. Ah, bien oui ! En fait de silence, on a droit à une musique envahissante et gênante dont on se passerait volontiers !
Je ne cherche nullement à mépriser le cinéma de divertissement, mais je fais partie résolument de ces spectateurs qui, quand ils se rendent dans une salle obscure, espèrent autre chose qu’un plaisir immédiat et sensoriel qu’ils auront tôt fait d’oublier ! Louis Guichard, dans Télérama, évoque avec juste raison les œuvres de cinéastes géniaux tels que Stanley Kubrick et Andréi Tarkovski. La comparaison avec Alfonso Cuarón ne peut se faire qu’au détriment de ce dernier. Le cinéaste russe affirmait, dans une interview de 1984, qu’à ses yeux le cinéma était un art et que, par conséquent, il se devait de proposer autre chose que du simple divertissement. Et, comme Kubrick, il a prouvé, si besoin est, en réalisant « Solaris », qu’on peut montrer au cinéma des spationautes sans céder uniquement à l’événementiel et au spectaculaire, mais en proposant un autre voyage, un voyage intérieur, en allant loin, très loin, dans un voyage d’ordre spirituel du meilleur aloi !
P.S. : En 1968, dans un de ses chansons (« Dessin dans le ciel »), Serge Reggiani dénonçait déjà « la fourrière d’en-haut, la ferraille du ciel » ! Les choses, manifestement, ne se sont pas arrangées depuis cette année-là ! Si l’on en juge d’après « Gravity », il y a tant d’objets dangereux qui gravitent là-haut qu’il vaudrait mieux renoncer à y envoyer des êtres humains ! Dieu, que l’espace est encombré à 600 kilomètres au-dessus de notre bonne vieille Terre !
6,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20131017 – Chanson Française
LE JOUR ET LA NUIT
un album de chansons de Gilbert Laffaille.
Chouette ! Un nouvel album de Gilbert Laffaille ! Depuis le temps qu’on l’attendait ! Et l’on n’est pas déçu :le talent de celui qui a chanté « Le président et l’éléphant » ou « Le gros chat du marché » ne s’est pas amoindri avec le temps. Les douze chansons qu’il nous offre aujourd’hui sont toutes parfaitement ciselées, belles, profondes, poétiques, incisives quand il le faut et sans en avoir l’air. Le trait n’est jamais lourd avec Laffaille, tout est écrit et composé avec finesse et simplicité. Pas besoin d’insister plus qu’il ne faut, pas besoin de brandir les drapeaux de la révolte ni de lever le poing :les chansons de Gilbert Laffaille ne nous touchent que davantage, elles vont droit au cœur de qui sait entendre.
Gilbert Laffaille a l’art de mêler avec intelligence les petites choses de la vie et les grands événements du monde. Avec ses chansons, il nous invite à être attentifs à ce qui se passe autour de nous, à voir plus loin ou plus profond que les apparences. Quand il brosse le portrait de Mr Li et qu’il décrit le bric à brac de son « Palais de Shangaï », c’est au détour d’un vers que l’on apprend, l’air de rien, que le monsieur en question « a connu l’enfer/et s’est enfui/en radeau sur la mer ». Dans « Just like you », Gilbert Laffaille évoque ceux qui, regardant les nantis détruisant la planète (« voyez ces calamités/ces coulées de boue/tous ces oiseaux mazoutés!), sont cependant avides de tout avoir (« tout comme vous/just like you »). Et dans « Homme en boubou femme en sari », le chanteur-poète convoque les habitants du Sénégal, de Madagascar, du Centrafrique, du Niger, de Guyane, ceux qu’on a appelés lors des guerres pour servir la France et dont les enfants ou les petits-enfants ne sont plus les bienvenus (« A vous Ali et Mamadou/tombés à Lens ou à Nancy/à vos enfants venus chez nous/à qui l’on dit :Partez d’ici ! »).
Dans « Comme un ange au paradis », c’est d’un enfant qu’il s’agit, d’un petit bébé qui dort au milieu des détritus et de la pauvreté :que deviendra-t-il, ce « petit bonhomme », demande le chanteur, « qui saura voir ce beau levain/cette eau de source qui ruisselle/ces gouttes d’or entre tes mains » ? On n’en finirait pas d’évoquer toutes les chansons de cet album, celles qui, tout simplement, nous invitent à « lancer des balles/des oiseaux des mots bleus des mots doux/des cigales » ou à prêter attention aux petits riens, aux « petits gestes/du quotidien ». « Nous sommes nous dans nos rêves », affirme encore Gilbert Laffaille, lorsque nous rêvons aux « chemins de l’enfance », lorsque nous imaginons un monde meilleur.
Merci, Gilbert Laffaille, de nous inviter à parcourir ensemble « nos chemins de voyageurs » ! En votre compagnie et avec vos chansons, le voyage devient passion, enchantement et interpellation !
Luc Schweitzer,sscc
20131016 –Cinéma
OMAR
un film de Hany Abu-Assad
Le « mur de la honte » comme le nomment certains, ce mur édifié par les autorités israéliennes à des fins de protection, Omar le franchit régulièrement, au risque d’être abattu par une balle, afin de rejoindre ses amis Amjad et Tarek, tous militants de la cause palestinienne. Omar prend d’autant plus le risque de le franchir qu’il est également amoureux de la soeur de Tarek, la belle Nadia, au point qu’il ne rêve que de l’épouser.
Mais les choses se compliquent irrémédiablement lorsque les trois amis fomentent l’attaque d’un camp militaire israélien. Un soldat est tué, les combattants palestiniens s’enfuient, mais Omar finit par être rattrapé, emprisonné et torturé. Commence alors une intrigue des plus tortueuses car la police israélienne veut mettre la main sur les complices d’Omar et, en particulier, sur celui qui a abattu le soldat. Pour ce faire, tout est permis, y compris, au moyen de menaces, de réinfiltrer Omar parmi ses amis pour en faire un traître.
Comment se sortir de ce guêpier? Omar est tiraillé entre ses amitiés, son devoir, son amour sans réserves pour Nadia. Il est pris au piège, captif d’un monde dans lequel, il s’en aperçoit rapidement, personne ne peut plus faire confiance à personne. La suspicion, la jalousie, la trahison, le mensonge sont partout. Qui est exempt? Nadia elle-même est-elle aussi pure et nette qu’il l’imaginait?
Malgré sa complexité, ce thriller haletant se regarde sans que jamais l’on perde le fil de l’intrigue. Mêlant la grande et la petite histoire, le contexte politique douloureux de ces territoires et les questions et les atermoiements des individus, le réalisateur Hany Abu-Assad a réussi un film passionnant et virtuose. Les poursuites dans les dédales des rues et des maisons sont filmées avec grand talent. On tremble pour ces personnages, on se pose mille questions à leur sujet, et l’on sait qu’une telle histoire, que tous ces pièges et ces mensonges ne peuvent conduire qu’à des drames, à des gestes terribles et inéluctables.
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20131010 –Cinéma
LA VIE D’ADELE
un film d’Abdellatif Kechiche.
Le voilà donc enfin sur nos écrans, ce film qui a déjà fait couler beaucoup d’encre et de salive :célébré au festival de Cannes, encensé par tous les critiques au point qu’on ne peut aller le voir sans être quasi certain d’avoir affaire à un chef d’oeuvre. Les polémiques qui ont agité le petit monde de la cinéphilie n’y changent rien, on nous a dit et répété que « La Vie d’Adèle » est un chef d’oeuvre et nous n’avons donc plus qu’à acquiescer !
Je prendrai donc le risque d’aller à contre-courant (ou à contre-opinion ou à contre-critique) car je n’ai pas du tout le sentiment d’avoir vu un chef d’oeuvre. J’ai vu un film qui certes ne manque pas de qualités (quelques moments ou quelques scènes d’une fulgurante beauté, des actrices d’exception), je ne le nie pas, mais qui, pris dans son ensemble, éreinte, fatigue, annihile le spectateur ! Je suis sorti de la salle saturé et n’en pouvant plus !
Au début du film, avant qu’Adèle ne rencontre Emma, elle essaie de vivre une histoire d’amour avec un garçon, histoire éphémère mais qui donne lieu à quelques dialogues. Ainsi Adèle raconte-t-elle à ce garçon sa passion pour la littérature :« je n’aime pas, précise-t-elle, les professeurs qui se croient tenus de tout expliquer, d’entrer dans tous les détails, car cela bloque l’imagination ! » Or c’est exactement le piège dans lequel est tombé Abdellatif Kechiche :son film est tellement surchargé qu’il bloque l’imagination !
Il y trop de tout dans « La Vie d’Adèle » :le film est beaucoup trop long, les scènes sont beaucoup trop longues, il y a trop de gros plans, trop de réalisme, trop de crudité, trop d’explications, trop de démonstrations…Et, du coup, il n’y a plus de place pour le spectateur ! Quand on voit un tel film, on est sommé de n’être rien d’autre précisément qu’un spectateur, un être passif qui doit assimiler sagement et bêtement tout ce qu’on lui montre. Il n’y a plus de place ni pour l’imagination ni pour l’intelligence du spectateur :tout lui est dit, tout lui est montré, jusqu’à la morve qui souille le beau visage peiné d’Adèle !
Les polémiques qui ont opposé les actrices et le réalisateur ces dernières semaines nous ont tout appris sur le comment. Mais ce qui m’intéresse, ce n’est nullement de savoir comment s’est déroulé le tournage. Je ne tiens pas particulièrement à connaître les secrets de fabrication d’un film. Ce qui m’intéresse beaucoup, par contre, ce sont les questions du pourquoi (en un mot) et du pour quoi (en deux mots). Or plus d’une fois pendant la durée du film je me suis posé ces questions :pourquoi Abdellatif Kechiche a-t-il tourné telle scène et dans quel but ? Les scènes d’étreinte torride, par exemple, apportent-elles quelque chose au film ? A cela je réponds clairement non ! Non seulement ces scènes n’apportent rien, mais en les imposant aux spectateurs, le réalisateur prend le risque d’en faire des voyeurs ! Et ce ne sont pas seulement les scènes de sexe que j’incrimine. Bien d’autres scènes invitent également à quelque chose qui ressemble à du voyeurisme. Pourquoi tant de gros plans sur le visage d’Adèle ? Est-ce nécessaire ? Il y avait tant de manières de raconter cette histoire ; la manière choisie par le réalisateur me laisse très insatisfait.
Dès lors qu’il est question de sexe ou de violence, le mieux est toujours, à mon avis, de suggérer plus que de montrer. Est-ce donc si difficile de miser sur l’intelligence, la sensibilité et l’imagination du spectateur ? A-t-on besoin de tout détailler ? Les grands réalisateurs classiques (les Ernst Lubitsch, John Ford, Billy Wilder, etc. ) savaient bien comment s’y prendre pour tout suggérer sans rien montrer. On me dira qu’à cette époque-là sévissait la censure. Certes, mais aujourd’hui encore, il est des réalisateurs, comme les frères Dardenne, qui savent faire place aux spectateurs, qui savent les rendre en quelque sorte participants de leurs films.
Tel n’est pas le cas avec ce film d’Adbellatif Kechiche, tellement surchargé qu’il en devient fatigant ! Pour bien faire, il faudrait réduire sa durée de moitié ! D’autant plus que le scénario en somme n’a rien que de très banal, sa seule originalité étant qu’il s’agit d’une histoire d’amour lesbienne (mais traitée, il faut le dire, intelligemment, comme une histoire d’amour qui touche à l’universel!). Il faut aussi, malheureusement, déplorer les dialogues :la plupart du temps ils sont d’une grande pauvreté et, quand ils essaient d’échapper à la banalité, c’est pour tomber dans la pédanterie et donc dans une autre forme d’insignifiance (c’est le cas chaque fois que les personnages parlent de littérature, de philosophie ou de peinture!). On n’échappera pas non plus à certains clichés, Adèle et Emma étant issues de deux milieux sociaux opposés :chez la première on mange des spaghettis tandis que chez la deuxième on se régale avec des huîtres !
Je ne veux pas accabler davantage ce film qui offre néanmoins quelques beaux moments de cinéma. Mais, on l’aura compris, quand je me rends dans une salle obscure c’est pour y trouver autre chose que ce que ce film m’a offert. Tout à l’heure j’entendais à la radio l’annonce du prix Nobel de littérature accordé à Alice Munro. Et le commentateur ajoutait :Alice Munro, qui écrit essentiellement des nouvelles, possède l’art de mettre tout un monde dans une forme restreinte. Le film d’Abdellatif Kechiche, c’est un peu le contraire :c’est un tout petit monde qui remplit une forme très ample (le film ayant une durée de trois heures) jusqu’à saturation !
5/10
Luc Schweitzer,sscc
20131007 –Cinéma
LA VIE DOMESTIQUE
un film d’Isabelle Czajka
Tout est dit (ou plutôt suggéré) dans le titre de ce film d’Isabelle Czajka! Dans « la vie domestique », il y a le mot « domestique »qui d’adjectif peut devenir substantif et prendre le sens de « larbin ». Mais ce sont les femmes qui ont le rôle de « larbins »:à elles la charge de la maison, son entretien, le souci et la préparation des repas, les courses à faire, le soin des enfants, etc. , etc.
Rien d’extraordinaire dans ce film, sinon la vie banale de quelques femmes vivant dans une banlieue résidentielle de la région parisienne. 24 heures de la vie de Juliette (Emmanuelle Devos, impeccable comme toujours) et de ses amies, de leurs vies si remplies, si trépidantes, qu’on se demande comment elles tiennent le coup ou ne sombrent pas dans la dépression. Juliette qui ne se satisfait pas cependant de son sort, qui voudrait décrocher un emploi dans une maison d’édition. Juliette qui trouve néanmoins l’énergie de donner un peu de son temps à des lycéennes en difficulté scolaire, ce qui donne lieu à une scène amusante qui rappelle le beau film de Laurent Cantet, « Entre les murs ». Juliette qui emmène ses enfants à l’école et qui se soucie de leur trouver une baby-sitter quand c’est nécessaire. Juliette qui retrouve une ancienne connaissance perdue de vue et qui l’invite à dîner. Et Juliette qui s’active à la cuisine afin de bien recevoir ses invités. On n’en finirait pas d’énumérer tout ce que fait Juliette (et ce que font ses amies).
Tout cela paraît tellement banal qu’on se demande pourquoi ce film a tant de charme, pourquoi il captive à ce point. Cela s’explique bien entendu par plusieurs facteurs qui, mis ensemble, forment un film d’excellence:la grâce de la mise en scène, le talent indéniable des actrices et la qualité des dialogues (superbement écrits!).
Mais une question nous vient tout naturellement à l’esprit:et les hommes dans tout ça? Où sont les hommes et que font-ils? N’ont-ils donc pas leur place dans la vie domestique? Il faut l’admettre, ils sont grandement absents! La faute à leur travail, certes! Mais quand ils rentrent à la maison, comment se comportent-ils? Ne vont-ils pas soulager leur épouse et prendre leur part des tâches domestiques? Aïe, aïe, aïe! La vérité, c’est qu’ils sont tire-au-flanc. Ils se bâfrent de nourriture et leurs propos sont le plus souvent triviaux, voire carrément stupides!
Isabelle Czajka a réalisé avec « La vie domestique »un film qu’on peut qualifier de féministe, à condition de donner à ce mot son sens le plus noble, à condition de le faire sonner comme un hommage rendu à ces femmes, épouses et mères, dont les vies sont si pleines et si fatigantes, mais qui risquent de se perdre, si l’on n’y prend garde, dans la vacuité ou dans l’ »à quoi bon ».
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20130930 –Cinéma
LETTRE A MOMO
un film de Hiroyuki Okiura.
Pour patienter, en attendant la sortie prochaine du « Vent se lève », l’ultime film du maître Hayao Miyazaki, voici un petit bijou de film d’animation signé Hiroyuki Okiura. Certaines de ses scènes et certains de ses personnages peuvent d’ailleurs être perçus comme des hommages au génial créateur du « Voyage de Chihiro ».
L’une des particularités des auteurs japonais de films d’animation, c’est de ne pas craindre d’aborder les sujets les plus difficiles et de le faire, en règle générale, avec beaucoup de sensibilité, de justesse, de pudeur et d’intelligence. Ici il est question de Momo, une petite fille en deuil puisqu’elle vient de perdre son papa et dont la peine est d’autant plus grande qu’elle s’était querellée avec ce dernier juste avant son décès. La petite Momo débarque donc, au début du film, avec sa mère, chez son grand-oncle et sa grand-tante. Elle apprend à vivre, sans grand enthousiasme, dans sa nouvelle maison et son nouvel environnement. Elle apprend aussi à connaître de nouveaux camarades de jeux.
Mais Momo, marquée par son deuil, a bien du mal à se familiariser avec toutes ces nouveautés et ce d’autant plus que sa nouvelle maison recèle de grands mystères. Et, sans s’en rendre compte, voici que la petite fille libérera des esprits, trois esprits d’aspect terrifiant mais qui, au fil du temps, se révéleront facétieux et chapardeurs sans être du tout méchants. La fillette aura cependant bien du fil à retordre avec ces esprits fantasques, ce qui donnera lieu, au cours du film, à des scènes délectables dont une course poursuite d’anthologie avec des sangliers! Et de quoi sont-ils encore capables, ces trois esprits surgis d’un vieux livre d’images? Que ne feront-ils pas pour secourir la petite Momo?
Ce merveilleux film entièrement dessiné à la main se regarde avec un bonheur et une fascination qui ne faiblissent jamais, nous menant à la scène de tempête, dramatique, terrifiante, qui constitue l’un des points d’orgue de l’oeuvre. A voir et à revoir sans modération.
8/10
Luc Schweitzer ,sscc
20130929 –Cinéma
THE WAY – LA ROUTE ENSEMBLE
un film d’Emilio Estevez
J’aimerais tant dire du bien d’un tel film, mais hélas son seul mérite est de donner la preuve, si besoin est, que ni les bonnes intentions ni les bons sentiments ne suffisent…Il faut tant d’autres choses pour faire ne serait-ce qu’une oeuvre de qualité! Il faut une vraie mise en scène, une vraie direction d’acteurs, de vrais choix de cinéaste, un vrai scénario, etc.
Ici, dans ce film, il n’y a rien de tout cela! Seule émerge de cet ensemble sans relief une idée première intéressante, celle d’un médecin ophtalmologiste américain qui apprend soudainement le décès de son fils, mort accidentellement alors qu’il venait à peine d’entreprendre le pélerinage de Saint Jacques de Compostelle. Arrivé à Saint Jean Pied de Port, notre ophtalmo (campé par Martin Sheen), après avoir récupéré les cendres de son fils, décide de faire lui-même le pélerinage.
Jusque là, on se dit qu’on pourrait assister à un film de qualité. Mais tout ne tarde pas à se gâter et à se gâter irrémédiablement car, petit à petit, se joint à l’ophtalmo un groupe de trois comparses qui, par leur seule présence, ôtent toute crédibilité à ce récit! Ces trois personnages ne sont rien d’autres que des stéréotypes imaginés par un scénariste en mal d’inspiration et qui a sans doute cru faire oeuvre originale en les imaginant. Mais, les ayant imaginés, il a été incapable de leur donner vie et d’en faire autre chose que des fantoches! Cela commence avec un néerlandais jovial et bon vivant ayant entrepris le pélerinage de Saint Jacques pour perdre du poids! Cela se poursuit avec une canadienne accro à la cigarette et qui souhaite se libérer de cette addiction! Cela s’achève avec un écrivain irlandais en panne d’inspiration et qui espère retrouver le goût d’écrire!
On pourrait peut-être, à la rigueur, se satisfaire de ces caricatures de personnages si les acteurs étaient bien dirigés, mais ce n’est pas du tout le cas. Tous ces acteurs sont lamentables, le summum de la médiocrité étant atteint par les interventions toutes plus ridicules les unes que les autres du troisième comparse (l’irlandais écrivain, exécrable!). Même Martin Sheen, lors de certaines séquences, est très mauvais! Quant aux autres personnages du film (les espagnols rencontrés lors d’une halte par exemple) ils sont tous plus ou moins grotesques!
Que dire de plus? « The Way », c’est l’exemple même d’un film non seulement raté mais sans âme (ce qui est un comble quand on met en scène des pélerins se dirigeant vers Compostelle)!
2/10
Luc Schweitzer,sscc
20130923 –Cinéma
ALABAMA MONROE
un film de Felix Van Groeningen
La passion cinéphilique réserve parfois de grandes surprises, heureuses ou…malheureuses! Voici un film qui, depuis qu’il est sorti sur les écrans, il y a plusieurs semaines, a récolté un concert de louanges presque unanimes. Les internautes l’ayant vu et le commentant y vont quasiment tous de leur dithyrambe, vantant à qui mieux mieux les extraordinaires qualités de cette œuvre. Comment un passionné de cinéma de mon espèce aurait-il pu résister? Impossible!
Je me suis donc décidé, poussé par ce chœur de laudateurs ne sachant plus quels superlatifs employer pour échapper à la banalité et certain de vivre un grand moment de cinéma, à voir enfin l’un des films prétendument les plus marquants de cette année! Hélas! Hélas! Quelle déconvenue, quelle déception, quel film affligeant et pervers!
Mais comment se fait-il que je sois l’un des seuls spectateurs de ce film à en avoir décelé le projet retors? Mystère…Il faut dire que son réalisateur, Felix Van Groeningen, est un grand malin, un rusé qui connaît les ficelles et qui sait bien par quels moyens on peut, pour ainsi dire, mettre le spectateur dans sa poche, en faire un indéfectible allié qui finira par dire amen à tout! Peut-être a-t-il pris ses leçons chez Michael Haneke, autre cinéaste qui, dans certains de ses films, n’hésite pas à prendre en otage le spectateur!
Car il s’agit de cela, n’ayons pas peur des mots, une prise d’otage du spectateur! Felix Van Groeningen s’y prend avec malice:l’air de rien, il conduit le spectateur où il veut, jusqu’aux scènes finales où, si l’on n’est pas un rebelle de mon espèce, on ne peut que rendre les armes.
De quoi s’agit? Par petites touches et en jonglant constamment avec la chronologie, le cinéaste nous fait découvrir Didier et Elise, un couple uni par la passion:passion l’un de l’autre, passion de la musique country, et bientôt passion de Maybelle, l’enfant née de leur union. Mais le malheur les frappe rudement lorsque survient la terrible maladie, une leucémie, dont est atteinte la petite fille. Ils lutteront, ils espéreront, mais en vain. Et l’on assistera, médusé, à leur détresse…
Comment une telle histoire ne submergerait-elle pas d’emotion le spectateur? Felix Van Groeningen, avec grande habileté, passe sans arrêt d’une scène heureuse (la rencontre de Didier et Elise, les concerts de musique country) à une scène éprouvante (la petite fille à l’hôpital…). Pendant la première moitié du film, on ne peut qu’être bouleversé. Mais, petit à petit, le rusé cinéaste conduit son monde vers des conclusions hasardeuses et sans appel. Elise offre à sa petite fille une croix. Puis, à plusieurs reprises, l’on voit à la télévision des discours de George Bush:une première fois au moment des attentats du 11 septembre, puis lorsque ce dernier explique son refus des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Et enfin, lors d’un concert de musique country, à la fin d’une chanson, Didier hurle aux spectateurs son rejet du Dieu de la Bible et sa détestation de toutes les religions, accusées d’être rétrogrades et bornées, puisqu’elles interdisent toute manipulation d’embryon! Et le Pape bien sûr n’est pas exempt, lui qui va jusqu’à rejeter le préservatif! Or cette éructation de Didier n’est tempérée par rien! Elise tient un discours certes différent de celui de Didier, mais tellement infantile qu’il devient dérisoire. Le cinéaste a tellement su nous émouvoir que l’on ne peut plus qu’aquiescer. Voilà ce que j’appelle une prise d’otage du spectateur:on est quasiment obligé d’adhérer aux propos de Didier! Et tant pis s’ils sont dénués de subtilité et caricaturaux! Le film donne le sentiment que toutes les religions se valent et qu’il convient de les honnir puisqu’elles ne sont composées que de fondamentalistes fanatiques!
C’est donc un film qui, s’il ne manque pas de séduction dans sa première moitié, dérape complétement ensuite. Les dernières scènes sont toutes, sans exception, ratées. Cette dégringolade commence avec une parodie de mariage qui confine au ridicule et trouve son point d’orgue dans le discours de Didier que je viens d’évoquer. Encore une fois, même si le réalisateur ne manque pas de ruse, je ne comprends pas que tant de spectateurs se soient laissés mener par le bout du nez jusqu’à tant applaudir une oeuvre en fin de compte très malhonnête!
3/10
Luc Schweitzer,sscc
20130915 –Cinéma
JIMMY P. (Psychanalyse d’un Indien des Plaines)
un film d’Arnaud Desplechin
L’union du cinéma et de la psychanalyse m’a toujours semblé hasardeuse et les films qui se sont appuyés sur ce thème se sont souvent soldés par des ratages ou des semi-ratages. Je ne suis donc guère amateur de ce genre cinématographique et, même si j’ai fort apprécié jusqu’ici les films d’Arnaud Desplechin, je m’attendais, pour ce qui concerne cette oeuvre, à être vite pris par l’ennui et à sentir mes paupières s’alourdir très rapidement…
Erreur totale! Non seulement ce film ne m’a pas ennuyé une seule seconde, mais je l’ai trouvé passionnant! Voici donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la rencontre de Jimmy Picard, un Indien Blackfoot revenu blessé et traumatisé de France, et de George Devereux, Juif d’origine hongroise, à qui l’on fait appel en sa qualité d’ethnologue et de psychanalyste. Car ce n’est pas tant le corps de Jimmy Picard qui est blessé que son esprit. Comme le lui dira George Devereux, si le corps peut être marqué de nombreuses cicatrices qu’on ignore, il en est de même et plus encore quand il s’agit de l’esprit.
Ce sont ces cicatrices que, patiemment, tout au long des rencontres entre les deux hommes, l’on va découvrir. Mais ce qui passionne et ce qui surprend aussi et surtout, davantage même que les blessures passées, ce sont ces hommes et ces acteurs:l’Indien Jimmy Picard (Benicio del Toro) étonamment fragile et doux malgré son corps massif qui semble taillé pour remporter tous les combats –et le psychanalyste George Devereux (Mathieu Amalric) tellement minuscule à côté de l’Indien mais si agité, si captivé, si sûr de lui et de ses méthodes qu’elles semblent parfois faire violence. Et l’on découvrira, bien sûr, que ce dernier n’est pas indemne, que si l’Indien est hanté par ses démons, le psychanalyste n’est exempt ni de blessures ni de cicatrices. Arnaud Desplechin s’est inspiré de personnages réels et, pour son premier film américain, a réussi le dosage délicat entre les scènes de dialogues (forcément assez nombreuses), les flashbacks et les scènes de rêves. Il y a peut-être quelques maladresses, mais en règle générale tout est bien agencé et filmé avec intelligence. On sent aussi à quel point Arnaud Desplechin (si français cependant) aime le cinéma classique américain, celui du génial John Ford en particulier. Une des scènes de « Jimmy P. »lui rend d’ailleurs explicitement hommage:l’Indien et le psychanalyste assistent ensemble à une séance de cinéma. Et que projette-t-on? « Young Mister Lincoln », un film de John Ford!
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20130909 –Cinéma
LA DANZA DE LA REALIDAD
un film d’Alejandro Jodorowsky.
Curieux personnage que le réalisateur de ce film, Alejandro Jodorowsky. Dans les années 70 il signe plusieurs films que je n’ai jamais eu l’occasion de voir et qui ont la réputation d’être à la fois ésotériques et surréalistes. Puis il délaisse le cinéma pour se consacrer à d’autres arts, le mime, le roman, la poésie et surtout la bande dessinée. Et voici qu’après 23 ans d’absence sur le grand écran et à l’âge de 84 ans il resurgit avec un film étonnant, inclassable, fou, dont il faut dire d’emblée que c’est un chef d’oeuvre (que j’ai regardé les yeux écarquillés comme un enfant qui découvre le monde!).
Pas de fatras ésotérique dans « La danza de la realidad », mais une recréation de l’enfance de Jodorowsky, enfance vécue à Tocopilla, un village cerné par le désert, un trou perdu du Chili. Quand je dis « recréation », il faut l’entendre au sens littéral:Jodorowsky ne cherche nullement à reproduire son enfance de manière réaliste, il la recrée en lui donnant des couleurs fantastiques et fantasmatiques, il fait danser la réalité comme dit si bien le titre du film. Cette oeuvre apparaît comme son « à la recherche du temps perdu »et, pour ce faire, tout est possible, tout est permis. Jodorowsky ne se refuse rien, aucune audace, aucune folie, aucun délire, pourvu qu’il puisse retrouver quelque chose du trésor perdu de l’enfance.
Voici donc le petit Alejandro, petit garçon juif dont les parents tiennent une boutique de lingerie à Tocopilla. Un petit garçon écartelé entre un père communiste, admirateur de Staline, et une mère qu’il imagine en cantatrice, au point qu’elle ne parle qu’en chantant comme si elle passait sa vie sur une scène d’opéra! Le père veut élever son enfant à la dure:tout est affaire de volonté, pas question d’avoir pitié d’autrui, pas question d’être une mauviette! Ainsi quand le petit Alejandro passe sur le fauteuil du dentiste, son père exige de lui qu’il refuse toute anesthésie! Et bien sûr il n’est pas question d’accorder du crédit aux religions:« quand tu meurs, tu pourris, un point c’est tout. »
Mais tout n’est pas si simple et la profession de foi stalinienne risque d’être fort malmenée. Jaime, le père d’Alejandro, le découvrira à ses dépens. Sous sa carapace de pur et dur du stalinisme se dissimule un coeur qui sait s’apitoyer et quand des travailleurs en révolte sont cernés par l’armée et réclament à boire, c’est lui, Jaime, qui ose braver les soldats en apportant de l’eau aux assoiffés. Jaime sera conduit, au fil de l’histoire, par des chemins ô combien douloureux, vers une sorte de rédemption. Pour ce faire, il connaîtra, lui aussi, ce que c’est que souffrir, lui qui inculquait à son fils qu’il fallait souffrir sans se plaindre:il empruntera son chemin de croix ou plutôt son chemin de torture…
Il faut cependant que je mette en garde les éventuels spectateurs de ce film:il faut, pour l’apprécier, accepter non seulement de se laisser surprendre, mais même d’être choqués! Car Jodorowsky se permet tout et il y a, sans aucun doute, l’une ou l’autre scène qui heurtera la sensibilité de certains spectateurs. Il serait dommage cependant d’être rebuté au point de ne retenir que ces scènes-là et de passer ainsi à côté de l’essentiel. Or l’essentiel, me semble-t-il, c’est d’apprendre qu’il faut s’aimer et c’est bien à cela que le film invite. On peut le percevoir comme une vaste parabole à l’intérieur de laquelle sont insérées d’autres paraboles. Prenons un exemple qui, pour ceux qui connaissent l’Evangile, ne manquera pas de rappeler la parabole du bon samaritain. Jaime se retrouve, à un moment, loin des siens, démuni, misérable, abandonné, sans personne pour l’aider. Il s’adresse d’abord à un prêtre qui, en guise d’obole, lui remet une mygale! Puis il s’approche d’un groupe de jeunes filles de bonnes familles (comme on dit) et celles-ci lui jettent des pierres. Las! Ce ne sont pas les gens biens qui lui porteront secours, mais un pauvre menuisier!
Impossible de tout dire ni même de tout évoquer tant ce film est foisonnant, surprenant, inventif, bien plus que n’importe quel film de Fellini. Mais il y a une parole que dit ou plutôt que chante sa mère au petit Alejandro et qui me semble révéler quelque chose de la quintessence du film:« Ce n’est pas moi qui t’aime, chante-t-elle à son fils, c’est Dieu qui t’aime. Et moi je suis celle qui te transmet cet amour de Dieu. »Ah! oui, il valait la peine d’attendre 23 ans le retour au cinéma de Jodorowsky si c’était pour nous donner un tel chef d’oeuvre!
9,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20130908 –Cinéma
TIREZ LA LANGUE,MADEMOISELLE
un film d’Axelle Ropert.
Il y a quelque chose d’atypique, d’étrange, voire d’excentrique dans ce film dont les deux personnages masculins principaux sont frères, tous deux médecins généralistes, travaillant dans le même cabinet, voyant en consultation les mêmes malades et donc arpentant le même quartier de Paris (en l’occurrence le Chinatown du 13e arrondissement). Il y a peut-être aussi autre chose, de plus caché, mais de non moins important, c’est un réel souci non seulement du malade, mais de l’autre:de la compassion pourrait-on dire, ce qui, après tout, n’est pas si fréquent dans les films.
Or voilà que nos deux médecins, Boris et Dimitri, sont appelés une nuit au chevet d’Alice, une petite fille diabétique qui vient de faire un malaise. Sa mère, Judith, travaillant de nuit dans un bar, l’a laissée seule. Boris et Dimitri, bien sûr, finiront par la rencontrer, cette maman qui a les traits charmants de Louise Bourgoin et dont tous deux tomberont amoureux.
Il y a des failles chez l’un et chez l’autre, chez Dimitri surtout qui essaie de se guérir de son addiction à l’alcool. Les deux médecins tournent autour de Judith, tentent de la séduire, mais sans rien se dire l’un à l’autre, en tout cas dans un premier temps. Quant à la petite Alice, la malade, elle n’a pas sa langue dans sa poche et elle pose bien des questions. Et le père de la fillette, où est-il, qu’est-il devenu? Judith cédera-t-elle aux avances de Boris ou à celles de Dimitri ou encore se refusera-t-elle à l’un et à l’autre?
Toutes ces questions trouveront leurs réponses au fil d’une histoire qui se déroule à la fois avec légéreté et avec gravité. Pas de grands drames dans ce film, mais, comme dans les meilleures comédies, on perçoit un fond de mélancolie. La réalisatrice n’appuie jamais excessivement sur ce qui fait mal, elle sait donner à son film de l’élégance, elle ne dissimule pas les souffrances, mais elle les évoque avec retenue. C’est un film qui suscite beaucoup d’émotion, mais sans jamais être tire-larmes! C’est un film ouvert:ouvert comme ces portes automatiques qui, dans une des nombreuses belles scènes qui l’émaillent, n’arrivent plus à se refermer. Et nous non plus, spectateurs, nous n’avons guère envie de refermer la porte et de chasser de nos esprits les personnages curieux et attachants que ce film nous a fait découvrir.
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20130903 –Littérature
A PROPOS DE WALTER SCOTT (ET DE CHARLES DICKENS)
quelques réflexions après avoir lu « Waverley » de Walter Scott.
« Waverley » est le premier roman « écossais »rédigé par Walter Scott. Il y est question de l’insurrection des clans écossais des Highlands qui défendaient les Stuart contre les Anglais qui se réclamaient de la maison de Hanovre, en 1745-1746. Ce contexte historique ne manque pas d’intérêt et il y a, dans ce roman, des pages très instructives. Malheureusement on s’ennuie tout de même quelque peu: les scènes sont trop étirées, les personnages n’ont pas su susciter mon empathie. Je n’ai pas retrouvé ici ce qui m’avait séduit l’an dernier tandis que je lisais « Ivanhoé », le roman le plus célèbre de Scott. Cela dit, je continuerai à lire cet auteur qui vaut mieux que la réputation qu’on lui a faite.
Walter Scott souffre (en France, car je suppose qu’il n’en est pas de même dans les pays anglo-saxons) des mêmes préjugés qui affectent Charles Dickens. Ces auteurs ne sont connus que soit par les éditions abrégées de leurs oeuvres faites pour les enfants ou les adolescents soit par les films ou les téléfilms qu’on a tirés de leurs oeuvres. Autrement dit, on ne se donne pas la peine de les lire et, sans les avoir lus, on les méprise quelque peu en les classant dans la catégorie des écrivains pour la jeunesse. C’est absurde! Même s’ils peuvent convenir à la jeunesse, ni Scott ni Dickens n’ont écrit exclusivement pour ce public-là! En vérité, si l’on est curieux, si l’on ouvre leurs romans, si l’on se donne la peine de les lire, on se rend vite compte que ces oeuvres d’une part sont faites pour tous les publics et d’autre part qu’elles valent bien mieux que la réputation qu’on leur prête.
Cela vaut, en premier lieu, pour Dickens qui est un bien meilleur écrivain que Walter Scott. Mais ce dernier n’a pas à être méprisé et il réserve parfois de bonnes surprises. Cela m’a frappé, l’an dernier, quand je lisais « Ivanhoé ». Je me souvenais d’un critique de cinéma qui expliquait que le film de Richard Thorpe de 1952 (avec Robert Taylor et Elizabeth Taylor) était beaucoup plus passionnant que le roman dont il était tiré. Certes ce film est une belle réussite (je l’ai visionné bien des fois et toujours avec bonheur) mais il est faux, archi-faux, de prétendre que le roman de Scott est inférieur au film. Au contraire, il y a dans le roman des éléments qui ont été expurgés lorsqu’il s’est agi de réaliser le film (car dans l’Hollywood de 1952, la censure était encore très active et il y a des choses qu’il ne convenait pas de montrer sur un écran). Ainsi, dans le roman, Scott insiste beaucoup sur l’appartenance de Bois-Guilbert à l’ordre des Templiers. Autrement dit, Bois-Guilbert (le méchant du roman!) est un religieux et ce religieux se consume d’amour et de désir pour la belle juive Rébecca. Scandale qui est complétement absent du film (Bois-Guilbert y est présenté comme un simple chevalier et non pas comme un Templier) et qui donne au roman, en autres aspects, une force supplémentaire.
Méfions-nous des a priori, des préjugés, des idées toutes faites, dans tous les domaines, et également en littérature. Avant de répéter bêtement ce qui se dit à propos d’un auteur, allons-y, lisons et portons notre propre jugement! Gageons que le critique de cinéma qui méprisait le roman de Scott n’avait jamais pris la peine de le lire!
Luc Schweitzer,sscc
20130901 –Cinéma
GRAND CENTRAL
un film de Rebecca Zlotowski.
Comment faire du neuf avec un sujet rebattu, avec un mélo qui parle d’amour et de désir comme dans tant d’autres films, avec l’histoire d’une femme qui irradie et qui fait chavirer et qui fait entrer dans la déraison? « Grand central »donne la preuve, si besoin est, que ce n’est nullement l’originalité du sujet qui compte au cinéma, mais son traitement , son cadre, la direction des acteurs, l’inventivité de la mise en scène, etc.
La première originalité du film de Rebecca Zlotowski, c’est de l’avoir situé dans le monde méconnu, fermé, opaque, des travailleurs du nucléaire. Cela lui donne un ton inhabituel:tout le film est comme placé sous tension, le danger est présent, invisible, inodore, mais d’autant plus sournois. La réalisatrice n’a certes pas eu l’intention de faire un film militant, mais on ne peut pas rester indifférent au sort de ceux qui sont envoyés au coeur même des zones dangereuses, risquant ainsi à tout moment d’être les victimes d’une surdose de radiations. Cela remet tout de même sérieusement en cause le refrain lénifiant qu’on entend habituellement en France dès qu’il s’agit du bien-fondé de nos centrales nucléaires.
Mais laissons cela car ce n’est pas à proprement parler le sujet du film. Ce dont il est question, c’est non seulement des radiations qui émane du nucléaire, mais de celles que propage le personnage joué par Léa Seydoux. Saluons ici le jeu impeccable de l’ensemble des acteurs (Tahar Rahim, Olivier Gourmet, Denis Ménochet) et celui, remarquable, de Léa Seydoux (décidément une très grande actrice, capable de faire le grand écart, c’est-à-dire d’incarner, film après film, des personnages aux antipodes les uns des autres, interprétant aussi bien une hospitalière dans « Lourdes »de Jessica Hausner qu’une sorte de vamp dans ce film-ci).
Autre originalité du film de Rebecca Zlotowski, moins évidente que la première peut-être mais qui n’échappera pas au spectateur attentif, c’est la maîtrise de la mise en scène:tout le film est constitué de scènes très courtes, parfois un peu maladroites, un peu trop abruptes, mais la plupart du temps très justes et très intenses. Des scènes qui ne s’encombrent pas de fioritures, qui vont droit à l’essentiel, qui font percevoir les menaces qui pèsent sur les personnages, non seulement à l’intérieur mais à l’extérieur de la centrale nucléaire. Il y a les corps bien sûr, les corps qui s’attirent, se touchent, se repoussent, se battent, transpirent de peur, les corps lavés, récurés, pour les nettoyer de toute trace de contamination. Et il y a les regards:plus encore que les corps, ce sont les regards que Rebecca Zlotowski filme avec le plus d’intensité; on y trouve toute la gamme des sentiments, l’attirance, la fascination, la peur, la haine, le vide, l’absence, la détresse, etc. Il y a des échanges (mais aussi à d’autres moments des non-échanges) de regards entre Léa Seydoux et Tahar Rahim qui en disent plus long que tous les discours.
Ce film fort n’est certes pas parfait, mais il est habité, mais il donne à voir des personnages qui restent, qu’on n’oublie pas. Et l’on peut supposer qu’avec Rebecca Zlotowski on a affaire à une cinéaste qui n’a pas fini de nous surprendre.
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20130819 –Cinéma
MICHAEL KOHLHAAS
un film d’Arnaud des Pallières.
Le thème de l’homme qui, étant victime d’exactions et ayant épuisé tous les recours possibles, estime qu’il n’a plus d’autre choix que de s’ériger lui-même en justicier de sa propre cause, ce thème a déjà été abordé bien des fois au cinéma et tout particulièrement dans nombre de westerns. « Michael Kohlhaas »précisément, au fil de plusieurs de ses scènes, a tout à fait l’allure d’un western, avec ses hommes chevauchant leurs montures dans des paysages cévenols qui, par moments, ressemblent à s’y méprendre à certains paysages de l’ouest américain. Avons-nous donc affaire à un thème rebattu et à un film manquant d’originalité? Pas du tout, car même les thèmes ou les sujets les plus ressassés peuvent apparaître comme nouveaux pour peu qu’on sache leur donner une couleur ou un ton inédit. Or ce qui fait, à mon avis, l’originalité de « Michael Kohlhass », c’est que le thème de la justice y est abordé d’une manière très précise en résonance avec la foi chrétienne et avec des références bibliques. C’est un théologien en effet qui, au cœur même du film, dans ce qui m’a semblé en être la scène la plus significative, rappelle à l’insurgé Michael Kohlhaas les exigences de la foi chrétienne et lui fait en quelque sorte sentir ainsi dans quelle folie il s’est engagé.
Mais reprenons les faits depuis le début sans bien sûr dévoiler la totalité de l’intrigue et en se gardant de raconter l’issue vertigineuse du récit. Arnaud des Pallières a adapté un roman d’Heinrich von Kleist en le transposant dans les Cévennes du XVIe siècle. Un marchand, Michael Kohlhaas, en route vers une ville pour y vendre des chevaux, se trouve arrêté dans sa course par une barrière. C’est un seigneur local, un baron, qui, au mépris de toutes les règles, a pris la décision d’exiger un péage de quiconque veut passer sur ses terres. Michael Kohlhaas s’insurge mais se voit contraint de laisser en gage deux de ses chevaux jusqu’à ce qu’il revienne et s’acquitte de la somme due. Mais, à son retour, il découvre que ses chevaux ont été terriblement maltraités et que le valet qu’il avait chargé de leurs soins a disparu. On le retrouvera plus tard, blessé, mordu par des chiens qu’on a lâché sur lui. Michael Kohlhaas demande justice, mais il n’obtient rien. Il finit même par envoyer sa femme intercéder pour lui auprès d’une princesse. Mais la violence n’épargne rien ni personne et, en désespoir de cause, Michael Kohlhaas ne voit plus d’autre issue que de prendre les armes, que d’entraîner à sa suite les paysans de la région et que de se venger par la guerre.
Michael Kohlhaas qui lit la Bible, qui connaît l’Evangile, sait bien qu’il y est exigé le pardon des ennemis, mais son appétit de justice l’emporte sur toute autre considération. A quel prix? Au prix du sang! Est-il permis de se faire justice soi-même et, pour ce faire, d’entraîner avec soi des hommes qui le paieront de leur vie? Le théologien qui interpelle Michael Kohlhaas lors de la scène la plus importante du film lui pose ces questions. Au nom de la justice, Michael Kohlhaas n’a-t-il pas ouvert la porte à mille injustices plus graves encore que celle qu’il a lui-même subie?
Ce film puissant apparaîtra peut-être à certains un peu trop sage, un peu trop classique, dans sa réalisation. Il y a aussi, ici ou là, l’une ou l’autre scène quelque peu confuse, il faut l’admettre. Mais ces défauts mineurs sont largement compensés par la force de ce récit, par les plans superbes qui émaillent le film d’un bout à l’autre, et aussi et surtout par le jeu des acteurs, à commencer bien sûr par le danois Mads Mikkelsen, impressionnant dans le rôle titre. Mais les autres acteurs et actrices ne sont pas en reste:ainsi la fillette qui joue de le rôle de l’enfant de Michael Kohlhaas; elle apparaît à la fois comme une fille aimante et comme un reproche vivant pour un père qui a emprunté des chemins de désastre!
Luc Schweitzer,sscc
20130802 –Cinéma
My Childhood
My Ain Folk
My Way Home
une trilogie de Bill Douglas.
En cette période de disette cinématographique (je suis peu enclin à aller voir les films nouveaux du genre « Wolverine »ou « Pacific Rim »!), il y a cependant de belles et grandes découvertes à faire. Ainsi en est-il de cette trilogie de Bill Douglas, un cinéaste britannique dont j’ignorais tout jusqu’à ces jours-ci…
Cinéaste méconnu donc mais qu’il est urgent de connaître! Les trois films de courte durée qui composent la trilogie qui vient de ressortir sur les écrans m’en ont définitivement convaincu! Ces films furent réalisés dans les années 70 et ils retracent, volet après volet, l’enfance et la jeunesse d’un garçon prénommé Jamie et dont l’itinéraire correspond sans doute fortement à celui du réalisateur lui-même.
Ce qui nous est raconté ici est terrible:c’est le portrait d’une enfance meurtrie, abandonnée, sacrifiée…Un des films les plus déchirants jamais réalisés sur l’enfance. Dans le décor sordide d’une ville minière d’Ecosse vivote Jamie, balloté d’un endroit à l’autre, entre ses grands-mères, son père et son demi frère, n’ayant que la faim au ventre, le froid au corps couvert de crasse…Qui l’aidera? Qui lui donnera de l’espoir? Sûrement pas sa mère qu’on a enfermé à l’asile des fous! Il y a bien un prisonnier de guerre allemand dans le premier volet, mais il finit par s’en aller, laissant Jamie encore plus seul.
On songe à Dickens, mais les romans de ce dernier ressemblent à des bluettes si on les compare à ce qu’éprouve Jamie. Celui-ci d’ailleurs reçoit en cadeau (son premier livre!) « David Copperfield »qui finira déchiré, lacéré, jeté au rebut! Bill Douglas compose ses films à coups d’ellipses, ne laissant apparaître que des scènes qui semblent comme arrachées au destin tragique du jeune Jamie. Au spectateur de boucher les trous, d’imaginer, d’être participant aux films. Les scènes les plus brutales se déroulent toutes hors champ. Ces films sont-ils désespérés? Pas tout à fait car le dernier volet (« My Way Home ») nous fait découvrir Jamie devenu jeune adulte et faisant son service militaire en Egypte. C’est là enfin qu’il aura la chance de trouver, en la personne d’un de ses camarades militaires, celui qui l’aidera vraiment, lui donnant ou lui redonnant le goût de vivre, d’aimer quand même la vie!
Retenons bien le nom de ce cinéaste, Bill Douglas! En dehors de cette trilogie, il n’a pu tourner qu’un seul autre film (« Comrades ») avant de décéder en 1991 à l’âge de 55 ans. Son oeuvre annonce celle des grands réalisateurs britanniques que nous aimons et qui ont pour noms Ken Loach ou Mike Leigh!
9/10
Luc Schweitzer,sscc
20130627 –Cinéma
UN MOIS EN THAÏLANDE
un film de Paul Negoescu.
Ce premier long-métrage du roumain Paul Negoescu, même s’il s’en dégage une impression de morosité et de monotonie, est une indéniable réussite.
Le film tout entier se déroule pendant les fêtes de la saint Sylvestre. Au petit matin du 31 décembre, nous découvrons Radu et sa petite amie Adina dans leur train-train quotidien. Déjà il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de ferveur dans ce que font les deux protagonistes. Certes Adina exprime verbalement son amour pour Radu, certes ce dernier lui fait la surprise de lui proposer un voyage en Thaïlande, mais l’impression qui domine aux yeux du spectateur oscille entre le manque d’entrain et le manque de sincérité.
Cette première impression ne tardera pas d’ailleurs à se vérifier. Paul Negoescu, le réalisateur, a choisi de dresser le portrait d’un homme indécis, pris dans ses atermoiements comme dans une toile d’araignée. En effet, un peu plus tard, tandis qu’il fait ses courses dans un supermarché, Radu croit reconnaître, parmi les clients, celle qu’il a aimée auparavant et qu’il a quittée, Nadia. Et le voilà qui se met à regretter cet amour perdu!
Cela l’obsède à tel point que, plus tard, en pleine nuit du nouvel an, alors que l’on se congratule et qu’explosent les pétards, Radu rompt avec Adina et se met à la recherche de Nadia. Toute la nuit, il erre d’une boite de nuit à une autre jusqu’à ce qu’il la retrouve. Après les explications houleuses qu’on est en droit d’attendre, cette dernière finit par se laisser aller dans les bras de Radu au point que c’est à elle que celui-ci propose maintenant de faire un voyage en Thaïlande! Nadia décline gentiment cette offre et l’on imagine que Radu se réinstallera sans tarder dans son petit train-train…Avec Adina ou avec Nadia, en fin de compte quelle importance? Les deux petites amies semblent être interchangeables, y compris dans leurs prénoms qui sont l’anagramme l’un de l’autre…
En faisant le portrait de Radu, le réalisateur nous propose aussi une vision désabusée de son pays, la Roumanie. Un pays qui certes a tourné la page des heures sombres du communisme, de la terrifiante dictature de Ceausescu, un pays où l’on trouve dorénavant de tout, où les magasins regorgent de denrées, mais un pays qui n’a pas d’autre objectif que de se laisser engloutir par le consumérisme. Quand Radu déambule dans les allées d’un supermarché, on constate à quel point celui-ci est bien achalandé, tellement bien achalandé que l’on ne sait plus quel produit choisir! Et quand, dans la nuit du nouvel an, Radu va d’une boite de nuit à une autre, on a le sentiment que toutes les fêtes sont identiques et que les gens dansent et s’amusent mécaniquement, parce qu’il faut bien danser et s’amuser en une telle occasion!
C’est donc un film que peut-être certains spectateurs jugeront trop monotone, mais que, pour ma part, j’ai regardé avec beaucoup d’intérêt. L’image qu’il renvoie de la Roumanie n’est certes pas enthousiasmante, mais, dans la mesure où elle correspond à quelque chose de réel, elle mérite d’être reçue. «Je sens que j’appartiens à une génération perdue. Je me demande ce qui a changé dans nos modes de vie qui nous rend si incertains de nos sentiments. La seule raison à laquelle je pense est que ma génération est l’une des premières à avoir grandi après la chute du communisme, dans un environnement consumériste. Mes parents n’avaient pas le choix. Nous, au contraire, n’avons que des options», dit le cinéaste dans un court texte de présentation pour le festival Premiers Plans d’Angers.
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20130527 –Cinéma
LA GRANDE BELLEZZA
un film de Paolo Sorrentino.
Le film s’ouvre sur une citation du « Voyage au bout de la nuit »de Céline mais Paolo Sorrentino, son réalisateur, aurait aussi bien pu mettre en exergue quelques lignes de Blaise Pascal, lui qui explique longuement, dans ses « Pensées », qu’ »un roi sans divertissement est un homme plein de misères ». Car c’est bien de cela dont il est question ici, sauf que le personnage central du film ne règne pas sur un pays, mais sur le néant:il est le roi des mondains!
Après quelques plans magistraux sur la ville de Rome et ses touristes, le film nous entraîne dans un maelström de sons, de rythme, de musique effrénée, de corps en mouvement, de danse, de fête:c’est l’anniversaire de Jep Gambardella (Toni Servillo), 65 ans. C’est lui qu’on appelle le roi des mondains et c’est lui qui, passé le tourbillon de la fête, se retrouve face à lui-même, face à sa vie de néant, face à sa misère (au sens pascalien du terme).
Car, à 65 ans, on peut certes faire le bilan de sa vie. Mais quel bilan dresser quand on n’a rien fait d’autre que de se divertir (toujours au sens pascalien du terme)? Il y a 40 ans, Jep a écrit un roman, devenu introuvable mais qui, à l’époque, avait remporté du succès. Il aurait pu continuer sur cette voie, devenir (qui sait?) un grand écrivain, mais il a préféré, peut-être par paresse, le journalisme, les chroniques mondaines, et, du coup, il s’est lui-même étourdi dans les mondanités.
Ce qui le différencie cependant de beaucoup de ses compères en mondanité, c’est qu’il porte un regard lucide, sans illusion, autant sur sa propre vie que sur celle des autres. Il sait que, dans ce monde-là, l’on est dans le royaume des apparences où tout n’est que spectacle:l’important est de se montrer, de « faire comme si », de se divertir. Même les funérailles, dit-il, n’échappent pas à cette règle:croit-on que l’on y est plus sincère qu’ailleurs? Pas du tout! On va aux enterrements comme on va au spectacle!
Non sans mélancolie, Jep considère sa vie, son néant, ce qu’il a raté. Il aurait pu s’engager sur un autre chemin…Autrefois, quand il était jeune, il y avait une fille de son âge qui s’offrait à l’aimer, mais il a tout laissé passer, il a tout gâché. Comme ses semblables en mondanité, il a chassé de son coeur l’esprit d’enfance. Plusieurs scènes montrant des enfants, à différentes étapes du film, s’interrogent sur ce gâchis. Parmi elles, une scène splendide et bouleversante, au début du film:on y voit des fillettes habillées en communiantes, portant l’aube et la croix, derrière une grille, et pouffant en voyant un homme tirant sur la laisse d’un chien rétif. Une religieuse apparaît et les rappelle à l’ordre. Les fillettes s’en vont, sauf une qui reste là, dévisageant Jep de ses grands yeux à la fois incisifs et innocents. On sent, à ce moment-là, que ce dernier en est troublé, que ce regard lui fait appréhender en quelque sorte sa propre vacuité.
Monde du paraître, monde des apparences qui n’épargne pas même les gens d’Eglise! Jep trouvera-t-il un soutien, une aide, une porte de sortie vers autre chose en questionnant un évêque? Las! Celui-ci s’intéresse bien davantage aux recettes de cuisine qu’aux arcanes de la spiritualité! On en vient même à exhiber une « sainte », une religieuse de 104 ans, comme on exhiberait un phénomène de foire. Mais la « sainte », lorsqu’elle daigne enfin répondre aux questions qu’on lui pose, n’a que ceci à dire:« j’ai épousé la pauvreté, et la pauvreté ne se raconte pas, elle se vit! »
Arrivé à un tournant de sa vie, Jep se demande s’il pourra se sortir de l’impasse dans laquelle il s’est fourré. Y a-t-il encore moyen, à 65 ans, d’échapper à une vie de néant? Ecrire un nouveau livre? Aller enfin vers « la grande bellezza », la grande beauté?
Quoi qu’il en soit, Paolo Sorrentino a conçu et réalisé là un film qui, s’il n’est pas un chef d’oeuvre, n’en est en tout cas pas bien loin. Remarquable à tout point de vue:scénario, réalisation, interprétation, prises de vue, tout dans ce film laisse une impression inoubliable. Il y a, par exemple, dans la scène de fête du début du film, des mouvements de caméra tout à fait saisissants de beauté et de virtuosité.
Ce qui me surprend beaucoup, pour finir, c’est que le jury du festival de Cannes n’ait pas jugé bon de décerner la moindre récompense à une telle oeuvre…Mais après tout, non, ça n’est pas si surprenant:ce n’est ni la première ni (sans doute) la dernière fois qu’un jury à Cannes laisse repartir bredouille un grand film!
9/10
Luc Schweitzer,sscc
20130520 –Cinéma
Bonjour à tous!
LE PASSÉ
un film d’Asghar Farhadi.
Le cinéaste iranien Asghar Farhadi, à qui l’on doit déjà plusieurs films remarquables tournés dans son pays, a réalisé ce film-ci en France, dans un coin de la banlieue de Paris, à Sevran. Après le triomphe tout à fait mérité d’ »Une séparation », voici donc « Le Passé ». Ici aussi cependant, il est question de séparation et même de divorce puisque c’est la raison pour laquelle Marie (Bérénice Bejo) vient chercher à Roissy celui qui l’a quittée il y a quatre ans pour repartir dans son pays, l’Iran. Ahmad (Ali Mosaffa) aperçoit Marie dans le hall de l’aéroport, tous deux cherchent à se parler, mais une vitre les sépare, empêchant dans un premier temps toute communication autre que gestuelle.
Curieusement, alors qu’Ahmad est revenu en France pour finaliser son divorce d’avec Marie, cette dernière insiste pour l’accueillir chez elle, dans son pavillon de banlieue. C’est d’autant plus étonnant que Marie veut refaire sa vie avec un nouveau compagnon, Samir (Tahar Rahim). Ahmad fera donc la connaissance de ce dernier, mais aussi de son fils Fouad et des deux filles de Marie dont Lucie, une adolescente en crise formidablement interprétée par Pauline Burlet. Tout ce monde se trouve pris dans un sac de noeuds, dans des complications inextricables, dans de terribles culpabilités. L’on apprend en effet que la première épouse de Samir est à l’hôpital, plongée dans le coma, suite à une tentative de suicide.
S’engage alors tout un jeu de confidences, de prises de conscience, d’interrogations, de recherche de la vérité car il se peut bien que la tentative de suicide de la femme de Samir soit la conséquence d’un acte malveillant. On ne se débarrasse pas des actes du passé:il faut chercher, fouiller, tâcher de comprendre afin de parvenir, peut-être, à la vérité et au pardon libérateur. Et c’est l’homme du passé précisément, c’est Ahmad qui recueille le plus souvent les confidences des uns et des autres, trouvant dans ce rôle-là, peut-être, une jouissance quelque peu malsaine.
Car comment parvenir à la vérité? Comment débrouiller les écheveaux des mensonges, des faux-semblants, des illusions? Lucie est rongée de remords, elle est persuadée d’être coupable, mais l’est-elle vraiment? Qui croit avoir commis une faute sans être coupable de rien, qui a vraiment des raisons de culpabiliser?
Comme l’a très bien observé Pierre Murat dans Télérama, Asghar Farhadi, comme le grand et regretté cinéaste polonais Krzysztof Kieslowski, fait un cinéma « du doute, de l’inquiétude morale ». Ce cinéma-là, qui ne cherche pas tant à répondre aux questions qu’à bien les poser, ce cinéma qui invente des scénarios complexes et des personnages qui restent en partie énigmatiques, ce cinéma captive! De film en film, Asghar Farhadi s’affirme comme un des grands cinéastes d’aujourd’hui, entraînant le spectateur dans des mondes compliqués, dans des histoires embrouillées, mais qui, parce qu’elles sont mises en scène avec un indéniable talent, non seulement n’ennuient jamais mais suscitent le plus grand intérêt.
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20130518 –Littérature
LA CLÔTURE DES MERVEILLES
un ouvrage de Lorette Nobécourt.
Je ne connaissais pas Lorette Nobécourt, je n’avais jamais lu une ligne d’elle avant d’être intrigué par un article et d’entreprendre la lecture de « La clôture des merveilles », petit livre dont le sous-titre ne pouvait qu’attiser ma curiosité :« Une vie d’Hildegarde de Bingen ». Une sainte, une moniale du XIIe siècle, que Benoît XVI a proclamé il y a tout juste un an docteur de l’Eglise, faisant d’elle la quatrième femme à porter ce titre. Ce n’est certes pas banal, mais de là à susciter l’intérêt d’une romancière contemporaine, voilà qui avait de quoi m’interpeler! Mais non, après tout, ça n’est pas si surprenant :il y a tant de « merveilles » en effet dans la personne et dans la vie d’Hildegarde de Bingen qu’on n’est pas si étonné, en fin de compte, qu’une romancière ait l’idée de s’en emparer.
Je parle d’une romancière parce que, de fait, Lorette Nobécourt a écrit des romans et des récits, mais c’est en poétesse plus qu’en romancière qu’elle a composé « La clôture des merveilles ». Il faut dire qu’Hildegarde s’y prête bien, elle à qui furent accordés de multiples dons, parmi lesquels celui de la poésie et du chant. Ce n’est donc ni en romancière ni même en hagiographe que Lorette Nobécourt s’empare en quelque sorte de cette femme hors du commun que fut Hildegarde de Bingen. Ce qu’elle soulignera, ce qu’elle exaltera, ce qui lui servira de fil conducteur, c’est la liberté, oui la liberté d’une femme qui entre en clôture, et même, pourrait-on dire, son insoumission ! Tel est le paradoxe :le mot « clôture » que nos esprits bornés associent automatiquement à l’enfermement signifie au contraire, pour Hildegarde et ses semblables, l’entrée dans la liberté la plus parfaite, celle des émerveillements :« le monde est lent, écrit Lorette Nobécourt. Mais c’est tout de même la liberté qu’un pape couronne en 2012, faisant d’Hildegarde de Bingen la quatrième femme docteur de l’Eglise. »
Toute sa vie, Hildegarde a cultivé cette liberté et l’a déclinée de toutes les manières possibles. Elle fut une grande mystique, racontant, dictant ses « visions » et composant ainsi plusieurs ouvrages dont le « Scivas » et « Le livre des œuvres divines ». Mais semblable à toutes les grandes mystiques, elle fut aussi une femme de son époque, attentive aux événements et ayant, selon la formule consacrée, les pieds sur terre ! Elle fut musicienne, composant de multiples chants sacrés. Elle fut herboriste, connaissant parfaitement les plantes et la pharmacopée. Elle fut abbesse et fonda le couvent du Rupertsberg près de Bingen. Elle fut en contact avec les grands de ce monde, papes et empereurs, sans crainte de les tancer s’il le fallait. Frédéric Barberousse ne l’impressionna nullement et au pape Eugène III elle écrivit :« Prends garde de ne pas mépriser les mystères divins… ».
Une femme libre, oui, à tel point que, même au soir de sa vie, à l’âge de 80 ans, elle trouvera encore la force de s’opposer aux prélats de Mayence qui veulent faire déterrer un jeune homme qu’elle a pris la décision de faire inhumer dans son couvent de Rupertsberg. Coupable de crime, ce jeune homme a été excommunié ! Impossible donc que son cadavre soit inhumé dans un couvent ! Mais si, répond Hildegarde, car avant sa mort, elle l’a guidé vers le pardon, vers la réconciliation, et le jeune homme a confessé ses péchés. « J’ai regardé vers la vraie lumière, écrit Hildegarde. Les yeux grands ouverts j’ai vu en mon âme que si nous déterrions sa dépouille en nous confrontant aux ordres, cette exhumation, telle une épaisse ténèbre menacerait notre couvent. » Voilà qui est parlé !
Libre, et même rebelle quand il le faut, sainte Hildegarde est chantée, magnifiée par ce superbe livre de Lorette Nobécourt. Un livre magnifiquement écrit , il faut le souligner pour finir :écrit, comme je l’ai dit, en poétesse, à tel point qu’on a souvent le sentiment de lire un poème en prose plus qu’un simple récit. « Grâce à [sa liberté], écrit l’auteur, Hildegarde a été plus loin que la doctrine et la science, elle est entrée dans la connaissance et l’amour. »
La clôture des merveilles,de Lorette Nobécourt,éditions Grasset,153 pages.
Luc Schweitzer,sscc
20130513 –Cinéma
UNE VIE SIMPLE
un film de Ann Hui.
Il y a un titre ou un sous-titre qui conviendrait parfaitement à ce film:ce serait le mot « Amour », s’il n’avait déjà servi de titre au fameux film de Michael Haneke. Mais Haneke trompait en quelque sorte le spectateur en voulant faire passer pour de l’amour l’enfermement et la folie menant à un acte fatal, tandis qu’ici le mot ne serait pas usurpé…
Amour et simplicité dans ce film beau et tendre qui se dévoile à nos yeux comme une évidence, comme ce qu’il convient de faire quand on est reconnaissant et qu’on aime vraiment. Sans donner de leçons bien entendu, sans jamais tomber non plus dans un déferlement de bons sentiments qui finirait par nous écoeurer, la réalisatrice Ann Hui a su trouver le ton juste et la juste distance pour nous parler de choses simples:des petits gestes d’amour et de tendresse qui mettent un peu de douceur dans nos vies, même quand surviennent le grand âge et les déchéances physiques.
Nous voici donc à Hong Kong, dans un grand appartement bourgeois déserté de la plupart de ses occupants:n’y résident plus que Roger et Ah Tao, la servante. Cette dernière fut placée dès son adolescence dans cette famille, elle a servi et materné quatre générations de ses membres et elle continue de servir fidèlement Roger, achetant tout avec soin et faisant la cuisine comme personne!
Mais voilà qu’elle fait un infarctus et qu’elle se retrouve à l’hôpital, sauvée mais affaiblie. N’ayant plus la force de faire ce qu’elle a toujours fait, elle prend la décision de se retirer dans un foyer pour personnes âgées. Que fera Roger? Comment réagira-t-il, lui qui a toujours été servi par Ah Tao, l’habitude engendrant peut-être une sorte d’inattention? Or Roger non seulement n’est pas un ingrat, mais c’est lui qui dorénavant se mettra au service d’Ah Tao et sera aux petits soins pour elle. Il ne l’abandonnera certes pas aux mains du personnel de la maison de retraite:il sera là, présent autant qu’il le peut, tâchant par tous les moyens d’adoucir la vie de celle qui l’a tant servi. Les autres membres de la famille aussi, même s’ils ont déménagé, viendront à l’occasion visiter celle qui leur a consacré sa vie. On découvrira d’ailleurs, dans une belle scène de la fin du film, qu’on a affaire à une famille chrétienne:tous rassemblés autour du lit d’Ah Tao qui a dû être hospitalisée, ils se donnent la main et ils prient. Ne croyons pas cependant que la réalisatrice se soit égarée dans l’angélisme:il n’y a pas, comme je l’ai dit, de débauche de bons sentiments, et rien ne nous est épargné ni des déchéances physiques des personnes âgés ni des petites ou des grandes turpitudes des uns ou des autres…Non, tout cela sonne juste et vrai. Pas besoin de grandes péripéties ni de scènes d’action ni d’effets spéciaux à foison pour faire un bon film:ce film-là est simple comme son titre et il va droit au coeur!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20130509 –Cinéma
ENFANCE CLANDESTINE
un film de Benjamin Avila
Semblable en cela à « Mud »de Jeff Nichols, « Enfance clandestine »de Benjamin Avila se présente comme un film initiatique, comme le récit d’un passage de l’enfance à l’adolescence. Mais bien sûr le contexte est différent, d’autant plus qu’ici nous avons affaire à un film en partie autobiographique, le réalisateur s’étant inspiré de sa propre histoire pour composer son scénario.
Histoire tragique puisqu’elle se situe dans l’Argentine de 1979, donc en pleine dictature de la junte militaire. Les parents de Juan, 12 ans, prennent le risque de revenir dans leur pays, eux qui avaient fui l’oppression des militaires. Ils sont membres des montoneros, une organisation peroniste qui décide de s’attaquer, même de manière violente, à la dictature en place. Tel est le contexte donc, qui oblige à vivre dans la clandestinité et à dissimuler sa véritable identité. Juan se prénommera désormais Ernesto et il devra bien sûr veiller à ne jamais dévoiler quoi que ce soit au sujet de ses parents ou de son oncle Beto. Sachant cela, on pourrait craindre d’avoir affaire à un film constamment oppressant, mais ce n’est pas le cas. Il y a certes des scènes de grande tension, mais il y en a aussi d’une tout autre tonalité. Il y a de tout dans ce film:de la peur, de la violence, de la colère, mais aussi des rires, des chansons, de la tendresse…On ne peut pas vivre uniquement dans la peur, on ne peut pas se repaître uniquement de violence, on ne peut pas être constamment stressé…
Et puis, Juan, s’il est le fils de parents militants, n’en est pas moins un garçon de son âge, un garçon qui grandit, qui découvre de nouvelles émotions, qui s’éprend d’une de ses camarades d’école. Comment concilier les deux parties de sa vie? Comment mener d’un côté la vie d’un écolier ordinaire et de l’autre celle d’un garçon à qui l’on a appris à se cacher dès que résonnent les sirènes des véhicules de police?
Benjamin Avila a réalisé ce film avec un indéniable talent:tout sonne juste et ne manque pas d’inventivité. Ainsi toutes les scènes de violence ont-elles été filmées en usant de dessins, comme si l’on visionnait des planches de bande dessinée. Après d’autres cinéastes d’Argentine et du Chili qui, eux aussi, ont tenté de revisiter des pages d’histoire tragiques de leur pays respectif, ce film-ci apparaît sans aucun doute comme l’un des plus justes et des plus émouvants
Luc Schweitzer,sscc
20130501 –Cinéma
MUD – SUR LES RIVES DU MISSISSIPPI
un film de Jeff Nichols
Quand Ellis et Neckbone, deux gamins de quatorze ans qui semblent échappés d’un récit de Mark Twain, quand ces deux-là, au hasard de leurs pérégrinations sur le fleuve Mississippi, découvrent une île et, sur cette île, au sommet d’un arbre, un bateau échoué, ils ont encore le comportement des enfants. Ce bateau, ils l’ont trouvé, il leur appartient, c’est la plus belle des cabanes dont on puisse rêver. Oui mais voilà, des signes indiquent que le bateau est déjà occupé, squatté par quelqu’un d’autre. Et ils ne tarderont pas, en effet, à découvrir celui qu’ils considèrent d’abord comme un intrus:c’est Mud, un type étrange qui vit là, loin de tout, comme un marginal. Qui est-il? Que fait-il là? Pourquoi éprouve-t-il le besoin de demander de l’aide à ces gamins?
Jeff Nichols, dont c’est le troisième film, nous entraîne alors dans un récit initiatique d’apparence très simple, très linéaire, mais d’une extrême richesse sur les plans de la thématique et du visuel. C’est comme une ode à un pays, à une région, à un fleuve, le Mississippi, encore majestueux, sauvage et dangereux avec ces serpents, ces mocassins d’eau qui peuvent vous mordre s’ils vous surprennent.
C’est aussi et surtout, pour Ellis et Neckbone, la découverte de tout ce qu’ils ignoraient encore, à commencer par l’amour et par l’amitié. Amour fragile, amour qui enchante, mais amour qui chancelle…Ellis le pressentait en voyant ses parents se quereller, mais il le découvre bien davantage encore en s’éprenant lui-même d’une jeune fille et surtout en apprenant un des secrets de Mud:s’il a trouvé refuge sur son île c’est parce qu’il a tué, et s’il a tué c’est par amour pour une femme…Mais c’est l’amitié qui demeure le pivot du film, celle qui naît et grandit entre Mud et le jeune Ellis (Neckbone, lui, reste plus pragmatique et plus prudent). Amitié qui fera faire des folies aux deux adolescents, amitié qui chancellera, elle aussi, mais qui sera rétablie et sauvée de la plus belle des manières à la fin du film.
Oui, les deux gamins du début du film en auront beaucoup appris, ils seront déjà transformés quand éclatera une scène de grande violence (car Mud est recherché par le père de l’homme qu’il a tué)…Et Mud disparaîtra, emporté par le fleuve…Mais qui sait s’il est mort ou s’il est vivant?
Superbe film qui installe dans l’esprit du spectateur une fascination qui ne défaille à aucun moment:Jeff Nichols a réussi là son film le plus limpide et le plus achevé à ce jour.
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20130425 –Cinéma
L’écume des jours
un film de Michel Gondry
Ceux qui connaissent les films de Michel Gondry, qui ont apprécié son imagination sans borne, son art du bricolage, sa fantaisie sans limite, ceux-là ne pouvaient rêver meilleur cinéaste pour adapter à l’écran l’univers débridé et fantasque de Boris Vian. Or on est obligé de déchanter et d’admettre que le résultat est plus que décevant: disons-le tout net, le film est complétement raté!
Ah certes, l’imagination de Gondry ne fait pas défaut, mais c’est là justement que le bât blesse! Gondry en fait trop, beaucoup trop, c’est un festival d’effets spéciaux, de bricolages en tout genre, de fantaisie en liberté, mais c’est trop, à tel point qu’au bout de quelques scènes cela devient exténuant! On ne voit plus que cela! C’est un peu comme lorsqu’on est devant un panneau d’affichage encombrés d’affiches de toutes sortes: on se dit parfois, dans ce cas-là, que « trop d’information tue l’information ». Eh bien, pour ce qui concerne ce film de Gondry, on peut dire que « trop de poésie tue la poésie »ou, plus justement, que « trop de fantaisie tue la fantaisie ».
La conséquence de cela, c’est qu’à cause de cette débauche d’effets spéciaux, on a le sentiment que ce sont les objets qui sont doués de vie, bien davantage que les êtres humains, que les personnages inventés par Vian, y compris Colin et Chloé, les deux personnages principaux du récit. Les objets bougent dans tous les sens, même les objets les plus inattendus comme la sonnette d’une porte, mais les personnages, eux, ressemblent plus à des marionnettes qu’à des êtres de chair et de sang. C’est particulièrement flagrant lors des scènes de danse, lorsque les jambes des personnages s’allongent démesurément: on a vraiment le sentiment de voir des pantins qui ne bougent que parce que Gondry tire les ficelles. Même lorsque survient la maladie de Chloé, le fameux nénuphar qui lui dévore un poumon, on reste de marbre, on n’éprouve pas le moindre intérêt ni pour son sort à elle ni pour celui des autres personnages. C’est comme si Gondry ne s’était intéressé qu’à ses bricolages en tout genre et que, du coup, il ne savait plus que faire de ses acteurs. Ceux-ci d’ailleurs semblent parfois ne pas savoir eux-mêmes ce qu’ils font au milieu de tout ce fatras!
En fin de compte, Gondry, au lieu de faire appel à des acteurs, aurait dû filmer un théâtre de marionnettes: on y puiserait alors, peut-être, un certain plaisir de spectateur!
3/10
Luc Schweitzer,sscc
20130421 –Cinéma
PROMISED LAND
un film de Gus Van Sant
Un film dossier de Gus Van Sant? Eh bien oui, et il faut dire aussitôt qu’il s’agit d’une belle réussite! En l’occurrence il est question ici des méthodes dont use un grand groupe d’exploitation de l’énergie pour parvenir à ses fins:forer sans vergogne les terres d’un coin perdu de l’Amérique afin d’y puiser du gaz de schiste. Et qu’importent les conséquences écologiques! Steve et Sue, les deux envoyés du groupe « Global », ne doutent pas qu’à coup de dollars ils auront vite fait de convaincre, l’un après l’autre, tous les fermiers de cette région déshéritée.
Mais en sont-ils si persuadés que cela? N’y a-t-il pas des questions, des hésitations qui s’insinuent dans l’esprit de Steve (formidable Matt Damon), lui qui ne peut pas ne pas se souvenir de ses propres origines, de sa région natale si semblable à celle qu’il sillonne à présent? Il y aura, au cours du film, des surprises, des rebondissements, émanant en particulier du surgissement d’un activiste écologiste venu mettre des bâtons dans les roues de ceux qui croyaient expédier cette affaire en deux jours. On découvrira jusqu’où va le cynisme des groupes d’exploitation de l’énergie…
Mais s’il ne s’agissait que d’un film dossier, que d’un film de dénonciation, on aurait peut-être un fort sentiment de déjà vu et on se lasserait rapidement. Or il n’en est rien; on se passionne au contraire d’un bout à l’autre du film et ce parce que Gus Van Sant ne s’est pas contenté de faire un film engagé parmi d’autres, il nous donne à voir de vrais personnages qui ne sont pas seulement les porte-paroles d’une idée ou d’une conviction, qui sont des êtres de chair que l’on aime accompagner dans leurs déambulations et dans leurs questionnements. Et puis Gus Van Sant filme ce coin d’Amérique avec infiniment de sensibilité. C’est passionnant.
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20130411 –Cinéma
Le Temps de l’aventure
un film de Jérôme Bonnell.
Dans l’interview qu’elle a accordé à Télérama, Emmanuelle Devos déplore le sort que l’on réserve, en règle générale, au travail des acteurs lorsqu’on fait la critique d’un film. Tout ce qu’on sait dire, affirme-t-elle, ce sont des banalités du genre:« elle est géniale »ou « il est nul ». Ah! Comme je voudrais précisément échapper à tous les poncifs et à toutes les banalités pour dire à quel point la performance d’Emmanuelle Devos est remarquable dans ce film! Elle a sans aucun doute trouvé là le meilleur rôle de sa carrière, elle a fait un travail impressionnant, tout en nuances, exprimant tour à tour la fragilité, la détresse, la solitude, la tendresse, l’émotion, la détermination, l’humour, etc. Ne prenons qu’un exemple pour souligner combien le talent d’Emmanuelle Devos est ici exemplaire:elle joue dans ce film pour ainsi dire son propre rôle, celui d’une actrice de théâtre, et, lors d’une des scènes, elle passe une audition pour je ne sais quelle pièce et doit répéter deux fois la même scène, mais en y ajoutant de l’émotion la deuxième fois, ce qu’elle fait avec un brio incomparable.
Ne minimisons pas, cependant, le travail du metteur en scène qui a su magnifier son actrice, la célébrer pour ainsi dire, faisant de ce film en quelque sorte un hymne au talent d’Emmanuelle Devos.
Quant à la trame du film, elle n’a rien de très original et ne manquera pas de rappeler à ceux qui connaissent leurs classiques le beau film de David Lean, « Brève rencontre ». Ici donc, il est question également d’une rencontre fortuite entre une actrice, Alix, et un Anglais prénommé Douglas, de passage à Paris pour des obsèques. Aventure sans lendemain, comme l’indique le titre du film, rencontre éphémère de deux paumés (un peu comme dans « Lost in translation »de Sofia Coppola). Rien de très original donc, de ce point de vue, mais la mise en scène est si réussie et le talent d’Emmanuelle Devos si grand que l’on se moque de voir une histoire rebattue:on a même un peu l’impression de la découvrir pour la première fois. Et puis ce qui tranche d’avec les autres films, c’est que Jérôme Bonnell a su glisser dans une histoire forcément émouvante des touches d’humour qui sont les bienvenues; il y a même de ci de là des scènes vraiment hilarantes!
Un très beau film donc, porté de bout en bout par la grâce de son actrice principale, mais aussi par l’intelligence de la mise en scène de Jérôme Bonnell.
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20130408 –Cinéma
INCH’ALLAH
un film d’Anaïs Barbeau-Lavalette
La québecoise Anaïs Barbeau-Lavalette s’est manifestement inspirée de son propre vécu lorsqu’elle a conçu ce film qui plonge le spectateur au coeur même du conflit qui oppose depuis tant d’années déjà Palestiniens et Israéliens. Le style adopté par la réalisatrice –un film tourné caméra à l’épaule –accentue encore le sentiment que l’on ressent d’être confronté à un drame véridique, à une tragédie sans fioriture!
L’héroïne du film, si l’on peut dire, Chloé, est précisément une québecoise qui réside à Jérusalem mais qui travaille dans un camp de Palestiniens en tant qu’obstétricienne. Elle sera vite en butte aux dures lois de la guerre, à l’intransigeance des soldats israéliens, à la misère des laissés-pour-compte, de ceux qui croupissent dans un cloaque, à l’exaltation des martyrs, etc. Pourtant Chloé a noué des amitiés des deux côtés, aussi bien avec sa voisine de palier, une jeune militaire israélienne, qu’avec une Palestinienne enceinte et les membres de sa famille. Mais comment faire? Y a-t-il moyen d’établir des ponts entre les deux camps? Comment ne pas prendre parti?
Or justement Anaïs Barbeau-Lavalette fait preuve de suffisamment de finesse et d’intelligence pour ne jamais tomber dans la caricature:elle évite le manichéisme autant que le sentimentalisme facile. Elle n’occulte rien cependant de la dureté des faits:son film est tout empreint de la brutalité des actes commis et nous montre combien il est difficile, voire impossible, de se contenter d’être un simple témoin du conflit, même lorsqu’on est un étranger, ni Palestinien ni Israélien…La guerre ne laisse personne indemne.
Hormis quelques scènes du début (en particulier une scène montrant des enfants sur une décharge) qui m’ont semblé manquer un peu de naturel, tout le reste du long-métrage est donc extrêmement poignant. C’est aussi une sorte de thriller qui va vers un inéluctable drame:un attentat kamikaze évoqué dès le début du film, puis repris vers la fin, sans être d’ailleurs montré en tant que tel, ce qui dénote, là encore, une belle capacité et un beau savoir-faire dans la mise en scène.
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20130423 –Cinéma
LA RELIGIEUSE
Un film de Guillaume Nicloux
L’adaptation très austère du roman de Diderot réalisée par Jacques Rivette en 1966 avait fait sensation au point que le film avait été interdit pendant quelques mois. Il ne risque pas d’en être de même avec cette nouvelle adaptation, bien moins austère cependant, signée Guillaume Nicloux.
Les temps ont changé et l’on admet volontiers aujourd’hui que les communautés religieuses peuvent être le théâtre de graves dérives. Pas plus que le film de Rivette, celui de Guillaume Nicloux ne s’en prend à la religion en tant que telle ni même à l’Eglise en tant qu’institution. L’héroïne du récit, Suzanne Simonin, est contrainte par sa famille d’entrer en religion comme on disait alors. Après s’être rebellée, elle se résoudra à prendre le voile, mais comme il n’y a pas en elle la moindre trace de véritable vocation, elle luttera jusqu’à ce qu’elle puisse se sortir de ce guêpier! En attendant, elle passera entre les griffes de deux communautés et donc de deux mères supérieures aux méthodes antagonistes mais toutes deux perverses. Malgré cela, malgré ce qu’on lui fait subir, il est à noter que Suzanne Simonin garde la foi:celle-ci n’est pas remise en question et on la voit, à plusieurs reprises, en train de prier.
Le sujet est intéressant et, même s’il semble d’un côté vieillot (on n’oblige plus qui que ce soit à entrer en religion!), il reste d’actualité d’un autre côté, car il peut toujours y avoir ici ou là de graves dérives au sein de communautés religieuses.
Là où le bât blesse, là où le film de Guillaume Nicloux paraît bien faible cependant, c’est dans sa mise en scène. Souvenons-nous d’un autre film, sorti il y a quelques mois, et qui lui aussi dénonçait de terribles dysfonctionnements au sein d’une communauté religieuse:je veux parler d’ »Au-delà des collines »de Cristian Mungiu, remarquable dans sa mise en scène, inventif et, du coup, passionnant d’un bout à l’autre. Ici malheureusement, tout apparaît bien plat:pas un plan vraiment intéressant! Certes les actrices de « La religieuse »sont toutes excellentes, mais le film manque de relief et on s’ennuie un peu. C’est bien dommage mais, à cause de ce manque d’originalité dans sa réalisation, l’impression que l’on garde, après avoir vu ce film, reste très mitigée.
6/10
Luc Schweitzer,sscc
20130311 –Cinéma
A LA MERVEILLE
un film de Terrence Malick.
Disons-le d’emblée: ce sixième film de Terrence Malick est un chef d’oeuvre d’une stupéfiante beauté! Plus encore que le film d’un philosophe (Malick est certainement nourri de philosophie et il l’a même enseignée dans sa jeunesse), il s’agit d’un film de poète. Depuis son premier film (« La Balade sauvage »en 1973), il y a indéniablement chez ce réalisateur une propension à user de la caméra, mais aussi des sons et des mots, à la manière d’un poète.
Ce penchant trouve maintenant son point d’orgue, il s’épanouit comme jamais, et Malick nous livre des films inouïs, des films comme peuvent les rêver les poètes, des films qui hantent l’esprit et le coeur longtemps après qu’on les a vus, des films qu’on verra et reverra comme on revient toujours aux grandes oeuvres poétiques sans jamais s’en fatiguer. Ce penchant vers un cinéma qui s’apparente à la fois au poème et à la prière s’épanouissait déjà dans « The tree of life », le précédent film du réalisateur, et se poursuit aujourd’hui avec « A la merveille », à tel point qu’on a le sentiment d’avoir affaire au deuxième volet d’un diptyque. Certes il y a des différences notables entre les deux films, certes on ne retrouve pas ici ce qui irritait tant certains critiques dans « The tree of life »(cette ampleur lyrique, cette métaphysique qui, bien évidemment, n’a rien de commun avec les nigauderies d’un Paulo Coelho!), mais les deux films épousent sans conteste une même esthétique, usant en particulier avec abondance des voix off.
Poème et prière donc, mais dans la nuit! En fait, ce film de Terrence Malick a des accents mystiques, non pas tant au sens de l’extase qu’à précisément celui de la nuit! L’extase, d’une certaine façon, est présente cependant, lors d’une des premières séquences du film, qui nous montre de manière sublime un couple (Ben Affleck et Olga Kurylenko) visitant le Mont-Saint-Michel. Là, dans les hauteurs du Mont, à la Merveille, il y a le bonheur d’aimer. Mais, aussitôt après, nous voyons Olga Kurylenko patauger dans la vase de la baie du Mont-Saint-Michel et nous savons que ce bonheur, que cette extase d’aimer sont déjà en péril.
La suite du film nous le montrera en effet, nous le fera comprendre:l’amour est là mais on ne sait pas le garder, on se déchire, on se sépare, on se défait, on va d’Olga Kurylenko à une autre femme (Rachel McAdams) et tous ces personnages, en quelque sorte, errent dans la nuit. Un autre personnage intervient, à plusieurs reprises, un personnage qui, peut-être, donne une clé d’interprétation du film: celui d’un prêtre (Javier Bardem) en proie au doute et à ce qu’il pense être son incapacité d’aimer. Il y a beaucoup de souffrance chez ce prêtre qui, lui aussi, se perd ou croit se perdre dans une sorte de nuit mystique. S’agit-il pour autant d’un film désespéré? Je ne le pense pas! C’est le film de ceux qui doivent espérer contre toute espérance.
On entend pendant une séquence du film la voix off du prêtre en question, de ce prêtre perdu dans sa nuit, appeler le Christ, lui demander de venir en lui et autour de lui, partout. Est-ce là la prière de qui n’a plus aucune espérance? De plus, ce prêtre, qui croit avoir perdu sa capacité d’aimer, continue cependant d’aimer et de servir sans même peut-être sans rendre compte. On le voit à un moment visiter des prisonniers, leur apportant pardon et réconfort. Et quand, dans une autre séquence, ce prêtre annonce à certains de ses paroissiens qu’il va sans doute devoir les quitter car il est nommé ailleurs, l’un de ceux-ci, dont on voit qu’il souffre d’un handicap mental, lui répond qu’il le regrettera beaucoup:« on a grand besoin de prêtres comme vous ici », lui dit-il. Toute proportion gardée, ce prêtre me fait songer à Mère Térésa, dont on sait à présent que, pendant de nombreuses années, tout en continuant à servir les pauvres, elle souffrit cruellement de doutes concernant la foi. Le prêtre que nous propose Malick, de même, persévère dans le service des autres, tout en étant la proie de cette nuit obscure…
Tel est ce prêtre, tels sont ces personnages, que l’on pourrait caractériser en citant un beau vers de Victor Hugo, dont Julien Green avait repris les premiers mots pour en faire le titre d’un de ses romans: « Chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa lumière ».
Luc Schweitzer,sscc
20130226 –Cinéma
ELEFANTE BLANCO
Un film de Pablo Trapero
Ce devait être le plus grand hôpital d’Argentine. Mais le projet, plusieurs fois entrepris, a fini par être complètement abandonné. Il n’en reste qu’une carcasse de béton que l’on a baptisé du beau nom d’ »Elefante blanco ». Les miséreux, bien sûr, n’ont pas tardé à investir les lieux, créant ainsi un gigantesque bidonville à proximité de Buenos Aires. Lieu de toutes les pauvretés et de toutes les violences, gangrené par les narco-trafiquants, et dans lequel se risquent parfois, non sans brutalité évidemment, les forces de police.
Tel est le décor du film poignant, impressionnant, beau et terrible à la fois, que nous livre Pablo Trapero. Que reste-t-il à ces gens, que reste-t-il à ceux qui vivent là, dans ce bidonville? Eh bien, l’espoir suscité par ceux qui ont choisi ou qui ont accepté d’y vivre avec eux:quelques prêtres et une assistante sociale…Le réalisateur s’attache à suivre particulièrement les faits et gestes de deux prêtres:Julian et Nicolas, dont on sait, dès le début du film, qu’ils sont tous deux des êtres fragilisés, Julian par la maladie, Nicolas par la culpabilité, par la honte d’avoir échappé en se cachant à un massacre perpétré dans la jungle.
Voici donc réunis ces deux hommes, ces deux prêtres, engagés l’un et l’autre dans une mission périlleuse, au cœur des misères et des violences. Comment se comporter ? Quelle attitude adopter avec les trafiquants de drogue ? Le réalisateur nous montre la vie de ces prêtres avec un réalisme quasi documentaire. On les voit prier, célébrer les sacrements, entretenir la chapelle, visiter les uns et les autres, protéger les faibles en cas d’irruption de la violence. On les voit s’interroger, débattre, se quereller, douter, défaillir. Malgré la maladie qui le ronge, le plus solide des deux est manifestement Julian. Nicolas, lui, vacille au point qu’il cherche refuge ou consolation dans les bras de la belle assistante sociale.
Malgré cela (ou à cause de cela), il me semble qu’on a rarement vu au cinéma des acteurs interpréter des rôles de prêtres de manière aussi juste, aussi convaincante. Foi, dévouement, sacrifice de soi vont de pair avec les blessures et les fragilités. Ce film puissant, inoubliable, nous fait pressentir et ressentir ce que peuvent être les vies, ce que peuvent être les engagements et les difficultés d’hommes et de prêtres partageant les conditions de vie des laissés-pour-compte.
Luc Schweitzer,sscc
20130218 –Cinéma
GOODBYE MOROCCO
un film de Nadir Moknèche.
Les scénaristes et les réalisateurs s’ingénient assez souvent, dans les films, à l’art de la simplification:simplifier les intrigues et les personnages, les rendre un peu plus lisses que ceux qu’on rencontre dans la vie réelle permet de ne pas trop désorienter les spectateurs. Ici, rien de tel. Que ce soit dans l’intrigue, que ce soit, surtout, dans la description des personnages, Nadir Moknèche ne craint pas la complexité. Et pourtant, passées les premières scènes, tout se met en place et, même s’il demeure beaucoup de zones d’ombre, on se passionne pour ce thriller sans concession qui fait appréhender un Maroc gangrené par la corruption, la violence et le déni de la réalité.
Toute l’intrigue, précisément, tourne autour de Dounia (Lubna Azabal), une marocaine divorcée qui vit à présent avec un serbo-croate, ce qui apparaît aux yeux de ses compatriotes comme un scandale. Lorsque, dans le chantier où travaille ce dernier, on découvre un site paléochrétien comprenant des catacombes et la fresque d’une orante, Dounia tisse tout un projet lucratif qui lui permettra, après avoir récupéré l’enfant qu’elle a eu de son mari, de le mettre à l’abri hors du Maroc.
Mais autour de Dounia gravitent des personnages qui enrayeront cette mécanique si bien conçue. Il y a, sur le chantier, des travailleurs clandestins, dont l’un d’eux, un nigérian, aura la mauvaise idée de vouloir ramener de nuit un crâne qu’il avait dérobé…Il y a la relation homosexuelle que celui-ci entretient avec un projectionniste de cinéma…Il y a surtout Ali, le chauffeur de Dounia, qui se meurt d’amour et de désir pour elle…Que de tensions, que de passions contradictoires dans tous ces êtres! Amour et haine, respect et mépris, violence et paix:tout s’entremêle dans les coeurs et dans les esprits. Et, bien sûr, il y aura d’inévitables drames…
Ce film, sûrement, fait partie de ceux qui se bonifient au fil du temps, comme les films noirs de l’Hollywood des années 30 ou 40, les films avec Humphrey Bogart, par exemple, qu’on peut voir et revoir sans se lasser…On pourra également visionner plusieurs fois « Goodbye Morocco »sans l’épuiser: il y a trop de richesses dans le scénario et dans les personnages pour se fatiguer d’eux!
Ce film,sûrement,fait partie de ceux qui se bonifient au fil du temps,comme les films noirs de l’Hollywood des années 30 ou 40,les films avec Humphrey Bogart,par exemple,qu’on peut voir et revoir sans se lasser…On pourra également visionner plusieurs fois « Goodbye Morocco »sans l’épuiser:il y a trop de richesses dans le scénario et dans les personnages pour se fatiguer d’eux!
Luc Schweitzer,sscc
20130211 –Cinéma
WADJDA
un film de Haifaa Al-Mansour
Ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’un film saoudien (donc issu d’un pays qui ne compte pas une seule salle de cinéma!) et qu’il est réalisé par une femme, « Wadjda » mériterait amplement que nous lui accordions notre soutien!
Or il se trouve que c’est également un film doté d’un excellent scénario et dont la réalisation est plus que convaincante. Sous une apparence de récit assez simple, Haifaa Al-Mansour, la réalisatrice, nous en dit beaucoup sur son pays, un pays en quelque sorte coupé en deux, moderne lorsqu’on est à l’intérieur des maisons, archaïque dès qu’on est à l’extérieur. Chez soi, il y a tout le confort possible et l’on peut se permettre des libertés. A l’extérieur, dans les rues, dans les institutions, on est sous l’emprise des lois les plus strictes, des codes qui régissent toute chose et, en particulier, les rapports (ou les non-rapports) entre hommes et femmes.
Pas question de déroger ni aux règles ni à la bienséance. Il y a d’un côté ce qui est rigoureusement interdit, mais aussi d’un autre côté ce qui ne se fait pas. Ainsi aucune loi n’interdit à une fille de faire de la bicyclette, mais ça n’est pas admis par la coutume! Et voilà tout le combat que va mener la petite Wadjda, elle qui, voyant les garçons du voisinage parader sur leurs vélos, s’est mis dans la tête de faire comme eux. Bien sûr, elle se heurtera au refus des adultes, mais elle ne baissera pas les bras, elle ira jusqu’au bout de son combat, elle imaginera tous les stratagèmes pour parvenir à ses fins, quitte même à participer à un concours de récitation de versets du Coran! Eh oui, ça se fait, dans ce pays-là!
Voilà donc un beau film qu’il vaut vraiment la peine de voir, qui nous en apprendra beaucoup sur la société saoudienne et qui nous incitera à l’espoir! Tant qu’il y aura des « Wadjda », rien ne sera totalement perdu!
Luc Schweitzer,sscc
20130210- Cinéma
HITCHCOCK
un film de Sacha Gervasi
Encore un biopic, puisque c’est ainsi qu’il faut dénommer ce genre de films. Après « Renoir »(excellent) et « Lincoln »(plutôt ennuyeux), voici donc « Hitchcock »(ni excellent ni ennuyeux, disons…pas mal!).
Il y a, dans ce film, des idées de scénario dont on se serait bien passé. Hitchcock était sans doute quelque peu frustré sur le plan sexuel, mais de là à le montrer épiant une de ses actrices se déshabillant!!! Quant à l’imaginer dialoguant avec un tueur pour alimenter son inspiration, c’est grotesque!!!
Cela dit, pour ceux qui ne connaîtraient rien de la vie d’Hitchcock et de ses sources d’inspiration, ce film ne manque pas d’intérêt. On y découvre ainsi très justement à quel point la femme d’Hitchcock, Alma, tenait une place déterminante, non seulement dans sa vie, mais dans la conception de ses films.
Anthony Hopkins évidemment, même s’il évolue avec assez de brio, ne rappelle que très vaguement le véritable Hitchcock. Helen Mirren dans le rôle d’Alma est vraiment épatante.
C’est donc un film assez intéressant, malgré toutes ses limites, mais dont la plus grande qualité sera peut-être d’inciter furieusement à revoir les films d’Hitchcock en général et « Psychose »en particulier.
Quant à ceux qui voudraient en savoir davantage sur Hitchcock, sa vie et son oeuvre, je recommande fortement la lecture de la passionnante biographie du maître du suspens écrite par Patrick McGilligan et récemment éditée par les éditions Institut Lumière/Actes Sud.
Luc Schweitzer,sscc
20130209 –Cinéma
FOXFIRE – Confessions d’un gang de filles
Un film de Laurent Cantet
Laurent Cantet adapte ici un roman de Joyce Carol Oates, roman que j’ai lu en 1998. Si mes souvenirs sont bons, cette adaptation cinématographique est très fidèle non seulement à la lettre, mais surtout à l’esprit de la grande romancière américaine qui ne cesse, de livre en livre, de mettre le doigt sur ce qui fait mal dans la société de son pays, les Etats-Unis.
Dans les années 50, dans une petite ville de ce pays, se constitue un gang de filles appelé « Foxfire ». Il s’agit, au départ, de se venger de ceux qui leur font subir des avanies, les hommes essentiellement dans la société machiste de ces années-là. Mais, de retour après un séjour en maison de redressement, celle qui est le leader du groupe et qu’on appelle Legs décide d’aller plus loin encore dans le refus des codes habituels et ce en constituant une véritable communauté vivant dans sa propre maison et selon ses propres lois. Evidemment, ce projet utopique qui pourrait avoir pour slogan le « ni Dieu ni maître »des anarchistes est voué à l’échec et s’achève d’une manière catastrophique. Ces filles en rébellion contre toute forme d’autorité retrouvent d’ailleurs au sein même de leur groupe le schéma qu’elles rejettent:il le faut, il faut qu’il y ait l’autorité de Legs pour que le groupe fonctionne!
Le film de Laurent Cantet aborde ces questions-là et d’autres encore, comme le racisme, mais au risque de seulement les effleurer. Peut-être aurait-il fallu être un peu moins fidèle au roman de Joyce Carol Oates, élaguer, resserrer, se concentrer davantage sur quelques scènes, ne pas vouloir aborder trop de sujets à la fois. Ce qui convenait à un roman qu’on peut lire en prenant son temps ne convient pas nécessairement à un film. Le film de Laurent Cantet est trop long et finit par être quelque peu lassant, mais il n’est pas dénué d’atouts:des actrices étonnantes et une invitation, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, à lire la très prolifique romancière Joyce Carol Oates!
Luc Schweitzer,sscc
20130204 –Cinéma
DANS LA BRUME
un film de Sergueï Loznitsa
Ceux qui n’aiment que le cinéma trépidant, ceux pour qui, dans un film, il faut que les plans se succèdent à un rythme effréné, ceux-là feront bien de s’abstenir:ce film n’est pas fait pour eux! Ils manqueront cependant un joyau, un film à la fois beau et âpre, un film qui prend son temps certes, qui aime s’attarder, scruter, mais pour nous raconter la plus terrifiante et la captivante des histoires.
Nous voici dans la campagne biélorusse en 1942. Le premier plan du film, inoubliable, étonnant, nous montre des soldats allemands conduisant au gibet trois hommes. Ils sont pendus hors champ, mais qui sont-ils? Qu’ont-ils fait? La suite nous l’apprend:ils sont coupables de sabotage! Mais on apprend aussi et surtout que leur complice Souchénia a, lui, été épargné et libéré par les nazis. La conséquence est évidente:on soupçonne ce dernier d’être un traître. Deux partisans viennent donc le chercher dans sa ferme et l’emmènent dans la forêt pour l’abattre.
On découvrira rapidement que Souchénia n’est pas coupable de ce dont on l’accuse. Mais comment prouver son innocence? La suite du film, au moyen de quelques flash-back, sonde toute la complexité des êtres. Qui sont les innocents? Qui sont les coupables? La guerre peut-elle laisser qui que ce soit indemne? Sans grandiloquence, mais avec beaucoup de précision, le réalisateur invite à réfléchir à toutes ces questions, et ce sans jamais lasser le spectateur, car chaque plan du film est à la fois superbe et oppressant. Les nombreux plans tournés dans la forêt m’ont rappelé « L’enfance d’Ivan », le beau film d’Andréi Tarkovski.
Grand film donc que cette oeuvre de Sergueï Loznitsa, dont beaucoup de scènes me hantent encore. Comment oublier, par exemple, Souchénia portant sur son dos le cadavre de celui qui devait l’abattre mais qui, au moment d’appuyer sur la gâchette, a été lui-même la victime d’une embuscade? Il y a presque quelque chose de christique dans cette scène-là! Tout est filmé avec le plus grand soin, et en laissant hors champ quasiment tous les actes de violence. Enfin un réalisateur qui ne se croit pas tenu de tout montrer mais qui parie sur l’intelligence du spectateur!
Luc Schweitzer,sscc
20130131 –Cinéma
LINCOLN
un film de Steven Spielberg
Il n’y a pas styles plus dissemblables que ceux de Quentin Tarantino et de Steven Spielberg, et cependant comment ne pas comparer, dans une certaine mesure, les deux films que les écrans français nous proposent en ce début d’année 2013? Dans les deux cas, l’on s’empare d’un grand sujet, la lutte contre l’esclavagisme, et, pour ce faire, l’on visite des pages de l’Histoire des Etats-Unis, dans le cas de Tarantino en la malmenant allégrement, dans le cas de Spielberg avec une attitude beaucoup plus respectueuse. Dans les deux cas, l’on ne peut qu’emporter l’adhésion des spectateurs:qui n’applaudira pas à la lutte contre l’esclavage et à son abolition? Las, dans les deux cas, on a droit, en fin de compte, à des films moyens, ennuyeux, pompeux, voire franchement médiocres!
Quelle figure intéressante que celle de Lincoln! Malheureusement, Spielberg nous assène des débats à n’en plus finir à propos du 13e amendement (celui qui doit précisément abolir l’esclavage) et sur les moyens qu’il faut utiliser pour obtenir les votes nécessaires à son adoption. Cela captivera peut-être les spectateurs américains, mais, pour ceux qui sont étrangers aux Etats-Unis, c’est à la fois ennuyeux et abscons. Heureusement qu’il y a, de temps à autre, des scènes nous montrant un Lincoln humain, descendu de son piédestal, se disputant avec son épouse par exemple. Il y a aussi, il faut l’avouer, quelques scènes très belles pendant la dernière demi-heure du film. Mais, dans l’ensemble, cela reste un film lassant, pédant, bavard, usant…
Quand arrive la fin d’un tel film, on pousse un ouf de soulagement, on se dit « je l’ai vu, c’est bien, dans peu de temps je l’aurai oublié! »Et puis l’on se souvient d’avoir vu, il y a quelque temps, des films que John Ford avait tournés pendant les années 30:« Vers sa destinée »(Young Mister Lincoln) et « Je n’ai pas tué Lincoln »(The prisoner of Shark Island). Et l’on se dit « je ne vais pas tarder à les revoir, ces films-là! John Ford, tout de même, c’est tellement plus captivant que cette grande fresque soporifique éminemment spielbergienne!).
Luc Schweitzer,sscc
20130128 –Cinéma
BLANCANIEVES
un film de Pablo Berger.
Après « The Artist »qui, certes, ne manquait pas de charme, mais qui se cantonnait trop, à mon goût, dans le registre de l’hommage compassé et, somme toute, peu inventif…Après la sublime deuxième partie de « Tabou », le film magistral de Miguel Gomes…Voici « Blancanieves », un film de Pablo Berger d’une sidérante beauté.
Encore un film muet, eh oui, mais un film qui sait échapper au piège dans lequel est tombé Michel Hazanavicius, un film qui sait non seulement retrouver les codes du cinéma muet, mais qui les réinvente et qui les réenchante pour le plus grand bonheur du spectateur.
Pablo Berger s’est inspiré du conte des frères Grimm, mais pour en faire quelque chose de neuf et de surprenant:Blanche Neige au pays de Carmen! Et précisément, Carmen est le prénom qu’il a donné à l’héroïne. On retrouve bien des éléments du conte:la marâtre qu’il faut fuir, les nains qui recueillent l’abandonnée, la pomme empoisonnée…Mais tout est tellement réimaginé qu’on a l’impression de découvrir cette histoire pour la première fois. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, les nains sont-ils ici des forains qui présentent un spectacle de tauromachie…
Le réalisateur a fait un travail extraordinaire non seulement sur le scénario, comme je viens de le dire, mais sur la direction d’acteur et sur la photographie. Il y a énormément de gros plans, mais les acteurs sont tellement excellents, tellement bien dirigés, que tout semble parfait. Une mention spéciale doit être faite des deux actrices qui jouent le rôle de Carmen –Blanche Neige:Carmen enfant et Carmen adulte.
Pour finir, je dirai que ce film compte désormais parmi les oeuvres qui ont été capables de me faire aimer, le temps qu’elles durent, ce qui d’ordinaire m’est indifférent, voire ce que je trouve détestable! Dans le domaine de l’opéra, il y avait déjà « Der Freischütz »de Carl-Maria von Weber, opéra qui me séduit chaque fois que je l’écoute, bien qu’il y soit question de chasse! Il y aura donc aussi « Blancanieves »qui aura trouvé le moyen de rendre agréables à mes yeux des scènes de tauromachie! C’est la magie de l’art, c’est la magie du cinéma, c’est la magie du cinéma muet!!!
Luc Schweitzer,sscc
20130114 –Cinéma
THE MASTER
un film de Paul Thomas Anderson
Je craignais, après avoir lu certaines critiques, d’avoir affaire à un film à la fois grandiloquent, confus et démonstratif. Mais ce que j’ai vu, c’est un film grandiose qui m’a tenu en haleine d’un bout à l’autre, malgré quelques longueurs, peut-être, vers la fin. Comment ne pas se passionner pour un tel récit, même s’il comporte des ellipses qui déroutent quelque peu? Mais qu’importe! La relation ambiguë, étrange, qu’entretiennent Freddy et Lancaster Dodd m’a véritablement passionné en même temps qu’elle m’a laissé avec plein de questions sans réponses (et c’est tant mieux!).
Qui est donc ce Freddy, ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui reste habité par des pulsions de violence incontrôlées et qui s’attache cependant à un gourou? Qui est Lancaster Dodd, le Maître, le fondateur d’un mouvement que l’on voit virer à la secte, maître certes mais néanmoins dépendant et de son disciple et de son épouse (car c’est elle qui, parfois, tire les ficelles)? Maître et disciple incarnés par des acteurs impressionnants:Philip Seymour Hoffmann et Joaquin Phoenix.
Pour créer le personnage de Lancaster Dodd, le gourou, le réalisateur s’est inspiré du fondateur de la scientologie, L. Ron Hubbard. Mais bien sûr, Paul Thomas Anderson s’est bien gardé de faire un film à thèse. « The Master »n’est une charge ni contre la scientologie ni contre son fondateur, il est mieux que cela, il montre comment un homme aux théories fumeuses, qui écrit des livres qui ne valent pas un clou, parvient cependant par d’habiles méthodes de suggestion à fasciner des esprits crédules et à faire des disciples. Et même ceux qui ne sont pas crédules et qui ont deviné qu’ils ont affaire à un expert en fumisterie, même Freddy, qui n’est pas dupe, défend celui qu’il considère comme un maître. De ce point de vue, il me semble que le film est sans ambigüité et donne à voir le gourou et la secte pour ce qu’ils sont. Certes, voilà un film complexe, qui ne conviendra pas à ceux qui vont au cinéma pour paresser devant l’écran. Les autres n’auront qu’une idée:revoir ce film et le revoir encore, car ils ne sont pas près d’en épuiser toute la signification.
Luc Schweitzer,sscc
20130114 –Cinéma
RENOIR
Un film de Gilles Bourdos
Premier film vu en 2013 et premier coup de coeur!
Peut-être aurait-il fallu cependant imaginer un autre titre à ce film, ou lui adjoindre un sous-titre? Plutôt que de se contenter d’un banal « Renoir », on aurait pu donner comme titre « Le patron se meurt ». Ce serait rendre hommage à Michel Bouquet, formidable interprète d’Auguste Renoir, comme il l’est, sur les planches, du roi Bérenger 1er, dans la fameuse pièce d’Eugène Ionesco, « Le roi se meurt ». Car il y a des points communs entre ce film et l’oeuvre d’Ionesco. Auguste Renoir, que tout le monde appelle « patron », n’est plus qu’un vieillard perclus de rhumatisme lorsqu’éclate la guerre en 1914. Il mourra bientôt et il le sait, mais, comme au début de la pièce d’Ionesco, Renoir nie cette fatalité, et l’on fait tout, dans son entourage, pour la nier avec lui. Pourtant, elle est à l’oeuvre, dans le corps de Renoir qui a de plus en plus de mal à peindre, et sur les champs de bataille. Mais Auguste Renoir fait comme si rien n’avait changé. Son fils Jean, le futur grand cinéaste, revient blessé du front. Mais le peintre ne veut rien changer à son oeuvre, il ne veut peindre que des scènes heureuses car il ne faut pas ajouter du malheur à ce monde. Et ce bonheur éclate d’autant plus qu’il tombe sous le charme d’Andrée, une jeune fille qui se présente à lui pour être modèle et qu’il est ravi d’accepter et de peindre. Le bonheur, rien que le bonheur, dans ce petit paradis bien protégé qu’est le domaine des « Collettes ». Pendant ce film, je songeais quelque peu à la belle exposition qui s’est tenu au Centre Pompidou de Metz l’été dernier et qui présentait des oeuvres, et en particulier des peintures, réalisées en 1917. En voyant cette expo, on pouvait, d’une certaine façon, diviser les artistes en deux camps: ceux qui avaient tenu à rendre compte, dans leurs oeuvres des horreurs de la guerre et ceux qui, comme Renoir, n’en tenaient aucun compte et peignaient comme ils avaient toujours peint. A la fin de ce film, lors d’une scène de repas champêtre, des soldats improvisent un chant, mais Auguste Renoir s’insurge: « Est-ce un repas de fête ou un repas funèbre? », demande-t-il. Ce qui importe, c’est de continuer à peindre jusqu’au bout et sans se laisser troubler par rien, même pas par la guerre!
Luc Schweitzer, sscc

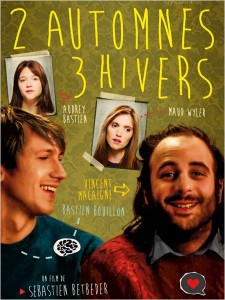





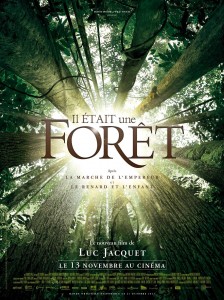




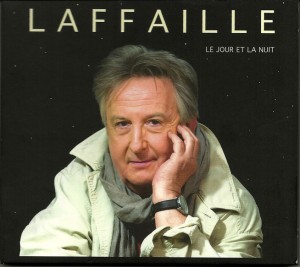
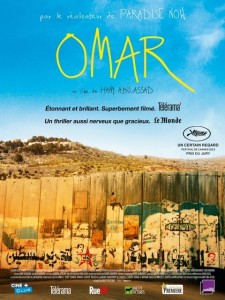




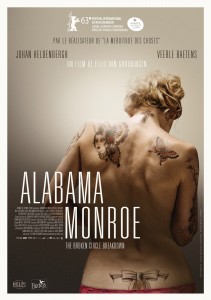
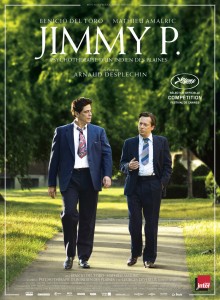

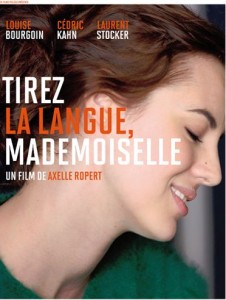
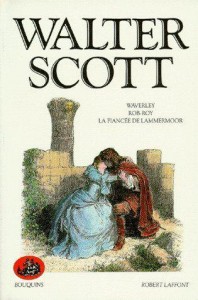
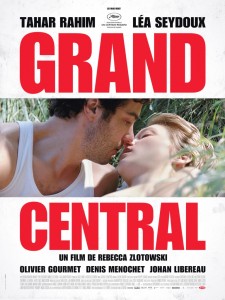

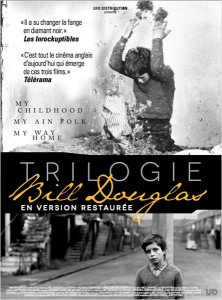




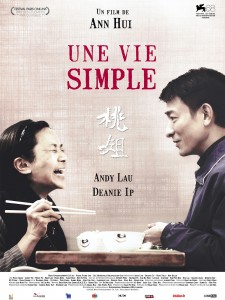







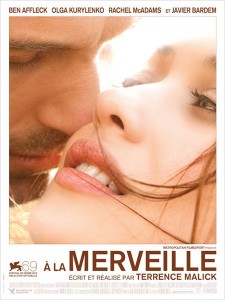


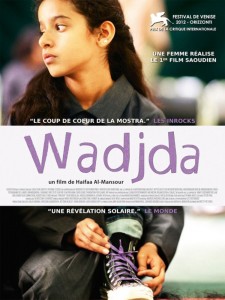


![Blancanieves[1]](http://paroissesaintjean.org/wp-content/uploads/2013/01/Blancanieves1-210x300.jpg)