Le blog du Père Luc – Films, livres, musiques, etc.
[où il est question de films, de livres, de musiques, etc. par un religieux de la Congrégation des Sacrés-Coeurs (Picpucien)]
=> http://lucschweitzer.over-blog.com/
20200806 – Cinéma

EVA EN AOÛT
Un film de Jonás Trueba.
Avec son beau visage nimbé d’une auréole, qui ressemble à celui qu’aurait immortalisé un peintre, Eva (Itsaso Arana) fait figure de sainte sur l’affiche française du film. C’est sans doute quelque peu trompeur, mais pas tant que ça, dans la mesure où l’on admet une définition large de la sainteté. Quoi qu’il en soit, quiconque se familiarisera avec le personnage qui est au cœur de ce film ne pourra, je le suppose, rester hermétique à son aura. L’apparence rohmérienne du film (le cinquième de Jonás Trueba, mais le premier à être diffusé en France) convient à merveille aux déambulations de cette jeune femme de presque 33 ans choisissant de rester dans la capitale espagnole, plutôt que d’imiter la majeure partie des Madrilènes désertant la ville au mois d’août. Les quinze premiers jours de ce mois s’égrènent donc au long du film, découpés comme aurait pu le faire le cinéaste de Conte d’été (1996) et de tant d’autres chefs d’œuvre.
Jonás Trueba s’inspire donc clairement du style d’Eric Rohmer, de manière à la fois assumée et libre. De toute façon, il nous propose le portrait d’un personnage si attachant que, très vite, on cesse de songer à quelque référence que ce soit. Le mot « portrait » ne convient d’ailleurs peut-être pas, le réalisateur ayant la sagesse de garder à son personnage sa part de mystère. Le film ne nous dit pas grand-chose, en effet, au sujet de son « héroïne », sinon son âge et son passé de comédienne. Ce qui compte, c’est plutôt de saisir l’instant présent, les déambulations d’Eva dans la touffeur madrilène et les quelques rencontres qu’elle fait.
Ainsi, dès le début, quelque chose de plus important qu’un CV nous est suggéré lorsque l’ami qui lui prête son appartement se met à parler des comédies américaines des années 30 et, en particulier, des comédiennes qui s’y distinguaient, comme Barbara Stanwyck ou Katharine Hepburn, autrement dit des actrices qui prenaient leurs distances d’avec les schémas classiques et stéréotypés des personnages féminins du cinéma hollywoodien. Plus tard, une actrice comme Olivia de Havilland, qui vient de mourir à l’âge de 104 ans, se permit aussi des audaces, à sa manière.
Eva, manifestement, est une femme du même acabit, ce qui n’empêche nullement l’expression d’une sensibilité empreinte de délicatesse. Celle-ci se manifeste à bien des reprises, en particulier lors de chacune des rencontres que fait la jeune femme. Y compris même lorsque pas une parole n’est échangée, comme avec une jeune fille asiatique que croise Eva. Sans se parler, mais uniquement au moyen d’un rapide échange de regards, une communication s’établit, fugace mais réelle.
Au fil des jours se précisent quelques aspects de la personnalité d’Eva. Rêveuse et contemplative lorsqu’elle observe les étoiles filantes de la nuit de la San Lorenzo ou, simplement, lorsqu’elle regarde un rayon de lumière courant sur un mur, la jeune femme se montre tout aussi apte à profiter des fêtes qui ponctuent cette première quinzaine du mois d’août. Elle semble curieuse de tout, ouverte aux événements, voire aux imprévus, aux rencontres non programmées. La plupart d’entre elles donnent lieu à des dialogues, parfois légers, parfois profonds. Eva n’est pas du genre à passer à côté d’une anomalie en faisant semblant de ne pas la voir. Et quand elle aperçoit un homme qui s’est infiltré dans un endroit interdit au public, non seulement elle ne passe pas son chemin, mais elle le rejoint en se glissant sous une palissade de verre, comme si elle passait de l’autre côté d’un miroir, se risquant ainsi à quelque chose d’indéterminé.
Précisons-le, le titre français gomme l’une des facettes énigmatiques du personnage d’Eva, car le titre espagnol nous parle de La Vierge d’août. Certes, le film s’achève le 15 août, fête mariale de l’Assomption, et l’on voit à l’écran des processions de Madrilènes, mais il s’agit aussi d’Eva elle-même et du mystère de son propre corps. Eva apparaît d’ailleurs comme une jeune femme en questionnement. Lors d’un de ses échanges verbaux, elle explique un projet qu’elle n’a encore pu mettre à exécution : proposer une visite guidée des églises de la ville avec un guide qui, après avoir disserté sur les beautés architecturales de chacun des édifices, poursuivrait avec un questionnement sur la foi (« les gens ne vont plus à l’église », ajoute Eva). Lors d’une autre scène, elle semble être interpellée par les paroles d’une chanson proférée par le chanteur d’un groupe, dans la rue : « Qui régit l’univers ? », demande-t-il.
En fin de compte, pendant les deux heures et quelques que dure le film, et comme le réalisateur nous a laissé un espace, à nous spectateurs, nous nous sommes délectés de la compagnie d’Eva, car elle fait partie de ces personnes dont on peut dire qu’elles font du bien. Sans le savoir, bien évidemment, parce qu’elles sont comme ça, des êtres beaux. Après avoir vu le film, j’avais d’ailleurs en tête la superbe chanson qu’écrivit Gilles Servat sur ce sujet : « Il est des êtres beaux comme un matin du monde / Des êtres déchirants comme un amour enfui / Ils passent lumineux sur nos vies moribondes / Comme un jour qui se lève éteint la vieille nuit… ».
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200716 – Cinéma

ÉTÉ 85
Un film de François Ozon.
Comme la plupart des cinéastes de talent, François Ozon construit, au fil des années, une filmographie cohérente, habitée, hantée même, pourrait-on dire, par un certain nombre de thèmes, qu’il ne cesse d’explorer, d’une manière ou d’une autre. De ce point de vue, d’ailleurs, son long-métrage de 2019, Grâce à Dieu, pouvait faire figure de parenthèse, non pas parce que c’était un film mineur, bien au contraire, mais du fait d’un sujet, disons, hors normes dans sa production. Aujourd’hui, au contraire, Été 85 s’accorde à merveille avec un grand nombre d’œuvres réalisées précédemment par Ozon.
On devine le réalisateur très à l’aise, très en confiance, avec ce film dont l’action se situe sur la côte normande de l’été ensoleillé de 1985, là où les deux protagonistes principaux évoluent, deux adolescents : Alexis (Félix Lefebvre), 16 ans, et David (Benjamin Voisin), son aîné d’un ou deux ans, le plus endurci et plus entreprenant des deux. Leur rencontre se produit sur l’océan, au large, un soir où, alors qu’il s’est aventuré sur une petite embarcation, Alexis se retrouve en grande difficulté et risque de périr noyé. Il en réchappe grâce à David qui s’est porté à son secours. Mais, déjà, l’on pressent qu’on va avoir affaire à une histoire à deux faces, l’une lumineuse, l’autre sombre.
En 2013, dans Jeune et jolie, où il mettait en scène les transgressions très risquées d’une adolescente de 17 ans, François Ozon avait habilement intégré au film un poème célèbre de Rimbaud. Dans Été 85, c’est un poème de Verlaine que lisent et commentent les deux garçons. Rimbaud et Verlaine, les deux poètes scandaleux qui partagèrent 4 années de passion amoureuse, mélange de désir, d’alcool et de violence, s’achevant par la tentative d’assassinat de Rimbaud par Verlaine.
Or, c’est bien de quelque chose de semblable dont il est question dans le film d’Ozon. Le sujet du film n’est pas l’homosexualité en tant que telle, mais bien plutôt le désir avec ce qu’il comporte de bonheur et de souffrance. Le plaisir extrême qu’éprouve Alexis au contact de son aîné ne s’exprime pas seulement parce que les garçons couchent ensemble, mais aussi parce que, pendant un temps, ils partagent tout en commun. Alexis brûle d’un désir si fort qu’il ne peut être comblé. Et c’est ce manque qui provoque la souffrance, une souffrance qui ne demande qu’à prendre toute la place. Le bonheur est éphémère, on le sait bien.
Si le film est ensoleillé, s’il rayonne, non seulement parce qu’il fait beau temps, mais parce que les deux acteurs principaux crèvent l’écran, il n’en reste pas moins que quelqu’un, et pas n’importe qui, jette une ombre inquiétante sur les événements. Il n’y a rien à divulgâcher, car, dès le début du film, nous en sommes avertis : la ténébreuse invitée de cette histoire, c’est la Mort. Avec un M majuscule, comme l’exige Alexis qui se présente d’emblée comme obsédé par elle. Et, de fait, elle est omniprésente tout au long du film, même dans ce qui semble banal et très peu terrifiant. Ainsi quand Alexis compare la baignoire dans laquelle il prend un bain avec un sarcophage égyptien. En vérité, si la Mort marque tout le film de sa présence, elle ne se présente pas comme une réalité horrifique, mais plutôt comme ce qui provoque une fascination malsaine.
Le trouble ressenti par Alexis, ce qui le déstabilise, ne vient pas seulement de son obsession de la Mort, mais aussi de la découverte de plus en grande et de plus en plus pénible de la face cachée de l’être aimé. Même (et peut-être surtout) celui qu’on aime, on ne le connaît pas. Les apparences, à nouveau, sont trompeuses. Et le doute grandit dans l’esprit d’Alexis. Ainsi, à deux reprises, David agit comme un bon samaritain : d’abord, quand il sauve Alexis de la noyade ; ensuite, un soir où il se porte au secours d’un garçon ivre mort. Cela semble exemplaire mais, dans les deux cas, il n’est pas du tout sûr que le garçon ait agi avec un esprit de gratuité ou de pur désintéressement.
Dès le début du film, dès la première scène, on sait que l’histoire commune d’Alexis et de David a mal tourné. Et tout le long-métrage se présente comme une suite d’allers-retours entre le récit des événements fait par Alexis et les événements eux-mêmes. Car, et c’est aussi l’un des grands points forts du film, celui-ci se présente, d’une certaine façon, comme l’œuvre de résilience d’Alexis, sa guérison si l’on veut. Pour en arriver là, une chose est nécessaire : raconter, se confier, parler, écrire. Heureusement pour lui, il se trouve deux personnes à qui il peut se confier, voire s’expliquer : d’une part, Kate (Philippine Velge), une jeune fille au pair venue d’Angleterre qui, sans aucune volonté de sa part, a été la cause du déboire d’Alexis et qui devient néanmoins sa confidente ; d’autre part le professeur de français du garçon (Melvil Poupaud) qui lui propose, puisqu’il lui est difficile de se raconter oralement à son éducatrice, de faire sa confession par écrit. On peut dire que ce sont eux, Kate et le professeur de français, qui sont les vrais bons samaritains de cette histoire.
Quelques petites maladresses de peu d’importance (ainsi la séquence durant laquelle Alexis examine différentes manières de se suicider) n’y changent pas grand chose, le film impressionne par la justesse de son propos, le talent de ses acteurs et la finesse de sa réalisation.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200623 – Cinéma

L’OMBRE DE STALINE
Un film de Agnieszka Holland.
Un homme pour qui la vérité l’emporte sur toute autre considération. Ainsi pourrait-on désigner Gareth Jones (1905-1935), jeune conseiller aux Affaires étrangères dans le gouvernement britannique, dont Agnieszka Holland choisit de retracer l’histoire. Ou, en tout cas, une page mémorable de sa courte existence. Cet aventurier, qui a réussi à interviewer Hitler tout juste arrivé au pouvoir, rêve à présent d’aller à Moscou pour s’y entretenir avec Staline en personne. A ses yeux, le miracle économique tant vantée non seulement par les soviétiques eux-mêmes mais par plus d’un admirateur dans le monde (à l’exemple d’André Gide, avant qu’il ne déchante lorsqu’en 1936 il entreprend son propre voyage en URSS), ce miracle économique reste suspect. Gareth Jones se demande par quels moyens est financée l’industrialisation massive du pays.
Parvenu à Moscou, plutôt que d’interviewer Staline, le jeune homme cherche à orienter ses investigations du côté de l’Ukraine. Son intuition ne l’a pas trompé. Réussissant avec audace à fausser compagnie à son guide (pour ne pas dire surveillant), il s’aventure en Ukraine pour y découvrir la terrible réalité : les autochtones meurent par milliers, par millions, affamés, sans ressources, alors que leur patrie a la réputation d’être un grenier à blé. C’est ce qu’on appelle l’Holodomor, l’extermination par la faim, qui, en 1932 et 1933, fit entre 2,6 et 5 millions de victimes. Impossible de connaître le chiffre exact. Ce sont les céréales qui, exportées et vendues, servaient à financer le « miracle » à la soviétique, au prix du génocide d’un peuple.
Agnieszka Holland a trouvé la manière et les tons appropriés pour filmer les scènes terribles de l’Ukraine moribonde, sans en rajouter dans le pathétique. C’est par le regard effaré de Gareth Jones, témoin gênant de la tragédie, que sont montrées ces scènes, en gris et blanc. Si le film a pris peut-être un peu trop de temps pour entrer dans le vif du sujet, il trouve, dès l’instant où l’on est en URSS et, surtout, en Ukraine, une expression qui n’a plus rien d’académique. Cela se confirme d’ailleurs durant toute la fin du film, lorsque Gareth Jones, de retour en Occident, cherche à publier son reportage, en opposition au prétendu journaliste Walter Duranty, homme sans scrupules décidé à nier l’Holodomor et persistant à diffuser la propagande soviétique.
Pour Gareth Jones, nombreux sont les obstacles, les refus, mais aussi les questions morales, car les soviétiques détiennent des diplomates britanniques, ce qui leur permet d’exercer un chantage. Qu’est-ce qui est préférable ? Se taire et, ainsi, épargner la vie de six ou sept otages ou dire la vérité, témoigner des horreurs perpétrées en Ukraine, en espérant ainsi sauver des milliers, peut-être des millions de vies. Heureusement, même si sa voix a bien du mal à se faire entendre, avec Gareth Jones, on a affaire à ce qu’on appellerait aujourd’hui un lanceur d’alerte. Un homme qui place la vérité au-dessus de tout, même lorsqu’elle déplaît à un grand nombre de personnes.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200621 – Littérature

UN ÉTÉ AVEC PASCAL
Un livre de Antoine Compagnon.
Commencée en 2013 avec Montaigne, la collection d’ouvrage consacrée à divers écrivains, philosophes, poètes avec qui l’on est invité à passer un été (collection reprenant d’ailleurs des émissions diffusées sur France Inter) s’est enrichie chaque année d’un nouveau volume. Après Montaigne donc, il y eut Proust, Baudelaire, Hugo, Machiavel, Homère, Valéry et, cette année, Pascal. Sans surprise, c’est Antoine Compagnon, qui écrivit le volume sur Montaigne, qui est également l’auteur de celui sur Pascal. On ne peut lire, en effet, ce dernier qu’en se référant au premier. Pascal fut un lecteur assidu de Montaigne, il le critiqua sévèrement, le railla à l’occasion (« le sot projet qu’il a de se peindre », écrivait-il), mais aussi, parfois, tout en condamnant son scepticisme et sa nonchalance, après réflexion, finit par « le rencontrer », autrement dit se trouver en accord avec lui.
Le grand intérêt du livre d’Antoine Compagnon, c’est, au moyen d’une quarantaine de chapitres très courts, de nous inciter à une lecture renouvelée de l’auteur des fameuses Pensées. Renouvelée mais aussi plus complète. Car ce que nous gardons en mémoire au sujet de Pascal n’est peut-être qu’une toute petite partie de son œuvre et de sa réflexion. Comme le note Antoine Compagnon, dans Ma nuit chez Maud (1969), film d’Éric Rohmer assez célèbre, à juste titre, deux des protagonistes dissertent longuement au sujet de Pascal, mais en limitant leurs propos au pari pascalien. Le fameux pari de Pascal ! Or, s’il a certes son importance, s’il trouve sa place dans le développement des réflexions de l’auteur des Pensées, il serait vraiment dommage de l’isoler d’un ensemble qui, même s’il ne nous est parvenu qu’à l’état de fragments, n’en a pas moins sa cohérence propre.
Le projet initial de Pascal, ne l’oublions, était de rédiger un ouvrage apologétique destiné à convertir les libertins (entendons non pas des jouisseurs, mais ceux qui exercent leur pensée en dehors des contraintes du dogme). Pour ce faire, Pascal avait imaginé un livre en deux parties : une anthropologie (qui décrit la misère de l’homme sans Dieu) et une théologie (qui décrit la félicité de l’homme avec Dieu). Comme on le sait, du fait de sa mort à l’âge de 39 ans, il ne put achever cette œuvre. Nous n’en connaîtrons jamais que les fragments, que les notes prises par Pascal, que nous appelons ses Pensées. Aussi fractionnées soient-elles, elles n’en sont pas moins une œuvre incontournable, géniale dans sa formulation, dans la forme comme dans le fond, de la langue française.
Par le moyen de multiples voies d’accès, Antoine Compagnon nous propose une aide précieuse pour mieux appréhender les subtilités des réflexions de celui que Chateaubriand désignait comme un « effrayant génie ». Virtuose de la langue française, mathématicien, physicien, philosophe, théologien, Pascal fut tout cela et plus encore. Nombreux sont ceux qui furent impressionnés par la finesse de sa prodigieuse dialectique. Et l’on ne peut le lire sans être profondément marqué. Même ceux qui rejettent la foi chrétienne trouvent en Pascal des motifs d’admiration. Si Voltaire et les autres philosophes des Lumières déploraient sa foi rigoriste, ils n’en étaient pas moins émerveillés par son génie scientifique. D’une manière ou d’une autre, Pascal peut toucher ou rejoindre les préoccupations de tout un chacun, dans la mesure, évidemment, où l’on n’est pas quelqu’un de totalement superficiel. Et si nous craignons de nous aventurer dans une œuvre marquée par le rigorisme de son auteur, ou par un ton qui semble tragique au point d’être pesant, il nous faut corriger cette étiquette trop vite accolée au nom de Pascal. Certes, il y a de la tragédie chez lui, on ne peut le nier, mais il y a aussi son contraire : l’auteur des Pensées ne se prive pas, à l’occasion, de rédiger de petites paraboles, voire d’adopter un ton léger, presque primesautier, et teinté d’humour !
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200508 – Littérature
Bonjour à tous!
Si les cinémas restent fermés au public, les livres, eux, demeurent disponibles. Voici donc ma critique des « Lumières de Tel-Aviv » de Alexandra Schwartzbrod.
Bien amicalement.
Luc Schweitzer, ss.cc.
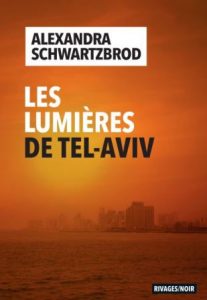
LES LUMIÈRES DE TEL-AVIV
Un roman de Alexandra Schwartzbrod.
Récemment, sur Arte, l’on a pu voir un documentaire saisissant intitulé Tous surveillés, qui montre comment, en prenant prétexte du besoin de sécurité des populations, l’on fait installer, un peu partout dans le monde, des systèmes de surveillance de plus en plus sophistiqués. Le monde tel que l’avait imaginé George Orwell dans 1984, son fameux roman d’anticipation, est bel et bien en cours de fabrication, si l’on peut dire. Certains pays, parce qu’ils sont contaminés plus que d’autres par la peur, se placent en leaders dans le domaine en question. En Israël, les caméras ne se comptent plus et l’on y est fort intéressé par les prouesses technologiques inventés par les Chinois, soucieux de contrôler en permanence les Ouïghours musulmans de la province du Xinjiang. Pour ce faire, ce territoire est couvert de caméras « intelligentes », c’est-à-dire capables de repérer les individus suspects qu’il convient d’arrêter et de placer dans des maisons de redressement. Autrement dit, ce ne sont plus des hommes qui décident, mais des machines fonctionnant selon de mystérieux algorithmes. Ce sont elles qui désignent les suspects. Big Brother est devenu un œil électronique.
Ces réalités, Alexandra Schwartzbrod les prend formidablement en compte dans son nouveau roman, dont l’action se situe en Israël, entre Jérusalem et Tel-Aviv, un pays qu’elle connaît à merveille pour y avoir séjourné longuement en tant que journaliste et correspondante de Libération. Ce pays, si obsédé précisément par la sécurité, elle l’imagine coupé en deux, un mur séparant les deux parties. D’un côté, du côté de Jérusalem, ce sont les ultra-religieux qui ont pris le pouvoir et fondé le Grand Israël, aidés en cela par des Russes omniprésents capables de mettre en place des systèmes de surveillance dernier cri, le fleuron en étant les drones tueurs qui, d’eux-mêmes, sans être guidés par une main humaine, repèrent et éliminent les individus suspects, en particulier à proximité du mur. De l’autre, du côté de Tel-Aviv, se sont repliés et réfugiés des rebelles qui, juifs et arabes, ont rejeté les diktats du Grand Israël et s’emploient à un retour aux origines, tentant de ranimer la flamme qui animait les premiers kibboutzim.
Bien évidemment, Alexandra Schwartzbrod ne se contente pas de décrire un monde qui est devenu « une succession de murs et de cloîtres » (au passage, elle indique que l’Europe a implosé et retrouvé ses frontières intérieures), mais elle introduit habilement une touchante galerie de six personnages, tous en quête d’une vie différente. Homme religieux, Haïm se décide pourtant à fuir Jérusalem, tant la pratique de la foi, avec ses nombreux interdits et son corollaire, la haine des autres, risque de le rendre fou. Or, il s’enfuit en emportant avec lui les plans du système de surveillance en cours de réalisation, équipé de robots tueurs. Sa femme Ana, qu’il a laissé derrière lui, faute de l’aimer vraiment, se prend à rêver de liberté, elle aussi. Quant à Isaac, ami d’Haïm, il se trouve que lui est réellement épris de la belle Ana. Il faut compter aussi avec Moussa et Malika, deux jeunes Palestiniens qui trouvent refuge, pendant un temps, dans une grotte, ainsi qu’avec Eli Bishara, un ex-commissaire de police, palestinien réfugié à Tel-Aviv, ville à la fois honnie et adorée.
Tous ces personnages, avides de changement, la romancière sait les rendre familiers au lecteur, passant des uns aux autres, au moyen de chapitres assez brefs. Ce roman choral, bien conçu, bien découpé, on l’imaginerait sans peine adapté au cinéma ou en série télévisée. Il semble presque déjà écrit dans cette intention, ce qui ne supprime en rien ses qualités, au contraire. L’écriture n’en est pas le moins du monde bâclée et l’on n’a aucune peine à se prendre d’intérêt, voire de passion, pour les divers protagonistes. Tout en espérant très fort de n’être pas en présence d’un roman prémonitoire. Car la réalité d’Israël et du monde, telle que l’entrevoit Alexandra Schwartzbrod, il ne faut la souhaiter pour personne.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200424 – Un texte à lire, méditer, partager…
Bonjour à tous!
Je vous fais parvenir à nouveau un texte dont je ne suis pas l’auteur mais qui me paraît non seulement intéressant mais très approprié.
Oserons-nous changer radicalement le visage de l’Eglise, entreprendre des réformes, imaginer des chemins nouveaux pour notre être-chrétien, ou bien nous enfermerons-nous dans nos traditions et pratiques éculées? Les enjeux sont de taille et ils ne peuvent s’accorder avec le cléricalisme encore omniprésent chez nous, les catholiques, comme on peut le constater, malheureusement, même en cette période de confinement.
http://www.lavie.fr/debats/idees/les-eglises-fermees-un-signe-de-dieu-23-04-2020-105809_679.php
Bien amicalement.
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200412 – Interview à méditer
Mon message d’aujourd’hui ne comporte pas de critique ni de film ni de livre, mais un lien vers une belle et intéressante interview de Gabriel Ringlet qui invite, entre autres, à donner toute sa place à la créativité en cette période où il n’est pas possible de se rassembler. Plutôt que de se filmer en train de célébrer des messes sans assemblées, comme le font paresseusement tant de prêtres aujourd’hui, pour les diffuser à leurs fidèles, ne vaut-il pas mieux proposer aux fidèles de célébrer chez eux, à leur manière, en laissant toute place à la créativité! On évitera ainsi de retomber, une fois de plus, dans le piège du cléricalisme. D’une certaine façon, le fait de ne pas pouvoir se rassembler dans les églises pour des célébrations présidées par des prêtres, c’est une chance à saisir. Les laïcs peuvent prier et célébrer sans la présence d’un prêtre, et c’est très bien!
Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous!
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200406 – Un grand roman d’aventures maritimes
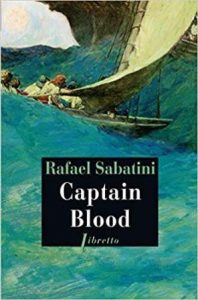
CAPTAIN BLOOD
Un roman de Rafael Sabatini.
On doit à Rafael Sabatini (1875-1950), écrivain italo-britannique, quelques fleurons de romans d’aventures historiques qui n’ont rien perdu de leur pouvoir de séduction. Quand on est amateur de « grande littérature », si tant est que l’on puisse définir précisément cette expression-là, on sera peut-être enclin à traiter par le mépris ce qu’on considérera comme de la sous-littérature, tout juste bonne à distraire le grand public. Pour ce qui me concerne, je me défie de ces distinctions et suis peu prédisposé au dédain. On a vite fait de se rendre compte, d’ailleurs, si on prend la peine (ou plutôt le plaisir) de les lire, que nombre d’auteurs ayant écrit des romans destinés, sans nul doute, au divertissement des lecteurs, n’en ont pas moins fait preuve d’un grand savoir-faire et de beaucoup plus de subtilités que ce que nos préjugés leur accordent. Rafael Sabatini est de ces auteurs-là, lui à qui l’on doit au moins trois grands romans d’aventures qui furent aussi de grands succès : Captain Blood, Scaramouche et L’Aigle des Mers.
Dans Captain Blood, tout comme dans les deux autres romans que je viens de nommer, les péripéties se succèdent presque sans arrêt. Néanmoins, on n’a jamais le sentiment que le récit est bâclé, au contraire. Les personnages, bien que pris dans des tourbillons d’aventures incessantes, ne sont nullement brossés à grands traits. Le romancier s’attache à faire comprendre leurs motivations et il réussit à les dépeindre avec une surprenante finesse. Plusieurs d’entre eux, en tout cas, échappent aux facilités qu’on imagine être fatalement de mise dans ce genre de romans. C’est vrai, en particulier, pour ce qui concerne le personnage éponyme. Les premières pages du roman nous décrivent Peter Blood comme un homme désireux d’en finir, une fois pour toutes, avec les aléas d’une vie aventureuse. Retiré en tant que médecin dans une bourgade d’Angleterre, il n’aspire qu’à exercer ce métier-là et rien de plus. Or, bien sûr, des événements ne tardent pas à le propulser dans une existence qui n’a plus rien d’une sinécure. Ayant donné des soins à un fuyard blessé, il est compté au nombre des rebelles s’étant soulevés contre la sujétion du roi Jacques. Condamné au bagne, il est envoyé aux Caraïbes où il est vendu comme esclave. Ce qui lui permet de rencontrer à la fois son plus grand ennemi et son plus grand amour : le premier est celui qui l’achète, le colonel Bishop, la deuxième est la nièce de celui-ci, Miss Arabella Bishop.
Bien évidemment, Blood ne reste pas esclave. Avec des compagnons d’infortune, il réussit non seulement à s’échapper mais même à s’emparer d’un navire espagnol. Commence alors la grande série d’aventures maritimes qui mène Blood jusqu’à l’île de la Tortue où il se résout à se joindre aux flibustiers. Mais tout n’est pas si simple. Blood va devoir composer avec de multiples interlocuteurs, espagnols, hollandais, français, allant d’une île à une autre, d’un combat à un autre, de Bridgetown à Maracaibo et à Carthagène et en d’autres lieux encore. Son itinéraire périlleux et complexe lui donnera l’occasion, bien sûr, d’affronter encore et encore Bishop, mais aussi d’autres ennemis, et de croiser à plusieurs reprises le chemin de la belle Miss Arabella dont il est amoureux, une Miss Arabella qui se pose beaucoup de questions à son sujet, se demandant (pendant un temps) s’il n’est rien de plus, en fin de compte, qu’un pirate et un voleur.
C’est sur ce sujet, celui de l’identité de Blood, mais aussi d’autres personnages, sur les apparences qui peuvent être trompeuses, que le romancier abonde en subtilités. Oui, on a affaire à un roman d’aventures, et des plus captivants, mais cet aspect n’écrase pas ce que le récit peut contenir du point de vue de l’intelligence, de la réflexion. Blood est un homme complexe qui ne cesse de dérouter ses compagnons, ses interlocuteurs, ses ennemis et son amoureuse. Un événement, parmi bien d’autres, montre parfaitement le peu de pertinence des étiquettes trop vite associées aux personnages. Cela apparaît, de manière évidente, lorsque, Blood s’étant mis, pour un temps, au service du roi de France, se tient un débat au sujet d’une expédition à mener contre les Espagnols : Blood suggère d’envahir la totalité de l’île d’Hispaniola, tandis que les Français préfèrent attaquer Carthagène afin de s’emparer de ses trésors et de la livrer au pillage. Autrement dit, en cette circonstance, c’est Blood qui se comporte en d’homme d’honneur et en chef de guerre responsable et ce sont les Français qui adoptent les manières de faire des flibustiers ! « … il est étrange, dit Blood, que le général des armées du roi de France propose une expédition de flibuste, tandis que le chef des flibustiers songe à l’intérêt et à l’honneur de la France. » Voilà qui prouve, si nécessaire, qu’un roman d’aventures tel que celui-ci ne manque nullement de sagacité.
Pour finir, je ne peux manquer de rappeler (ou peut-être d’apprendre à certains) que les trois grands romans de Sabatini que j’ai nommés au début de cet article furent tous trois adaptés au cinéma et donnèrent lieu à trois chefs d’œuvre de films d’aventures. Deux d’entre eux furent confiés à Michael Curtiz : Captain Blood en 1935 et L’Aigle des Mers en 1940. Quant à Scaramouche, il fut réalisé en 1952 par George Sidney. On est parfois enclin à estimer que les films subvertissent toujours plus ou moins les romans, les scénaristes n’hésitant pas à chambouler le texte et à y tailler à loisir. En vérité, ce n’est pas toujours le cas. Le film de Michael Curtiz reste on ne peut plus fidèle au roman de Sabatini. Il bénéficie, en outre, d’un impressionnant savoir-faire et d’un casting idéal. Pour tous ceux et toutes celles qui ont vu le film, le capitaine Blood aura toujours le visage et le charisme sans faille d’Errol Flynn, tandis que Miss Arabella conservera les traits ainsi que la grâce d’Olivia de Havilland !
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200317- Un livre très captivant
Emmanuel Macron nous ayant invité à tirer profit de la période de confinement qui commence aujourd’hui en nous adonnant, entre autres, à la lecture, je n’en ai que plus d’empressement à vous communiquer l’article que j’ai écrit sur un livre très captivant intitulé « Au café existentialiste » et écrit par Sarah Bakewell.
Bonne lecture donc.
Bien amicalement.
Luc Schweitzer, ss.cc
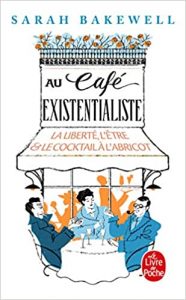
AU CAFÉ EXISTENTIALISTE
Un livre de Sarah Bakewell.
Raconter l’existentialisme et tous les méandres des systèmes philosophiques ayant été construits au XXème siècle en prenant appui sur les vies à rebondissement de celles et ceux qui en furent les fers de lance, en proposer le récit sans jamais affadir le propos, sans contourner les complexités des diverses philosophies, et cependant rédiger un ouvrage qu’on peut lire presque comme un roman d’aventures, telle est la gageure brillamment relevée par Sarah Bakewell. Même si l’on n’est pas féru de philosophie, même si l’on a toujours eu les plus grandes difficultés à décrypter, autant que faire se peut, le jargon dont usent ceux qui se sont illustrés dans ce domaine, et je dois préciser que je fais partie de ceux-là, on peut se prendre de passion pour les vies et les pensées étroitement entremêlées des différents actrices et acteurs de la pensée philosophique au XXème siècle. Le livre de Sarah Bakewell donne à vibrer, à s’interroger, à réviser ses idées toutes faites, à s’enthousiasmer ou à s’effrayer, en tout cas à penser.
Les différentes figures de proue de la réflexion philosophique, nous en connaissons plus ou moins les noms, je suppose. Deux d’entre eux sont au cœur de l’ouvrage, comme ils furent de leur vivant au cœur des débats de la philosophie. L’un est allemand, Martin Heidegger (1889-1976), l’autre français, Jean-Paul Sartre (1905-1980). Autour d’eux, ou, en tout cas, en résonance avec eux, gravitent de nombreuses autres personnalités : Edmund Husserl (1859-1938), Hannah Arendt (1906-1975), Raymond Aron (1905-1983), Simone de Beauvoir (1908-1986), Albert Camus (1913-1960), Karl Jaspers (1883-1969), Emmanuel Levinas (1906-1995), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) et bien d’autres encore.
Or les débats entre ces diverses personnes ne cessent jamais tout au long d’un siècle marqué par deux guerres mondiales et de nombreux autres événements. Car ce qu’il faut remarquer, au fil de la lecture du livre de Sarah Bakewell, c’est que, faisant fi du cliché selon lequel les philosophes ne demandent rien mieux que rester enfermés dans leur tour d’ivoire, ceux dont il est question ici ont été, pour la plupart, des femmes et des hommes engagés, prenant part aux bouleversements du monde et, pour nombre d’entre eux, prenant aussi parti, autrement dit optant pour des choix politiques, au risque, parfois, de surprenantes alliances ou de stupéfiants aveuglements.
Il est d’autant plus passionnant, quoi qu’il en soit, de se remémorer toutes les discussions, tous les débats d’idées, toutes les controverses qui ont agité le monde de la philosophie au siècle dernier que tout cela reste largement d’actualité. Les prises de position des uns et des autres nous interpellent toujours, alors que ceux même qui les ont prononcées sont morts depuis longtemps. Il est même des réflexions qui semblent prémonitoires et dont on mesure encore mieux aujourd’hui le caractère, si l’on peut dire, prophétique. Quand, par exemple, Martin Heidegger explique, dans un de ses ouvrages, que « l’humanité est devenue monstrueuse » et que l’homme se détruit lui-même, comment ne pas penser à la destruction inéluctable de la planète telle que nous la constatons aujourd’hui ? De même Camus lorsqu’il observait que « l’humanité devait choisir entre le suicide collectif et un emploi plus intelligent de sa technologie. »
On le voit, même si ceux qui en sont les concepteurs et les auteurs se plaisent toujours à émettre leurs idées au moyen de jargons que le commun des mortels peine à maîtriser, la philosophie telle qu’elle se déploie au XXème siècle ne se démarque pas, la plupart du temps, des réalités les plus concrètes du monde. Au contraire même, puisque son objectif est de mieux appréhender l’expérience du vivant, de l’humain en particulier. Au moment où elle expose le projet de son livre, Sarah Bakewell explicite fort bien l’interaction entre philosophie et vie: « Je pense que la philosophie devient plus intéressante quand elle se fond dans le cadre d’une vie. Je crois de même que l’expérience personnelle est plus intéressante quand elle se pense philosophiquement. »
A ce sujet, puisqu’il est question des vies des uns et des autres, il est impressionnant de constater à quel point elles furent marquées autant par les amitiés que par les querelles. L’estime que l’on se porte mutuellement, les rencontres et les amitiés entre les uns et les autres se sont, plus d’une fois, soldées par des ruptures plus ou moins tonitruantes. C’est le cas de ceux qui vouèrent une admiration sans borne pour Martin Heidegger et qui se trouvèrent bien dépités lorsque celui-ci, après la guerre, refusa obstinément et jusqu’à son dernier jour de désavouer le nazisme auquel il s’était lui-même rallié dès 1933.
Mais il serait injuste et malhonnête de tenter d’enfermer, en quelque sorte, dans une formule un seul des philosophes dont il est question. « Vous pouvez penser me définir sous une certaine étiquette, écrit Sarah Bakewell, mais vous vous trompez puisque je suis toujours a work in progress, en chantier. » C’est une des raisons pour lesquelles des amitiés qui paraissaient indéfectibles n’ont pas résisté à l’épreuve des événements conduisant à des prises de position inconciliables. Ce fut le cas, entre autres, lorsque se brouillèrent Jean-Paul Sartre, soutenu par Simone de Beauvoir, et Albert Camus. Dès la Libération, en janvier 1945, lorsque se tint le procès de l’écrivain collaborationniste Robert Brasillach, de profondes divergences apparurent : tandis que Camus s’opposait fermement à la peine de mort, Sartre et Beauvoir s’efforçaient, au contraire, de trouver des raisons de la justifier.
Je comprends mieux, d’ailleurs, grâce à la lecture du livre de Sarah Bakewell, pourquoi je me suis toujours senti bien plus proche d’un Camus que d’un Sartre, le premier n’autorisant aucune justification ni de la violence ni du terrorisme, alors que Sartre et Beauvoir estimaient que, dans certaines circonstances, il fallait « se salir les mains ». Cela dit, encore une fois, il faut éviter de trop simplifier, d’émettre des jugements à l’emporte-pièce. Sartre fut quelqu’un d’extrêmement complexe, capable de s’aveugler lui-même au point de s’entêter à défendre les régimes politiques les plus infâmes, le communisme à la soviétique du temps de Staline, par exemple, mais également enclin à se positionner toujours du côté des exclus. Simone de Beauvoir et Sartre furent ainsi scandalisés par les inégalités raciales qu’ils constatèrent lors de leurs séjours aux États-Unis. Et ils prirent bien d’autres engagements en faveur des laissés-pour-compte. D’un côté, il y eut le Sartre extrémiste qui, préfaçant un ouvrage de Frantz Fanon, trouvait le moyen de louer la violence en soi, de l’autre, celui qui était décrit par ses amis (y compris ceux avec qui il s’était fâché) comme « un homme bon », ne se privant pas d’être on ne peut plus généreux dès que l’occasion se présentait.
Ce n’est là, bien entendu, qu’un aperçu de tout ce que raconte Sarah Bakewell avec un formidable talent de conteuse, réussissant à retracer les vies et les pensées des philosophes du XXème siècle à la manière d’une grande épopée. C’en est une d’ailleurs, sans nul doute, c’est l’épopée de la philosophie.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200311- Cinéma

UN FILS
Un film de Mehdi M. Barsaoui.
Décidément, à l’heure actuelle, ce sont des réalisateurs issus de pays de tradition musulmane qui abordent avec le plus de savoir-faire et d’intelligence du propos les questions morales et les dilemmes qui en découlent. Après l’iranien Asghar Farhadi et le turc Nuri Bilge Ceylan, voici un jeune cinéaste tunisien qui signe là un premier long-métrage remarquable à tout point de vue.
À vrai dire, on peut émettre un petit bémol au sujet de la scène d’ouverture du film, la caméra ayant une fâcheuse tendance à bouger sans arrêt. Mais, dès qu’on entre dans le vif du sujet, ce désagrément non seulement n’est plus de mise mais on est saisi par la qualité des images et de la mise en scène. Le réalisateur a choisi, il faut le préciser, un couple d’acteurs incarnant leurs personnages respectifs avec une justesse et une intensité qui ne peuvent laisser de marbre.
Nous sommes en 2011 et Fares (Sami Bouajila) et Meriem (Najla Ben Abdallah) forment ce couple de parents modernes séjournant dans le sud de la Tunisie avec leur garçon de 10 ans prénommé Aziz. Or, au cours d’une escapade en voiture, tous trois sont les cibles d’une attaque terroriste au cours de laquelle Aziz est grièvement blessé. Amené à l’hôpital, le garçon est sauvé, mais doit bénéficier au plus tôt d’une greffe de foie, sans quoi il ne pourra survivre.
Bien sûr, ses parents se portent volontaires. Mais les analyses effectuées sur chacun d’eux ne donnent pas les résultats escomptés. Le film propose dès lors une succession quasi ininterrompue de dilemmes moraux qui en disent long non seulement sur les personnages directement impliqués, mais aussi sur la société tunisienne dans son ensemble. Car Mehdi M. Barsaoui ne craint pas d’aborder de front des sujets qui restent plus ou moins tabous dans un pays encore fortement régi par des traditions et des lois résultant de la religion musulmane. C’est le cas, en particulier, dans le film, de l’adultère (toujours passible d’une peine de prison en Tunisie) mais aussi du don d’organes, une pratique qui reste occultée dans les conversations et les discours tout en donnant lieu à des trafics sordides dont profitent des gens peu scrupuleux qui opèrent là où se déroulent des conflits armés (en l’occurrence à la frontière libyenne).
Le film propose aussi une réflexion des plus intéressantes sur la question de la paternité. Qu’est-ce qu’un père ? Qui est le vrai père, lorsque celui qui élève un enfant n’est pas le père biologique ? Dans le film, Sami Bouajila incarne à merveille ce père blessé dans son orgueil et cependant capable de tous les dévouements pour l’enfant qui risque de perdre la vie. Entre l’homme à la fierté rabaissée et sa femme peu encline à fouler aux pieds sa dignité tout en étant, elle aussi, apte à tous les sacrifices pour le salut de son enfant, les regards importent plus que les paroles. Ils ouvrent, semble-t-il, en fin de compte, sur un nouveau départ.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200305- Cinéma

LA COMMUNION
Un film de Jan Komasa.
Aussi étonnant cela peut-il paraître, il nous est affirmé, dès l’entrée du film, que l’histoire qui y est racontée est basée sur des faits réels. En vérité, d’ailleurs, les affaires de faux prêtres ne sont pas aussi rares qu’on pourrait l’imaginer et il s’avère qu’en Pologne, plusieurs escroqueries de ce genre ont défrayé la chronique. Cela étant, le personnage mis en scène par Jan Komosa n’en reste pas moins extrêmement fascinant.
Prénommé Daniel dans le film, nous le découvrons, dans un premier temps, confronté à une scène très violente qui se déroule dans l’atelier de menuiserie où il travaille avec ses codétenus. Le jeune homme, en effet, purge une peine d’emprisonnement dans un centre de détention pour la jeunesse. La violence s’y déchaîne volontiers, on l’imagine, mais il s’y trouve un lieu où règne la paix, c’est dans la salle où se rassemblent ceux qui veulent assister à la messe. Daniel, lui, non seulement y est présent, mais il fait office de servant d’autel.
L’aumônier est là, également, le jour où Daniel sort de prison, il lui recommande de se rendre sans faute dans l’entreprise de menuiserie où une place lui est réservée et de se consoler de ne pouvoir aller au séminaire comme il le souhaiterait. Avec son casier judiciaire, ce n’est pas envisageable. Or, arrivé dans le lieu où il devrait travailler, Daniel préfère entrer à l’église. Il y trouve une jeune fille et se présente bientôt à elle comme un prêtre de passage. Il a d’ailleurs en sa possession le col romain qu’il avait dérobé à l’aumônier du centre pénitentiaire.
Le voilà bientôt qui est présenté au curé de la paroisse, un prêtre âgé qui ne demande pas mieux que d’avoir un peu d’aide. C’est ainsi que, par un concours de circonstances, car le curé, malade, doit être bientôt emporté à l’hôpital, c’est Daniel en personne qui se met à officier en tant que prêtre de la paroisse. Il entend les confessions, célèbre des messes en prenant quelques libertés par rapport au rituel, mais sans offusquer les fidèles, visite les personnes…
Ce ne sont donc pas des questions de rituel qui peuvent perturber la communauté villageoise, celle-ci étant déjà chamboulée par quelque chose de beaucoup plus grave. Car ce village reste profondément marqué par un drame récemment survenu, celui qui a emporté dans la mort sept de ses habitants, tués lors d’un accident de voitures. Or, sur un panneau commémoratif, à l’entrée de l’église, il n’y a que six photos, celles des six qui circulaient dans une même voiture. Si le septième est absent, c’est parce qu’on l’accuse d’être le fautif, celui qui a provoqué l’accident fatal. Depuis lors, la communauté est divisée, la veuve du prétendu chauffard reçoit des lettres d’insultes, sa maison est taguée. Quant au curé de la paroisse, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’avait pas apaisé les tensions puisqu’il avait refusé de célébrer les funérailles de cet homme.
Or, c’est à propos de ce drame et des tensions et des divisions qu’il a générées que le film de Jan Komasa prend une direction inattendue. Car, ce que le vrai prêtre, le curé de la paroisse, avait contribué à défaire par sa rigidité, le faux prêtre, l’imposteur, s’emploie à le réparer. En somme, c’est le menteur qui se conduit en véritable pasteur d’une communauté divisée qu’il s’emploie à guérir. De ce fait, ce film propose une réflexion des plus judicieuses sur le sacerdoce et sur ce que doit être l’attitude d’un prêtre guidant une communauté. Pour ce faire, le réalisateur peut s’appuyer sur le talent, le charisme, de son acteur principal, Bartosz Bielenia, capable de jouer, de manière convaincante, aussi bien le registre de la violence (dont il ne peut totalement se défaire) que celui de l’exaltation de la foi. Car, il y a chez lui, malgré son imposture, quelque chose d’indéniablement sincère. Dommage que quelques scènes très conventionnelles affaiblissent un peu le propos (cela concerne la relation bien peu originale qui se noue entre le faux prêtre et la jeune fille à qui il s’était présenté à l’église, mais aussi une séquence ultraviolente, filmée frontalement, dont on se passerait volontiers).
7,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200227- Cinéma
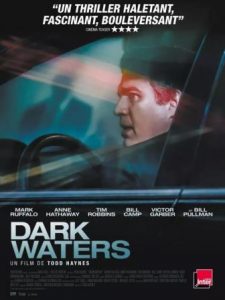
DARK WATERS
Un film de Todd Haynes.
Ses grands films, Todd Haynes les a réalisés dans le genre mélodramatique (Loin du Paradis en 2002 ou Carol, son chef d’œuvre, en 2015). On ne l’attendait pas, à priori, dans un registre très différent, celui du film-dossier, mais, sans atteindre des sommets, il s’en tire avec un indéniable savoir-faire. Certes, comme dans la plupart des films de ce type, on peut déplorer quelques longueurs et quelques redondances, mais on reste suffisamment captivé et l’on se sent suffisamment interpellé pour ne jamais risquer de perdre le fil de l’histoire.
Il faut dire que ce film met en évidence un scandale planétaire car, sans possiblement en être conscients, nous sommes tous contaminés, empoisonnés à plus ou moins haute dose par un produit qui sert, entre autres, à fabriquer le téflon. Or qui ne s’est jamais servi d’une poêle composée, au moins en partie, de cette matière ? Une matière hautement toxique fabriquée à grande échelle par les industries DuPont qui, tout en étant averti de la nocivité de leur produit, n’en continuent pas moins de le mettre sur le marché.
Cette infamie méritait bien un film, d’ailleurs basé sur des faits réels se déroulant du côté de Pakersburg en Virginie-Occidentale, une région que Todd Haynes montre comme figée dans de pâles couleurs d’hiver. Là se trouve un fermier qui assiste, impuissant, à l’hécatombe de toutes ses vaches. L’une après l’autre, elles deviennent comme folles, au point qu’il est obligé de les abattre. Il en a perdu 190. Or sa ferme se trouve non loin des usines DuPont et à proximité d’une décharge où les industriels enfouissent des déchets toxiques. Toute la région de Pakersburg en est affectée, l’eau des robinets étant elle-même contaminée.
Par un concours de circonstances, le fermier en question, débouté par tous les avocats de sa région, tant ils craignent de s’en prendre à un géant de l’industrie, adresse sa requête à Robert Bilott (Mark Ruffalo), pourtant très mal placé, puisqu’il fait partie d’un cabinet d’avocats spécialisé dans la défense des industries chimiques. C’est pourtant cet homme, dont le rôle a été confié par le réalisateur à l’acteur idéal, qui se laisse toucher par la détresse du fermier au point de se résoudre à le défendre.
Il s’engage alors dans une procédure au long cours, parsemée de divers rebondissements, une procédure harassante, qui n’est pas sans conséquences ni sur sa santé ni sur l’harmonie de sa vie de famille. Il faut être doté d’une volonté de fer, d’un acharnement peu ordinaire, pour tenir bon pendant des années, persévérer, envers et contre tout, à mener la lutte du frêle David contre le géant Goliath. Il faut le voir, cet avocat, épluchant des masses de dossiers remplissant des dizaines de cartons, comme un insecte s’attaquant à une montagne ! Ne serait-ce qu’à cause du portrait de cet homme allant jusqu’au bout de sa quête de vérité et de justice et mettant à jour tout un système économique et politique corrompu, ce film mérite sans nul doute qu’on fasse son éloge.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200219 – Cinéma

WET SEASON
Un film de Anthony Chen.
« Il pleure dans mon cœur / Comme il pleut sur la ville ». Ces vers bien connus de Verlaine, Ling pourrait les prononcer, tant ils lui conviennent parfaitement. Originaire de Malaisie, elle habite à Singapour où elle enseigne le chinois à des élèves qui considèrent cette matière comme très secondaire, préférant apprendre l’anglais, beaucoup plus utile quand on veut trouver place dans le monde des affaires. Nous sommes à la saison des pluies et ce sont des trombes d’eau qui s’abattent sur la ville. En dehors de son métier de professeure, Ling doit s’occuper pas tellement d’un mari qui semble très distant et brille souvent par son absence, mais surtout de son beau-père, homme âgé, infirme, qu’il faut soigner comme on soignerait un bébé, en le nourrissant, le lavant, le langeant, etc.
Or c’est précisément la raison première de la souffrance de Ling que le manque d’un véritable bébé. Cela fait huit ans qu’elle désire avoir un enfant, mais en vain. Même les moyens de la médecine n’ont donné aucun résultat. Cette stérilité, c’est sans doute aussi l’une des causes pour lesquelles son mari s’est éloigné d’elle. Anthony Chen filme la douleur de cette femme avec une extrême délicatesse, sans jamais céder au pathétique. Il lui suffit de faire entendre quelques sanglots, de la filmer de dos pendant qu’elle pleure ou de montrer, juste un instant, ses yeux baignés de larmes reflétés par le miroir intérieur d’une voiture. Rien de plus, et cela suffit pour qu’on comprenne le chagrin de Ling.
Sa vie sans attrait se trouve cependant bouleversée, petit à petit, par l’intérêt grandissant que lui porte un de ses élèves, le seul qui semble avoir à cœur d’apprendre le chinois. Ling se fait un devoir de l’encourager en lui donnant des cours de rattrapage. Entre la professeure et l’élève se noue, dès lors, une relation ambivalente. Sur ce terrain-là aussi, celui des désirs interdits qui s’accompagnent d’un goût de vivre recouvré, Anthony Chen fait preuve de savoir-faire. Comme il l’explique lui-même, il fait le choix de se tenir, le plus souvent, un peu en retrait, ce qui est la meilleure manière d’éviter le sentimentalisme tout en préservant de la place pour les regards des spectateurs. L’une de ses inspirations, ajoute-t-il, provient des tableaux du peintre danois Vilhelm Hammershøi, artiste ayant réalisé beaucoup de portraits de femmes, souvent vues de dos. Ce qui n’empêche nullement l’émotion de naître, bien au contraire. Comme on peut le vérifier en allant voir ce film de toute beauté.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
P. S. : À la séance à laquelle j’ai assisté, le réalisateur en personne était présent, tout heureux de partager aux spectateurs présents son émotion. Wet Season est son deuxième film. Le précédent, Ilo Ilo, était sorti sur les écrans en 2013. « J’espère que je n’aurai pas à attendre aussi longtemps avant de réaliser le troisième », nous a-t-il dit. Je le souhaite de tout cœur également.
20200111 – Livre / Musique
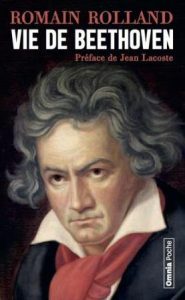
VIE DE BEETHOVEN
Un livre de Romain Rolland.
« Ludwig van Beethoven naquit le 16 décembre 1770 à Bonn, près de Cologne, dans une misérable soupente d’une pauvre maison », écrit Romain Rolland. Dès sa venue au monde, semble peser sur celui qui, avec Mozart, est devenu le compositeur le plus célèbre de tous les temps, comme une chape de désolation qui ne l’a quasiment jamais quitté. En cette année, où nous commémorons le 250ème anniversaire de sa naissance, découvrons, redécouvrons ce génie de la musique dont nous ne connaissons peut-être que les compositions les plus célèbres. Mais, pour peu que nous soyons suffisamment curieux, nous ne finirons jamais ni de sonder l’âme de cet homme ni de nous émerveiller des œuvres qu’il nous a léguées.
Pour ce faire, pour renouveler notre écoute, éduquer notre oreille, ouvrir notre cœur, il peut être très profitable d’en savoir davantage sur la vie du compositeur ou, au moins, d’en avoir un aperçu. Ce n’est pas le cas de tous les musiciens, mais Beethoven (tout comme Robert Schumann, par exemple) fait partie de ceux dont les œuvres et la vie sont étroitement intriquées. Ni les articles ni les ouvrages ne manquent, bien évidemment, mais il en est beaucoup de très savants qui ne sont à la portée que des musicologues accomplis. Il existe aussi, fort heureusement, des livres plus simples, plus accessibles au grand public, et qui s’avèrent bien suffisants pour une première approche. Parmi ceux-ci, l’on peut distinguer l’opuscule qu’écrivit Romain Rolland en 1903, opuscule qui fut édité par Charles Péguy dans ses Cahiers de la Quinzaine et qui, à la surprise et de l’auteur et de l’éditeur, connut un important succès. Il vient d’être opportunément réédité par les éditions Bartillat.
Il faut croire que le petit ouvrage répondait à une attente, à un appétit de connaissances, à une curiosité très saine. Romain Rolland avait imaginé cette Vie de Beethoven comme le premier volet d’une série d’ouvrages consacrés aux hommes illustres. Il voulait, ce faisant, proposer des exemples d’héroïcité. Mais attention, il ne s’agissait pas de n’importe quelle héroïcité : « Je n’appelle pas héros, écrivait-il dans sa préface de 1903, ceux qui ont triomphé par la pensée ou par la force. J’appelle héros seuls, ceux qui furent grands par le cœur. » Rolland conçoit ce livre comme une sorte d’antidote au nietzschéisme qui remportait alors un franc succès. Il s’agissait, en vérité, d’un nietzschéisme assez caricatural, mais peu importe. Pour Romain Rolland, la grandeur de Beethoven s’oppose radicalement au nihilisme « surhumain », puisqu’elle se traduit, comme l’explique très bien Jean Lacoste dans sa passionnante préface, par « une expérience positive, créatrice, celle de la Joie. »
Voilà ce qui fait de Beethoven un héros ! Pourtant sa vie, telle que la raconte Romain Rolland, n’est qu’une suite de déboires, d’épreuves, de souffrances, presque ininterrompue. Dès sa jeunesse, à Bonn, ville dont il gardera cependant toujours un précieux souvenir (tout comme il préférera toujours le Rhin au Danube), il doit subir l’emprise d’un père ivrogne qui ne cherche qu’à exploiter ses dispositions musicales. À cela s’ajoute le décès de sa mère en 1787. Mais, bien sûr, c’est à Vienne qu’il se fixe dès 1792, ville qu’il ne quitte plus, même si, comme ce fut le cas pour bien d’autres compositeurs, la capitale autrichienne se montre très ingrate à son égard.
Dès ce moment-là, entre 1796 et 1800, la surdité commence ses ravages. Une telle infirmité est une épreuve terrible pour n’importe qui, elle complique considérablement la communication avec autrui, elle isole. Mais quand on est compositeur ! Dans une lettre à Wegeler, un de ses amis, Beethoven s’exprime à ce sujet : « … Je mène une vie misérable. Depuis deux ans, j’évite toutes les sociétés, parce qu’il ne m’est pas possible de causer avec les gens ; je suis sourd. » Or la surdité, aussi redoutable soit-elle, n’est pas le seul motif d’affliction de Beethoven. Sur le plan sentimental, lui qui se fait une haute idée de l’amour, lui qui déteste les propos grivois, mais lui qui s’enflamme rapidement pour les personnes de sexe féminin qu’il rencontre, ne connaît que des déconvenues. Deux femmes sont particulièrement chères à son cœur : Giulietta Guicciardi qui, en fin de compte, préfère épouser un autre homme, ce qui provoque une profonde crise de désespoir chez Beethoven, au point qu’il est tenté par le suicide ; et Thérèse de Brunswick, avec qui il se fiance en 1806, mais avec qui, pour des raisons qui demeurent mystérieuses, le mariage s’avère impossible.
D’autres adversités encore accablent Beethoven : son neveu, pour qui il se dévoue sans compter, mais qui se montre très indigne d’une telle confiance ; et d’incessants soucis d’argent car, même s’il y a une période de sa vie où il est aidé par de riches mécènes, le compositeur n’est jamais rémunéré à sa juste valeur. Même la 9ème symphonie, qui remporte, dès sa création, un franc succès, ne lui rapporte rien sur le plan pécunier.
Venons-en justement, pour finir, à cette fameuse symphonie et à son Hymne à la Joie, jaillissement inattendu de voix chantant le poème de Schiller. Personne encore n’avait eu cette audace de faire intervenir des voix solistes et un chœur au terme d’une œuvre symphonique. Beethoven, lui, y songe depuis longtemps avant de s’y résoudre enfin. Tout l’opuscule de Romain Rolland culmine dans cet événement sur lequel l’écrivain s’étend longuement. Car elle est là, l’héroïcité de Beethoven : du fond d’un abîme de tristesse, parvenir à célébrer la Joie. Pas n’importe quelle Joie, qui plus est : comme le fait, très justement, remarquer Romain Rolland, il y a un silence juste avant l’apparition du thème de la Joie dans la symphonie, comme pour signifier que la Joie descend du ciel. Elle est un cadeau offert à une humanité souffrante : « Toute une humanité frémissante, écrit Romain Rolland, tend les bras au ciel, pousse des clameurs puissantes, s’élance vers la Joie, et l’étreint sur son cœur. » La grandeur, l’une des grandeurs en tout cas, de Beethoven, c’est d’avoir puisé au tréfonds de son cœur ce trésor insoupçonné, imprévu. « Un malheureux, écrit Romain Rolland, pauvre, infirme, solitaire, la douleur faite homme, à qui le monde refuse la joie, crée la Joie lui-même pour la donner au monde. » Comment mieux dire les choses et comment mieux inviter à découvrir ou redécouvrir l’homme Beethoven et ses œuvres ?
Luc Schweitzer, ss.cc.
20200106 – Cinéma
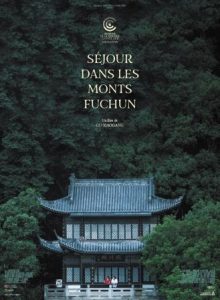
SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN
Un film de Gu Xiaogang.
Comme le faisait remarquer, ces jours-ci, sur son blog, le critique de cinéma Pierre Murat, 2019 fut marqué, entre autres, par l’excellence des films venus de Chine jusqu’à nos grands écrans. La qualité indéniable de la production cinématographique de ce pays se confirme brillamment, dès le début de 2020, avec la sortie de Séjour dans les monts Fuchun, d’ailleurs présenté comme le premier volet d’une trilogie qui promet, d’ores et déjà, d’être passionnante.
Malgré la censure toujours en vigueur du côté de Pékin, les cinéastes chinois font preuve d’une habileté des plus remarquables pour donner à voir les réalités complexes, parfois antinomiques, de leur pays. Nouveau venu dans le 7ème art, Gu Xiaogang non seulement n’échappe pas à cette règle mais l’affine au point qu’on a le sentiment d’avoir affaire à un cinéaste chevronné. Or il s’agit bel et bien de son premier film ! Voilà qui est pour le moins prometteur.
Le titre se réfère à un rouleau peint au XIVème siècle par un ermite qui s’était retiré dans cette région des monts Fuchun. De nos jours, la belle vallée désertique de jadis s’est transformée en un centre urbain en pleine mutation. La ville, certes encore entourée d’îlots de verdure, se renouvelle de fond en comble : des immeubles, des quartiers entiers, sont en cours de destruction tandis que d’autres s’érigent. Quantité de projets immobiliers émergent, avec une nouvelle ligne de métro. Seul le fleuve Fuchun, qui traverse la métropole, semble avoir échappé au cours du temps. Mais ce n’est qu’apparence car ce fleuve, réputé autrefois pour l’abondance de ses poissons, a été si malmené par les pollueurs ou par des systèmes de pêche inconsidérés qu’on ne peut plus guère y attraper de quoi sustenter grand monde.
Cette réalité, Gu Xiaogang la montre tout en s’attachant à suivre les différents membres d’une des familles qui y résident. La scène d’ouverture nous les présente rassemblés à l’occasion de l’anniversaire de l’aïeule du clan. La fête est joyeuse mais s’interrompt brutalement lorsque cette dernière, peut-être sous le coup de l’émotion, doit être transportée à l’hôpital du fait d’une attaque cardiaque. Quoi qu’il en soit, nous avons pu apercevoir celles et ceux dont le cinéaste s’attache ensuite à évoquer les parcours. Ils sont à l’image de leur ville, marqués par le passé et les traditions tout en étant fortement confrontés au monde moderne, à ses tentations et aux changements de mentalité qui surgissent inévitablement.
Les quatre fils de l’aïeule dont on célébrait les 70 ans au début du film sont tous confrontés à des difficultés et contraints à prendre d’importantes décisions. Aucun ne roule sur l’or. L’aîné, qui tient un restaurant, se décide, malgré les réticences de son épouse, à prendre chez lui sa mère qui perd de plus en plus la mémoire, lorsqu’elle sort de l’hôpital. Un autre fils, pêcheur, est obligé de trouver refuge jour et nuit sur son bateau, avec sa femme, depuis que l’immeuble dans lequel il résidait a été détruit. Un autre essaie de s’en sortir financièrement en organisant des jeux clandestins, tout en ayant la charge d’un fils trisomique. Tous sont dépeints par le cinéaste avec bienveillance, malgré leurs défauts petits ou grands, ce qui les rend, à nos yeux de spectateurs, très attachants. Mais celle qui émeut le plus, avec le jeune trisomique, c’est Gu Xi, la fille du restaurateur. Le garçon avec qui elle veut se marier, un enseignant sans le sou, ne convient pas à sa mère qui, comme la jeune fille s’obstine, va jusqu’à la rejeter impitoyablement. En un long travelling, saisissant de technicité mais surtout de beauté, une pure merveille de cinéma, le réalisateur avait pris soin de nous montrer la naissance de cet amour : cela se passait au cours d’une promenade au bord du fleuve. Le garçon avait parié qu’il ferait une longue partie du trajet en nageant, tandis que son amie le suivrait sur la rive. Il s’exécute et tous deux se retrouvent une fois l’exploit réalisé, reprenant leur marche ensemble jusqu’à un navire. La caméra ne les quitte pas un seul instant : c’est une scène belle à tomber !
Arrivés au bout de ce superbe film, qui dure 2 heures 30, c’est à regret que nous en quittons les personnages, mais déjà heureux à l’idée de les retrouver quand sortira le deuxième volet de la trilogie.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.