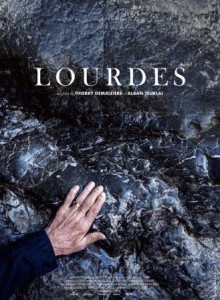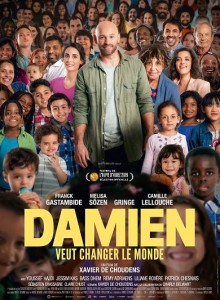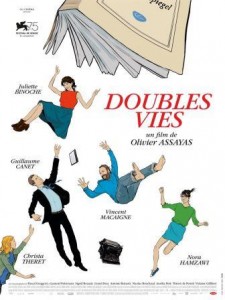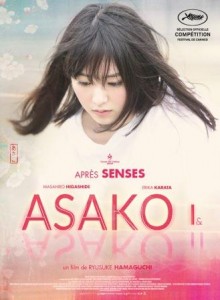Le blog du Père Luc – Films, livres, musiques, etc.
[où il est question de films, de livres, de musiques, etc. par un religieux de la Congrégation des Sacrés-Coeurs (Picpucien)]
=> http://lucschweitzer.over-blog.com/
20191213 – Cinéma
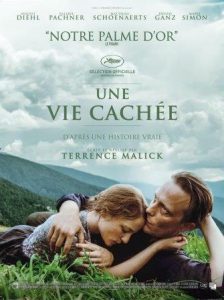
UNE VIE CACHÉE
Un film de Terrence Malick.
Ils ne furent pas nombreux, ceux qui, en Allemagne comme en Autriche, eurent l’audace de dire non, d’une manière ou d’une autre, à Hitler et au nazisme. Oser faire cela, il est vrai, c’était, fatalement, le payer de sa vie. En Allemagne, du côté de Munich, il y eut Sophie Scholl, son frère Hans et leurs autres compagnons de la Rose Blanche. En Autriche, il y eut le parcours exemplaire de Franz Jägerstätter, un paysan du village de Sainte Radegonde qui fut guillotiné le 9 août 1943 à la prison de Brandebourg à Berlin. Il faut observer que celles et ceux qui s’opposèrent à Hitler le firent toutes et tous au nom de leur foi chrétienne. Franz Jägerstätter a d’ailleurs été béatifié le 26 octobre 2007 à la cathédrale de Linz.
C’est donc de cet homme-là que Terrence Malick a choisi de raviver le souvenir. Après sa série de films plus ou moins expérimentaux conçus à la manière de poèmes, de méditations, voire de prières, films sublimes mais qui pouvaient déconcerter certains spectateurs, le réalisateur de The Tree of Life renoue avec une narration beaucoup plus classique, mais sans se délester pour autant de son style, reconnaissable entre tous. On retrouve donc, dans Une Vie cachée, le goût du cinéaste pour les voix off, sa propension à filmer la nature, ainsi que de nombreux gros plans sur les acteurs qui semblent presque filmés avec une focale trop courte (mais c’est, évidemment, un effet voulu), etc.
Le début est on ne peut plus caractéristique. Comme dans la plupart de ses films, Malick commence par filmer la nature d’une manière quasi édénique. En quelques plans, nous sommes conviés à goûter la vie à la montagne du fermier Franz Jägerstätter (August Diehl), de sa femme Fani (Valerie Pachner) et, bientôt, de leurs trois filles, ainsi que de quelques autres personnages, dont la belle-sœur de Franz qui est venue vivre avec eux. La vie de paysan est rude, certes, mais, au départ, tout est filmé dans une sorte d’innocence première, comme s’il fallait ainsi souligner d’autant plus, par contraste, l’irruption du mal absolu, qui ne tarde pas à paraître.
Nous en avions déjà été averti, il est vrai, dès l’ouverture, par des films d’archives montrant avec quel empressement de nombreux Autrichiens accueillirent l’hitlérisme. On pouvait espérer, néanmoins, que le petit village de Sainte Radegonde resterait préservé de cette folie. Il n’en est rien. Personne ne peut se targuer ni d’être neutre ni d’être indifférent. Franz, lui, ne tergiverse pas. Il fait d’abord ses classes, puis, de retour chez lui, ne peut ignorer qu’on va exiger de lui, comme de tout homme en âge de combattre, un serment d’allégeance au Führer. Mais, au nom de sa foi comme de son humanité, il lui est impossible de se résoudre à un tel engagement. Dans son village, il se fait aussitôt remarquer et ostraciser. Quand des nazis passent par là pour réclamer à chaque habitant sa contribution à l’effort de guerre, il est le seul à refuser.
Dès lors, sa détermination est telle que rien ne peut l’en détourner. C’est bien l’itinéraire d’un martyr que filme Malick, il n’y a pas de doute, mais sans ostentation, sans prêchi-prêcha, comme certains se plaisent à le reprocher au cinéaste, à la sortie de chacun de ses films, de manière totalement fallacieuse. Au contraire, il y a dans cet homme, tel qu’il est ici filmé, une sorte d’évidence ou de simplicité, comme si la sainteté allait de soi. Pour le détourner de sa voie, certains reprochent à Jägerstätter son orgueil, alors que c’est son humilité qui, au contraire, nous interpelle. Plusieurs interlocuteurs interviennent pour le faire changer d’avis, y compris l’évêque du lieu qui se réfère à saint Paul affirmant qu’il faut se soumettre aux autorités. Le maire du village, lui, affirme à Franz qu’il est plus coupable que les ennemis du pays, puisqu’il agit comme un traître. Plus tard, quand il est emprisonné, il est sournoisement invité à signer son acte d’allégeance à Hitler, quel que soit son sentiment profond, même si celui-ci est contraire à la déclaration écrite. On ne lui demande pas d’aimer le Führer, mais de parapher un document. « Ce n’est qu’un bout de papier, lui dit-on. En ton for interne, tu peux penser ce que tu veux. »
Mais Jägerstätter ne peut se résoudre à cette hypocrisie. Terrence Malick film l’obstination d’un homme dont la droiture morale est sans faille et qu’aucun raisonnement, aucune intimidation, aucune torture ne font plier. En cet homme, tout comme d’ailleurs en sa femme Fani, il y a une bonté qui semble naturelle et qui se traduit, entre autres, par une absence de jugement d’autrui. Même ses bourreaux, Franz ne les juge pas. Le cinéaste réussit le tour de force de filmer la bonté sans maniérisme, sans mièvrerie d’aucune sorte. Car la force de l’accusé, ce qui lui permet de tenir jusqu’au bout, jusqu’au don de sa vie, cette force, il la puise dans sa foi chrétienne, sans nul doute, mais aussi, c’est évident, dans l’amour qui l’unit à Fani. Leurs échanges épistolaires, superbes, interviennent en voix off, à plusieurs reprises au cours du film. Malgré les épreuves, le mépris des villageois, la séparation du couple, la dureté des travaux de ferme en l’absence de Franz, malgré l’issue fatale qui se profile, l’amour ne faiblit pas. Ceux qui affirment à Franz que son sacrifice ne sert à rien, qu’il ne modifiera en rien le cours de l’histoire, qu’il ne sera connu de personne, qu’il n’aura d’autre effet que de faire du mal à ses proches, ceux-là ne savent rien de la grandeur de l’amour. « L’amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L’amour ne passera jamais… », écrit saint Paul dans sa Première Lettre aux Corinthiens (13, 7-8). Les bourreaux de Jägerstätter avaient tout prévu, sauf cela. Une phrase de George Eliot, tirée du roman Middlemarch, phrase projetée sur l’écran à la fin du film, le dit aussi à sa manière et l’éclaire de sa douce lumière : « Si les choses ne vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu’elles eussent pu aller, remercions-en pour une grande part ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée ».
10/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20191208 – Cinéma

IT MUST BE HEAVEN
Un film de Elia Suleiman.
Vers la fin de ce film, alors qu’il est à New York, Elia Suleiman se retrouve, chez un producteur, en compagnie de l’acteur et réalisateur mexicain Gael Garcia Bernal. Après s’être entretenu au téléphone avec un interlocuteur de son projet de film, dont il est à peu près sûr qu’il n’aboutira pas, car on veut lui faire tourner en anglais un film sur les conquistadors, ce que bien sûr il refuse, ce dernier fait au producteur la présentation de son compagnon : « C’est un réalisateur palestinien », dit-il. Et il ajoute aussitôt : « Mais ses films sont drôles ». Cette seule réplique résume à peu près tout. Elia Suleiman, à la grande surprise de tous ceux à qui il propose ses projets de films, préfère la légèreté et le burlesque au drame ou à la tragédie. Du coup, on lui répond que certes ses scénarios sont intéressants, mais qu’ils ne sont décidément pas assez « palestiniens » !
Pour notre plus grand bonheur, en effet, Elia Suleiman désamorce tous les clichés. Quand il filme des personnages inquiétants, c’est en fin de compte, toujours, pour se diriger vers une pirouette ou une situation cocasse qui fait sourire. Dans ce film, sans doute son meilleur à ce jour, il se met donc lui-même en scène sous l’apparence d’une sorte de pierrot lunaire qui serait presque totalement mutique. Malgré de notables différences, cela rappelle monsieur Hulot, le personnage qu’interprétait si bien Jacques Tati et qui n’avait pas son pareil pour dénicher les petites drôleries de la vie. Elia Suleiman est du même acabit : il observe d’un œil amusé tout ce qui se déroule autour de lui pour en faire la substance de ses films.
Et cela fonctionne à merveille. Qu’il soit chez lui, à Nazareth, ou à la recherche d’un producteur à Paris, puis à New York, partout, il se délecte de « l’humaine comédie » : c’est le nom si bien trouvé d’une librairie parisienne, apparaissant, lors d’une des scènes, à l’écran. Quel que soit le lieu, Elia Suleiman fait figure d’étranger, y compris à Nazareth où il a affaire à un voisin envahissant qui ne se gêne pas pour venir cueillir les fruits de son citronnier. Y a-t-il un endroit où un Palestinien peut se sentir chez lui ? C’est la question que pose le film et dont Elia Suleiman voudrait connaître la réponse. À New York, il va jusqu’à consulter un tireur de cartes pour savoir s’il y aura un jour réellement une Palestine…
En attendant, le cinéaste préfère sourire plutôt que pleurer et le moins qu’on puisse dire, c’est que son humour est communicatif. Plutôt que de faire un film ouvertement politique, ne vaut-il pas mieux observer les bizarreries et les absurdités de la vie d’un œil amusé ? Les policiers parisiens se déplaçant sur des rollers, les promeneurs du jardin du Luxembourg à la recherche d’une chaise où s’asseoir, un oiseau au comportement facétieux, une femme de ménage de New York nettoyant un écran sur lequel défilent des mannequins, une femme portant des ailes d’ange et portant le message « free Palestine » poursuivie par des policiers à Central Park, etc. Les situations cocasses s’enchaînent avec bonheur. Il y a même des tanks qui surgissent inopinément à Paris.
Elia Suleiman s’amuse à regarder tout cela sans jamais dire un mot. Il n’y a qu’une exception à cette règle. Arrivé à New York, tandis qu’il voyage en taxi, le chauffeur lui demande d’où il vient. « De Nazareth. En Palestine. », répond Elia Suleiman. Le taximan est si surpris qu’il s’arrête pile, offre la course à son passager et téléphone à sa femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Je transporte un Palestinien ! De Nazareth ! Nazareth, tu te rends compte ? Comme Jésus de Nazareth ! ». Il y a de quoi être surpris, en effet ! Sauf si, avec Elia Suleiman, on considère que le monde entier ressemble, d’une certaine façon, à la Palestine !
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20191122 – Cinéma

LES ÉBLOUIS
Un film de Sarah Suco.
Les plaintes ou révélations compromettantes concernant des membres de l’Église, mais aussi, parfois, des communautés tout entières faisant partie de l’Église catholique ont été si nombreuses et si convaincantes depuis quelque temps que cette dernière a enfin entrepris non seulement d’examiner en profondeur son propre fonctionnement mais de le remettre en cause si nécessaire. Disons, pour être exact, que de timides réformes sont en cours, mais que bien du chemin reste encore à parcourir. Or cette trajectoire, dont on espère qu’elle aboutira à de grands changements structurels, est accompagnée, de temps à autre, par la sortie de films qui viennent à point nommé témoigner à leur façon des dégâts commis sur des personnes vulnérables du fait de dérives inquiétantes, provenant d’individus ou de groupes, au sein de communautés catholiques. Il y a quelques mois, nous avions grandement apprécié Grâce à Dieu, le remarquable film de François Ozon. Aujourd’hui, avec Les Éblouis, la réalisatrice du film, Sarah Suco, entreprend de raconter des éléments de sa propre histoire au temps de sa prime adolescence dans une communauté de mouvance charismatique.
De ce fait, même les quelques scènes qui pourraient paraître excessives s’intègrent parfaitement dans un récit tout à fait cohérent que la cinéaste a soigneusement évité de rendre trop tendancieux. Ce n’est pas un film à charge, mais bien plutôt une œuvre dont le but est d’inviter à la vigilance : comment faire pour que des communautés comme celle dont il est ici question soient rapidement mises dans l’incapacité de nuire ? Ce qu’on voit à l’écran est assez ahurissant, sans nul doute, mais, très certainement, véridique. Car, malheureusement, il est avéré que des communautés de cette sorte, qu’on appelait, dans les années 70 et 80, communautés nouvelles, et qu’on présentait volontiers comme des modèles de la nouvelle évangélisation, il est avéré qu’elles ont pu prospérer, bien souvent nanties de la bénédiction des plus hautes autorités de l’Église. Or de nombreux témoignages nous obligent aujourd’hui à regarder la réalité dans toute sa laideur : beaucoup de ces communautés nouvelles ont été le théâtre de dérives sectaires, leurs membres et, bien souvent, leur fondateur ou leur guide se livrant à des abus de pouvoir, si ce n’est à des abus d’ordre sexuel.
Dans le film, c’est toute une famille, à commencer par la mère (Camille Cottin), qui se laisse séduire par une communauté à tendance charismatique et son berger (Jean-Pierre Darroussin). Au début, comme toujours dans ce genre d’histoire, tout paraît irrésistiblement attirant : les membres de la communauté semblent toujours joyeux, ils partagent tout, ils aident les pauvres, etc. Un petit monde idéal, en somme, pour une mère de famille quelque peu fragile, comme celle dont il est question dans le film. Elle n’a pas trop de peine à y entraîner son mari (Éric Caravaca), un brave homme qui se laisse persuader que cette vie nouvelle sera bénéfique pour les siens et pour lui. Quant aux quatre enfants, ils n’ont pas le choix, il faut bien qu’ils suivent leurs parents. Mais c’est une fois qu’ils sont admis dans la communauté que commencent les insinuations et les contraintes, le plus souvent, d’ailleurs, en sauvegardant une apparence de bienveillance. Camille (formidable Céleste Brunnquell), l’aînée des enfants, une adolescente de treize ans, est invitée à ne plus participer à l’école de cirque où elle était pourtant si fière d’exercer ses talents. Mais cette activité (qui implique le corps, bien évidemment) déplaît au berger qui y décèle quelque chose de malsain, voire de diabolique. Car la grande affaire, quand on fait partie de la communauté, c’est de débusquer le diable. Pour ce faire, il faut changer de vie. Cela va même jusqu’à porter une tenue réglementaire (que Camille, quand elle va au collège, remplace par un jean qu’elle a caché dans une armoire électrique désaffectée).
S’il ne s’agissait que de petites brimades de cette sorte, ce serait peut-être supportable. Mais c’est un véritable système, fermé sur lui-même, qui se met en place insidieusement et qui oblige à se couper d’autrui, y compris de sa propre famille. Le berger est obligé de tolérer que les enfants soient scolarisés, mais c’est pour mieux exercer son emprise lorsque ceux-ci sont de retour. L’ascendant est tel que c’en est parfois effarant et comique en même temps : ainsi quand les membres de la communauté se mettent à bêler comme des brebis pour appeler leur berger. Mais le pire advient lorsque ce dernier estime qu’il faut chasser le diable à coup d’exorcismes en « priant sur » la personne soupçonnée de s’adonner au mal. On ne prie pas pour quelqu’un, chez ces gens-là, mais sur quelqu’un, ce qui indique à quel point s’exerce un système de domination. Quant aux prières d’exorcisme, sur lesquelles la réalisatrice se garde judicieusement de s’attarder, elles suffisent à indiquer combien ces procédés sont illusoires. Avec de telles méthodes, on peut faire « remonter » du passé ce qu’on veut et, en particulier, des affabulations. Pourtant le mal radical, celui qui s’en prend aux enfants, est présent, au sein de la communauté, et il n’est pas nécessaire de le chercher dans le passé en se livrant à de sinistres et fallacieuses prières d’exorcisme. C’est Camille qui le débusque avec horreur et qui, ne pouvant réussir à convaincre sa mère, décide courageusement de protéger ses frères et sa sœur en les éloignant du péril.
En vérité, comme elle l’explique dans une interview donnée au Parisien, Sarah Suco, la réalisatrice, a passé dix années de sa vie, de 8 à 18 ans, dans une communauté de cette sorte, jusqu’à ce qu’elle décide de s’enfuir de ce lieu. Quant à son film, elle a attendu bien des années pour le réaliser, préférant sagement laisser d’abord sa colère s’apaiser. Elle explique aussi que ce qu’elle a choisi d’y montrer ne représente que 5% de la réalité de ce qu’elle a vécu. Elle n’a pas voulu faire un film d’horreur mais témoigner posément et mettre ainsi en vigilance, car des communautés comme celle qui apparaît dans le film, il en existe malheureusement encore. Quoi qu’il en soit, le film est une grande réussite et on ne peut le voir sans être remué aux entrailles.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20191106 – Cinéma
Ma critique de « J’accuse » de Roman Polanski. Les accusations dont fait l’objet le réalisateur sont l’affaire de la justice dont on peut que souhaiter qu’elle puisse un jour se prononcer. Pour ce qui concerne le film, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une oeuvre magistrale.

J’ACCUSE
Un film de Roman Polanski.
Le sujet de l’affaire Dreyfus n’avait curieusement été évoqué jusqu’à présent que dans un nombre restreint de films. Il en est question, par exemple, dans La Vie d’Émile Zola (1937) de William Dieterle. Il y eut aussi un téléfilm d’Yves Boisset en 1995. Pas grand-chose d’autre, si ce n’est, tout de même, un court-métrage de Georges Méliès qui, en 1899, se prononçait clairement et courageusement en faveur du capitaine injustement condamné. Un tel sujet ne pouvait pas manquer cependant, un jour ou l’autre, de faire l’objet d’un grand film et c’est, sans aucun doute, le cas aujourd’hui.
Roman Polanski ne se contente d’ailleurs pas de reconstituer méticuleusement quelques grands moments de l’affaire en question, avec un souci des moindres détails qui force l’admiration, mais il opte pour un point de vue qui n’a rien d’anodin, puisque c’est celui de l’homme à cause de qui (ou grâce à qui) il y eut, à proprement parler, une affaire Dreyfus. Sans cet homme-là, sans le colonel Marie-Georges Picquart, magistralement incarné à l’écran par Jean Dujardin, il est fort probable que l’injuste condamnation du capitaine Dreyfus (interprété par Louis Garrel) n’aurait pas eu de retentissement autre qu’éphémère et n’aurait pas provoqué de scandale.
Ce point de vue est d’autant moins banal que cet homme n’est pas dénué, loin s’en faut, des préjugés de son temps, allant jusqu’à professer, quand l’occasion s’y prête, des convictions antisémites. Or c’est ce même individu qui, promu chef de la section de statistiques du renseignement militaire, acquiert, en examinant un certain nombre de documents, la certitude que le capitaine Dreyfus est innocent du crime de haute trahison pour lequel il a été condamné et déporté sur l’île du Diable (où l’on va jusqu’à lui mettre les fers aux pieds, alors qu’il est impossible de s’évader d’un tel lieu). De plus, non seulement Picquart peut prouver l’innocence de Dreyfus, mais il débusque le véritable coupable en la personne du commandant Esterhazy.
Les preuves sont largement suffisantes, mais elles embarrassent l’État-Major, autrement dit les hauts gradés qui n’ont pour seul souci que de protéger l’institution dont ils sont les représentants. Une telle préoccupation est d’ailleurs partagée par la plupart des militaires, pour qui seule compte l’obéissance aux supérieurs, même si c’est au prix d’une injustice et d’un mensonge. C’est le cas, en particulier, du commandant Henry (Grégory Gadebois) qui apparaît, à l’écran, comme l’exact opposé de Picquart. Pour l’un, seuls comptent l’obéissance aux ordres et la protection de l’institution, alors que pour l’autre, c’est la recherche de la vérité qui l’emporte sur toute autre considération. Dans cette perspective, même si Picquart reste encombré de préjugés antisémites, malheureusement partagés par beaucoup de ses contemporains, il s’impose comme une figure exemplaire. Bientôt rejoint dans son combat par plusieurs personnalités, dont Georges Clémenceau et, bien sûr, Émile Zola, il n’a de cesse, même au risque de sa propre sécurité, de faire éclater la vérité au grand jour.
Les sinistres cris de haine antisémite que la foule, rassemblée le jour de la dégradation militaire de Dreyfus, éructait éhontément n’ont malheureusement pas fini de se faire entendre. Des enragés de même espèce vandalisent des magasins et brûlent les livres de Zola après qu’il ait fait paraître son fameux article dans L’Aurore. Néanmoins, sans qu’il soit nécessaire de parler d’héroïcité, ce qu’évite le film de Polanski, on ne peut qu’être impressionné par la conscience morale d’un homme comme Picquart, tout comme on ne peut qu’être choqué par la malhonnêteté des chefs militaires. Le petit monde étriqué, sale, empuanti, que découvre Picquart quand il est nommé aux renseignements militaires en dit long sur l’état de délabrement, physique et moral, d’une certaine France de ce temps-là. Roman Polanski a parfaitement réussi à le recréer, tout comme il nous interpelle, qui que nous soyons et quelle que soit l’institution dont nous sommes les membres. Quelle est notre préoccupation première ? La sauvegarde de l’institution, quel que soit le prix à payer ? Ou la passion de la vérité, même quand elle fait vaciller l’institution ?
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20191106 – Cinéma

J’AI PERDU MON CORPS
Un film de Jérémy Clapin.
Le thème de la main coupée n’a rien d’inédit. Gérard de Nerval en avait fait le sujet d’une nouvelle (La Main enchantée) qui fut adaptée au cinéma par Maurice Tourneur en 1943 sous le titre de La Main du Diable. Il y eut aussi Les Mains d’Orlac, roman mi-policier mi-fantastique écrit par Maurice Renard et adapté quatre fois au cinéma. Or le film d’animation de Jérémy Clapin, film déjà acclamé à Cannes où il a reçu le Grand Prix de la Semaine de la Critique ainsi qu’à Annecy où lui ont été décernés deux Prix, ce film donc renouvelle l’approche du thème en question. Sans lui enlever son caractère fantasmagorique (difficile de faire autrement quand on met en scène une main coupée en mouvement), le cinéaste insiste sur un autre aspect, celui de la quête, de la recherche irrépressible de ce qui manque, autrement dit le corps dont dépendait la main en question. Pas de magie comme chez Nerval ni d’affaire criminelle comme chez Maurice Renard, mais la nécessité impérieuse de retrouver le corps perdu.
De ce fait, dès le début du film, on est impressionné, car la main, symbole identitaire très fort, ne se contente pas d’agiter ses doigts, mais elle se met en mouvement, s’échappe du laboratoire où elle est conservée et entreprend un périple périlleux pour aller à la rencontre du corps dont elle a été retranchée. L’organe semble être doté d’une volonté propre, ce qui ne peut manquer de déconcerter mais qui, pourtant, s’impose rapidement comme une sorte d’évidence. De quoi est capable une main toute seule, coupée des autres membres ? J’allais dire qu’elle n’a qu’une chose en tête, ce qui est absurde pour une main, et pourtant la vérité est de cet ordre : c’est comme si elle avait une pensée propre ou, en tout cas, un désir, se traduisant par l’obsession de la quête du corps manquant, ce qui fait qu’elle prend tous les risques et affronte tous les dangers, entre autres ceux du métro où elle manque de se faire écrabouiller puis dévorer par des rats !
Mais le film ne se cantonne pas à nous faire haleter en suivant les déambulations de la main. Il nous raconte aussi, en parallèle, l’histoire de Naoufel et de Gabrielle. Le premier, quand il était un petit garçon, rêvait d’être à la fois pianiste et cosmonaute ! Les deux, oui ! Malheureusement, une fois devenu un jeune homme obligé de résider chez un oncle du fait du décès de ses parents, ses ambitions sont réduites à néant. Il n’a pour tout travail que de faire le livreur de pizzas. Or c’est précisément grâce à cet emploi qu’il fait la rencontre de Gabrielle. Une rencontre qui ne se concrétise que par étapes car, au départ, le garçon, arrivé très en retard à l’adresse de Gabrielle à qui il devait livrer une pizza, n’a droit à rien de plus qu’à la voix de cette dernière, par interphone interposée. Cela donne lieu à une scène assez longue qui est, sans doute, l’une des plus belles, des plus réussies, des plus émouvantes du film.
Le seul son de la voix de Gabrielle suffit à changer la vie de Naoufel. Il n’a dès lors qu’une obsession, qui est de faire la connaissance de la jeune fille. Sa quête lui donne l’occasion de trouver un nouvel emploi chez l’oncle de Gabrielle, un emploi dans la menuiserie, bien plus valorisant que celui de livreur de pizza. Quoi qu’il en soit, pour les deux jeunes gens, commence l’histoire de la quête de l’autre. On le comprend, dans ce film, il n’est question que de cela : la main recherche son corps manquant tout comme Naoufel et Gabrielle, malgré leurs déboires, se recherchent l’un l’autre. Comment ces histoires finissent par n’en faire qu’une seule, je ne le précise pas pour ne pas divulgacher, comme disent les Québécois.
Ce qui est sûr, c’est que ce film surprenant, audacieux, mérite amplement les Prix qui lui ont été décernés. Il s’encombre de peu de dialogues, mais est servi par la beauté des images, leur précision et leur poésie. Quant au thème, ne nous rejoint-il pas tous d’une manière ou d’une autre dans la mesure où nous recherchons, nous aussi, une part manquante dont nous avons besoin pour nous épanouir ?
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20191023 – Cinéma

SORRY WE MISSED YOU
Un film de Ken Loach.
À 83 ans, Ken Loach a encore de l’ardeur à revendre et il ne manque pas de combats à mener. Il n’est pas du genre à baisser les bras. Avec son complice scénariste Paul Laverty, il persiste, à juste titre, à dénoncer les dérives du système capitaliste et, en l’occurrence, avec ce nouveau film, de l’ubérisation de la société. Et, comme quasiment toujours, en ne faisant appel qu’à des acteurs non professionnels dont les rôles, du coup, ressemblent beaucoup à ce qu’ils sont dans la vie.
À Newcastle, Ricky et Abby croulent sous les dettes et se demandent s’ils pourront un jour avoir une vie meilleure, non seulement pour eux-mêmes mais pour leurs deux enfants, Seb et Liza. Abby a beau avoir un travail stable en tant qu’aide à domicile, son petit salaire ne suffit pas pour les besoins de la famille. Quant à Ricky, il n’a réussi, jusqu’à présent, qu’à passer d’un job mal payé à un autre. Mais un avenir plus heureux se profile, c’est en tout cas ce qu’il imagine, le jour où il se propose de devenir chauffeur livreur à son compte tout en travaillant pour une plateforme numérique. Or ce travail nécessitant l’achat d’une camionnette, il faut que Abby accepte de vendre son seul bien, sa voiture, et que, dorénavant, elle fasse ses trajets au moyen des bus. Elle se résigne, en ne songeant qu’au mieux-être de sa famille.
Dès lors, c’est une sorte d’engrenage du malheur qui se met en branle. Toutes les perspectives d’amélioration envisagées par Ricky s’effondrent les unes après les autres. Le travail de chauffeur livreur se révèle des plus précaires et des plus harassants. C’est comme si on y était à la merci d’une machine dictant ses ordres. Il y a bien un contremaitre, mais lui-même n’est qu’un rouage d’un système qui le dépasse : il en est lui-même une victime tout en se croyant tenu de se conduire comme un bourreau envers les employés. Du coup, du fait de conditions de travail astreignantes, Ricky n’a presque plus de temps à consacrer à sa famille. De son objectif initial, qui était d’apporter du mieux-être à ses proches, il ne reste rien. Pire encore, puisque Abby, obligée de faire ses déplacements en transports en commun, se fatigue, elle aussi, beaucoup plus qu’avant. Quant aux deux enfants, livrés à eux-mêmes, c’est peu de dire qu’ils ne vont pas bien. Seb, en particulier, déserte de plus en plus l’école, préférant se livrer à sa passion pour les tags. Un couple, qui ne songeait qu’à assurer sa subsistance et celle de ses enfants, s’est engagé dans un processus qui les broie.
On dira peut-être qu’il n’y rien de très nouveau, que c’est du pur Ken Loach et c’est vrai. Mais on peut aussi et surtout être reconnaissant à ce dernier. Parmi tous les cinéastes d’aujourd’hui, il reste l’un de ceux qui met le mieux en évidence les faillites de la machine capitaliste qui ne s’encombre pas de sentiments lorsqu’elle écrase ceux qu’elle utilise à ses fins de rentabilité. Et peut-être aussi que, grâce à Ken Loach, nous ne regarderons plus du même œil le livreur nous apportant à domicile le produit que nous avons commandé sur internet !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20191007 – Cinéma
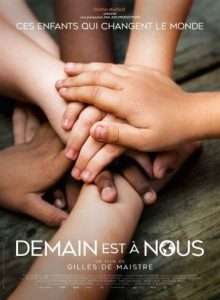
DEMAIN EST À NOUS
Un film de Gilles de Maistre.
Haro sur Greta Thunberg ! Tel semblait être le mot d’ordre des éditorialistes de la télévision et d’un bon nombre d’intervenants et de spécialistes de tout poil, ces derniers temps, tous unis dans une même antipathie envers la jeune militante suédoise. Il n’y avait pas de qualificatifs assez méprisants, voire assez vindicatifs, pour désigner l’adolescente ayant osé prendre son bâton de pèlerin pour interpeller les grands de ce monde, pour leur rappeler leurs devoirs et leurs engagements pour la sauvegarde de la planète. Les intellectuels eux-mêmes (ou soi-disant tels) y sont allés de leurs couplets anti-Thunberg ! Quel spectacle pitoyable que ces journalistes, que ces philosophes, que ces Onfray, Ferry, Bruckner et autres Finkielkraut crachant leur fiel sur une enfant ! En voulant la décrédibiliser, qu’ont-ils fait sinon de se discréditer eux-mêmes. En affirmant que c’est aux adultes qu’il convient de sauver le monde et non aux enfants, Luc Ferry a démontré l’étroitesse de sa pensée, rejoignant la cohorte des « penseurs » incapables de descendre de leur piédestal pour penser, ne serait-ce qu’un instant, à hauteur des petits de ce monde, voire à hauteur d’enfant !
Demain est à nous, le film de Gilles de Maistre, arrive à point nommé pour montrer qu’on a bien tort, quand on est adulte, de dénigrer les enfants. Non seulement on a tort, mais on serait bien avisé de les écouter, eux, et de suivre leur exemple, plutôt que de se laisser séduire par « les sages et les savants » ! Ils ont beau jeu, les Onfray, Ferry, Bruckner et autres Finkielkraut de déconsidérer les enfants. Quand la terre sera invivable, il est probable qu’ils ne seront plus de ce monde. Mais ce sont ceux qui, aujourd’hui, sont des enfants qui auront à subir les effets de nos inerties.
Or, ce qui est remarquable, c’est que, nonobstant toutes les raisons de baisser les bras, le film de Gilles de Maistre regorge d’espoir. Si tout n’est pas perdu, s’il y a des raisons de croire à une vie meilleure, ce n’est certes pas grâce aux philosophes, mais, n’en déplaise à Luc Ferry et consorts, grâce aux enfants ! Le réalisateur en a trouvé aux quatre coins de la planète, oui, des enfants qui, tout comme Greta Thunberg (qui apparaît très brièvement dans le film), prennent des engagements, trouvent des idées, les mettent en œuvre, pour la préservation de la planète et pour le bien d’autrui.
En France, à Cambrai, Arthur, 10 ans, récolte de l’argent grâce à la vente de ses peintures afin d’apporter du secours aux sans-abris de sa ville. En Inde, à New-Delhi, voici Heena qui a eu l’idée de créer un journal promouvant la scolarisation des enfants des rues obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. À Los Angeles, c’est Khloe, 11 ans, qui se bat pour le mieux-être des sans-abris. Au Pérou, à Arequipa, José Adolfo a eu l’idée géniale, dès l’âge de 7 ans, de créer une banque solidaire basée sur la récolte et le recyclage des déchets. En Afrique du Sud, Hunter est un garçon audacieux qui lutte pour la sauvegarde des rhinocéros menacés d’extinction à cause du braconnage. En Allemagne, voici Felix qui s’engage corps et âme pour le reboisement. En Guinée, c’est Hadja, une courageuse fillette de 12 ans qui ose s’opposer aux mariages forcés des jeunes filles mineures, coutume encore funestement fréquente dans son pays. En Bolivie, Peter, Jocelyn et Kevin se battent pour les droits des enfants obligés de travailler (parfois au fond des mines) malgré leur jeune âge.
Tels sont les enfants que Gilles de Maistre est allé rencontrer et filmer, illustrant de manière admirable, je trouve, l’encyclique Laudato Si du pape François. Et n’allons pas croire que la liste est exhaustive. Partout, des enfants osent prendre des engagements et les tenir, là où, souvent, les adultes sont beaucoup plus défaillants qu’eux. En les voyant, il me venait à l’esprit que Louis Aragon (et Jean Ferrat à sa suite, puisqu’il a mis cela en chanson) s’est fourvoyé lorsqu’il a affirmé que « la femme est l’avenir de l’homme ». Non, c’est l’enfant (quel que soit son sexe) qui est l’avenir de l’homme (ou, si l’on préfère, de l’humain) ! S’il y a quelque chose à sauver sur notre terre avant qu’il ne soit trop tard, cela viendra (cela vient !) de l’impulsion des enfants. Cela ne fait pour moi aucun doute.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190927 – Cinéma

AU NOM DE LA TERRE
Un film de Edouard Bergeon.
« D’après une histoire vraie », est-il indiqué au commencement du film. Elle est d’autant plus vraie, en effet, cette histoire, que, lorsque le film s’achève, une autre indication affichée sur l’écran nous révèle que le réalisateur a entrepris de raconter l’histoire de sa propre famille, la sienne, celle de sa mère et de sa sœur et, surtout, celle de son père. Celui-ci, nommé Pierre Jarjeau dans le film, porte les traits de Guillaume Canet et la première scène nous le montre, le crâne très dégarni et les traits fatigués, l’air d’être au bout du rouleau, tandis qu’il titube en parcourant un sillon d’un champ labouré.
Que s’est-il passé pour que cet homme soit dans un tel état ? C’est ce que le réalisateur se propose aussitôt de relater. Bien des années plus tôt, au début des années 70, Pierre s’en revient à la ferme familiale après avoir séjourné aux Etats-Unis dans un ranch du Wyoming. Il est beau, entreprenant, il retrouve Claire (Veerle Baetens), sa fiancée, et ne tarde pas à acheter l’exploitation à Jacques (Rufus), son père. Ce dernier, homme intraitable qui n’a que le mot « travail » à la bouche, ne lui fait pas de cadeau. Pierre devra lui verser des mensualités durant de longues années. Mais qu’à cela ne tienne ! Pierre est vigoureux, il ne rechigne pas à la peine, il ne doute pas de sa réussite.
Le film nous transporte alors vingt années plus tard, vingt années dont on peut supposer qu’elles ont été heureuses. Pierre et Claire ont eu deux enfants : Thomas (Anthony Bajon), déjà assez grand pour donner un sérieux coup de main à son père tout en espérant devenir ingénieur agronome, et Emma (Yona Kervern). Malheureusement, les années du bonheur sont passées et commence le temps de l’épreuve. Pierre est incité à se moderniser, à s’agrandir toujours plus et les dettes commencent à s’accumuler de façon inquiétante. Claire, qui s’occupe de la comptabilité, s’alarme. Malgré cela, Pierre se laisse convaincre de faire bâtir un nouveau hangar pour y installer un élevage de poulets. Ce qui veut dire, concrètement, davantage de dettes et davantage de travail. Et pas question de demander du secours à son père ! Pierre est trop fier et son père trop inflexible.
C’est une véritable descente aux enfers qui commence alors. Des soucis sans fin, un travail exténuant, sans compter les produits dangereux qu’il faut manipuler, conduisent inévitablement à de sérieux ennuis de santé. Quand un incendie ravage un des hangars, cela ressemble à la fin d’un monde. Pierre ne s’en remettra pas. Il sombre irrépressiblement dans la neurasthénie, au point non seulement de se mettre en danger lui-même, mais d’être menaçant pour ses proches. C’est une famille entière qui croule sous le désastre. Impuissante, Claire, la mère, en est réduite à écrire ses angoisses sur un calendrier, comme si elle tenait le journal de la catastrophe. Quant à Thomas (joué par l’impressionnant jeune acteur dont on avait déjà apprécié le talent dans La Prière (2018) de Cédric Kahn), il se dépense sans compter pour tenter de sauver son propre père, avec l’énergie du désespoir.
On le sent de bout en bout, Edouard Bergeon a mis tout son être, toutes ses tripes pourrait-on dire, pour la réalisation de ce film. L’œuvre est poignante, elle rend hommage non seulement à sa propre famille, mais aux nombreux paysans qui, chaque année, poussés au désespoir, finissent par se suicider. Un texte affiché sur l’écran, à la fin du film, nous rappelle qu’en France, il y en a un, en moyenne, chaque jour. Bouleversant.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190920 – Cinéma

UN JOUR DE PLUIE À NEW-YORK
Un film de Woody Allen.
Interdit de projection aux États-Unis du fait d’un litige avec Amazon, détenteur des droits du film outre-Atlantique, et de rumeurs diffamatoires concernant son contenu, Un jour de pluie à New-York peut néanmoins être programmé en Europe et vient enfin de sortir sur nos écrans. C’est d’autant plus réjouissant qu’il s’agit, sans nul doute, d’un grand cru. À 83 ans, malgré son impressionnante filmographie, à quoi s’ajoutent aujourd’hui l’accusation d’agression sexuelle dont il fait l’objet et qui, selon lui, est calomnieuse, le cinéaste n’a manifestement rien perdu ni de ses talents de metteur en scène ni de ses capacités de création. Qu’on le veuille ou non, il demeure un grand cinéaste.
Preuve en est ce film qui raconte l’aventure new-yorkaise d’un couple d’étudiants d’une petite université du Nord-Est des États-Unis. Lui porte un nom improbable qui ouvre, à lui seul, des perspectives alléchantes : il se prénomme Gatsby comme le personnage de Fitzgerald et se nomme Welles comme le réalisateur génial de Citizen Kane (1946) et est interprété par l’acteur Timothée Chalamet. Elle se prénomme plus prosaïquement Ashleigh (avec gh, elle tient à le préciser), porte le nom d’Enright et elle a la grâce et la fraîcheur de l’actrice Elle Fanning. Or cette dernière a réussi à obtenir, pour le journal de sa fac, une interview d’un cinéaste de renom de New-York. Bien décidé à profiter de cette aubaine pour passer du bon temps avec son amoureuse, Gatsby se propose pour l’accompagner.
Bien évidemment, une fois sur place, rien ne se déroule comme prévu. L’interview avec le grand cinéaste (Liev Schreiber) a bien lieu, mais sous le signe de l’insatisfaction. L’homme n’est pas content de sa dernière réalisation et tient à démontrer à Ashleigh que son mécontentement est fondé en la conviant à une projection. Du coup, au lieu de poursuivre son séjour à New-York, comme cela avait été programmé, avec Gatsby, la jeune femme se trouve non seulement séparée de ce dernier mais, au gré du hasard, et du fait de sa naïveté, devient tour à tour la compagne de Ted Davidoff (Jude Law), un scénariste découvrant que sa femme le trompe avec son meilleur ami, puis de Francisco Vega (Diego Luna), un acteur de renom qui n’est pas insensible à son charme, c’est le moins qu’on puisse dire. De son côté, Gatsby n’est pas en reste : séparé de son amoureuse, il fait la rencontre, sur un tournage, de Chan (Selena Gomez), la petite sœur d’une de ses ex, une jeune femme d’un grand charme qui, pour les besoins du film, doit l’embrasser à pleine bouche ! Plus tard, il a affaire à une escort-girl, à qui il propose, pour une grosse somme, d’essayer de se faire passer pour quelqu’un d’autre.
Que ce soit dans le registre de l’émotion ou que ce soit dans celui du burlesque, le film étincelle d’inspiration et, parfois, de malice. C’est le cas, par exemple, lorsque Woody Allen met en scène un jeu de cache-cache dans un musée où, au milieu des pièces égyptiennes, Gastby tente d’échapper à une rencontre qu’il juge importune. L’émotion, elle, affleure souvent, mais toujours de manière discrète, sous une apparence de légèreté, un peu comme dans le théâtre tchekhovien. À cela s’ajoute, comme une cerise sur le gâteau, de multiples références, plus ou moins explicites, à de grands films de l’âge d’or d’Hollywood, comme La Griffe du Passé (1949) de Jacques Tourneur. Or c’est précisément le fil rouge du film que la question du temps, passé, présent, futur… Une journée à New-York, journée marquée aussi par le temps qu’il fait, puisqu’il pleut abondamment, une journée suffit à chambouler les existences et redistribuer les cartes. C’est plus ou moins vrai de tous les protagonistes du film d’ailleurs, y compris, par exemple, de la mère de Gastby qui fait à ce dernier d’étonnantes confidences sur son passé. Quant au futur, un peu comme dans Elle et Lui (1939 et son remake de 1957) de Leo McCarey, il se laisse entrevoir à l’occasion d’un rendez-vous dans un endroit précis de New-York, près d’une horloge précisément. Mais qui sont donc les deux protagonistes qui s’y retrouvent ? Mystère, mystère… Pour le savoir, précipitez-vous donc vers vos salles de cinéma et délectez-vous en regardant ce film !
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190911 – Cinéma

JEANNE
Un film de Bruno Dumont.
« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits », dit Jésus en s’adressant au Père dans l’évangile de Luc (10, 21). C’est probablement la citation des évangiles qui convient le mieux au nouveau film de Bruno Dumont, deuxième partie de son diptyque sur Jeanne d’Arc. A sa sortie en septembre 2017, le premier volet, sur l’enfance de la bergère de Domrémy, avait surpris par son dépouillement et ses audaces stylistiques. Les scènes chantées, sur une musique tonitruante d’Igorrr, donnaient au film un côté déjanté qui pouvait rebuter certains. Pour ma part, j’avais été séduit, ne serait-ce que parce que le réalisateur avait puisé son inspiration chez Charles Péguy et avait réussi, nonobstant les ruptures de ton dues à la musique, à donner au film une expression et un contenu faisant songer aux mystères tels qu’on les proposait au Moyen-Âge, par exemple sur le parvis des églises. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, qui s’accordait à merveille avec les textes de Péguy.
Cette analyse reste pertinente pour ce qui concerne le film qui sort aujourd’hui, même si, par la force des choses, celui-ci apparaît un peu moins dépouillé que le premier volet. Comme il s’agit, cette fois-ci, de mettre en scène Jeanne au cours des batailles puis au cours de son procès, il a fallu filmer des hommes en armes, des chevaux caparaçonnés, des hommes d’Eglise avec leurs vêtements de fonction et, dans la deuxième partie, user du décor grandiose d’une cathédrale (Amiens ?), ce qui donne lieu à de superbes prises de vue. Cela étant dit, Bruno Dumont ne s’encombre, pas plus que dans le Jeannette de 2017, de la vraisemblance des décors : les scènes de guerre sont toutes filmées dans le paysage de dunes qui avait déjà servi pour le film précédent et, lorsque Jeanne est filmé dans sa prison, en fait de cellule elle est enfermée derrière la grille d’un bunker ! Si, au premier abord, Jeanne peut sembler moins insolite que Jeannette, ce n’est qu’apparence. Le film qui sort aujourd’hui est tout aussi audacieux que le précédent, et il est encore plus séduisant, ne serait-ce que parce que c’est à Christophe qu’a été confiée la musique de ce deuxième volet et non plus à Igorrr. Or, toutes les parties musicales de Jeanne comptent parmi les grandes réussites du film (et réservent une belle surprise lorsque le visage jusque là caché d’un des juges de la pucelle se relève et montre son identité). On ne peut qu’être subjugué, par exemple, lorsque, alors que doit avoir lieu une bataille, on assiste, en guise de combat, à un étonnant ballet équestre. C’est une des séquences les plus admirables du film.
C’est donc un mystère qu’a, à nouveau, filmé le réalisateur, mettant sur les lèvres des différents protagonistes les mots de Péguy. Un mystère d’autant plus insondable et d’autant plus fascinant que c’est celui de Jeanne en personne. Jeanne qui a gardé un cœur d’enfant. Ce mystère de l’enfance spirituelle, Bruno Dumont a eu l’idée sublime de le confier à la même toute jeune actrice qui jouait dans Jeannette : Lise Leplat Prudhomme. Une interprète d’une dizaine d’années pour jouer le rôle de Jeanne d’Arc ? Cela n’a rien de saugrenu, non, au contraire, c’est une idée que je trouve éblouissante. Dès la première partie du film, on le ressent très fortement chaque fois qu’apparaît celui qui est l’exact contraire de Jeanne : Gilles de Rais, dont on connaît le funeste destin. Et, bien sûr, dans la deuxième partie du film, plus austère parce que consacrée au procès, ce sont les juges, évêques et théologiens, qui, par contraste avec Jeanne, exposent les visages de ceux qui ont renié, rejeté, foulé au pied, la grâce de l’enfance : les chefs, les censeurs, les arrogants n’éprouvant que dédain pour celle qu’ils ont juré de déclarer hérétique afin de la faire mettre au bûcher. L’un d’eux, lors d’une des dernières scènes du film, semble presque devenu fou. Comme l’écrivait si bien Georges Bernanos dans un texte que j’ai cité récemment dans sa totalité sur mon blog : « Il y a un complot des grandes personnes contre l’enfance, et il suffit de lire l’Evangile pour s’en rendre compte. Le Bon Dieu a dit aux cardinaux, théologiens, essayistes, romanciers, à tous enfin : « Devenez semblables aux enfants. » Et les cardinaux, théologiens, historiens, essayistes, romanciers, répètent de siècle en siècle à l’enfance trahie : « Devenez semblable à nous. » ». On ne peut mieux résumer, me semble-t-il, le propos du nouvel et admirable film de Bruno Dumont.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190906 – Cinéma

FOURMI
Un film de Julien Rappeneau.
En 2015, la sortie de Rosalie Blum avait révélé les talents de réalisateur de Julien Rappeneau dans le registre d’un cinéma de type populaire qui n’en reste pas moins exigeant sur les plans de la finesse du scénario et de l’écriture des personnages, entre autres qualités. Les mêmes compétences sont présentes dans le film qui sort aujourd’hui, un film dont l’action se déroule au sein d’un petit club de football, un film qui raconte une histoire presque simple, mais qui n’en réserve pas moins mille trésors d’émotion et d’intelligence du propos.
Dans ce petit club, se trouve Théo (Maleaume Paquin), un garçon de 12 ans qui, malgré sa petite taille (qui lui vaut le surnom de Fourmi), brille sur le terrain. Flanqué de Laurent (François Damiens), un père qui ne manque pas une occasion de venir le soutenir au point d’en être encombrant (d’autant plus qu’il a de sérieux problèmes d’alcool), le garçon fait la fierté de Claude (André Dussollier), son entraîneur.
Le jour où Théo, après avoir été convoqué en entretien privé par le sélectionneur d’un grand club anglais, affirme crânement qu’il a été recruté, on imagine le débordement de joie, non seulement de son père et de son entraîneur, mais de la commune tout entière où réside le garçon. Or ce dernier a menti : du fait de sa petite taille, le sélectionneur anglais n’a pas voulu de lui. Mais une fois qu’un mensonge a été prononcé, il est difficile de s’amender. D’autant plus que l’intention du garçon était bonne : il souhaitait, en contentant son père, se rapprocher de lui. Il faut préciser que, ses parents étant divorcés, c’est sa mère qui en a, quasi exclusivement, la charge.
A partir de cette histoire dans le milieu du football, le réalisateur déploie finement tous ses dons pour explorer les conséquences d’un mensonge. C’est là le sujet principal du film. Or, contrairement aux idées reçues, les répercussions du mensonge, en l’occurrence, n’ont rien de négatif, au contraire. Le père de Théo en est dynamisé. Il ne se fait pas prier pour suivre les conseils de l’assistante sociale (Laetitia Dosch) qui l’accompagne : trouver un travail, cesser de boire et apprendre l’anglais. Un vrai chemin de conversion a été entamé. Et, bien sûr, plus important que tout, c’est dans le rapport père/fils qu’il se passe quelque chose de déterminant.
Et quand la vérité éclatera, que se passera-t-il ?, se demande-t-on. Pas sûr que cela change grand-chose. Théo mérite bien la fierté de son père autant que son surnom de Fourmi. Car ce sobriquet ne lui convient pas seulement à cause de sa petite taille. Il est une autre caractéristique des fourmis. Ce sont des hyménoptères qui ne vivent qu’en colonie. Une fourmi solitaire est condamnée, elle ne peut déployer ses talents que dans la collectivité. Tout comme Théo : il ne s’affirme bon footballeur que parce qu’il « joue collectif » !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190904 – Cinéma (Animation)

LES HIRONDELLES DE KABOUL
Un film de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec.
Quels que soient les prétextes religieux invoqués, quel que soit le but à atteindre (s’il y en a un), sous tous les cieux et dans toutes les religions, quand se met en place un régime théocratique, le fonctionnement ne varie guère. Tout ce qui compte aux yeux des fanatiques et de ceux qui les soutiennent, c’est de faire régner la terreur, quitte à édicter des prescriptions et des lois qui confinent à l’absurde. En voyant ce film, dont l’action se déroule à Kaboul en 1998, sous le régime des talibans, on se demande, par exemple, pour quelle raison ces derniers interdisent aux femmes de porter des chaussures de couleur blanche. Il y a sûrement une motivation à cela, mais elle ne peut être qu’inepte, l’important n’étant pas la perspicacité des lois, mais leur utilisation afin d’assujettir jusqu’aux individus les plus récalcitrants.
Le roman de Yasmina Khadra, ingénieusement adapté en film d’animation, sublimé par les talents graphiques de la dessinatrice Eléa Gobbé-Mévellec, montre bien le mécanisme de la peur qui s’était mis en place à Kaboul, un mécanisme qui n’épargne personne, pas même les enfants. Dès le début du film, cela apparaît de la manière la plus terrible, au cours d’une scène de lapidation d’une femme condamnée par les oppresseurs. Les enfants eux-mêmes jettent des pierres, ainsi qu’un homme du nom de Mohsen, un homme au cœur bon, mais qui, s’étant retrouvé là, pris de panique et porté par la foule, ne peut s’empêcher de faire comme les autres.
Cet homme, qui ne tarde pas à regretter amèrement son geste, est l’un des quatre protagonistes les plus importants du film. En fait, celui-ci se concentre sur deux couples. Il y a donc Mohsen et Zunaira, femme d’une grande beauté qui reste le plus souvent confiné à la maison où elle s’occupe à recouvrir les murs de peintures audacieuses, voire sensuelles, tout en écoutant de la musique interdite, en signe de rébellion. Tous deux, enseignants avant l’arrivée des talibans, ne sont plus autorisés à exercer leur métier. L’autre couple évoluant pendant le film est composé de Mussarat, une femme malade d’un cancer, et de son mari Atiq, dont le travail n’est autre que de diriger une prison pour femmes. Or Atiq, à qui l’on recommande volontiers d’abandonner son épouse pour se remarier, les femmes ne méritant pas le moindre égard aux yeux des tyrans, n’en reste pas moins attaché à Mussarat. Mais voilà que, à la suite d’une circonstance tragique, c’est la belle Zunaira qui échoue en prison en attendant d’être mise à mort lors d’un des rituels macabres qu’organisent les talibans. Atiq a beau exercer un métier qui exige d’avoir le cœur endurci, il lui est impossible de rester insensible face à la terrible injustice qui se prépare.
Culpabilité, remord, rébellion, sacrifice de soi, conversion : tous ces thèmes irriguent le film jusqu’à culminer dans de grands moments d’émotion. Car, même sous le régime implacable des talibans, dans le cœur de certains hommes, tout ne s’est pas endurci, si bien qu’il peut y survenir un retournement complet. Les regards changent aussi, y compris celui que certains hommes portent sur les femmes. Quant à ces dernières, il leur reste encore le moyen d’espérer un retour au Kaboul du passé, un Kaboul qu’on entrevoit lors d’une des scènes, un Kaboul où femmes et hommes pouvaient se prévaloir d’espaces de liberté. Qui sait d’ailleurs si l’une d’elles ne va pas réussir à s’envoler à tire d’ailes comme font les hirondelles ?
Les deux réalisatrices n’ont pas ménagé leurs peines puisqu’elles ont travaillé six années durant sur la fabrication de ce film. Le résultat est à la hauteur d’un tel acharnement : il est somptueux sur le plan visuel et il est constamment judicieux sur le plan du scénario.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190827 – littérature
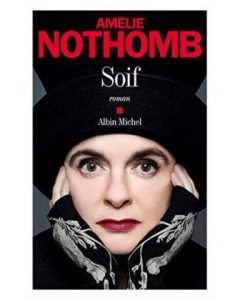
SOIF
Un livre d’Amélie Nothomb.
Depuis longtemps, c’est ce qu’elle affirme, Amélie Nothomb avait le projet d’écrire un livre sur Jésus et, plus précisément, sur sa Passion. Un projet reporté d’année en année parce qu’elle ne s’estimait pas capable de le réaliser. Jusqu’à ce qu’enfin elle se décide et écrive l’ouvrage qui paraît aujourd’hui sous le titre Soif.
Le livre est audacieux puisque l’écrivaine ne se contente pas de raconter Jésus comme l’ont fait tant d’autres avant elle, non, elle fait parler Jésus, elle écrit à la première personne du singulier, ce sont les ruminations et les états d’âme de celui-ci qu’Amélie Nothomb imagine et transcrit. Quelles peuvent bien être les pensées de Jésus à l’heure de la Passion, à celle de la croix et même dans la mort ?
Dans une interview, Amélie Nothomb explique qu’elle ne s’est nullement souciée, ce faisant, ni de la critique historique ni des commentaires des exégètes. Son propos est différent, il est celui d’une romancière qui se souvient de ce qu’elle ressentait lorsqu’elle était enfant et qu’on lui racontait la Passion et la mort de Jésus. Le livre tel qu’il est proposé aujourd’hui aux lecteurs semble, en effet, pour une part, comme surgi de la voix de l’enfance, mais pour une part seulement. Car un grand nombre des propos qu’Amélie Nothomb prête à Jésus s’appuient, sans aucun doute, sur des réflexions d’adulte.
Nous avons donc affaire au Jésus d’Amélie Nothomb, qui n’est pas celui des « cathos », comme elle l’affirme dans une interview. En vérité, c’est avec les récits évangéliques eux-mêmes que l’écrivaine prend ses distances, plutôt qu’avec les seuls « cathos ». Elle se fait un malin plaisir, semble-t-il, à prendre le contre-pied, presque systématiquement, des textes des quatre évangiles. Et quand elle retient certains des écrits ou certaines des paroles rédigés par les évangélistes, c’est pour leur donner une interprétation toute personnelle.
En fin de compte, il y a de tout dans ce livre : des invraisemblances, des banalités, mais aussi de belles méditations et quelques fulgurances. Au registre des invraisemblances, il faut placer tout le début du livre ou presque. Amélie Nothomb veut nous faire avaler que tous ceux qui ont été les bénéficiaires des miracles de Jésus sont, au bout du compte, si mécontents qu’ils viennent témoigner contre lui à son procès ! Voilà qui ne manque pas d’originalité, mais que l’écrivaine n’explique que laborieusement et sans jamais réussir à convaincre, au moyen de subtilités peu crédibles. Au rayon des banalités, on n’échappe pas, bien évidemment, au grand amour entre Jésus et Marie-Madeleine, que le premier préfère appeler simplement Madeleine (à cause du prénom Marie qui est également celui de sa mère). Là, Amélie Nothomb ne fait que reprendre à son compte (ou à celui de son Jésus) ce que d’autres avaient déjà imaginé, par exemple Nikos Kazantzakis dans La Dernière Tentation du Christ.
Amélie Nothomb prête à Jésus des pensées très humaines, très incarnées, ce qui, en soi, n’a rien de choquant, mais était-il, pour autant, judicieux de prétendre, par exemple, qu’à Cana, Marie et Jésus avaient si bien profité du bon vin qu’ils en étaient, au bout du compte, pompettes ! C’est le genre de petites audaces que se permet l’écrivaine et qui n’indigneront que les béni-oui-oui.
Heureusement, dans sa deuxième moitié, l’ouvrage acquiert une intensité et une profondeur qui impressionnent. Certes, les pensées prêtées à Jésus ne perdent rien de leur originalité, mais de façon bien plus intéressante, plus forte, qu’au début du livre. Il y a même des pages de méditation très belles sur le chemin de croix, sur l’amitié de Simon de Cyrène et sur l’amour de Véronique : « deux courages d’une sublimité sans exemple ». En fin de compte, si l’on y réfléchit, on peut estimer que les questions que se pose l’écrivaine au fil de ses pages sont non seulement légitimes mais bienvenues. Ce sont, pour reprendre ce que je disais plus haut, des questions d’enfant. Or ces questions-là sont les plus judicieuses qui soient, je n’en ai pas le moindre doute.
Ce qui fait difficulté, ce ne sont donc pas les questions, mais ce sont les réponses, d’autant plus qu’en l’occurrence elles sont proposées sous la forme des ruminations et des pensées de Jésus lui-même. Et, comme je l’ai dit, elles se démarquent presque toujours des évangiles et de leurs interprétations courantes. Qu’Amélie Nothomb prenne très au sérieux l’incarnation, son implication, ses conséquences, en essayant de percevoir ce que cela veut dire concrètement, c’est pertinent. Mais qu’elle fasse dire (ou penser) à Jésus que, par exemple, il n’a jamais eu un très bon sommeil, c’est se risquer dans des particularisations qui laissent sceptique. Qu’Amélie Nothomb se heurte à l’énigme de la croix (« scandale pour les Juifs et folie pour les païens », comme écrit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens), qu’elle soit effarée par la notion de sacrifice, par la souffrance, par le martyre, au point de les refuser, cela se conçoit et elle est loin d’être la première à passer par là. Mais faire passer Jésus par tous les stades allant de l’incompréhension (le projet du Père voulant voir jusqu’où peut aller Jésus par amour, c’est une « idée nuisible jusqu’à l’épouvante », fait dire Amélie Nothomb à son Jésus) jusqu’à l’orgueil (car aucune autre crucifixion n’aura autant de retentissement que la sienne), en passant par la révolte, la désobéissance (non, le Jésus de Nothomb n’est pas obéissant au Père !) et la haine de soi, il faut l’oser ! Car ce n’est pas aux autres que ce Jésus-là doit pardonner, mais à lui-même, ne serait-ce que parce que, par exemple, il va en entraîner plein d’autres sur la voie du martyre, ce qui paraît injustifiable à l’écrivaine (qui a d’ailleurs raison de buter au sujet d’une quelconque tentative de justification du mal et de la souffrance) !
Il ne s’agit donc pas d’évacuer ni de mépriser les questions posées par le livre d’Amélie Nothomb ! Je le répète, elles sont bienvenues et nombreux sont, probablement, ceux qui s’y heurtent, pour peu qu’ils y réfléchissent tant soit peu. Mais, pour ce qui concerne les affirmations égrenées dans le livre, c’est autre chose et l’on est totalement en droit de ne les point partager. Il y a trop de systématisme chez Amélie Nothomb, une propension à prendre le contre-pied des évangélistes qui ne peut que susciter le scepticisme.
Jésus qui s’oppose au Père au point de lui interdire la capacité d’aimer (car, selon Amélie Nothomb, seul un être doté d’un corps peut aimer), cela laisse rêveur. Mais Jésus qui se corrige lui-même (ou plutôt qui corrige ce que lui fait dire Jean dans son évangile) au point de faire l’éloge de la soif, c’est peut-être ce que le livre propose de plus séduisant. Car la seule parole que veut bien accorder à Jésus sur la croix Amélie Nothomb, c’est « J’ai soif ». Tout le reste, selon elle, n’est qu’invention de mauvais goût ! Mais avoir soif, c’est la seule chose qui compte. Et, surtout, dit-elle, ou dit son Jésus, il faut ne jamais l’étancher totalement, car « l’amour de Dieu, c’est l’eau qui n’étanche jamais » !
7/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190821 – Cinéma

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Un film de Arnaud Desplechin.
Au début du film, il y a la nuit, mais pas n’importe quelle nuit, puisque c’est celle de Noël. Les guirlandes qui scintillent dans les rues de Roubaix semblent cependant bien dérisoires. Ont-elles le pouvoir de dissiper un tant soit peu la disgrâce de la ville réputée la plus pauvre de France ? 46% des habitants y vivent sous le seuil de pauvreté. C’est là, cependant, dans cette ville où la misère sociale et humaine est omniprésente, ville où lui-même est né, qu’Arnaud Desplechin a entrepris de chercher de la lumière. Ou, plutôt, une lumière, comme l’indique le titre. Il s’inscrit ainsi dans une veine, parfois exploitée, dans le genre du film noir, y compris à l’époque de son âge d’or, durant les années 40 et 50. Un film comme La Maison dans l’Ombre (On dangerous ground – 1952) de Nicholas Ray en est l’exemple parfait. Dans une histoire de violence très sombre intervient un personnage porteur de lumière, le paradoxe étant, dans le film de Ray, qu’il s’agit d’une femme aveugle jouée par la sublime Ida Lupino.
Mais revenons au film d’Arnaud Desplechin, qui s’est lui-même inspiré d’un documentaire de 2008 intitulé Roubaix, commissariat central, documentaire au cours duquel on pouvait voir deux femmes qui, pressées de questions par les policiers, passaient aux aveux, admettant avoir commis le meurtre d’une personne âgée. Tous les éléments de ce documentaire, dans lequel il est également question, entre autres, d’un incendie criminel, de la fugue d’une jeune fille mineure et d’un viol dans le métro, se retrouvent dans le film de Desplechin. Du coup, on peut légitimement se demander s’il était vraiment utile de faire jouer à des acteurs les rôles de ces personnes bien réelles. La réponse est oui, ne serait-ce qu’à cause de l’intention affichée dans le titre du film, chercher une lumière là où il semble impossible d’en trouver, de quelque ordre que ce soit.
Nul besoin pour Arnaud Desplechin de mettre en scène les crimes, il lui suffit de quelques plans pour placer en évidence la sordidité des lieux où se traînent des vies sans le moindre espoir d’un avenir meilleur. C’est là que, enquêtant sur un incendie criminel, les policiers se trouvent en présence d’un couple de deux femmes dont on devine aussitôt, rien qu’à leur aspect, qu’elles ne connaissent que la misère. Claude et Marie sont interprétées de manière persuasive par Léa Seydoux et Sara Forestier. Interrogées d’abord parce qu’elles sont voisines de l’immeuble incendié, elles deviennent progressivement suspectes, non seulement d’avoir provoqué l’incendie mais également d’avoir tué, pour lui dérober ses quelques biens, la femme âgée qui y résidait et dont on a fini par retrouver le cadavre.
Or, parmi les policiers qui interviennent au cours du film, il en est deux qui se détachent : le commissaire Daoud (joué par l’excellent Roschdy Zem) et Louis (Antoine Reinartz), l’un de ses lieutenants. La grande idée d’Arnaud Desplechin, c’est de les avoir conçus de façon complémentaire. Le second, Louis, quelques plans rapides nous font savoir qu’il est croyant. Il a certes rejeté, à l’époque où il devait faire sa première communion, un appel au sacerdoce, mais un plan très fugace nous le fait voir en train de prier, demandant à Dieu la force du pardon. Or cet homme qui prie, lorsqu’il exerce son métier de policier, n’en reste pas moins un enquêteur comme les autres, prompt à s’énerver, à crier, à s’emporter, voire à menacer, quand il est en présence des supposées coupables qu’il s’agit d’interroger. À contrario, Daoud, lui, se distingue invariablement par sa patience, sa prévenance et sa douceur. Dès qu’il est là, quelque chose change. Lui qui n’est pas présenté comme quelqu’un de croyant, quand il apparaît, c’est comme s’il portait avec lui la lumière. En somme, l’on a affaire deux hommes dont l’un est un croyant sans la grâce et l’autre un sceptique porteur de grâce.
En écrivant cela, je songe à d’autres œuvres abordant ce même thème, par exemple A la merveille (2013) de Terrence Malick, film dans lequel Javier Bardem jouait le rôle d’un prêtre n’ayant plus la foi mais n’en continuant pas moins de servir les pauvres. Qu’est-ce qui est préférable ? Avoir la foi tout en étant dépourvu de grâce ou en être doté bien qu’incroyant ? Je n’ai pas la moindre hésitation, pour ma part, quant à la réponse.
Pour la première fois dans son parcours de cinéaste, Arnaud Desplechin aborde le genre du film noir, ou du polar, et il le fait avec un indéniable talent. Captivant, le film, sans jamais céder au voyeurisme, n’occulte rien ni de la misère sociale ni de ses terribles conséquences. Deux filles paumées, exclues, sans avenir, assassinent une pauvre vieille. Le commissaire Daoud fait son boulot de policier mais il a bien perçu que ces filles-là, si elles sont coupables, sont aussi et d’abord des victimes.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190728 – Cinéma

303
Un film de Hans Weingartner.
Comment susciter non seulement l’intérêt, mais l’enthousiasme, en filmant l’histoire la plus simple, on pourrait même dire la plus rebattue, du monde ? Cette gageure, Hans Weingartner la relève de la manière la plus belle, la plus convaincante, qui soit. En racontant, sur fond de road-movie, la naissance du sentiment amoureux entre deux jeunes gens, il ne sort certes pas des sentiers battus, et cependant il réussit un film enthousiasmant. C’est la preuve, si besoin est, que, pour faire du bon cinéma, il n’est nullement obligatoire d’imaginer un sujet très original, mais qu’il faut avant tout se fonder sur de bons acteurs et faire des choix judicieux de mise en scène. Et c’est le cas dans ce film : tout y est réuni pour provoquer l’engouement bien mérité du spectateur.
L’histoire d’amour n’est d’ailleurs pas gagnée d’avance et il faut beaucoup de temps pour qu’elle surgisse, grandisse et s’épanouisse. Au début du film, les deux jeunes en question subissent tous deux un échec : elle, prénommée Jule (Mala Emde), parce qu’elle rate un examen de biologie, lui, prénommé Jan (Anton Spieker), parce qu’on lui refuse la bourse sur laquelle il comptait. Tous deux décident, chacun de son côté, d’entreprendre un voyage : elle pour rejoindre son petit ami qui réside momentanément au Portugal, lui pour faire connaissance avec son père biologique qu’il n’a encore jamais vu et qu’il espère retrouver en Espagne. Or comme Jan s’est fait larguer par le conducteur qui devait l’emmener en covoiturage, il décide de faire du stop et, voyant Jule auprès de son camping-car 303, lui demande si elle veut bien le prendre à bord.
Ainsi commence le long périple qui les conduit tous deux d’Allemagne au Portugal en passant par la Belgique, la France et l’Espagne. Un voyage en duo qui semble devoir s’achever dès les premiers kilomètres. Car la première discussion qui s’engage entre les deux jeunes gens tourne au fiasco. Jule s’irrite tellement des propos maladroits que lui tient son compagnon qu’elle décide de l’abandonner aussitôt sur une aire d’autoroute. Or un concours de circonstances fait que non seulement tous deux se retrouvent un peu plus tard mais que Jule accepte de reprendre Jan à son bord.
C’est alors que débute vraiment leur voyage en commun et le lent apprivoisement, la patiente découverte de l’autre. Ponctué de pauses, de baignades, de visites, d’explorations des paysages superbes qui jalonnent leur route, le périple est aussi l’occasion de débats passionnés sur des questions de politique et d’anthropologie mais également et surtout sur la question du sentiment amoureux. C’est ce dernier sujet qui s’impose en effet, dessinant, au fil de discussions enflammées, une véritable carte du Tendre. Jule affirme ses convictions optimistes sur la nature humaine, elle exalte la bonté et l’empathie, tandis que Jan expose son pragmatisme, son scepticisme et son scientisme. Mais si leurs opinions semblent inconciliables, elles n’empêchent pas que s’établisse et que grandisse entre les deux itinérants quelque chose de plus que le simple plaisir d’être ensemble et de débattre de sujets controversés. Avec douceur, avec délicatesse, c’est le sentiment amoureux, non plus seulement théorisé, mais vécu, qui tisse ses liens entre les deux jeunes gens. Cela se fait par le biais des sens, bien entendu, la vue, le toucher, mais aussi l’odorat, et cela se fait sans doute aussi parce que chacun d’eux se heurte à ses propres limites, à ses propres difficultés : Jan par rapport à son père biologique, Jule par rapport au petit ami qu’elle est censée rejoindre au Portugal, mais aussi du fait qu’elle est enceinte. Fragilisés, vacillants, Jule et Jan, après tant de complicité intellectuelle, peuvent tout naturellement orienter leur histoire vers un amour partagé. Un amour que le réalisateur affirme d’ailleurs n’avoir pas imposé à son couple d’acteurs, un amour qu’il a laissé venir, tout naturellement, devant sa caméra, ce qui donne au film encore plus de justesse et de beauté.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190724 – Cinéma
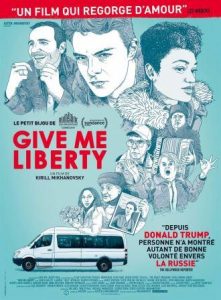
GIVE ME LIBERTY
Un film de Kirill Mikhanovsky.
« La vie est belle. La vie est merveilleuse quand on aime. Rien ne compte en dehors d’aimer. » Ces paroles, prononcées dès la première scène de ce film, semblent présager une œuvre comportant de bonnes doses de mièvrerie. Mais elles sont dites par un homme qui, en vérité, ne se paie pas de mots et sur un ton qui ne s’apparente nullement à de la guimauve. L’homme est tétraplégique et ses paroles n’ont rien de superficiel. De plus, elles ne mentent pas, elles sont la meilleure introduction possible pour un film dans lequel, de fait, il est question d’amour, et d’amour vécu, et non pas seulement enrobé dans de grandes phrases pontifiantes.
Le film est réalisé par un russe, comme le nom l’indique, mais un russe qui a quitté son pays à la fin des années 80 pour venir s’établir aux États-Unis. L’action se déroule sur une journée, à Milwaukee, dans le Wisconsin, et elle met en scène, majoritairement, prioritairement, des personnes handicapées issues, pour une part, précisément, de la communauté d’origine russe de cette ville, et, d’autre part, de la communauté afro-américaine. Tous sont des laissés-pour-compte, mais, chez qui, s’affirme, malgré les épreuves, un extraordinaire appétit de vivre. Pas une seule fois, il faut le souligner, le film ne bascule dans le larmoyant. Au contraire, même s’il ne dissimule aucunement ni les épreuves ni les coups de gueule des personnages, il est tout entier marqué par un réjouissant dynamisme.
Sur une durée d’un jour donc, nous sommes invités à suivre les déplacements de Vic, jeune homme qui veille sur des personnes handicapées et, au moyen d’un véhicule utilitaire, les conduit en différents lieux, à commencer par un cimetière où se réunissent les différents protagonistes pour un dernier hommage à une femme récemment décédée. Même en ce lieu et en cette occasion, ce n’est pas la tristesse qui prévaut. Il s’y déroule d’ailleurs un quiproquo qui prête à sourire plutôt qu’à pleurer. Il faut préciser qu’avec les russes, tout comme avec les afro-américains, on ne rate pas une occasion de chanter. Des chants russes, bien sûr, mais pas seulement. Pendant un déplacement, c’est « Let my people go » qui se fait entendre, ce qui donne lieu à une belle explication de texte, prononcée par une femme d’origine russe !
À bord de son véhicule, malgré des manifestations de rue qui le perturbent dans ses projets, Vic accueille bientôt Tracy, jeune femme noire atteinte de la maladie de Charcot, et Dima, un jeune russe dont on ne perçoit pas totalement les motivations mais dont les propos sont, parfois, cocasses et attachants (ainsi lorsqu’il raconte qu’à sa naissance, on ne donnait pas cher de sa vie, et qu’il n’a survécu que grâce aux prières de sa grand-mère invoquant saint Pantaléon !). Tout au long du film, d’ailleurs, les dialogues vont bon train, ils ne cessent presque jamais, et ils sont souvent savoureux.
Tout comme les dialogues qui n’arrêtent pas de fuser d’une personne à une autre, la caméra, elle aussi, s’agite beaucoup, presque trop. C’est sans doute le seul bémol à formuler à propos de ce film : les plans sont hachés et la caméra si mobile qu’on en a presque le tournis. Cela dit, ce choix du réalisateur se justifie, dans la mesure où il a voulu donner une apparence de documentaire à un film qui semble pris sur le vif et qui n’est joué que par des acteurs non professionnels. De ce fait, on ne peut qu’être très favorablement impressionné par la galerie de personnages qui apparaissent dans le film : des éclopés, des cabossés, des laissés-pour-compte de l’Amérique de Trump, qui, même s’ils sont forts en gueule, n’ont pas retranché de leur vie le principal, c’est-à-dire leur capacité d’aimer.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190718 – Cinéma

WILD ROSE
Un film de Tom Harper.
Nous sommes en Écosse, à Glasgow, et, dès la scène d’ouverture, apparaît celle qui est au cœur de ce film : Rose-Lynn (Jessie Buckley). C’est une jeune femme pour qui s’achève une peine de prison, mais qui n’est libérée que sous condition de porter un bracelet électronique avec obligation de ne pas sortir de chez elle à certaines heures. C’est le premier obstacle, la première des nombreuses difficultés à surmonter pour celle qui est habitée par une passion dévorante : pouvoir se produire sur scène en tant que chanteuse de country. Ce style de musique, qu’on imagine volontiers réservé aux Américains, compte aussi de fervents interprètes en Europe et, singulièrement, en Écosse. Cela étant dit, Rose-Lynn, elle, ne rêve que de pouvoir un jour traverser l’Atlantique pour pouvoir affirmer ses talents de chanteuse rien moins qu’à Nashville.
Mais comment s’y prendre pour passer du rêve à la réalité quand on est en liberté surveillée, quand il faut se contenter d’un travail de femme de ménage et quand on est mère de deux enfants ? Ces deux-là, un garçon et une fille, ont été gardés par leur grand-mère, la mère de Rose-Lynn (Julie Walters), durant le temps de l’incarcération. Or, quand leur mère les retrouve, les enfants ne montre aucun signe d’enthousiasme, c’est le moins qu’on puisse dire. La vie avec leur mamie leur convenait à merveille. Pour Rose-Lynn, écartelée entre sa passion pour la musique et ses devoirs de mère, des choix compliqués s’imposent et ils s’accompagnent de bien des maladresses. Dans le même temps, Rose-Lynn fait la connaissance de celle qui va devenir, en quelque sorte, son Pygmalion : son employeuse (Sophie Okonedo), une femme riche qui ne tarde pas à découvrir que sa femme de ménage a de réels talents en tant que chanteuse de country. Grâce à elle, grâce aux opportunités qui s’ouvrent devant elle, Rose-Lynn peut à nouveau prétendre au succès.
Si l’on s’en tient à ce résumé, on pourra dire, à juste titre, que ce film ne renouvelle guère le genre qui est le sien. Or, ce qui lui donne son originalité et le rend passionnant, outre les talents éclatants de son actrice principale et les belles idées de mise en scène dont fait preuve le réalisateur, c’est que ce dernier a placé au centre de cette histoire la question du mensonge et de la vérité. C’est là le sujet principal du film et il est même tatoué sur le bras de son héroïne. Quand on lui demande ce qu’est la musique country, elle montre son bras où il est écrit : « trois accords et la vérité ». Pour ce qui concerne les trois accords, pas de problème : Rose-Lynn est une chanteuse d’exception qui maîtrise son domaine à merveille. Mais pour ce qui est de la vérité, il y a du chemin à parcourir. À son employeuse, par exemple, elle préfère mentir plutôt que lui révéler qu’elle sort de prison et qu’elle est mère de deux enfants. Et, quand elle a la chance de pouvoir se rendre à Londres afin d’y rencontrer un célèbre animateur de radio, celui-ci perçoit ce qui fait défaut chez elle : non pas sa voix qui est superbe, mais quelque chose de l’ordre de la vérité, ou de sa vérité peut-être. En fin de compte, Rose-Lynn ne sera une grande chanteuse de country qu’à partir du jour où elle sera capable de mettre en communion la musique et la vérité. Et que cela ait lieu à Glasgow plutôt qu’à Nashville importe peu ! En développant ce sujet-là, dont dépend aussi une possible réconciliation de Rose-Lynn avec sa mère et ses enfants, le film, nonobstant son apparence quelque peu conventionnelle, séduit à la fois du point de vue de l’émotion et de celui de l’intelligence.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190706 – Cinéma

SO LONG, MY SON
Un film de Wang Xiaoshuai.
Dans une interview parue dans Télérama, le réalisateur raconte à quel point il a dû batailler avec la censure de son pays pour l’aboutissement de chacun de ses films. Ainsi, ce sont, entre autres, les autorités en charge des cultes qui sont intervenues pour faire retirer de « So long, my son » une scène montrant une femme sortant d’un temple bouddhiste puis passant devant une église en faisant un signe de croix. Dans la version telle qu’elle nous est proposée, il reste néanmoins une scène se déroulant dans un temple bouddhiste ainsi qu’un plan très fugitif sur une église, mais rien de plus.
Compte tenu de ces tracasseries et des compromis qui en découlent, « So long, my son » n’en demeure pas moins un film remarquable qui nous fait découvrir, en une longue fresque, tout un pan de l’histoire de la Chine sous l’angle de la politique de contrôle des naissances qui y a sévi entre le début des années 80 et 2015. On le sait, durant cette longue période, les couples étaient tenus de n’avoir qu’un seul enfant, sous peine de sanction. On voit ainsi, dans ce film, comment les couples obéissants étaient récompensés, entre autres, par une remise de diplôme et les insoumis réprimés.
Mais, si le film est passionnant, malgré quelques longueurs, c’est aussi et surtout parce qu’il s’attache à raconter l’histoire d’un couple parmi beaucoup d’autres. Or ce couple connaît la pire épreuve qui soit : leur enfant unique, leur garçon, décède tragiquement à la suite d’une noyade. Peut-on imaginer drame plus terrible que celui-là ? Or, le cinéaste montre, presque aussitôt, le même couple, quelques années plus tard, en charge d’un garçon, d’un adolescent en pleine crise, qui porte le même prénom que l’enfant décédé.
Wang Xiaoshuai a savamment construit son film, osant toutes sortes d’ellipses, d’allers et retours dans le temps, pour nous faire percevoir ce qui s’est passé et comment le couple en deuil a pu accueillir un autre enfant sous son toit. Bien d’autres événements éprouvent, au fil du temps, cet homme et cette femme qu’on voit vieillir à l’écran puis rajeunir à l’occasion de flashbacks. Difficile de ne pas être profondément touché, voire bouleversé, par ces deux-là, par leur fidélité l’un à l’autre, fidélité qui leur permet de tenir bon au milieu des tourmentes. Et puis, et c’est sans nul doute la scène la plus belle et la plus poignante du film, voici que, alors qu’ils sont âgés, tous deux apprennent enfin la vérité entière sur ce qui s’est passé le jour où leur fils est mort. Ce sont la culpabilité d’une part et le pardon de l’autre qui sont alors à l’œuvre. La scène est inoubliable, elle illumine le film.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190608 – Cinéma
L’AUTRE CONTINENT
Un film de Romain Cogitore.
Au début, on croit avoir affaire à une romance presque banale, pas foncièrement différente de toutes celles qui ont déjà été mises en scène et projetées sur les écrans. On est néanmoins captivé, car cela se déroule à Taïwan et l’on est en présence d’une actrice et d’un acteur qui ne laissent pas indifférent. Déborah François joue le rôle de Maria, une jeune femme experte en néerlandais et au caractère déterminé. Paul Hamy joue Olivier, un garçon âgé, comme Maria, d’une trentaine d’années, très doué en langues (il en parle quatorze) mais de caractère plus réservé ou moins entreprenant que la jeune femme. Les différences de tempérament n’empêchent pas l’amour de naître, de grandir et de s’épanouir.
Mais, au bout d’un an de vie commune, pris de fatigues anormales, Olivier consulte un médecin et la nouvelle tombe comme un couperet : il est d’atteint d’une forme grave de leucémie. Ses chances de guérison sont minimes. Il lui faut rentrer dare-dare en France et se faire hospitaliser à Strasbourg. Accueillie et hébergée par les parents d’Olivier, Maria est fermement décidée à l’accompagner dans son combat. Les médecins, plutôt pessimistes, sont néanmoins déterminés, dans un premier temps, à tout entreprendre pour la guérison du malade. Mais, à Maria, un des médecins affirme que c’est elle, que c’est sa présence, que c’est son amour, plus que tous les traitements médicaux, qui sont une aide pour Olivier.
Or c’est là, précisément, le vrai sujet de ce film, c’est sa beauté, et c’est grâce à cela qu’il fait vibrer nos émotions. Jusqu’où peut aller l’amour ? Quelle est sa force ? Quelle est sa puissance ? Comme dans les meilleurs films de ce très grand réalisateur que fut Frank Borzage (1894-1962), l’amour semble pouvoir renverser tous les obstacles, il peut aller jusqu’à faire des miracles. Même les prévisions les plus défaitistes des médecins peuvent donc se trouver déjouées.
Oui, c’est vrai, mais jusqu’à un certain point ou dans une certaine mesure seulement. Ou, plus exactement, il y a ce dont est capable l’amour mais il y a des limites humaines contre lesquelles on continue à se heurter. L’amour de Maria est grand, sans nul doute, mais, pour qu’il puisse faire véritablement son oeuvre, c’est-à-dire une œuvre de salut, il lui faut peut-être, en quelque sorte, se sacrifier. Jusqu’où aller dans le don de soi ? Quand on est « l’autre continent » d’un homme qui, précisément, n’est plus continent, souffre d’incontinence, quand il le faut soutenir tout en se sentant impuissant devant ses défaillances, n’est-il pas nécessaire de prendre de la distance ? Dans certains cas, au nom même de l’amour, il faut se résoudre à une perte. Ce superbe film, qui prenait, au début, des allures de romance quasi ordinaire, nous a conduits, en fin de compte, vers des sommets de singularité. Et, sans être jamais larmoyant, il a fait palpiter toute la gamme de nos émotions.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190605 – Cinéma
PARASITE
Un film de Bong Joon-ho.
Le film du coréen Bong Joon-ho, film ayant obtenu la Palme d’Or au festival de Cannes, étant d’ores et déjà programmé sur nos écrans, l’on peut juger du degré de pertinence de cette distinction. Pour moi, sans aucun doute, « Douleur et Gloire » de Pedro Almodovar méritait davantage de recevoir cette récompense. Il aurait été judicieux, me semble-t-il, à l’occasion de la sortie d’un de ses meilleurs films, de saluer l’œuvre du cinéaste espagnol. Le jury du festival en a décidé autrement, préférant consacrer un film peut-être plus accessible, plus grand public, il est vrai, que celui d’Almodovar.
Certes, « Parasite » ne manque pas de qualités, il faut le reconnaître. En le voyant, on peut d’ailleurs songer à d’autres films de Bong Joon-ho, à « Snowpiercer » (2013) par exemple, à ce train transportant les rescapés du réchauffement climatique, les pauvres étant relégués en queue du convoi tandis que les riches se pavanent à sa tête, à la révolte des miséreux s’efforçant de passer de wagon en wagon jusqu’à affronter les puissants. Dans « Parasite » aussi, les défavorisés vivent dans des bas-fonds sordides tandis que les riches, dans leurs luxueuses habitations des hauteurs de la ville, jouissent sans restriction de tous les conforts possibles. On ne peut pas ne pas songer à « Métropolis » (1927), le film mythique de Fritz Lang.
Cela étant dit, le ton adopté par Bong Joon-ho dans « Parasite » se révèle très différent de celui qui prévalait dans « Snowpiercer ». Dans le nouveau film, l’humeur est plutôt joyeuse, détendue, mais également tout imprégnée de ruse, voire carrément retorse. La famille de pauvres, père, mère, fils et fille, que met en scène le cinéaste, n’est pas du genre à se plaindre. Pour eux, rien ne compte davantage que de manigancer non seulement pour s’en sortir, mais pour s’immiscer chez les riches et, d’une certaine façon, prendre possession d’eux. Se mettre à leur place. Profiter sans scrupule de leur petit paradis qui semble pourtant si bien protégé.
Pour en arriver là, le cinéaste coréen imagine, pour ses pauvres, tout un jeu de dupes à laquelle la famille des riches se laisse prendre. On peut d’ailleurs estimer qu’ils sont d’une grande naïveté, ces riches, pour se laisser pigeonner ainsi. Mais c’est là, précisément, à mon avis, un des points faibles du film qui, à force de vouloir trop caractériser les personnages, les rend à la fois grotesques et caricaturaux à l’excès. Le réalisateur a certes préféré la satire plutôt que le réalisme, mais c’est un peu au détriment de la vraisemblance, me semble-t-il.
Reste qu’on peut prendre un grand plaisir à voir ce film et à s’en amuser, malgré ses outrances. Je me garderais d’en raconter les péripéties afin de ne pas en éventer les surprises. Or, des coups de théâtre, il n’en manque pas, dans ce film, surtout lorsque sont découverts d’autres parasites que ceux qui s’annonçaient dès le début du film. La maison des riches, à elle seule, est une des grandes trouvailles du film, une maison qui dissimule des secrets inattendus.
Le film a ses faiblesses, mais il comporte, néanmoins, un grand nombre d’idées de scénario ingénieuses. L’une des plus astucieuses a un rapport avec l’odeur, celle des pauvres en l’occurrence, et le petit garçon de la famille des riches (un petit garçon qui aime jouer aux Indiens !) ne s’y trompe pas. Une autre surgit lorsque des protagonistes essaient de communiquer grâce à l’alphabet morse. Une fois encore, c’est le petit garçon qui, ayant pris ses leçons chez les scouts, déchiffre ce que ses parents ne sont pas capables d’imaginer. Bienvenues, ces idées-là, et quelques autres, introduisent de la subtilité dans une histoire qui, sinon, paraîtrait tout de même assez rudimentaire.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190528 – Textes et Chansons
RÊVES AMÉRICAINS, TOME 2 : LA GRANDE CRISE
Un album de textes et de chansons de Thomas Hellman.
S’il est des musiciens et chanteurs qui sortent des sentiers battus afin de proposer quelque chose d’original, le québécois Thomas Hellman compte sans conteste parmi ceux-là. Il fait paraître aujourd’hui le deuxième volume d’une série d’albums revisitant, de manière forte et innovante, l’histoire américaine. Après un premier tome, lancé en 2015, qui était consacré à la ruée vers l’or, voici donc, en guise de deuxième volume, une évocation de la Grande Crise.
Par la vertu de ses récits et de ses chansons, l’artiste emporte irrésistiblement l’auditeur dans son voyage. Quand sa voix raconte, toujours en français et toujours accompagné d’une musique appropriée, on n’a pas de peine à écouter. On est même captivé, car la voix de Thomas Hellman parvient sans peine à susciter l’intérêt : elle est belle, elle est faite pour la narration. Mais elle convient aussi aux chants : car les parties chantées (le plus souvent en anglais, parfois en français) sont, elles, toujours irrésistibles. On y devine l’influence de grands chanteurs folks engagés comme Pete Seeger. Somptueusement arrangées, magnifiées par d’excellents musiciens (banjo, guitare, piano, dulcimer, percussions, contrebasse), toutes les chansons séduisent sans restriction.
Les textes empruntent aux grands écrivains américains comme Steinbeck et évoquent, avec justesse, avec émotion, la complexité de l’Amérique, des rêves qu’elle a suscités et des souffrances qu’elle a prodiguées à plus d’un de ses aventuriers. Oui, il est passionnant de parcourir le territoire des États-Unis et d’en relire l’histoire en compagnie de Thomas Hellman. C’est un voyage dans l’espace et dans le temps qui ne peut laisser indifférent. Tout ce que l’Amérique offre en fait de grandeur et de misère humaines est bien au rendez-vous : après les avoir convoquées par le biais des chercheurs d’or dans le premier volume, c’est au temps de la Grande Crise que nous emporte le deuxième, un temps où l’on rêve d’industrialisation, un temps où l’on peut tout perdre d’un jour à l’autre, un temps qui multiplie les misères et envoie sur les routes une multitude de vagabonds faméliques. L’Amérique a ses beautés et ses cruautés, Thomas Hellman ne les ignore ni les unes ni les autres. Avec lui, quoi qu’il en soit, le voyage est palpitant.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190524 – Théatre
L’ÉTAT DE SIÈGE
Une pièce de théâtre d’Albert Camus.
Il y a un point commun entre La Mouette d’Anton Tchekhov, pièce que proposait en juin 2018 la Troupe Réplic’Pus (et dans laquelle je jouais le rôle de Sorine), et L’État de Siège d’Albert Camus, pièce que la même troupe présente cette année (et dans laquelle je joue plusieurs des personnages). Ce point commun, c’est que la première représentation de chacune des deux pièces se solda par un four ! Mais la comparaison s’arrête là, car, si La Mouette n’a pas tardé à être reconnue à juste titre comme un chef d’œuvre du répertoire, il n’en est pas de même pour ce qui concerne la pièce de Camus. Elle demeure toujours aujourd’hui l’œuvre théâtrale la moins connue de cet auteur et, si elle est néanmoins quelquefois montée et jouée, personne n’a la prétention, je suppose, de la hisser au même niveau que Caligula ou Les Justes.
Faut-il donc la considérer comme indéniablement mineure, voire ratée ? Non, bien sûr. Si L’État de Siège souffre de quelques imperfections, elle n’en est pas moins une pièce remarquable par bien des aspects et son sujet (on pourrait ajouter : malheureusement) reste brûlant d’actualité. Représentée pour la première fois en octobre 1948, elle prend en compte le contexte politique de l’époque, elle questionne un siècle déjà funestement marqué par les dictatures, voire les totalitarismes, et leurs terribles conséquences. Nul besoin de se perdre en explications pour amener le spectateur d’aujourd’hui à admettre que la pièce a gardé sa pertinence. Les montées des populismes et des extrémismes auxquelles nous assistons de nos jours devraient suffire à emporter l’adhésion quant au bien-fondé de la pièce et de sa présentation sur scène.
À Réplic’Pus, troupe qui ne craint pas de relever des défis, nous faisons ce pari de monter et de montrer cette pièce de Camus, quitte à la dépoussiérer un brin, avec la conviction non seulement qu’elle peut mais qu’elle doit nous interpeller. Pour ce faire, il s’agit d’amoindrir ce que la pièce risque d’avoir de trop didactique, voire de trop théorique, pour donner chair aux personnages, y compris à ceux qu’une interprétation malhabile associerait facilement à des symboles, et rien de plus. Le danger, avec cette œuvre de Camus, ce serait d’en faire une pièce à thèse. Or quand on va au théâtre, on n’y va pas pour y entendre un cours de philosophie. Nous nous efforcerons donc de présenter des personnages auxquels on peut s’identifier et non pas simplement des figures abstraites.
Ce point établi, nous ne nous laisserons pas moins toucher par le propos de Camus. Face au mécanisme implacable des oppressions, des dictatures et même des totalitarismes, le courage d’une collectivité (conduite par un audacieux capable de se sacrifier) peut changer le cours de l’histoire. Il n’y a rien d’inéluctable. Ou, comme le dit le personnage de la secrétaire dans la pièce, « il y a une malfaçon dans leur machine ».
« Je ne m’explique pas que la pièce n’ait pas eu de succès, écrivait Jean Grenier, l’un des amis d’Albert Camus, Elle est écrite dans une langue très pleine, dans un style très direct qui porte ; et l’émotion doit se communiquer au spectateur comme à l’acteur ». Grâce à de judicieux choix de mise en scène et au jeu subtil des comédiens, nous sommes sûrs, à Réplic’Pus, de partager ce débordement d’émotion avec les spectateurs ! Venez donc nombreux à l’une des trois représentations que nous vous proposons :
Vendredi 14, mardi 25 et jeudi 27 juin à 20h à l’Espace Bernanos 4, rue du Havre 75009 Paris.
Réplic’Pus propose, d’autre part, Andromaque, la célébrissime pièce de Jean Racine, dans une mise en scène talentueuse, samedi 15, mercredi 19 et mercredi 26 juin au même horaire et dans le même lieu.
Prévente des billets :
https://www.billetweb.fr/letat-de-siege-dalbert-camus&src=agenda
https://www.billetweb.fr/andromaque-de-jean-racine&src=agenda
Luc Schweitzer, ss.cc.
Voici le très bref résumé de L’État de Siège tel qu’il a été rédigé par François Regnault :
« L’état de siège est proclamé », ainsi parle le tyran surgi d’on ne sait où, qui vient prendre le pouvoir dans cette ville tranquille, morte, soumise à un Gouverneur dont le désir est qu’il ne se passe rien. L’opportuniste se nomme la Peste. C’est une fable politique. Camus fait le récit alarmant d’une ville qui sombre dans la dictature : aidé de sa secrétaire (la Mort) et de sbires recrutés sur place (un fonctionnaire servile, un nihiliste accompli, un juge corrompu), la Peste fait régner la terreur : suspension de toutes les libertés, réglementations oppressives et contradictoires, la Peste contamine les sujets au hasard. Au sein de la population, un couple de jeunes amoureux, que leur amour inspire et soutient, choisit de se révolter. En échange de sa vie, le héros verra sa bien-aimée lui survivre et la ville sera sauvée. La Peste s’en ira ailleurs.
20190522 – Cinéma
STUBBY
Un film de Richard Lanni.
Mais c’est la voix de « Depardiou » ! Oui, oui, pas de doute, c’est bien notre Gégé qui a prêté le concours de sa voix pour l’un des personnages de ce film d’animation, un poilu de la Grande Guerre on ne peut plus « frenchy » qui s’efforce de vanter la gastronomie française à un soldat yankee. Enfin, le mot « gastronomie » est un peu fort, il s’agit d’expliquer à l’américain que si les français ont tenu bon dans les tranchées, c’est grâce au fromage et, davantage encore, au jus de la treille ! Ce qui laisse le soldat américain totalement médusé !
Voilà, en tout cas, un film d’animation on ne peut plus recommandable, tout à la gloire d’un des héros les plus inattendus de la Grande Guerre puisqu’il s’agit d’un chien ! Oui, le brave Stubby mérite amplement d’être mis à l’honneur dans ce film à la fois superbe et émouvant. Ses actes de vaillance ont été tels qu’ils lui ont même valu de recevoir le grade de sergent !
C’est qu’il en a fait du beau travail, donnant l’alerte quand des gaz toxiques sont envoyés par l’ennemi sur des soldats et des villageois, contribuant à l’arrestation de soldats allemands et au sauvetage de soldats alliés. Basé sur une histoire véridique, le film retrace avec brio le parcours de la plus incroyable des recrues canines.
S’étant entiché du soldat John Robert Conroy, Stubby, à force de persévérance et d’obstination, réussit donc à embarquer avec le contingent américain et se retrouve en première ligne, dans les tranchées, où sa présence ne tarde pas à être hautement appréciable. Mise en images avec grand talent et racontée avec habileté, l’histoire du chien Stubby donne lieu à des séquences amusantes, à d’autres poignantes, à d’autres encore angoissantes. Même si l’on a affaire à un film d’animation, le réalisateur n’a occulté ni l’horreur ni l’absurdité de la guerre. Certains ordres révoltants de l’état-major y trouvent également leur place, particulièrement celui qui a obligé les soldats à aller une dernière à l’assaut des lignes allemandes le matin du 11 novembre, alors que l’on savait pertinemment que la signature de l’armistice était imminente !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
LE JEUNE AHMED
Un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne.
« Il faut aimer Ahmed, pas le juger », affirment les Frères Dardenne à propos du personnage éponyme de leur nouveau film. On reconnaît bien, dans cette affirmation, la manière de faire des deux réalisateurs, la qualité de leur regard. De film en film, ils n’ont cessé de proposer la bienveillance plutôt que le jugement qui pourrait si facilement glisser vers la condamnation. Pensons, par exemple, au personnage joué par Cécile de France dans « Le Gamin au Vélo » (2011), personnage qui ne se laisse pas priver de sa prévenance envers un enfant dont le comportement pourrait en décourager plus d’un.
Il y a quelque chose du même ordre dans le film qui vient d’être présenté à Cannes. Cette fois-ci, le regard des deux frères se tourne du côté de l’islamisme radical, non pour essayer d’en expliquer les raisons, mais pour approcher au plus près d’un de ceux qui adhèrent à ce courant : un jeune garçon comme il y en a, malheureusement, plus d’un, mais que les Dardenne ont pris soin de ne pas trop identifier aux clichés habituels lorsqu’il est question de ce sujet. Avec ses lunettes et avec sa bouille plutôt avenante, Ahmed ne ressemble guère aux images toutes faites. Dans sa famille, certes, il n’y a pas de père, mais le garçon est aimé par sa mère qui, manifestement, veut le meilleur pour lui. En le voyant, on a le sentiment qu’il est plutôt bien entouré et, néanmoins, on découvre qu’il s’est laissé séduire par les propos inflexibles d’un imam radical.
Ahmed est à un âge où l’on est influençable, un âge où l’on peut facilement se laisser envoûter par un adulte qui s’exprime avec autorité tout en sachant manipuler autrui. Du coup, son regard se transforme et il se met à considérer tout contact avec les femmes comme impur. C’est d’ailleurs devenu l’obsession première de ce garçon que cette question de pureté et d’impureté. On le voit, plusieurs fois, faire ses ablutions non seulement avec soin mais avec une sorte d’acharnement, comme s’il redoutait de conserver sur lui le moindre indice de souillure.
Pourtant, dans son parcours, quelque chose change petit à petit. On le devine à certains signes. Alors que le garçon, parce qu’il a commis un acte d’une extrême gravité envers une femme dont l’imam estime qu’elle est coupable d’apostasie, se retrouve en centre éducatif, quelques indices font entrevoir l’ébauche d’une fêlure dans sa carapace de musulman fondamentaliste. Même s’il semble toujours déterminé à commettre l’irréparable, cherchant à dissimuler ses intentions à ses éducateurs, il n’en reste pas moins qu’il tient à écrire une lettre d’excuse à sa mère. Et puis surtout, il y a la présence d’une jeune fille de son âge, une jeune fille qui s’est entichée de lui et qui profite d’une occasion pour l’embrasser. Tout cela est fort innocent, mais pas aux yeux d’Ahmed, toujours obsédé par la nécessité de rester pur.
Les Dardenne suivent le garçon dans son obstination, à la fois en laissant entrevoir les terribles conséquences qu’elle pourrait avoir et en ménageant une issue envisageable vers quelque chose de l’ordre d’un pardon. Dans le même temps, ils nous rappellent, à bon escient, combien dangereuse s’avère pour les religions (car ce qui est vrai pour les musulmans l’est aussi, par exemple, pour les chrétiens) l’obsession de la pureté. La volonté compulsive d’être purs ou de constituer des communautés de purs, chez les chrétiens comme les musulmans, a pour conséquences automatiques l’intolérance, le jugement, le rejet d’autrui. Il n’est certes pas inutile de le redire à une époque comme la nôtre, alors que partout grandit la menace des extrémismes.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190518 – Cinéma
DOULEUR ET GLOIRE
Un film de Pedro Almodóvar.
C’est quand il puise dans le terreau de sa propre expérience que Pedro Almodóvar réalise ses meilleurs films. Or c’est le cas dans cette nouvelle œuvre qui comptera sans nul doute parmi ce que le cinéaste aura filmé de plus mémorable.
Il n’y a pas besoin d’être très perspicace pour comprendre, dès les premières scènes, que Salvador Mallo (joué par le fidèle complice Antonio Banderas), le personnage central du film, est une sorte d’alter ego du réalisateur. Cinéaste fameux, mais en panne d’inspiration, il apparaît, pour commencer, plongé entre deux eaux, c’est-à-dire entre une possible noyade et une tout aussi éventuelle remontée vers la surface. Son corps couturé est celui d’un homme d’âge mûr qui a dû passer par pas mal de souffrances. Ce que confirme, un peu plus tard, une séquence animée faisant état de toute une kyrielle de douleurs physiques mais aussi mentales. Le cinéaste renommé, plein de gloire, se déclare aussi homme de douleurs et, de ce fait, incapable de réactiver quelque processus de création que ce soit.
Or des évènements, qui ont un rapport avec la mémoire, avec les souvenirs, surviennent et ouvrent les chemins d’une possible renaissance. Mais précisément, quel chemin faut-il prendre pour renaître, pour retrouver le goût du premier désir ? Il y en a un qui s’offre à Salvador en la personne d’un de ses acteurs d’autrefois, un acteur qui ne l’avait pas satisfait et avec qui, fâché, il avait rompu toute relation. Les circonstances font qu’ils se retrouvent et que, réconciliés, se construit entre eux une sorte de connivence, y compris lorsqu’il s’agit de faire usage de drogue. Est-ce là le chemin à emprunter pour apaiser les douleurs et retrouver l’inspiration ?
Heureusement, d’autres réminiscences surgissent. L’une prend la forme d’un homme qui fut, jadis, le grand amour de Salvador. Leurs retrouvailles et même leur baiser donnent lieu à une scène sobre et touchante. Mais le plus beau, le plus émouvant, se hasarde du côté de l’enfance. C’est là, probablement, que se trouve la clé pour pouvoir ouvrir à nouveau le coffre des désirs et se mettre à créer au lieu de se morfondre. Almodóvar orchestre avec un extraordinaire talent les allers et retours entre l’enfance et l’âge mûr.
L’enfant, qui ne savait pas encore ce que son corps recelait de possibles douleurs, l’enfant que le cinéaste se plaît à filmer durant quelques-uns des instants où se manifestent ses goûts, ses talents et sa curiosité. L’enfant qui est désigné comme soliste de la chorale du collège religieux où il est scolarisé. Mais, surtout, l’enfant qui, avec sa mère (jouée par Penelope Cruz), découvre la maison troglodyte où ils sont forcés d’habiter : « une caverne », s’exclame la mère, tandis que l’enfant s’extasie de découvrir une ouverture donnant sur le ciel. L’enfant qui ne s’intéresse pas tant à la tablette de chocolat qui lui est offerte qu’aux images de stars hollywoodiennes qu’elle contient et dont il fait la collection. L’enfant qui aime les livres et qui propose volontiers ses services afin d’enseigner la lecture, l’écriture et le calcul à un bel homme analphabète. L’enfant qui, découvrant la nudité de ce même homme en train de se laver, en est si troublé qu’il s’évanouit.
N’est-ce pas non seulement dans la remémoration mais aussi dans le goût de l’enfance que se trouve sinon la guérison du moins l’apaisement de l’homme tourmenté, improductif et souffrant qu’est devenu Salvador ? Comme écrivait si bien Georges Bernanos, pour qui ce sujet était inépuisable : « Quel artiste est jamais sorti tout à fait de l’enfance ? Disons mieux, il s’y enfonce un peu plus chaque jour, c’est au cœur même de l’enfance, comme à la source de tous les rêves, qu’il va chercher sa terre inconnue. »
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190510 – Cinéma
LOURDES
Un film de Thierry Demaizière et Alban Teurlai.
Lorsque, après être passé par Lourdes en 1891, Émile Zola, saisi par le spectacle de ce qu’il nomme une « cité mystique », a l’idée de se mettre à la rédaction d’une trilogie des « Trois Villes », Lourdes, Rome et Paris, il fait ce qu’il a toujours entrepris pour chacun des romans de la série des « Rougon-Macquart », il séjourne sur les lieux afin d’enquêter sur la réalité qu’il souhaite décrire. En 1892 donc, de retour à la cité mariale, curieux de tout et s’étant bien documenté, il rédige un témoignage non dénué d’intérêt sur le pèlerinage, les malades, les foules ferventes, mais aussi le commerce qui prospère autour du sanctuaire. Cependant, si son enquête journalistique est sérieuse, son regard n’en demeure pas moins altéré par ses à priori de scepticisme. Pour lui, l’arrivée des malades en gare de Lourdes n’est qu’un « défilé affreux ». Il estime que la grotte, la basilique, les piscines et l’hôpital sont « à pleurer de laideur ». Même s’il compatit à la souffrance des malades, il va sans dire qu’il n’accorde aucun crédit aux miracles. Quant à Bernadette, il la considère comme n’étant qu’une « simple d’esprit, très ordinaire ». En somme, en dépit de ses compétences journalistiques, Zola ne voit à Lourdes que ce qu’il y cherche et rien de plus, ce qui lui vaut d’être affublé par Léon Bloy, qui n’y allait pas de main morte, du surnom de « crétin des Pyrénées » !
Tout autre est le regard adopté par les réalisateurs du film sur Lourdes qui vient de sortir en salles. Si Thierry Demaizière et Alban Teurlai ne se déclarent pas davantage croyants que ne le fut Émile Zola et si, comme l’écrivain, ils ont tenu à s’immerger dans la réalité de la cité mariale, y demeurant pendant dix mois, c’est, au bout du compte, pour proposer une tout autre vision de la cité mariale et de celles et ceux qui y vont en pèlerinage. Ce qui frappe d’emblée, quand on voit ce film, c’est la beauté. Là où Zola s’était désolé de ce qu’il estimait être laid, ils ont vu, eux, de la beauté et ils ont su la transmettre par leurs images. Les corps abimés des malades ne sont certes pas occultés, au contraire, et cependant le film parvient à mettre en évidence, à tout instant, autre chose que le constat des difformités physiques qui saute aux yeux. Il émane de la beauté, certes oui, lorsque des femmes et des hommes se mettent en prière, quelle que soit l’apparence.
Dès la première scène montrant une main, puis plusieurs mains, caressant la pierre de la grotte, la pierre polie par la foule innombrable de ceux qui l’ont touchée, on devine que l’approche des deux réalisateurs n’a rien de banal. Excepté à l’occasion d’un ou deux plans de la fin du film, ils laissent de côté les commerces pour mieux s’imprégner de ce qui se passe à la grotte et à ses alentours. Les hommes et les femmes en prière, prière individuelle, prière de foule, sont filmés avec à la fois du respect et de la bienveillance. Mais si le film de Thierry Demaizière et Alban Teurlai passionne et bouleverse, c’est parce que tous deux ont opté pour la méthode la plus judicieuse, qui consiste à se polariser sur quelques-uns des nombreux pèlerins de Lourdes.
Quelques-uns parmi tant d’autres, venus prier Marie, dans l’espérance d’un miracle peut-être, mais surtout d’un réconfort et d’un surcroit de force pour mieux affronter les vicissitudes de la vie. Cela passe par le rapport aux corps, omniprésents tout au long du film et pour cause, les malades ayant besoin d’être souvent soignés, manipulés. Et cela passe par les mots simples des prières, dont quelques-unes se font entendre au cours du film. Comment ne pas être touché par un père qui prie pour ses enfants malades, par un homme quasi paralysé du fait de la maladie de Charcot ou par une adolescente qui supplie Marie afin de ne plus avoir à subir les moqueries des jeunes de son âge et dont la prière s’achève en sanglots ? Comment ne pas sourire aussi en entendant une femme pleine de compassion pour la Vierge qui, la pauvre, ne peut pas guérir tous les malades de Lourdes, il y en a beaucoup trop !? Comment ne pas être bouleversés par les prostitué(e)s du Bois de Boulogne et, tout particulièrement, par un travesti à qui le prêtre qui l’accompagne demande d’être servant d’autel ?
On n’en finirait pas d’énumérer toutes les scènes émouvantes de ce superbe film. Peut-être faut-il se mettre tout particulièrement à l’écoute des gens du voyage, des gitans, qui ont installé leurs caravanes aux abords du sanctuaire. Car ce sont eux qui, par excellence, trouvent les mots les plus appropriés pour parler de Lourdes et des foules qui s’y pressent. Comme le dit l’un des membres de ce groupe, après avoir rappelé avec quelle promptitude on rejette partout les gens du voyage, à Lourdes, auprès de Marie, chaque personne est la bienvenue. La Vierge n’expulse personne. A Lourdes, ajoute-t-il, c’est comme au temps de Jésus. Ceux qui venaient à lui, c’était les pécheurs, les boiteux, les aveugles, les lépreux, les malades de toutes sortes. Et Jésus les accueillait tous. Ceux qui, aujourd’hui, viennent prier Marie à la grotte ne sont pas différents, ce sont les pécheurs et les malades d’aujourd’hui. Marie les accueille tous, quel que soit le poids de leur vie. Pour ces mots-là et tous ceux qu’ils ont su capter, pour le regard bienveillant, mais jamais empreint de pitié, encore moins voyeuriste, avec lequel ils ont filmé Lourdes et ses pèlerins, il faut, sans nul doute, saluer le mémorable travail accompli par les deux réalisateurs de ce documentaire.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190505 – Cinéma
GLORIA BELL
Un film de Sebastián Lelio.
Dans « Gloria », son quatrième long-métrage, en 2013, le chilien Sebastián Lelio avait confié le rôle-titre à Paulina Garcia, une actrice de son pays dont la prestation avait été si remarquée qu’elle lui avait valu un Ours d’argent de la meilleure actrice à la Berlinale 2013. Non content de ce succès, le cinéaste récidive en proposant aujourd’hui le remake de son propre film, mais situé, cette fois, du côté des États-Unis, très précisément à Los Angeles où Gloria (à qui est accordée Bell comme nom de famille) travaille dans un cabinet d’assurances. Le réalisateur chilien rejoint ainsi le groupe assez restreint des réalisateurs ayant tourné un remake d’un de leurs propres films (avec Hitchcock, Leo McCarey ou Raoul Walsh, parmi d’autres).
La bonne, l’excellente raison, d’aller voir « Gloria Bell », même si l’on a déjà vu la version de 2013, c’est que l’actrice Julianne Moore, à qui, cette fois-ci, est confiée le rôle principal, n’a rien à envier à sa consoeur chilienne. Son interprétation, remarquable, emporte le film tout entier vers des idéaux de subtilité et d’émotion. Et l’on ne peut être que profondément touché par un personnage joué, interprété, avec autant de raffinement.
Pourtant, Gloria Bell n’est pas quelqu’un d’extraordinaire. On pourrait même dire que c’est quelqu’un d’ordinaire (si toutefois ce mot peut réellement désigner qui que ce soit). Divorcée depuis longue date, mère d’un fils, dont le mariage va déjà à vau-l’eau, et d’une fille qui projette d’aller faire sa vie loin de Los Angeles, Gloria Bell s’efforce de goûter encore à la vie et, même, si possible, de se construire une vie heureuse. Pour ce faire, elle participe à des groupes d’expression corporelle et fréquente des lieux où l’on danse.
C’est ainsi qu’elle rencontre Arnold (John Turturro), homme esseulé mais ne manquant pas de charme depuis qu’il a réussi à se guérir d’une obésité. Gloria, en tout cas, se laisse séduire et entrevoit un bonheur possible en compagnie de cet homme. Tous deux partagent d’ailleurs des moments de complicité et d’épanouissement mutuels. Mais tout n’est pas si simple et Gloria Bell s’effraie du trop grand désir de son partenaire. Ce que montre parfaitement le film et ce que joue idéalement Julianne Moore, c’est l’évanescence du bonheur. Quand on croit le tenir, il est déjà ailleurs. Ou, comme chantait Léo Ferré, « le bonheur, c’est du chagrin qui se repose ». Il faut donc s’efforcer de ne pas réveiller le chagrin, ce qui, bien sûr, n’est pas possible.
Dans le film, une scène, assez brève, donne à elle seule, d’une certaine façon, tout son contenu. On y voit Gloria Bell, en compagnie d’autres personnes, lors d’une séance d’expression de groupe. L’exercice proposé par l’animateur consiste à croiser ses mains au-dessus de la poitrine et à rire à gorge déployé. Gloria Bell, comme toutes les personnes présentes, rit, elle rit très fort, tout le monde rit, mais d’un rire forcé, un rire qui sonne faux. Comme s’il fallait présenter aux autres un visage heureux alors qu’au fond, c’est le malheur qui est là et c’est lui qui l’emporte. Mais cela, bien sûr, il ne faut le montrer à personne. Julianne Moore, elle, se surpasse sur ce terrain-là : elle ressemble à quelqu’un d’enjoué mais l’on perçoit constamment combien son entrain est fragile.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190429 – Cinéma
90’s
Un film de Jonah Hill.
Comme pas mal d’autres actrices et acteurs avant lui, Jonah Hill, après avoir affirmé son talent devant la caméra (par exemple dans des comédies régressives comme « Supergrave », mais aussi dans « Le Loup de Wall Street » de Martin Scorsese), se décide maintenant à franchir le cap de la réalisation, ce qui lui permet d’affirmer, dans une interview, qu’il a enfin l’impression, ce faisant, d’être lui-même. Or le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il démontre, avec ce film, autant, sinon plus, de capacité que quand il se produit en tant qu’acteur.
Souvent lorsqu’on réalise un premier film, on cherche son inspiration dans un registre que l’on connaît bien, on explore du côté de sa propre histoire. C’est sans nul doute le cas dans ce film qui se déroule dans le Los Angeles des années 90, là même où le réalisateur a grandi. Si le film n’est pas strictement autobiographique, il est, en tout cas, imprégné de l’expérience même de son auteur. C’est une des raisons pour lesquelles on est gagné, dès les premières scènes, en tant que spectateur, par une impression d’authenticité, de parfaite justesse du propos.
Tout jeune adolescent de 13 ans, le personnage central du film, Stevie (formidablement interprété par Sunny Suljic), ronge son frein aux côtés de sa mère et de son frère aîné, ce dernier lui prodiguant volontiers à la fois son mépris et ses accès de violence caractérielle. Surtout, Ian, ce frère aîné, interdit formellement à Stevie de pénétrer dans sa chambre en son absence, défense que bien sûr celui-ci enfreint dès que possible, d’autant plus que la pièce regorge d’objets qui le fascinent : matériel de sport et, surtout, cassettes et cd de musique dont il recopie, presque religieusement, chacun des titres dans un carnet.
Mais c’est ailleurs, hors du clan familial, que l’adolescent trouve ce qui lui convient. Ce qu’il ne peut trouver chez lui, il le cherche du côté d’un groupe de quatre garçons plus âgés que lui de deux ou trois ans (ce qui est considérable au temps de l’adolescence). Pourtant, malgré cette différence d’âge, Stevie parvient, sans trop de difficultés, à intégrer cette petite troupe ayant une passion commune, le skate. Pour faire partie de la bande, lui-même s’efforce d’acquérir un skate et de s’en servir avec autant de savoir-faire que possible. Il n’égalera jamais les prouesses de ses compagnons, mais ses efforts suffisent à le faire accepter par ceux-ci.
Auprès de ces garçons-là, Stevie ne se contente pas de faire des progrès en skate. Il est également initié à leurs codes, à leur langage fleuri, aux cigarettes, à la musique, etc. C’est aussi, bien sûr, grâce à cet environnement, si l’on peut dire, que l’adolescent connaît sa première véritable expérience sexuelle. Avec eux, avec la bande des quatre, il est même prêt à faire le casse-cou pour montrer de quoi il est capable. Jonah Hill compare ces rites d’initiation à ce qui se passe dans le règne animal quand « un petit se pointe et apprend à survivre et à se construire au milieu de la meute ».
Il y a de cela, en effet, mais il y a aussi ce qui différencie l’expérience humaine de l’expérience animale, le changement de regard. Et c’est en cela, à mon avis, que ce film atteint des sommets de finesse et d’intelligence du propos. Certes, on ne peut qu’être impressionné par la maîtrise fulgurante de la réalisation, par des mouvements de caméra stupéfiants, par une bande musicale du tonnerre, mais le plus touchant, c’est que tout ce talent de mise en scène est au service d’un scénario qui fait mouche et qui repose sur un point de vue ne manquant pas de pertinence. Car que nous dit le cinéaste, en fin de compte ? Que l’on a tort de trop rapidement cataloguer les autres ! Les jeunes qu’on voit évoluer dans le film, il est facile et tentant de leur mettre une étiquette dévalorisante du genre « racailles » ou « bons à rien ». Or, avec une subtilité qui n’est jamais prise en défaut, le réalisateur s’emploie à abattre ces préjugés. La mère elle-même de Stevie, une mère qui a toutes les raisons d’exercer son mépris à l’égard de la bande qui a séduit son fils, finit par changer de regard, et c’est un des plus beaux moments du film.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190419 – Cinéma
LA FLOR
Un film de Mariano Llinás.
L’expression généralement adoptée à propos de ce film hors norme de l’argentin Mariano Llinás est celle de « film-monstre ». Mais peut-être vaudrait-il mieux parler de « film-monde » ou, tout simplement, de bouquet d’histoires. S’il y a quelque chose de monstrueux dans cette œuvre, cela résulte de sa durée tout à fait inhabituelle : 13 heures 30 de cinéma ! De quoi décourager plus d’un spectateur ! A tort d’ailleurs car cette durée, si elle est réelle, n’en est pas moins également trompeuse. Nombreux sont, aujourd’hui, ceux qui se repaissent de séries télévisées qui, au bout du compte, dépassent de beaucoup la durée de « La Flor ». De plus, ce film de Mariano Llinás est projeté sur les écrans en quatre parties (chacune d’entre elles durant un peu moins de 3 heures 30 !) et six épisodes. Du coup, cela devient plus abordable, à condition de réussir à voir chacune des quatre parties, le film étant programmé dans un nombre restreint de salles et à des horaires pas toujours très commodes !
Pour ce qui me concerne, en tout cas, c’est chose faite, et, qui plus est, j’ai toutes les raisons de m’en réjouir. Car voilà un film qui n’est pas seulement inhabituel du fait de sa durée, mais aussi du fait de son contenu et du fait de son style (ou de ses styles). J’ai indiqué que le film comporte six épisodes (de longueurs très inégales) ; or chacun d’eux se réfère à un genre particulier de l’histoire du cinéma, le tout composant, d’après le réalisateur lui-même qui représente son projet par un dessin (celui qui figure sur l’affiche), une sorte de fleur.
Mais puisque Mariano Llinás prend la peine de présenter lui-même son œuvre, laissons-lui la parole. « La Flor, dit-il, cambriole le cinéma en six épisodes. Chaque épisode correspond à un genre cinématographique. Le premier est une série B, comme les Américains avaient l’habitude d’en faire. Le second est un mélodrame musical avec une pointe de mystère. Le troisième est un film d’espionnage. Le quatrième est une mise en abime du cinéma. Le cinquième revisite un vieux film français. Le sixième parle de femmes captives au XIXème siècle. Mon tout forme La Flor. »
Comme on peut le comprendre, ne serait-ce qu’en se basant sur cette présentation, il ne s’agit nullement, pour le réalisateur, de concurrencer, sur grand écran, les séries télévisées. Son projet est différent et s’il faut lui trouver des équivalences, cherchons-les du côté de la littérature. Le cinéaste argentin propose, avec ce film, comme un recueil d’histoires de différents types, un peu comme le font des écrivains qui agencent une collection de nouvelles pour en faire un ouvrage. Ce rapprochement est d’autant plus pertinent que les références à la littérature ne manquent pas dans l’un ou l’autre des épisodes de « La Flor ».
D’ailleurs, si Mariano Llinás ne se prive pas de lorgner du côté de la littérature, il le fait aussi en affirmant son admiration pour la bande dessinée et, en particulier, pour celle d’Hergé. Dans le premier épisode, une mystérieuse momie rappelle à s’y méprendre celle de Rascar Capac dans « Les Sept Boules de cristal » et, dans le troisième épisode, un personnage inquiétant se nomme Casterman, comme l’éditeur de Tintin. Mais c’est le style lui-même adopté par le cinéaste qui, dans ces épisodes, rappelle celui de la BD. Que ce soit par leurs angles de caméra, par la composition de leurs plans, par leurs découpages, ces épisodes semblent fortement imprégnés d’un univers de BD.
Cela étant, chacun des six épisodes du film possède sa marque propre et son style particulier. Le deuxième (peut-être le plus ambitieux et le plus émouvant de tous) est un drame musical. Le cinquième est réalisé en forme d’hommage presque entièrement muet à un film de Jean Renoir (« Partie de campagne » – 1936). Le sixième est un film expérimental se basant sur le récit de l’errance de quatre femmes dans le désert au XIXème siècle. Ces deux derniers épisodes sont aussi les plus courts du film.
Manifestement, Mariano Llinás, malgré le peu de moyens dont il disposait, n’a voulu se priver de rien. Si le cinquième épisode est presque totalement silencieux, les autres, au contraire, sont truffés de dialogues et de voix off, sans compter les plages musicales, extrêmement présentes, parfois sublimes (comme dans la quatrième partie où le cinéaste prend le temps de filmer longuement ses quatre actrices tandis que se fait entendre un concerto pour piano). Le cinéaste ose toutes sortes de digressions, de péripéties rocambolesques, d’aventures extravagantes, en ne cherchant jamais à construire des récits bien ficelés. Son plaisir, c’est de raconter.
Y a-t-il un lien entre les six épisodes du film ? Oui, et je viens de l’indiquer en évoquant quatre actrices : Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa et Laura Paredes. Ce sont elles qui font le lien entre les différents épisodes (sauf le cinquième où elles n’apparaissent pas, car il faut toujours une exception !). Elles endossent, toutes quatre, des rôles différents dans chacun des épisodes, mais elles sont là et l’on a le sentiment que le réalisateur a imaginé ses histoires pour elles. Elles sont l’âme, la force et la beauté du film. Fondatrices et membres d’un collectif de théâtre, elles ont été repérées et choisies par Mariano Llinás qui, comme il le dit lui-même, a voulu « montrer la palette des talents de ces quatre comédiennes ». Avec elles, c’est sûr, sans être jamais propagandiste, le film est formidablement féministe, et c’est une de ses qualités les plus opportunes.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190401 – Cinéma
DUMBO
Un film de Tim Burton.
À l’heure où les cinéphiles déplorent la perte d’Agnès Varda, une artiste incomparable, curieuse de tout, qui fit, souvent avec de tout petits moyens, des films gorgés d’humanité, paraît sur les écrans, entre autres, ce nouveau film de Tim Burton, film à gros budget qu’on pourrait facilement mettre en opposition avec l’univers subtil de la première. En vérité, ce n’est pas si simple et il est toujours assez peu judicieux de mettre des étiquettes aux artistes afin de les comparer. Agnès Varda, femme libre s’il en fut, réalisait avec le même appétit un film sur Jane Birkin et un autre sur les habitants de la rue Daguerre (Paris XIVème). Quand on est un simple spectateur, on peut fort bien, avec la même liberté d’esprit et la même gourmandise, apprécier un film d’auteur tout comme se délecter de l’adaptation, par le cinéaste américain, du classique de Disney datant de 1947.
Nombre de critiques se sont accordés à souligner, ces dernières années, le supposé manque d’inspiration de Tim Burton, cinéaste qui, dans ses œuvres les plus récentes, semblait avoir perdu beaucoup de ce qui faisait l’originalité de ses premiers films. Ces jugements, trop sévères à mon avis, ne manquaient cependant pas de justifications. Quoi qu’il en soit, l’adaptation de « Dumbo », qui sort aujourd’hui, a de quoi rassurer : nul doute que le cinéaste a trouvé là une histoire à sa convenance.
Le film qu’il a réalisé est, en tout cas, un régal pour l’intelligence comme pour les yeux. On y retrouve d’ailleurs sans peine les obsessions du cinéaste et, en particulier, l’attrait qu’ont souvent exercé sur lui les êtres marqués par une différence et qui, de ce fait, se trouvent incompris, marginalisés, rejetés, moqués. Dès le début du film, le train qui ramène au cirque Medici un revenant de la guerre de 14, amputé d’un bras, semble avoir un drôle d’air sarcastique. Au cirque, ce dernier (Colin Farrell) espère retrouver son emploi et surtout ses deux enfants, Joe et Milly. Ils sont bien là, tous les deux, et l’on n’est pas près de les quitter, car ce sont eux, les enfants (en particulier Milly, la fille aux grands yeux) qui sauront le mieux se rendre disponibles à l’éléphanteau qui vient de naître. Or l’étrange animal est doté d’oreilles surdimensionnées qui semblent le handicaper mais se révèlent bientôt totalement magiques puisqu’elles lui donnent la capacité de voler comme un oiseau.
Très justement, très finement, Tim Burton tire parti de l’anomalie physique du jeune éléphant pour mettre à nu le cœur des gens. D’abord raillé et moqué par la foule des spectateurs (qui, plus tard, applaudira quand elle assistera à ses performances), l’éléphanteau ne tarde pas à provoquer chez certains quelque chose d’encore moins reluisant que la moquerie : le lucre. Un éléphant capable de voler, voilà qui peut rapporter gros, n’est-ce pas ? Séparé de sa mère, vendu à un rapace nommé Vandemere (Michael Keaton), Dumbo est tout désigné pour devenir le clou du grand show concocté par le magnat dans un parc qui ressemble étrangement (ô ironie !) à un parc de Disneyland, rebaptisé ici Dreamland. Un pays des rêves qui pourrait bien engendrer des cauchemars…
Face aux exploiteurs, face à ceux qu’aucun scrupule ne retient, il reste cependant, nous dit Tim Burton, ceux qui ont encore un cœur pur, Joe et Milly les enfants, leur père, les autres artistes de cirque, par exemple. Les grands moyens, le grand spectacle, les effets spéciaux bluffants, tout est là, tout est remarquable, mais le plus important, décidément, c’est le cœur !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190312 – Cinéma
DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE
Un film de Xavier de Choudens.
Quand il est question de militantisme, d’engagement politique, de combat pour une société plus juste, on en vient souvent à faire le constat que, par rapport à leurs aînés, les plus jeunes semblent moins impliqués, plus en retrait, pour ne pas dire plus égoïstes. Les associations caritatives et les mouvements à caractère politique peinent à recruter, ce que ne contredit d’ailleurs nullement la révolte des gilets jaunes.
Ce constat, cependant, ne peut se suffire, il faut aussitôt le pondérer en observant que ni la générosité, ni l’altruisme, ni le souci des plus faibles ne font défaut aux plus jeunes. La différence d’avec les aînés, c’est qu’ils hésitent peut-être davantage à s’engager à long terme. Mais face aux injustices flagrantes, plus d’un peut se montrer capable d’abnégation, de dévouement, même si ce n’est que pour un temps déterminé et sans besoin de s’inscrire à quelque groupement que ce soit.
Ce film de Xavier de Choudens vient à point nommé pour illustrer ce sujet. Pas plus que sa sœur Mélanie (Camille Lellouche), le personnage central, Damien (Franck Gastambide), n’a éprouvé le besoin de suivre les traces de ses parents qui s’étaient illustrés par leurs engagements politiques et leur militantisme. Mais lorsque l’un des élèves de l’établissement scolaire où il travaille comme surveillant est menacé d’être expulsé avec sa mère du territoire français parce que cette dernière est sans papier, il n’y a guère de place pour l’hésitation. Sans devenir un militant comme son père, Damien prend fait et cause pour l’enfant et sa mère.
Sa détermination est si grande qu’elle le conduit sur des chemins qu’il n’imaginait pas. Quand on se mouille pour les autres, cela peut mener à des situations totalement inattendues. Il faut prendre des décisions qui engagent vraiment, même si, au départ, on ne s’est laissé guider que par un simple élan du cœur. Damien ne changera sans doute pas le monde, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne fait pas les choses à moitié.
D’un point de vue purement cinématographique, il n’y a certes pas de quoi s’extasier avec ce film. Mais qu’importe ! Même s’il paraît par moments quelque peu naïf, le plus important, c’est qu’il fait un bien fou et qu’il est joué par d’excellents interprètes. Que demander de mieux à un tel film ? Dieu sait si on a besoin d’un peu d’optimisme et d’une bonne dose de générosité par les temps qui courent !
7,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190303 – Cinéma
CELLE QUE VOUS CROYEZ
Un film de Safy Nebbou.
Changer d’identité, vouloir entrer dans la peau d’un autre… Ce fantasme avait été remarquablement exploré par Julien Green dans son roman intitulé « Si j’étais vous ». Paru en 1947, ce livre racontait comment un personnage prénommé Fabien se retrouvait doté du pouvoir extraordinaire de devenir à volonté quelqu’un d’autre. Tel un nouveau Protée, il passait d’une apparence à une autre, jusqu’à ce que tout se résolve de manière tragique. Eh bien, ce sujet continue de stimuler l’imagination des raconteurs d’histoires, preuve en est le roman de Camille Laurens intitulé « Celle que vous croyez » (2016) dont voici aujourd’hui l’adaptation au cinéma.
Entre 1947 et aujourd’hui, le sujet s’est même enrichi d’une nouveauté. Ce qui, pour Julien Green, était de l’ordre d’un récit à la limite du fantastique, est aujourd’hui autre chose qu’une simple chimère. Du fait de Facebook et autres réseaux sociaux disponibles sur Internet, il est réellement possible, de nos jours, de prendre une autre identité, un autre nom, une autre apparence. On peut se faire passer pour quelqu’un d’autre et l’on peut tellement se prendre à ce jeu qu’on finit par être réellement une autre personne. Du moins s’en persuade-t-on.
Ce piège redoutable, vertigineux, c’est celui dans lequel tombe Claire (Juliette Binoche), une universitaire, professeure de littérature d’une cinquantaine d’années, à partir du jour où elle réalise que Ludo (Guillaume Gouix), son amant, beaucoup plus jeune qu’elle, l’a plaquée. Résolue à en savoir davantage, Claire cherche à espionner ce dernier sur Facebook et, pour ce faire, se crée une fausse identité. Rien de plus simple : quelques données à enregistrer, quelques clics, et le tour est joué. Or ce jeu dangereux conduit aussitôt Claire à entrer en contact avec quelqu’un d’autre que son ex-amant, en l’occurrence le colocataire de ce dernier, Alex (François Civil), un garçon qui se laisse rapidement enjôler. Se faisant passer pour Clara, une jeune femme de 24 ans, Claire est vite grisée par son pouvoir de séduction, au point qu’elle perd quasiment sa propre identité ou, en tout cas, a du mal à la retrouver. N’est-ce pas enivrant de charmer un beau garçon comme Alex ?
L’engrenage des mensonges donne le vertige. C’est magique, d’être quelqu’un d’autre, quelqu’un de jeune, quelqu’un de désirable. C’est exaltant d’en arriver à échanger par téléphones interposés et de percevoir que l’interlocuteur est sous le charme. Mais les fabulations en engendrent toujours d’autres, ce qu’une psychothérapeute jouée par Nicole Garcia essaie de mettre à nu, afin de faire la vérité là où il n’y a qu’apparence et tromperies. Ces rencontres-consultations ponctuent un film très savamment construit, de manière à égarer quelque peu le spectateur avant de lui donner la clé de ce qu’il vient de voir. Une des surprises du film, c’est précisément d’avoir réussi, à partir d’une idée simple, à construire une intrigue à rebondissements qui lui donne une allure de quasi thriller. Et puis, dans le rôle de Claire, Juliette Binoche excelle : on veut bien la croire quand elle affirme qu’elle n’est plus elle-même mais Clara, son avatar ayant la grâce d’une jeune femme de 24 ans. Ce qui ne l’empêche pas d’être comme transparente aux yeux de son amant virtuel, le jour où tous deux se retrouvent réellement l’un en présence de l’autre. Les petits jeux auxquels on peut se livrer sur Internet ne mènent qu’à des désillusions ou pire encore. N’y a-t-il pas là quelque chose comme une version moderne des « Liaisons dangereuses », l’ouvrage de Choderlos de Laclos que Claire enseigne à ses élèves de l’université ?
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190221- Cinéma
GRÂCE À DIEU
Un film de François Ozon.
« Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car c’est à leurs pareils qu’appartient le Royaume des Cieux » (Mt 19, 14). « …ces mots, écrit Christine Pedotti dans un ouvrage on ne peut plus pertinent intitulé Qu’avez-vous fait de Jésus ?, sonnent désormais comme une condamnation, ils évoquent le spectre de la perversion des abuseurs et l’horreur du système qui les a protégés. » (p. 12) Or, mis à part le Notre Père qui est prié, on pourrait dire imposé, lors d’une des scènes de ce film, le seul extrait des Évangiles dont il y est fait mention, c’est précisément cet extrait-là, lu en séance de catéchisme par Bernard Preynat en personne. Il suffit à François Ozon de cette scène-là et de quelques autres, rappelant les agissements de cet homme à l’occasion des camps de scoutisme qu’il accompagnait ou de ce qui se passait derrière les portes du local « photo » d’une des paroisses où il fut nommé, pour faire entrevoir les crimes dont il est supposé s’être rendu coupable, crimes d’autant plus ignominieux qu’ils furent commis, à de nombreuses reprises, par un homme d’Église. Or, on le sait, le scandale n’est pas seulement le fait d’un homme, mais d’une institution, l’Église, et de ses dirigeants, les évêques, qui ont étouffé sous une chape de silence les agissements de Bernard Preynat et d’autres prêtres supposés coupables de crimes similaires.
Bien sûr, il n’est pas question de se substituer aux décisions de justice ni d’ignorer la présomption d’innocence, ce qui est d’ailleurs indiqué au terme de ce film. François Ozon s’est inspiré d’une affaire fortement médiatisée pour réaliser une fiction, tout en conservant cependant les noms des divers protagonistes. On pourra toujours ergoter à ce sujet. Rien, dans le film, n’a été inventé « qui n’ai déjà été porté à la connaissance du public », comme le rappelle le cinéaste lui-même. Pourquoi peut-on quand même affirmer avoir affaire à une fiction dans ce cas ? Tout simplement parce qu’il ne s’agit pas d’un documentaire sur l’affaire Preynat, mais bel et bien d’un film doté d’un scénario, d’une mise en scène, d’un point de vue de cinéaste et des interprétations de divers acteurs.
Or le point fort le plus évident du film, c’est d’avoir tout misé sur les personnalités et les parcours de trois protagonistes (auxquels on peut adjoindre le personnage joué par Éric Caravaca, mais qui reste plus schématiques que les trois autres). Trois victimes du Père Preynat qui, bien longtemps après les faits, découvrent avec stupeur que ce dernier est toujours en fonction, trois individus aux caractères et aux trajectoires très différents que l’indignation conduit à se rencontrer et à s’unir. C’est une des grandes qualités du film, que de mettre en scène des personnages aussi dissemblables, mais qui ont pour point commun d’avoir été abusés et irrémédiablement perturbés par Bernard Preynat. Des trois, celui qui paraît le plus stable se prénomme Alexandre (Melvil Poupaud). Il donne le sentiment d’avoir une vie rangée : il est marié, père de cinq enfants scolarisés dans un établissement catholique et semble avoir gardé la foi. C’est pourtant par lui que se met en branle l’affaire car c’est lui qui, le premier, découvre que le Père Preynat est toujours en contact avec des enfants. C’est lui aussi qui, le premier, écrit au cardinal Barbarin, avant de se mettre à rechercher d’autres victimes du prêtre. C’est ainsi qu’il fait connaissance avec François (Denis Ménochet), un homme marié, mais ayant perdu la foi et ayant refoulé le souvenir des agressions qu’il a subies lorsqu’il était enfant. Homme impétueux, il s’emporte facilement, au point d’éveiller de l’exaspération chez ses proches et, en particulier, chez son frère. Enfin surgit Emmanuel (Swann Arlaud), celui qui, des trois, est le plus marqué, celui qui, en tout cas, mène la vie la plus chaotique. Souffrant de crises d’épilepsie, il estime n’avoir rien fait de sa vie, tout en ayant pour point d’appui sa mère (Josiane Balasko).
Aussi différents soient-ils sur les plans des caractères et des itinéraires de vie, tous trois se rejoignent au moins sur un point : après des décennies de silence, ils osent prendre la parole ! Ce n’est pas pour rien si l’association qui les rassemble se nomme « La Parole libérée ». C’est là, leur grande victoire ! Pouvoir enfin parler, après avoir été contraints au silence à cause des convenances ou de la peur ou simplement du regard d’autrui. Pouvoir parler, même en prenant le risque d’agacer des proches. En fin de compte, le voilà, le grand sujet de ce film : oser prendre la parole. Il faut d’ailleurs remarquer que si, parmi les proches des trois protagonistes principaux, il en est qui réagissent par de l’exaspération, il en est d’autres qui, au contraire, se distinguent par leur soutien. C’est, tout particulièrement, le cas des femmes ou, en tout cas, de certaines d’entre elles, comme l’épouse d’Alexandre ou la mère d’Emmanuel. Dans ce film d’hommes fragilisés, elles font parfois preuve d’une force et d’une détermination qui sont exemplaires et qui font du bien.
« Ce que je fais, affirme l’un des personnages, ce n’est pas contre l’Église, c’est pour elle ». Cette phrase peut s’appliquer au film de François Ozon dans son ensemble. Puisse-t-il contribuer, à sa manière, non seulement à une prise de conscience mais à des changements, voire à des réformes de fond, dans l’Église catholique ! Il y a encore beaucoup de pain sur la planche !
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190213 – Cinéma
LES DRAPEAUX DE PAPIER
Un film de Nathan Ambriosoni.
La vision de ce film a fait surgir, en ma mémoire, plus d’un visage. Comment ne pas songer à tous les détenus qu’il m’a été donné de connaître durant les quelques années où je fus l’aumônier du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin ? Et je pense, en particulier, à ceux qui, alors que je les avais rencontrés régulièrement sur une durée plus ou moins longue, m’annonçaient un beau jour leur libération prochaine. Plus d’une fois, en ces circonstances, je perçus chez mes interlocuteurs autant d’appréhension que de joie. Et plus la peine d’emprisonnement avait été longue, plus la crainte était perceptible. Bien sûr, la plupart des détenus se réjouissaient lorsqu’arrivait l’heure du départ. Mais combien se demandaient avec angoisse ce que serait leur vie hors de la prison, qui ils allaient revoir, comment se passeraient les retrouvailles, ce qu’ils pourraient faire pour vivre le plus dignement possible ? Parmi eux, certains, je m’en souviens fort bien, ne savaient pas où aller ni qui accepterait de les héberger. J’en ai vu plus d’un, égarés, perdus, tenant en mains le sac poubelle qui leur avait été remis pour porter leurs affaires. Bien sûr, à l’intérieur des centres pénitentiaires, il y a un personnel chargé de l’accompagnement des détenus, mais, comme on le sait, les prisons sont surchargées et il est difficile, sinon impossible, de préparer, comme il faudrait, chaque détenu à son retour à la vie libre.
Ces réalités, ces difficultés de réinsertion quand on sort de prison, Nathan Ambrosioni, le réalisateur des « Drapeaux de papier », les a remarquablement intégrées dans la construction du récit qu’il a imaginé et mis en scène. Lorsque Vincent (Guillaume Gouix) retrouve la liberté, il a derrière lui 12 années d’incarcération. Il a tout à redécouvrir, tout à réapprendre et, pour ce faire, il compte sur le soutien de sa sœur Charlie (Noémie Merlant). Quand cette dernière le voit réapparaître, elle accepte, presque malgré elle, de l’héberger, sachant bien qu’il n’a pas d’autre solution. La cohabitation, évidemment, ne sera pas toujours au beau fixe. Même si elle rêve d’être une artiste et de vivre de ses talents de dessinatrice, la réalité de l’existence de Charlie s’avère beaucoup plus prosaïque : elle est caissière dans un supermarché et se bat au quotidien avec ses difficultés financières. Elle exige donc de Vincent qu’il se trouve un emploi. Ce qui pose à celui-ci un dilemme : faut-il avouer la vérité ou s’efforcer de mentir ? Quel employeur donnera sa chance à un homme qui sort de prison ?
Pour compliquer encore la situation, il s’avère que Vincent est sujet à des troubles du comportement qui peuvent se manifester par des accès de violence. Et les entretiens avec une psychologue, qui lui ont été prescrits, ne suffisent pas nécessairement à les canaliser. Et puis, il y a la figure du père. Un père qui a renié son fils et qui apparaît, cependant, sans se douter qu’il sera en présence de ce dernier. La scène qui réunit Charlie, Vincent et leur père autour d’une même table est particulièrement intense, émotionnellement très forte et spécialement bien dirigée : tout y converge sur une question de regard (ou de son refus).
Cela dit, de grandes qualités de mise en scène sont également présentes tout au long du film. Nathan Ambrosioni a judicieusement choisi de privilégier les gros plans, ce qui, dans une histoire telle que celle-ci, qui fait la part belle à deux personnages, à leurs émotions respectives, convient à merveille. Quant aux performances des deux interprètes principaux, elles méritent tous les éloges. Guillaume Gouix incarne parfaitement un personnage à la fois fragile, déboussolé et capable de soudaines poussées de violence. Quant à Noémie Merlant, dont le talent ne cesse de s’épanouir de film en film, elle donne à son personnage une extraordinaire densité. Autant de savoir-faire conjugués apportent au film une formidable crédibilité.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190125 – Cinéma
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD
Un film de Peter Farrelly
Avec son frère Bobby, Peter Farrelly s’était spécialisé dans la réalisation de comédies à l’humour décalé, voire régressif. Il nous revient aujourd’hui, seul aux manettes, avec un film sans aucune comparaison avec ce qu’il avait fait jusqu’ici. Plus d’ironie grivoise flirtant avec le mauvais goût, mais l’histoire vraie de deux hommes que rien ne prédisposait à vivre une aventure commune, une histoire contée comme un hymne à la tolérance.
Cette histoire, c’est celle qu’ont vécu ensemble, en 1962, un certain Tony Lip (Viggo Mortensen), agent de sécurité italo-américain, et Don Shirley (Mahershala Ali), un noir, pianiste de jazz de renommée internationale. Or le premier, s’étant temporairement retrouvé sans emploi, est engagé par le second comme chauffeur pour une tournée de concerts d’une durée de deux mois dans le Sud des États-Unis. Dans ces contrées-là, à cette époque, le ségrégationnisme bat encore son plein. C’est donc un périple à haut risque qu’entreprend le musicien noir ayant pour employé un chauffeur blanc. Pourtant, et c’est une des belles révélations du film, alors qu’il pourrait très bien s’en passer, ses concerts dans le Nord étant couronnés de succès, c’est volontairement que Don Shirley souhaite se produire aussi dans le Sud.
Pour ce faire, il faut être muni du « Green Book », dégradant guide de voyage destiné précisément aux Noirs se hasardant à voyager dans le Sud. On y trouve toutes les adresses réservées pour ces derniers, ce qui, théoriquement, doit leur permettre de se soustraire à toute rencontre inopinée avec des Blancs. On imagine que, dans la réalité, ce n’est pas aussi simple, surtout quand on est un musicien noir invité à se produire devant un public de blancs. Plus d’un incident se produit donc fatalement durant le voyage. Il peut certes arriver que des sudistes blancs daignent accueillir le pianiste noir pour un cocktail, mais lorsque ce dernier souhaite se retirer aux toilettes, il se trouve quelqu’un pour lui indiquer que c’est une cabane au fond du jardin qui sert de lieu d’aisance aux Noirs tels que lui ! Petites et grandes brimades, petits et grands mépris ne manquent pas. Sans parler de l’ahurissement de certains policiers lorsqu’ils réalisent qu’un Noir a pour chauffeur un Blanc !
Mais ce qui fait tout l’intérêt du film, ce qui le fait sortir de la triste banalité du racisme, c’est ce qui se joue entre les deux voyageurs formidablement incarnés par des acteurs éblouissants de justesse. Tous les clichés se trouvent irrémédiablement balayés dès le début de leur périple commun, car on a vite fait de comprendre que, des deux, le plus digne et le mieux éduqué, c’est le pianiste noir. Il y a, chez cet homme, une sorte d’élégance naturelle tout à fait appréciable et qui, jamais, ne dévie du côté de quelque arrogance méprisante que ce soit. Quant au chauffeur, même s’il apparaît plutôt rustaud par rapport à son boss, il n’en adopte pas moins un regard de bienveillance, de compréhension, de respect d’autrui qui fait un bien fou. Ce regard plein d’amabilité trouve peut-être son apogée lorsque Tony Lip découvre que Don Shirley est homosexuel. Entre les deux hommes, en vérité, se noue, sinon une amitié, en tout cas une complicité des plus attachantes. Elle se traduit, entre autres, concrètement, lorsque le pianiste noir vient au secours de son chauffeur blanc peinant et suant en s’efforçant d’écrire des lettres à sa femme. Peut-être Don Shirley trouve-t-il en cette connivence de quoi briser un peu sa solitude. Car, tout au long du film, on ressent fortement combien pèse sur lui l’isolement, lui qui a appris le piano en jouant des œuvres de Beethoven ou de Chopin mais à qui on a fait comprendre que ces musiques-là ne convenaient qu’aux blancs et que, par conséquent, lui se devait de ne jouer que des « musiques de nègre » (ainsi est désigné le jazz) !
Ce n’est évidemment pas un hasard si l’aventure commune des deux hommes s’achève à l’occasion de Noël. Dès le début d’ailleurs, Don Shirley avait promis à l’épouse de Tony Lip que celui-ci serait de retour pour le réveillon. Mais il n’est pas interdit d’y percevoir davantage qu’une promesse tenue. Dans l’Amérique très chrétienne, Noël est fêté partout, y compris, bien évidemment, dans le Sud ségrégationniste. On y célèbre la naissance d’un Enfant venu briser toute barrière entre les hommes, et l’on continue pourtant à en ériger. Fugitivement, lors d’une scène en voiture, on aperçoit les effigies des mages en route vers la crèche, les mages figurant tous les peuples de la terre rassemblés autour de l’Enfant. Comment s’arrangent-ils donc, ceux qui affirment leur foi en Jésus-Christ tout en persistant à entretenir, comme si de rien n’était, leurs préjugés, voire leurs haines, xénophobes ? On est en droit de se le demander.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190118 – Cinéma
DOUBLES VIES
Un film de Olivier Assayas.
L’arrivée du numérique qui s’est rapidement imposé dans bien des domaines, bouleversant les habitudes et les repères de plus d’un responsable, valait bien de faire l’objet d’une fiction de cinéma, d’autant plus que le septième art est l’un des secteurs les plus bouleversés par ce phénomène. Mais c’est le monde de l’édition de livres que Olivier Assayas a davantage privilégié dans son film, mettant en scène Alain (Guillaume Canet), le directeur d’une vénérable maison d’éditions, et Léonard (Vincent Macaigne), un écrivain qui s’est spécialisé dans l’autofiction. Autour de ces deux-là gravitent des personnages investis dans d’autres secteurs, en particulier une actrice (jouée par Juliette Binoche) devenue célèbre pour le rôle qu’elle interprète dans une série policière et une attachée parlementaire (jouée par Nora Hamzawi). Sans oublier une séduisante experte de la transition numérique (jouée par Christa Théret).
Tout l’art d’Olivier Assayas est d’avoir réussi à placer tous ces personnages dans des controverses et des débats au sujet du numérique et des problèmes d’édition en général sans jamais verser ni dans la redondance ni dans des discussions oiseuses paraissant déjà complètement dépassées au moment même où elles sont prononcées. Il y a un peu de cela quand même, il faut le reconnaître, et, peut-être que d’ici peu de temps, le film paraîtra avoir pris un gros coup de vieux. Il perdurera néanmoins comme témoin d’une époque de doutes et de remises en question. Entre tel personnage qui ne jure que par l’édition sur papier, se refusant à lire quoi que ce soit sur une tablette ou une liseuse, et tel autre qui, au contraire, trouve que rien ne vaut, de nos jours, l’écriture de livres numériques, de blogs, voire de tweets, il y a de la place pour de multiples opinions. Les données elles-mêmes varient à la vitesse grand V : ainsi au début du film est-il affirmé par un des personnages que l’édition de livres numériques met en péril l’édition sur papier alors que, lors d’une scène suivante, quelqu’un affirme le contraire.
Quoi qu’il en soit de ces discussions sans fin, c’est le rythme imposé au film qui le rend assez captivant. Les répliques fusent sans arrêt, donnant à certaines scènes un ton, une couleur, un tempo qui font songer à quelques-unes des meilleures « screwball comedies » de l’âge d’or du cinéma hollywoodien. Cette comparaison est d’autant plus pertinente que, si le film d’Olivier Assayas prend pour sujet celui de l’arrivée du numérique dans le monde de l’édition, il le fait en l’entrelaçant de marivaudages des plus divertissants. Car, bien sûr, entre les divers personnages du film, s’opère aussi un joli jeu de séductions et de tromperies, un jeu d’autant plus piquant, d’autant plus hasardeux, que l’un d’eux, Léonard, est un écrivain qui ne sait écrire que de l’autofiction. Autrement dit, chacune de ses aventures galantes a de grandes chances d’être racontée en long et en large dans son prochain ouvrage. Et même s’il prend soin d’utiliser des pseudonymes, évidemment, personne n’est dupe, personne ne s’y trompe, les allusions aux personnes réelles demeurent on ne peut plus claires. Or, et c’est la jolie pirouette finale de « Doubles Vies » (que, bien sûr, je me garde de révéler), ce Léonard lui-même, écrivain qui ne sait pondre que ce genre de livres plutôt douteux, même lui est capable de devenir l’auteur d’un chef d’œuvre (à condition que ce ne soit pas dans son domaine de prédilection, celui de l’écriture !).
7,5/10
N.B. : Pour la petite histoire, l’une des scènes de ce film a été tournée à la librairie « Le Merle Moqueur », rue de Bagnolet, Paris XXème, une librairie que je fréquente moi-même très régulièrement. Si régulièrement que j’étais présent sur les lieux, le jour où fut tournée la scène en question !
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190114 – Cinéma
L’HEURE DE LA SORTIE
Un film de Sébastien Marnier.
Les réalisateurs français ne sont pas réputés pour être très doués dans le genre du film fantastique et, en l’occurrence, du thriller fantastique. Il y a cependant, bien entendu, des exceptions et ce film, sans nul doute, en est une. C’est même un film particulièrement réussi, dosant habilement les ingrédients nécessaires au succès d’une telle œuvre. Preuve, s’il est besoin, que, contrairement à ce que certains se plaisent à répéter, il est tout à fait possible de faire du cinéma de qualité en France, ce que vient confirmer, chaque année, un grand nombre de films.
« L’Heure de la Sortie » est formidablement bien écrit et il est réalisé avec une virtuosité confondante. C’est un film assez complexe, en vérité, car il faut, tout du long, se défier de ce qu’on voit à l’écran en acceptant cette évidence qui est que les apparences sont souvent trompeuses. De plus, et c’est une de ses grandes forces, le film se fonde sur des réalités très contemporaines. Qui n’a pas été marqué, de nos jours, par l’abondance, par la fréquence de plus en plus grande, des catastrophes ravageant des régions entières, catastrophes dont on sait bien que beaucoup d’entre elles sont imputables aux changements climatiques ? Qui n’est pas effaré par la profusion d’images de cataclysmes de toutes sortes diffusées sur nos écrans ? Désastres écologiques, attentats terroristes, crises sanitaires, etc. S’est-on suffisamment inquiété de l’impact que peut avoir cette pléthore d’images sur le psychisme et sur le comportement des plus jeunes, sur ceux qui, saturés de reportages terrifiants, risquent de désespérer de leur propre devenir ?
C’est cette réalité anxiogène que le film prend en compte et c’est en se basant sur elle qu’il bâtit une fiction se déroulant dans le cadre d’un établissement scolaire très huppé. C’est là que, suite au suicide d’un enseignant, arrive le professeur de français chargé du remplacement. C’est l’excellent Laurent Lafitte qui joue ce rôle tout en retenue et chargé d’ambiguïté. Car, si ce professeur quadragénaire, célibataire et grand lecteur de Franz Kafka, devient rapidement la cible de quelques-uns des élèves d’une classe de surdoués (ou d’intellectuellement précoces, comme préfère dire le directeur), il ne tarde pas à se changer lui-même en une sorte d’espion de ces derniers. Tandis que ces quelques élèves s’ingénient à le pousser dans ses retranchements, lui ne manque pas une occasion de les épier.
C’est un jeu inquiétant et morbide qui se met en place. Le professeur, victime de jeunes adolescents qui le harcèlent et même le volent, devient le spectateur intrigué, voire fasciné, d’une petite bande, mal vue des autres élèves, qui volontiers s’isole sur le terrain d’une carrière et non loin d’une centrale nucléaire pour se livrer à des activités troubles et dangereuses. Qu’ont donc en tête ces adolescents, quelle pulsion de mort s’est installée en eux, pour qu’ils s’adonnent à des occupations pour le moins risquées, souvent très violentes ? Le professeur n’est pas au bout de ses surprises.
Je n’en dis pas davantage pour ne pas dévoiler une intrigue pleine de rebondissements, de surprises, de tension. Mais je veux saluer encore les qualités d’écriture de ce film qui réussit parfaitement la gageure de créer un fascinant suspense au moyen de personnages perturbés mais jamais caricaturaux. Sans oublier sa forte emprise sociologique et politique. Quelle planète léguons-nous aux jeunes générations ? Et avec quels mensonges (sur la question de l’énergie nucléaire, par exemple) nos gouvernants cherchent-ils à nous illusionner ?
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190111 – Cinéma
LES INVISIBLES
Un film de Louis-Julien Petit.
Dans la vie ordinaire, celle de tous les jours, elles sont assurément invisibles, on peut passer à côté d’elles sans même les remarquer. Mais la grâce de ce film vivifiant, c’est précisément de donner à nouveau non seulement une visibilité mais une parole à ces femmes-là. Elles, ce sont les femmes de la rue qui, presque toutes, peut-être pour ne pas avoir à dévoiler leur vraie identité, se sont choisies pour pseudonyme celui d’une célébrité : il y a Lady Di, Brigitte Macron, Dalida, etc. L’une d’entre elles, cependant, se nomme simplement Chantal dans « Les Invisibles » (Adolpha Van Meerhaeghe dans la vie réelle) et elle est l’une des femmes qui y sont les plus présentes et pour cause. Elle possède un don pour la réparation des machines fonctionnant à l’électricité et n’a pas sa langue dans sa poche.
Dès la première scène, le film nous met dans l’ambiance. Les femmes se pressent derrière une grille que vient ouvrir la pétulante actrice Déborah Lukumuena (qu’on avait vue dans « Divines » en 2016). C’est au centre social « L’Envol » accueillant durant la journée les femmes SDF que des visages connus les reçoivent : Audrey Lamy, Noémie Lvovsky et Corinne Masiero y sont les animatrices. Mettre dans un même film acteurs professionnels et non professionnels, cela s’est déjà pratiqué, mais pas toujours avec autant de bonheur que dans cette œuvre-ci.
En se basant sur le travail documentaire réalisé par Claire Lajeunie, Louis-Julien Petit a imaginé une aventure qui, sans jamais dénaturer la dure réalité de la vie des femmes SDF, les entraîne vers un surplus d’entraide et de solidarité. Certes, le cinéaste se garde de tout dépeindre en rose : plus d’une scène montre combien le dialogue est difficile, combien les coups de gueule sont fréquents. Mais, face à la menace qui pèse sur elles, les femmes de la rue comme les animatrices qui les accompagnent et les motivent, s’efforcent de trouver les moyens de s’en sortir. Même un centre social comme celui qu’on voit dans le film peut, en effet, être jaugé selon des critères d’efficacité, voire de rentabilité. Et si l’on estime que le taux de réinsertion des femmes accueillies n’est pas atteint, la menace d’une fermeture ne tarde pas à apparaître. Or toute l’aventure racontée dans « Les Invisibles » nous montre que, quitte même à prendre des libertés avec les règlements, il est possible de trouver ensemble des moyens d’avancer, ce qui veut dire, en l’occurrence, dénicher un logement et un travail à ces femmes.
Pour ce faire, tout en ne dissimulant rien du mépris et de la brutalité avec lesquels les femmes de la rue sont parfois traitées par les autorités (leur camp de tentes démantelé à 5 heures du matin, les femmes étant chassées manu militari), Louis-Julien Petit prend, le plus souvent, le parti de l’humour et de la bonne humeur. C’est un pari gagnant que de mettre en scène des femmes SDF ayant gardé, pour la plupart, un superbe sens de l’humour. C’est de cette façon-là, entre autres, qu’elles expriment quelque chose d’une fierté qu’elles n’ont pas perdue. Même marquées par les épreuves, elles sont restées belles et joyeuses. C’est réjouissant de voir « Lady Di » se trouver un mec et c’est encore plus réjouissant d’admirer l’honnêteté, la transparence de Chantal. Les animatrices du centre social ont beau lui expliquer qu’il n’est pas nécessaire de tout dire pendant les entretiens d’embauche, rien n’y fait : Chantal ne peut s’empêcher de révéler que sa formation de réparatrice, c’est en passant par la case « prison » qu’elle l’a acquise.
On n’oubliera ni leurs visages ni leur gouaille ni leur résistance envers et contre tout à ceux qui voudraient leur faire plier l’échine : elles donnent un bel exemple de vie, ces « invisibles » !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20190103 – Cinéma
Bonjour à tous!
Ci-joint ma critique de « Asako I § II », premier coup de cœur cinématographique de cette nouvelle année.
Bien amicalement.
ASAKO I § II
Un film de Ryûsuke Hamaguchi.
Bien qu’il ait déjà accompli une quinzaine d’années d’activité cinématographique dans son pays, le Japon, ce n’est qu’en mai dernier qu’est apparu en France le nom de Ryûsuke Hamaguchi, à l’occasion de la sortie sur les écrans de « Senses », film de plus de cinq heures mettant en scène le portrait croisé de quatre femmes dont l’une disparait mystérieusement au cours de l’histoire. Aujourd’hui, avec « Asako I § II », c’est du portrait d’une seule femme dont il est question, mais, comme le suggère le titre, d’une femme qui se dédouble ou qui, en tout cas, se présente sous deux aspects dont on ne sait s’ils se complètent ou s’ils s’opposent.
Voilà un film fascinant et troublant, qui n’est pas sans faire songer à « Sueurs froides » (Vertigo – 1958), le chef d’œuvre d’Alfred Hitchcock. Tout comme cette oeuvre était bien davantage qu’un simple film à suspense, le long-métrage d’Hamaguchi dépasse de beaucoup la sorte de bluette romantique à laquelle il s’apparente. Dès le début, nous sommes d’ailleurs invités à entrevoir le caractère énigmatique d’une œuvre qui, petit à petit, donne une sorte de vertige (tiens ! comme dans le film d’Hitchcock !). Asako, en effet, tandis qu’elle visite une exposition de photographiques (parmi lesquelles on en remarque une de deux jumelles), est intriguée par un beau jeune homme. Sortie du musée en même temps que lui, elle ne peut s’empêcher de le suivre sans oser l’aborder. Ce sont des enfants qui jouent avec des pétards qui déclenchent la rencontre. « C’est le destin », affirme ensuite le beau jeune homme qui se présente sous le nom de Baku. Aruyo, la copine d’Asako, a beau la mettre en garde, lui affirmant qu’il faut se méfier d’un tel charmeur, la jeune femme s’en est déjà follement éprise. Or Aruyo avait raison, l’idylle ne dure pas longtemps et, un beau matin, le gracieux mais dédaigneux Baku disparaît comme il est venu.
Faut-il à nouveau invoquer le destin ? Deux ans plus tard, à Tokyo, la jeune femme, alors qu’elle livre du café dans un bureau, tombe nez à nez avec le sosie de Baku : un employé qui lui ressemble trait pour trait tout en ayant une tout autre allure, beaucoup plus sage que le précédent. Néanmoins, c’est avec ce nouveau venu, qui se présente sous le nom de Ryohei, que Asako se décide à partager sa vie. Une vie bien plus tranquille et sans doute beaucoup plus paisible que celle qu’elle avait rêvé de mener avec Baku. Tout ne s’arrête pas là cependant car, cinq ans plus tard, voilà que c’est ce dernier qui réapparaît comme si de rien n’était. Entre temps, il est devenu une sorte de mannequin adulé par les femmes. Asako, elle, a de quoi être troublée : entre les sosies, à la fois semblables et très différents, qui choisir ? Qui aimer ?
Les deux Asako, que suggère le titre du film, sont-elles, d’une part, celle qui rêve une vie aventureuse aux côtés de Baku et, d’autre part, celle qui s’adapte docilement à un mode de vie beaucoup plus classique aux côtés de Ryohei ? Le cinéaste se garde de répondre d’une manière simpliste à cette question. Le dédoublement de la personne est sans doute plus complexe et plus intime que cela. Toujours est-il que, de manière très suggestive et très habile, le cinéaste détourne une histoire d’amour qui, même si elle se divise en deux, pourrait paraître presque banale, pour en faire quelque chose de proprement vertigineux. En fait, le film pose une question toute simple mais à laquelle il n’est pas si facile de donner la réponse : qu’est-ce qu’aimer ? Et comment peut-on être sûr d’aimer (ou d’être aimé par) la bonne personne ? Les apparences sont trompeuses, et la perception des choses et des personnes peut beaucoup différer de l’un à l’autre. Comme la rivière que le compagnon d’Asako trouve sale, à la fin du film, et que celle-ci, par contre, trouve belle.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.