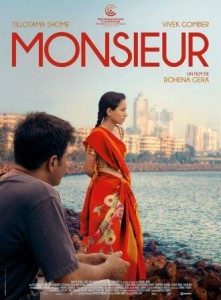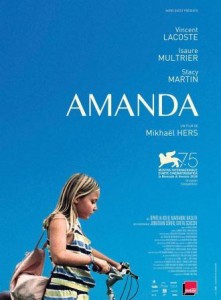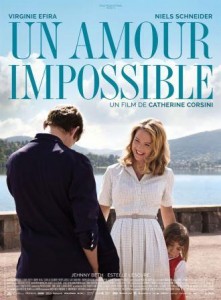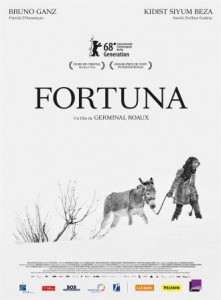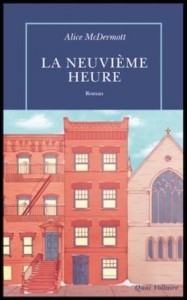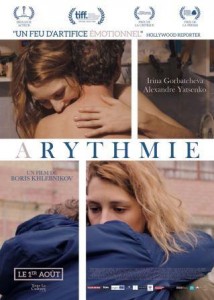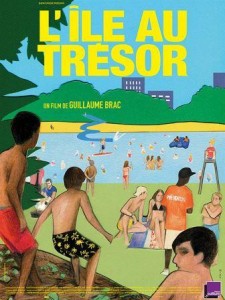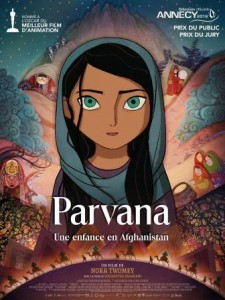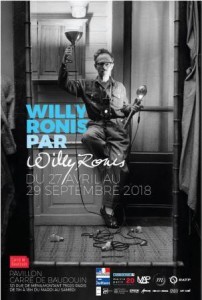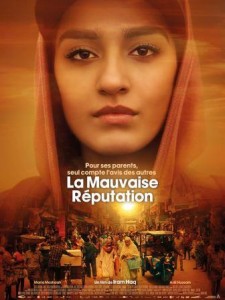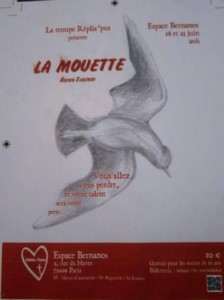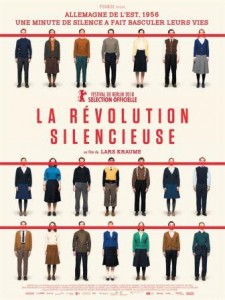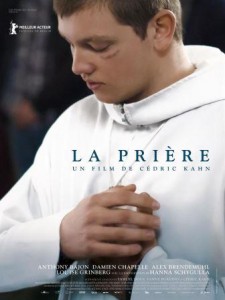Le blog du Père Luc – Films, livres, musiques, etc.
[où il est question de films, de livres, de musiques, etc. par un religieux de la Congrégation des Sacrés-Coeurs (Picpucien)]
=> http://lucschweitzer.over-blog.com/
20181231 – Cinéma – PALMARES 2018
- COLD WAR, de Pawel Pawlikowski
- LETO, de Kirill Serebrennikov
- MES PROVINCIALES, de Jean-Paul Civeyrac
- AMANDA, de Mikhaël Hers
- BURNING, de Lee Chang-dong
- LA FORME DE L’EAU, de Guillermo Del Toro
- FORTUNA, de Germinal Roaux
- DILILI À PARIS, de Michel Ocelot
- L’ÎLE AUX CHIENS, de Wes Anderson
- LADY BIRD, de Greta Gerwig
- PHANTOM THREAD, de Paul Thomas Anderson
- L’APPARITION, de Xavier Giannoli
- ARYTHMIE, de Boris Khlebnikov
- LE RETOUR DU HÉROS, de Laurent Tirard
- LA PRIÈRE, de Cédric Kahn
- HOSTILES, de Scott Cooper
- EN LIBERTÉ !, de Pierre Salvadori
- GIRL, de Lukas Dhont
- KATIE SAYS GOODBYE, de Wayne Roberts
- EN GUERRE, de Stéphane Brizé
- L’ÎLE AU TRÉSOR, de Guillaume Brac
- LEAVE NO TRACE, de Debra Granik
- MONSIEUR, de Rohena Gera
- PUPILLE, de Jeanne Herry
- BLACKKKLANSMAN, de Spike Lee
- SONATE POUR ROOS, de Bondewijn Koole
- UNDER THE SILVER LAKE, de David Robert Mitchell
- NOS BATAILLES, de Guillaume Senez
- MAYA, de Mia Hansen-Løve
- WONDER WHEEL, de Woody Allen
20181231 – Cinéma
MONSIEUR
Un film de Rohena Gera.
L’Inde n’en finit pas de surprendre, tant ce pays offre un contraste gigantesque entre, d’une part, son évolution ancrée dans le monde moderne et, d’autre part, les archaïsmes qui persistent à séparer résolument les classes sociales. Le fameux système de castes y reste toujours prégnant, au point qu’on se demande si ce pays réussira un jour à se défaire enfin de ce qui ressemble fort, à nos yeux d’occidentaux, à un anachronisme.
Dans son premier film, la réalisatrice Rohena Gera traite ce sujet avec toute la délicatesse et la finesse qui conviennent. Se souvenant de la nounou qui s’occupait d’elle quand elle était petite, une nounou « qui faisait partie de la famille et, en même temps, en était exclue », elle met en scène une bonne nommée Ratna qui, venant d’un village, a trouvé cet emploi de servante auprès d’Ashwin, le fils d’une riche famille de Bombay. Rien ne devrait rapprocher ces deux personnes, les coutumes indiennes s’opposant drastiquement à toute familiarité entre des individus de castes différentes (qui plus est s’il s’agit d’un homme et d’une femme). S’il veut respecter la tradition, Ashwin ne doit adresser la parole à Ratna qu’en cas de nécessité, pour lui donner un ordre, rien de plus.
Or, dans le film de Rohena Gera, tout est affaire de regards, avec, d’un côté, les regards qui évoluent, qui se transforment, et, de l’autre côté, le regard figé d’une société prompte au jugement, voire au rejet de qui outrepasse ce qu’elle considère comme une loi intangible.
Les regards qui changent, ce sont ceux du maître et de la domestique. Malgré les interdits, petit à petit, un rapprochement s’opère. Ratna n’a pas de peine à découvrir qu’Ashwin vient de se séparer de celle avec qui il avait prévu de se marier et qu’il en éprouve à la fois du dépit mais aussi le soulagement de n’avoir pas à partager la vie d’une femme qu’il n’aimait pas vraiment. Quant à ce dernier, il apprend, au fil du temps, que sa servante est une toute jeune veuve qui rêve de s’affranchir de toute dépendance en travaillant dans la confection de vêtements. Comment demeurer indifférents quand on passe une grande partie de ses journées l’un auprès de l’autre, dans le même appartement ? Les regards grandissent en intensité et les désirs affleurent.
Quant à vivre pleinement une histoire d’amour, puisqu’en fin de compte il s’agit de cela, ce n’est malheureusement pas si simple. Les regards d’autrui, ceux des proches, ceux des familles respectives, ne regorgent pas de bienveillance sur ce sujet, c’est le moins qu’on puisse dire. Ratna, plus encore qu’Ashwin, est consciente de ce qu’implique un éventuel échange amoureux avec son maître. Les conséquences, ce sont d’être rejetée impitoyablement et de voir s’effondrer ses rêves d’affranchissement.
Tout en nuances et en douceur malgré son sujet, souvent très coloré, enchanté même à deux reprises par des séquences musicales, le film se garde de chercher à démontrer quoi que ce soit. Il suffit, par exemple, à la réalisatrice de montrer Ratna manger avec ses doigts tandis que son maître se sert de couverts pour signifier ce qui les sépare l’un de l’autre. Il suffit également de quelques échanges de regards ou de paroles pour indiquer ce qui les rapproche. Pas besoin de surligner, en quelque sorte, l’intention du film. On la devine aisément : pour la cinéaste, bien sûr, l’idéal serait que la société indienne trouve les moyens d’en finir avec le système de castes.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181206 – Cinéma
PUPILLE
Un film de Jeanne Herry.
C’est l’histoire d’une rencontre : celle de Théo, un bébé né sous x, et d’Alice (Élodie Bouchez), une femme de 41 ans, qui devient sa mère adoptive. Avant d’en arriver là, le film décline tout le chemin qu’il a fallu parcourir et nous introduit dans l’intimité de tous les intervenants, de tous ceux (et surtout toutes celles) qui prennent leur part pour assurer au mieux, autant que faire se peut, l’avenir du nouveau-né.
Le film, évidemment, n’est pas dépourvu d’un aspect didactique puisqu’il explore le long et lent processus de l’adoption, mais c’est un aspect qui semble presque secondaire en regard de la justesse et de l’intensité que dégagent les nombreux personnages. Il est intéressant, d’ailleurs, de remarquer que la réalisatrice a pris soin d’éviter tout jugement autant que toute glorification des protagonistes. Même la mère du petit Théo, que rencontre longuement une assistante sociale et qui décide néanmoins d’abandonner l’enfant, n’est jamais filmée de façon hautaine (encore moins méprisante).
Il n’y a pas davantage de héros dans ce film, mais des travailleurs sociaux qui, même si leurs vies sont loin d’être parfaites, savent, quand c’est nécessaire, se soucier par-dessus tout du bien-être de l’enfant. Plus d’un a ses propres faiblesses, ses propres défaillances, comme Gilles Lellouche qui, au début du film, semble fatigué de tout, ou comme Sandrine Kiberlain qui avale bonbon sur bonbon pour compenser sa solitude affective, mais quand il s’agit de l’enfant, tous se montrent capables du meilleur. Et tous ont pour souci premier, comme le dit l’un d’eux, non pas de combler la carence de couples en mal d’enfant, mais de trouver, autant qu’il est possible, le (ou les) meilleur(s) parent(s) pour l’épanouissement de l’enfant. C’est d’autant plus important que, alors qu’on a affaire à un bébé, celui-ci semble déjà être perturbé par ce qui s’est passé à la maternité.
Au moyen de quelques flashbacks, Jeanne Herry montre aussi la longue patience qu’il faut à Alice avant d’être enfin désignée mère adoptive (non sans débats houleux du côté des travailleurs sociaux dont les avis diffèrent beaucoup). Son statut se modifie d’ailleurs au cours du temps : au début de sa démarche, elle vit en couple et c’est le couple qui fait la demande, alors qu’au bout du compte, quand enfin sa demande aboutit, elle est séparée et vit désormais seule. Or précisément, une loi vient d’autoriser l’adoption même en cas de monoparentalité. Exerçant, dans un théâtre, le beau travail d’audiodescriptrice pour les non-voyants, ce personnage, formidablement joué par Élodie Bouchez, est, sans nul doute, un des plus émouvants du film. Un film remarquablement construit, à la fois très documenté et très romanesque.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181205 – Cinéma
LETO
Un film de Kirill Serebrennikov.
Liberté ! C’est ce vocable, c’est cette revendication, qui viennent à l’esprit à la vision de ce film enthousiasmant d’un cinéaste qui, il faut le savoir, est assigné à résidence depuis plus d’an dans l’attente d’un procès pour détournement de fonds : une accusation qui, sans nul doute, n’est qu’une manœuvre destinée à nuire à un artiste jugé dérangeant. Dans la Russie de Poutine, ultra réactionnaire, les libertés que s’octroie le cinéaste homosexuel et défenseur des minorités Kirill Serebrennikov ont tout pour déplaire au pouvoir en place.
Du point de vue de l’atteinte aux libertés, la Russie d’aujourd’hui paraît même plus coercitive que du temps de Brejnev. Or c’est précisément cette période-là, celle du début des années 80, que revisite, à sa manière, le cinéaste. Il le fait par le biais d’une exploration de la scène rock qui émerge alors à Leningrad. L’un des chanteurs, un eurasien du nom de Viktor Tsoï, devint même, avec son groupe new wave du nom de Kino, une véritable star dans son pays.
Ce chanteur charismatique occupe une place importante dans le film de Kirill Serebrennikov, mais il n’est pas le seul. Le cinéaste a soigneusement évité le piège du biopic pour lui préférer une suite de variations totalement libres évoquant la scène rock de cette époque-là. Au cœur du film, on ne trouve pas un homme unique, aussi fascinant soit-il, mais plutôt un trio. Avant qu’apparaisse Viktor Tsoï, c’est un autre chanteur qui se produit sur scène, un chanteur qui, même s’il n’a pas connu autant de succès que celui-ci, ne manque ni de charme ni de talent. Il se nomme Mike Naumenko et il est père d’un bébé qu’il a eu avec sa compagne Natasha.
Dans la Russie soviétique du temps de Brejnev, tout est sous contrôle, bien entendu. Les chanteurs de rock sont admis sur scène, mais le public est prié de ne manifester aucun enthousiasme. Chaque chanson doit être examinée par un comité de censure. Le cinéaste se fait un plaisir de filmer ces scènes confinant à l’absurde. Mais il fait davantage, car, dans sa mise en scène comme dans sa réalisation, le film offre un festival d’inventivité et d’audaces de toutes sortes. Tourné en noir et blanc comme pour mieux illustrer la grisaille de l’époque, le long-métrage intègre, à plusieurs reprises, des séquences en couleur qui surgissent comme une prémonition de la liberté qui surgira dans le pays, quelques années plus tard, quand ce sera la perestroïka. Tout entier imprégné de musique, le film prend, à plusieurs reprises, des allures de comédie musicale : les passagers d’un train comme ceux d’un autocar se mettent tout à coup à chanter comme dans les meilleurs films de ce genre. À cela s’ajoutent même des éléments d’animation insérés dans l’image, ce qui donne à ces séquences un caractère fabuleux et totalement enchanteur. À d’autres moments, ce sont, par exemple, les paroles d’une chanson qui apparaissent à l’écran, en particulier celles de la chanson titre « Leto » (qui veut dire « L’été »).
Le cinéaste ne se refuse rien. Sa façon de filmer est originale, elle est libre comme le sont les personnages du film qui, malgré la chape de plomb du régime soviétique, savent trouver ou inventer leurs espaces de liberté. Liberté fragile, risquée, toujours menacée et pas seulement du fait des apparatchiks. Quand Viktor rejoint la communauté de chanteurs et musiciens rock, on devine aussitôt que son charme n’indiffère pas Natasha, la compagne de Mike. Le cinéaste filme avec élégance les échanges des uns et des autres, donnant à Natasha un rôle qui ne se limite jamais à celui d’une simple muse ou d’un simple faire-valoir. S’il est un personnage qui symbolise le mieux la liberté dans ce film, c’est peut-être davantage cette jeune femme, plus encore que les chanteurs et musiciens de rock. Ce qui n’empêche pas le film d’être tout entier envahi d’une irrésistible ferveur musicale, pour notre plus grand bonheur de spectateur.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181127 – Littérature
LEURS ENFANTS APRÈS EUX
Un roman de Nicolas Mathieu.
Les prix littéraires n’ayant jamais guidé mes choix de lecture, ce n’est pas parce que ce roman vient de décrocher le Goncourt que j’ai entrepris de le lire, mais plutôt parce que, dès sa parution, il a eu droit à des critiques très élogieuses, et aussi et surtout parce que son action se déroule non loin de mon berceau d’origine, autrement dit en Moselle dans la vallée de la Fensch. Il est d’ailleurs intéressant, pour qui connaît ce territoire, d’apprécier l’art de Nicolas Mathieu qui a su se l’approprier pour en faire quelque chose qui, à la fois, ressemble à l’original et s’en distingue, et ce pas seulement parce qu’il en a changé la plupart des noms, renommant Heillange la ville de Hayange, Lameck la ville de Fameck et la Henne la rivière la Fensch.
En avril dernier, je m’étais amusé à lire le savoureux ouvrage intitulé « Tour de France des Villes incomprises ». Son auteur, Vincent Noyoux, racontait, avec beaucoup d’humour, comment il était parti à la découverte des villes les moins attractives de France, Mulhouse, Vesoul, Guéret, Vierzon, etc. Or un chapitre de ce livre était consacré non pas à une ville mais à toute une vallée : la vallée de la Fensch, bien évidemment. Qui aurait l’idée d’aller visiter un endroit pareil, on se le demande ? Et ne parlons pas d’aller y passer ses vacances !
Or c’est précisément ce que propose, d’une certaine façon, Nicolas Mathieu, dont le roman se déroule sur quatre étés, ceux de 1992, 1994, 1996 et 1998. Quatre étés chauds et étouffants qui suffisent à battre en brèche le préjugé selon lequel il fait toujours gris en Lorraine. Ce n’est pas le ciel qui est gris dans ce roman, mais bien plutôt l’environnement, le lac aux odeurs de pétrole, le vestige rouillé du haut-fourneau, la ville sans attrait. Même la statue de fonte de la Vierge érigée par Wendel au-dessus de la vallée n’y peut rien : elle semble n’avoir plus d’autre fonction que de servir de point de rendez-vous pour les adolescents désoeuvrés.
Deux d’entre eux, Anthony et Hacine, sont au cœur du roman et, autour d’eux, gravitent beaucoup d’autres personnages : leurs parents et d’autres jeunes de Heillange comme Steph, Clem, Elliott, etc. Avec un réalisme souvent très cru, usant d’un style constellé d’argot qui convient parfaitement à son propos, Nicolas Mathieu raconte des vies brisées et des rêves qui ont peu de chances de se réaliser. Les adultes (surtout les hommes) ont déjà baissé les bras ou sont sur le point de le faire jusqu’à, pour certains d’entre eux, sombrer dans l’alcool. Les femmes, d’une certaine façon, s’en sortent mieux, surtout précisément quand elles sont seules, divorcées ou mêmes veuves, c’est-à-dire pouvant enfin profiter librement de ce qui leur reste de vie.
Quant aux jeunes, il n’en est pas un qui ne rêve de quitter la vallée pour se construire une autre vie (qui ne ressemblerait pas à celle de leur père). Or cette aspiration se heurte à de dures réalités et, quand il en est un qui parvient à s’échapper, c’est, le plus souvent, pour être forcé de revenir quelque temps plus tard. Nicolas Mathieu décrit avec justesse la banalité des vies, mais sans en rajouter dans la désolation. La vallée de la Fensch, certes sinistrée, n’en bénéficie pas moins de quelques atouts, parmi lesquels la proximité du Luxembourg où « les paies [sont] bonnes [et] les protections minces ». Quant à Anthony, Hacine et aux autres jeunes, même si leurs vies sont plus ou moins engluées dans des réalités poisseuses, ils ne sont pas dénués de la vitalité qui convient à leur âge.
On ne saurait parler de Nicolas Mathieu comme d’un Zola de seconde classe. Il décrit une réalité qui n’a rien de mirobolant avec le talent d’un homme qui perçoit parfaitement les ambiguïtés d’un territoire et de ses habitants, mais aussi, plus largement, d’une époque. Il le fait, par exemple, non sans ironie, en décrivant, à la fin du livre, l’illusion d’une unité retrouvée lorsque toute la France vibre à l’unisson à l’occasion de la Coupe du Monde de Football de 1998. Il le fait aussi, tout au long du roman, lorsque se présente une opportunité. Car Nicolas Mathieu sait comment caractériser une époque, ses chimères et ses déboires, il sait comment décrire la couleur du temps.
Ainsi, lorsque Anthony, à l’occasion de funérailles, entre dans une église. « Il regardait les vitraux, écrit Nicolas Mathieu, les sculptures, ces images de supplice et de gloire, sans rien comprendre. Le sens de cette langue, pour lui et beaucoup d’autres, était perdu. Il ne demeurait qu’un décorum prétentieux et des gestes tournant à vide. » Peut-on mieux dépeindre, en quelques lignes, le fossé qui sépare désormais le plus grand nombre de nos contemporains d’avec les représentations de la foi catholique ? Rien n’est irrémédiablement perdu cependant, comme le fait remarquer plus loin l’écrivain : « Anthony avait beau ne pas croire à cette fantasia biblique, l’élancement de la pierre, les bleus du vitrail, cette verticalité, ça faisait quand même un truc. » Il reste « un truc », quelque chose que beaucoup ne savent pas nommer et qui, cependant, n’a besoin que d’une occasion, l’entrée dans une église pour un enterrement, pour s’éveiller à la conscience. La question qui se pose à la lecture de ce roman, l’une des questions en tout cas, c’est précisément de pouvoir à nouveau nommer avec davantage de précision et de contenu ce qui n’est qu’un « truc ». Cela vaut pour ce qui concerne le sentiment religieux, pas totalement disparu comme on le constate, comme pour tout le reste. Y a-t-il quoi que ce soit, aujourd’hui, qui puisse donner le goût de vivre et d’entreprendre à ceux qui sont désenchantés ? L’euphorie suscitée par les succès des bleus à l’occasion de la Coupe du monde de football a peu de chance d’y suffire…
Ne nous y trompons pas, ne soyons pas rebutés par la trivialité du style dont use Nicolas Mathieu. Il lui permet de rester au plus près de personnages qui n’emploient pas d’autre langage que celui-là. Le ton est toujours juste et le texte vibre de beaucoup de résonances qui vont droit au cœur.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181121 – Cinéma
AMANDA
Un film de Mikhaël Hers.
« Elvis has left the building ». Cette phrase qui servait à disperser les admirateurs d’Elvis Presley à la fin de chacun de ses concerts, Sandrine (Ophélia Kolb), professeure d’anglais et maman célibataire, en explique la signification à sa fille Amanda (Isaure Multrier) âgée de 7 ans. Le chanteur s’en est allé, plus besoin de l’attendre. Ce faisant, elle n’imagine pas que, bientôt, c’est elle-même qui quittera non pas seulement un « building » mais ce monde et que c’est la petite Amanda qui devra se résoudre à ne pas l’attendre, car on ne revient pas du pays des morts.
Le thème du deuil, le réalisateur Mikhaël Hers l’avait déjà exploré en 2016 avec un film tout en finesse intitulé « Ce sentiment de l’été ». Il y revient aujourd’hui mais en le reliant à de terribles faits d’actualité, ceux des attentats qui ensanglantèrent Paris en novembre 2015. Il y revient aussi en prenant le temps et, pendant toute une grande première partie du film, avant que ne survienne la tragédie, en familiarisant le spectateur avec un ensemble de personnages, tous très attachants : Sandrine et Amanda, mais aussi et surtout David (Vincent Lacoste), le frère de Sandrine, ainsi que Léna (Stacy Martin), la voisine de ce dernier avec qui il ne tarde pas à flirter. David, très pris par ses deux jobs, la location d’appartements pour touristes et l’élagage des arbres du 20ème arrondissement de Paris, n’en trouve pas moins du temps pour aider sa sœur en allant, par exemple, chercher la petite Amanda à sa sortie d’école (quitte à arriver en retard et à se faire ensuite gourmander par Sandrine). On devine néanmoins la complicité qui unit tout ce petit monde.
Or voilà que tout est bouleversé le jour où David, allant à la rencontre de Sandrine et Léna qui sont parties se promener dans le bois de Vincennes, y découvre un carnage. Des terroristes ont tiré sur tous les passants qui se trouvaient à leur portée. Les corps ensanglantés gisent sur la pelouse. Quelques plans sur le massacre puis sur l’entrée de l’hôpital Tenon suffisent à faire percevoir l’ampleur du désastre. Plus tard, la même sobriété, la même pudeur sont au rendez-vous lorsqu’il s’agit pour David d’expliquer à sa nièce Amanda que sa mère est au nombre des victimes. Ces qualités, le cinéaste ne les abandonne jamais, parvenant ainsi à réaliser un film qui est un bijou de délicatesse.
Pour David, jeune homme de 24 ans quelque peu « adulescent » comme on dit, les décisions à prendre ne vont pas de soi. Elles engagent sa liberté. Hormis une tante qui donne volontiers un coup de main et sa mère qui vit à Londres et qu’il n’a pas vu depuis dix ans, il n’y a que lui pour prendre la charge de la petite Amanda et devenir son tuteur (voire l’adopter). À moins, bien sûr, de placer l’enfant dans une institution accueillant des petits orphelins, solution que le jeune homme envisage pendant quelque temps. Mais la relation qui se noue entre l’oncle et la nièce ne peut laisser de place à une telle perspective. Rien ne va de soi pourtant, l’enfant fait des cauchemars et se rebelle lorsqu’elle constate la disparition d’objets dont se servait sa mère, et cependant quelque chose se construit qui ne s’explique pas. Il faut même, pour David, accepter de renoncer à des satisfactions immédiates, lui qui fait le voyage jusqu’à Périgueux dans l’espoir d’en revenir avec sa bien-aimée Léna qui, blessée au cours de l’attentat et, bien évidemment, traumatisée, a préféré s’éloigner de Paris. En fin de compte, c’est au cours d’un voyage à Londres, projeté avant l’attentat du bois de Vincennes, qu’apparaissent en évidence les sentiments ambivalents qui habitent le cœur d’Amanda. Là, dans le stade de Wimbledon, ses yeux sont baignés de larmes tandis que, de sa bouche, s’échappent des rires. Larmes de douleur causées par la perte d’une maman, rires de joie parce qu’avec la présence affectueuse de son oncle la vie et le bonheur sont toujours possibles.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181108 – Cinéma
UN AMOUR IMPOSSIBLE
Un film de Catherine Corsini.
Au moment de sa parution en 2015, le roman éponyme, ou plutôt l’autofiction, de Christine Angot avait été autant complimentée par les uns que honnie par les autres. Les premiers estimaient qu’on avait affaire à « une romancière captivante et implacable » (critique de l’Express) tandis que les seconds déploraient « une écriture (…) spectaculairement catastrophique » (critique du Figaro). Tout ce monde se trouvera peut-être d’accord aujourd’hui pour admettre que l’adaptation du livre au cinéma par Catherine Corsini est de haute tenue.
Car, quoi qu’on pense des qualités littéraires supposées de Christine Angot, il faut convenir que ce qu’elle a entrepris de relater n’a non seulement rien de banal mais mérite la plus grande attention. Le crime, car c’est bien d’un crime dont il est question dans cette histoire, ce crime qui a pu se perpétrer sans être aussitôt repéré, ce crime n’a pas seulement un caractère privé, il est le fruit abject d’un système qui pervertit les relations, conduisant au mépris d’autrui ceux qui se considèrent comme des êtres supérieurs au point d’estimer avoir tous les droits.
Il ne s’agit pas seulement de répéter que l’amour rend aveugle. Le récit de Christine Angot, parfaitement adapté par Catherine Corsini, va beaucoup plus profond dans les plaies du monde qu’en se contentant d’illustrer ce lieu commun. Pourtant, c’est vrai que Rachel (Virginie Efira), tombée sous le charme de Philippe (Niels Schneider), semble totalement aveuglée par sa passion. Le beau parleur qui, dès leurs premiers échanges, cherche à délester Rachel de sa foi en Dieu en lui faisant lire Nietzsche, son auteur de prédilection, ne tarde pas à parvenir à ses fins. Certes, il prend la précaution, dès le début de leur relation, d’indiquer à Rachel que jamais il ne l’épousera. Il lui dit aussi qu’il n’a nullement l’intention de végéter à Châteauroux, la ville où ils se sont rencontrés. Mais déjà, plus sournoisement, il laisse entrevoir son antisémitisme, ses préjugés de classe, sa suffisance, son désir d’être riche. « Si tu étais riche, ose-t-il avouer à Rachel, je reconsidérerais peut-être ma position et envisagerais un mariage avec toi ! ».
Cet homme, il faudra bien du temps et bien des souffrances à Rachel pour percevoir son vrai visage. Le film se déroule, en effet, sur un grand nombre d’années (et il faut saluer la qualité des costumes et des maquillages qui rendent crédible cette fuite du temps). Quand Philippe se décide à quitter Rachel pour voler de ses propres ailes et courir vers ses ambitions, la jeune femme découvre qu’elle est enceinte. Elle donne naissance à Chantal et, dès lors, cherche à renouer contact avec le père afin qu’il reconnaisse l’enfant et lui donne son nom. Ce combat pour sa fille, elle devra le mener longtemps, sans imaginer une seconde, bien entendu, à quel point il sera funeste à l’enfant. Car, périodiquement, parfois après plusieurs années d’absence, le père réapparaît, d’abord assez indifférent à sa progéniture puis, au contraire, l’enfant ayant grandi et étant devenue adolescente, s’intéressant à elle au point de l’emmener régulièrement séjourner en sa compagnie. Il finit d’ailleurs aussi par accepter de la reconnaître. Or, à partir du jour où Philippe accepte de s’occuper de sa fille, les relations entre cette dernière et sa mère se modifient. Elles deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus tendues. Il faudra pourtant bien du temps pour que la vérité éclate, pour que le vrai visage d’un père indigne, malade d’orgueil, se révèle au grand jour. Terrible divulgation. On ne peut rien imaginer de pire.
Loin d’être un banal mélodrame, le film de Catherine Corsini met en évidence le système pervers qui peut s’établir dans les relations humaines au point de donner à certains un sentiment d’impunité qui les rend capables des pires exactions. Il donne aussi au personnage formidablement jouée par Virginie Efira une grande noblesse. Ni son aveuglement ni ses souffrances ni ses multiples épreuves n’y changent rien : il semble n’y avoir en elle pas une once de haine.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181031 – Cinéma
EN LIBERTÉ !
Un film de Pierre Salvadori.
Pierre Salvadori le déclare volontiers, il admire le genre de la « screwball comedy » qu’on peut désigner en français sous l’expression de « comédie loufoque », ces films bourrés de fantaisies qui furent un des fleurons des studios hollywoodiens pendant les années 30 et 40. Des réalisateurs comme Frank Capra, Howard Hawks, Ernst Lubitsch ou Preston Sturges s’y illustrèrent avec un incomparable bonheur. Ces films, d’ailleurs, n’ont, pour la plupart, pas pris une ride.
En sera-t-il de même avec celui que propose aujourd’hui le cinéaste français ? Peut-être. Ce qui est sûr, quoi qu’il en soit, c’est qu’on se délecte en le regardant. On y découvre une Adèle Haenel épatante qui confirme avec brio ses immenses talents d’actrice. Dans le rôle d’Yvonne Santi, inspectrice de police qui vient de perdre son mari, lui-même policier, mort au court d’une mission périlleuse, elle déploie tout le registre de ses dons. Surtout quand elle apprend que son cher époux, en l’honneur de qui l’on vient d’ériger une statue du plus effarant mauvais goût, n’était en vérité qu’un ripou.
En prenant comme point d’appui cette révélation, le film développe trois pistes sans jamais se priver d’y intégrer de bonnes doses de loufoqueries des plus réjouissantes. Tout d’abord, Yvonne Santi doit faire preuve d’habileté avec son propre fils, un tout jeune garçon à qui elle a pris l’habitude de raconter, chaque soir, les exploits de son père. Comment s’y prendre maintenant qu’elle sait que ce dernier n’était qu’un flic corrompu ? L’astuce de Pierre Salvadori consiste à reproduire, à de multiples reprises, une même scène d’intervention musclée du policier défunt en la modulant en fonction des hésitations d’Yvonne Santi ne voulant pas chagriner son fils tout en lui faisant entrevoir une vérité qui n’est pas aussi belle qu’il l’imagine.
La deuxième piste qu’explore avec talent le cinéaste, c’est celle de la réparation. Comme dans « La Fille inconnue » des frères Dardenne, Adèle Haenel joue le rôle d’une femme s’employant à réparer une faute commise. La différence, c’est que, dans le film de Pierre Salvadori, il ne s’agit pas de sa propre faute mais de celle de son défunt mari. À cause des agissements de ce dernier, en effet, un innocent prénommé Antoine (Pio Marmaï) a dû effectuer une peine de prison. Libéré, mais complètement chamboulé par son incarcération, l’homme ne pense plus qu’à se risquer à un véritable braquage. Pour Yvonne Santi, c’est à nouveau le grand embarras : comment se faire la protectrice d’un individu injustement condamné mais qui s’apprête à commettre de véritables exactions ?
Enfin, la troisième piste que se plaît à adopter le cinéaste, c’est celle, disons, de l’amoureux qui n’en revient pas. En l’occurrence, il s’agit de Louis (Damien Bonnard), un collègue policier qui n’a d’yeux que pour Yvonne, au point qu’il ne se rend pas même compte qu’il a affaire, à plusieurs reprises, à un sérial killer se présentant de lui-même au poste de police pour finir par être systématiquement renvoyé chez lui !
Et ce n’est là qu’un des excellents gags dont ce film est parsemé. On a droit aussi à une scène de braquage totalement extravagante, si extravagante que les vigiles n’en croient pas leurs yeux au point de rester sans réagir. Le film mêle avec intelligence l’humour le plus énorme et les sentiments les plus nobles. Ils sont, tout particulièrement, l’apanage des femmes : d’Adèle Haenel dont le personnage rayonne de compassion et d’Audrey Tautou qui, en épouse de l’homme qui sort de prison, lui fait refaire plusieurs fois la scène de leurs retrouvailles. C’est une des plus belles idées d’un scénario qui ne manque pas d’inventivité.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181028 – Musique
LES BAS-FONDS DE PARIS
Un conte musical de Marie Cherrier.
Ah ! Le bel album que nous propose Marie Cherrier ! Après plusieurs cd de chansons très remarqués, ce n’est rien moins qu’un conte musical dont il est question aujourd’hui. Un projet ambitieux qui a sans aucun doute demandé à l’artiste une somme importante de travail, de créativité, d’opiniâtreté et dont on peut d’ores et déjà apprécier les qualités, tout en espérant le voir jouer et interpréter sur scène dès que possible.
Son voyage en chansons, Marie Cherrier l’a imaginé dans un Paris futuriste qui n’est pas sans faire songer à la cité que mettait en scène le cinéaste Fritz Lang dès 1927 dans « Métropolis » : les puissants repliés sur les hauteurs, en l’occurrence à Paris sur la Butte Montmartre où sont désormais concentrés les pouvoirs financiers, et les miséreux relégués au niveau inférieur, dans les bas-fonds. Deux personnages, Camille et Momo, persistent à essayer, au moyen de leur théâtre ambulant, de distraire les quelques touristes qui viennent encore admirer les hauteurs de la capitale. Mais bientôt c’est vers les bas-fonds de Paris que se dirige une Camille désabusée se laissant guider par son compagnon Momo. Or les bas quartiers, s’ils sont certes peuplés de miséreux, n’en sont pas moins riches de personnages autrement intéressants que ceux des hautes sphères. C’est du côté de la fange, et pas ailleurs, qu’on fait de vraies rencontres, celles d’un Baptiste, d’un Nino, d’une Michèle, d’un gitan, d’un barman et de quelques zonards.
Tous ces personnages, tous ces paumés, Marie Cherrier leur donne voix et présence et leur faisant chanter leurs espoirs, leur révolte ou leur solitude. Quand on les écoute, on les imagine évoluant sur scène pour y donner la pleine mesure de leurs talents. Mais rien que par la grâce du chant, il y a de quoi être touché ! Du côté de la Seine, comme le dit Baptiste, « y’en a des âmes en peine qui demandent à être sauvées ! ». Des sans-le-sou qui, s’ils n’ont rien à donner d’autre, ont encore un corps pour danser, une voix pour chanter. Même si c’est pour déplorer « l’air du vide » où peut-être il est encore possible de « grandir à quelque chose ». Paris de misère, « eau grise », Paris « où la nuit vous est offerte ». Mais Paris qu’enchante Marie Cherrier qui, marchant sur les traces d’illustres prédécesseurs qui ont osé la même gageure, revêt la grisaille d’un habit de chansons.
Si c’est un véritable défi que de monter un tel projet, nul doute que Marie Cherrier l’a relevé en s’entourant d’une équipe dont on perçoit aisément les aptitudes rien qu’en écoutant le cd. On ne peut qu’admirer les arrangements d’orchestre conçus et réalisés par Brian Larsen. Car c’est un véritable orchestre qui accompagne les chanteurs, un orchestre que l’on se régale d’écouter. Marie Cherrier n’a pas lésiné sur les moyens, chaque plage du cd est synonyme d’enchantement. Comme je l’ai déjà indiqué, il ne reste qu’à souhaiter que ce conte musical puisse se produire sur scène pour qu’en soient mises en lumière toute la profondeur et toute la beauté.
L’album « Les Bas-Fonds de Paris » qui paraîtra au niveau national en 2019 est d’ores et déjà disponible sur le site de Marie Cherrier :
10/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181021 – Cinéma
Une petite mise au point pour commencer. Certaines personnes, en effet, s’étonnent de ne lire sous ma plume que des critiques élogieuses. L’explication est simple. D’une part, je n’envoie par mail que mes critiques les plus flatteuses. Mais il en est d’autres sur mon blog qui le sont moins, voire beaucoup moins. D’autre part, quand je sélectionne les films que je vais voir sur grand écran, je choisis en priorité ceux qui sont susceptibles de me plaire. Il en est donc beaucoup d’autres que je ne vois pas mais qui, si je les voyais , auraient peut-être droit à des critiques négatives, voire assassines!
Il y a cependant quelques exceptions. Preuve en est la critique que je vous envoie aujourd’hui, celle de l’abominable film de Lars Von Trier, « The House that Jack built ».
THE HOUSE THAT JACK BUILT
Un film de Lars Von Trier.
C’est étonnant, le cinéma ! En quelques jours, il est possible de passer du meilleur au pire, de voir un chef d’œuvre de raffinement, d’intelligence et d’émotion comme « Cold War » de Pawel Pawlikowski et d’être submergé, peu de temps plus tard, par un film accablant de bêtise et de bassesse comme ce nouvel opus de Lars Von Trier. Il est vrai que je ne suis pas surpris car il y a longtemps que je n’attends plus rien de bon de ce cinéaste. Dès la sortie de « Breaking the waves » en 1996, j’avais été effaré par la suffisance crasse d’un réalisateur qui cherchait à donner de la noblesse à la stupide histoire des prétendus « sacrifices » d’une femme amoureuse. C’était idiot et, cependant, cela plaisait beaucoup à une partie de la critique. Et ainsi de suite, jusqu’aux combles de stupidité et d’ignominie que sont les derniers films du cinéaste danois : « Nymphomaniac » 1 et 2 et, aujourd’hui, « The House that Jack built ».
Chaque fois que sort un film de Lars Von Trier, je ne vais le voir que parce qu’il se trouve toujours des critiques pour en faire l’éloge et que je veux pouvoir écrire et répéter que je déteste ce cinéma-là. Il m’a donc fallu supporter, à nouveau, les inepties d’un cinéaste sans talent pendant les 2 heures et demi que dure ce film et, qui plus est, à côté d’une jeune spectatrice qui n’a pratiquement pas cessé de pleurer et de renifler tout au long de la projection. Je la comprends, cela dit, il y a de quoi pleurer, en effet, devant tant un tel déluge d’abjection.
La petite ruse du cinéaste, dont il s’était déjà servi pour « Nymphomaniac », c’est de donner à ses histoires répugnantes une apparence, un revêtement de profondeur, en mettant en scène une sorte de confesseur à qui se confie le malade (ici un tueur en série du nom de Jack, joué par Matt Dillon) et en étalant un semblant de culture censé faire illusion. Comme s’il suffisait d’intégrer au film des séquences d’archives montrant le pianiste Glen Gould et des tableaux de peintres (en particulier de William Blake) pour faire, en quelque sorte, passer la pilule des nombreuses scènes de violence horrifique que, par ailleurs, le cinéaste inflige aux spectateurs ! En vérité, comme toujours, Lars Von Trier essaie d’enrober l’inanité de sa pensée avec des faux-semblants de culture et de métaphores insignifiantes (comme celle, sidérante de banalité, de l’homme dont l’ombre grandit et diminue tandis qu’il marche sous des lampadaires !).
Mais le pire intervient à la fin du film lorsque le cinéaste ne se contente plus de confier à son personnage le soin de se référer à de grands artistes mais à Albert Speer en personne, l’architecte de Hitler, avant de délirer sur le nazisme et sur de multiples autocrates de sinistre mémoire. À ce sujet, dans une interview, Lars Von Trier affirme que, dorénavant, Hitler sera présent dans chacun de ses films ! Nous voilà prévenus !
Je ne ferai pas le détail de toutes les pédanteries, de toutes les niaiseries, de tous les partis pris (dont une exécrable et indécrottable misogynie) et de toutes les atrocités qu’impose malignement le cinéaste à ses spectateurs. Le plus aberrant et le plus ridicule intervient probablement à la toute fin du film, lorsque le tueur en série est promené en enfer par son guide de l’ombre. J’imagine que cette séquence est censée donner du sens à un film atroce et ridicule à la fois. Mais, au lieu de produire de l’intelligence, elle ne fait que rajouter de l’incongruité à l’imbécillité abyssale du film ! Auparavant, le sinistre Jack, se prenant pour un nouveau Thomas de Quincey ne se contentant pas d’écrire mais passant à l’acte, avait parachevé son œuvre, faisant, lui aussi, « de l’assassinat un des beaux-arts » ! Terrifiante mise en scène imaginée par le plus pitoyable des cinéastes !
0/10
Je rappelle, enfin, qu’il est possible de consulter mon blog. On y trouve bien d’autres critiques que celles que j’envoie par mail:
http://lucschweitzer.over-blog.com/
Bien amicalement.
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181016 – Cinéma
COLD WAR
Un film de Pawel Pawlikowski.
« Ida », son succès ô combien mérité de 2014, a probablement incité le polonais Pawel Pawlikowski à adopter, pour ce nouveau film, les mêmes choix stylistiques : photographie en noir et blanc et format carré de l’image. Des choix qui, cependant, ne donnent pas le sentiment d’une simple redite, loin s’en faut. On comprend, dès les premières scènes, qu’ils sont totalement judicieux, qu’ils conviennent parfaitement à ce film, si parfaitement qu’on a le sentiment, de voir une œuvre qui compte déjà parmi les grands classiques incontournables du cinéma. Formellement, tout, dans « Cold War », est quasi parfait. Les cadres et les mouvements de caméra (quand il y en a) semblent toujours extraordinairement justes. Pas un plan, pas une scène, de ce film ne donnent une impression de banalité. Techniquement, voilà un exemple idéal de ce qui est approprié à l’art cinématographique.
Évidemment, pour qu’un film soit proche de la perfection, il lui faut aussi être séduisant du point de vue du contenu et pas seulement de celui de la technicité. Or, ici, tout est incroyablement fascinant à la fois pour les yeux, pour l’esprit et pour l’intelligence. Le film comble sur tous les plans. Et, bien sûr, comme dans les films les meilleurs, il laisse un grand espace de participation au spectateur, Pawel Pawlikowski misant sur son intelligence et sa puissance d’imagination et ne se croyant pas tenu de tout raconter dans les détails.
Au risque de « spoiler » un petit peu, je me dois de mentionner, pour commencer, la superbe épanadiplose que propose le film, l’une des belles qu’on ait vues au cinéma. De quoi s’agit-il ? Eh bien, tout simplement, de la reprise d’une même scène ou d’une scène semblable se déroulant dans un même lieu, au début et à la fin de l’œuvre. Or, dans « Cold War », les deux scènes trouvent leur juste place dans une église à moitié en ruine. Au début du film, le spectateur découvre cette église en se demandant pourquoi le cinéaste a cru bon de la montrer. On y aperçoit la fresque d’un visage (probablement celui du Christ) dont il ne reste que les deux yeux, des yeux qui semblent nous regarder comme ils regardent l’homme qui s’est introduit dans le lieu. On y voit aussi le dôme qui s’est écroulé, laissant au sommet de l’église une grande trouée vers le ciel. À la fin du film, le cinéaste filme à nouveau la même église et tout s’éclaire de façon sublime. Car, cette fois-ci, le bâtiment sert de cadre à un mariage, le plus simple et le plus dépouillé qui soit : rien qu’une bougie sur un autel, une rangée de dragées, et les deux amoureux qui échangent leurs consentements, sans ministre du culte, sans autre témoin que les yeux du Christ fixés sur eux et la bénédiction divine venant de l’infini du ciel au-dessus de leurs têtes. On se croirait dans l’un ou l’autre des films les plus personnels de Frank Borzage (1894-1962), cinéaste génial chez qui les scènes de mariage du même style (sans autre témoin que Dieu) sont récurrentes. C’est d’une beauté à couper le souffle.
Le reste est à l’avenant. Entre ces deux scènes d’église, bien des années se sont écoulées. Le film commence en 1949 et se termine en 1964. Autrement dit, en pleine période de guerre froide. Pawel Pawlikowski s’est inspiré de l’histoire de ses propres parents pour nous raconter celle de ses héros de cinéma, Wiktor (Tomasz Kot) et Zula (Joanna Kulig). Leur rencontre a lieu parce que le premier, musicien et même compositeur, fait partie d’une équipe chargée de collecter et d’enregistrer des chants traditionnels et populaires au fin fond des campagnes polonaises, un peu à la manière de ce que firent, quelques années auparavant, les compositeurs Bela Bartok et Zoltan Kodaly en Hongrie. Cependant, dans la Pologne de ces années-là, le but n’est pas seulement de préserver un patrimoine, mais de le vivifier en sélectionnant une équipe de chanteurs et de danseurs qui se produiront sur scène. C’est à cette occasion que Wiktor fait la connaissance de Zula et que la séduction opère. On a beau prévenir le premier que cette jeune fille n’est guère fréquentable (elle a subi une condamnation pour avoir blessé son père d’un coup de couteau – un père qui, explique-t-elle, a eu la fâcheuse idée « de la confondre avec sa mère), il n’en a cure. Zula non seulement est admise comme membre de la troupe folklorique mais elle en devient rapidement l’une des vedettes.
Du fait du contexte historique de guerre froide, l’histoire d’amour de Wiktor et Zula se complique rapidement. Arrive bientôt, pour la troupe folklorique, l’obligation d’intégrer dans leurs prestations des œuvres vantant la gloire du communisme triomphant et de Staline en personne. Pour Wiktor, le risque de la liberté s’impose. Profitant d’une tournée à Berlin, il parvient à passer de l’autre côté et à rejoindre Paris. Mais, pour Zula, ce n’est pas si simple. Elle a beau aimer Wiktor, elle ne se résout pas à le suivre. Tout n’est pas fini cependant entre les deux amoureux, loin de là. Sans ménager les ellipses, les sauts de plusieurs années (Pawel Pawlikowski n’éprouve pas la nécessité de tout expliquer, fort heureusement), le cinéaste montre, tout particulièrement, les périodes de retrouvailles des deux amants. Pendant un temps, même, Zula parvient non seulement à retrouver Wiktor à Paris mais à demeurer avec lui, sans cependant trouver l’équilibre qu’elle cherchait. Elle est déçue, elle est fantasque, elle se moque d’une poétesse dont s’est entiché Wiktor, elle ne supporte pas de rester à Paris. Mais ni les désillusions ni les emportements ne peuvent rien contre les cœurs et c’est, en fin de compte, Wiktor qui, profitant d’un voyage dans la Yougoslavie de l’époque pour revoir Zula qui s’y produit, revient à son point de départ.
Je ne peux terminer mon éloge de ce film sans en souligner les mérites du point de vue musical. Les musiques et les danses y sont omniprésentes. Bien sûr, de nombreuses scènes font écho au talent de la troupe folklorique polonaise dont fait partie Zula. Mais, Wiktor étant lui-même compositeur et musicien, la musique est présente partout. À Paris, dans les cabarets qui lui sont dédiés, explosent les rythmes du jazz. Une autre scène nous montre Wiktor travaillant à la musique d’un film. Et, surtout, le scénario fait de la place aux séquences les plus sensibles du film, lorsque Zula et Wiktor, s’étant retrouvés pour un temps, la première chante au micro tandis que le second l’accompagne au piano : instant de beauté inoubliable durant lequel on a le sentiment que les deux amants font l’amour par chanson interposée.
Ce film, qui a reçu un Prix de la mise en scène à Cannes, mérite, en vérité, d’être complimenté sur tous les plans. C’est lui, sans nul doute, qui aurait dû être couronné de la Palme d’Or.
10/10
P.S.: J’ai vu le film en avant-première. Il sortira sur les écrans le 24 octobre.
Luc Schweitzer, ss.cc.
20181010 – Cinéma
DILILI À PARIS
Un film de Michel Ocelot.
Après avoir entraîné petits et grands du côté de l’Afrique de Kirikou puis du côté de l’Orient d’Azur et Asmar, c’est à Paris que Michel Ocelot fait évoluer sa nouvelle petite héroïne du nom de Dilili. Quoi ! À Paris ! Quelle déception ! Fini le dépaysement… Pas du tout, car il ne s’agit pas du Paris d’aujourd’hui mais de celui de la Belle Époque ! Dans ce cas, quel enchantement ! Quel bonheur que de se promener dans un Paris qui méritait bien son surnom de Ville-lumière. Paris qui attirait les savants, les chercheurs, les inventeurs, les artistes lyriques, les compositeurs, les peintres, les écrivains, etc. Quelle ville attrayante !
Bon, cela est vrai, sans nul doute, mais ne nous emballons pas, semble nous dire Michel Ocelot dès le début du film. Car si la petite métisse kanake Dilili est à Paris, c’est parce qu’on l’y a fait venir de force pour l’exposer, avec quelques-uns de ses compatriotes, aux yeux des badauds. Mais le plus terrible ne se trouve pas dans ces sortes de « zoos humains » que l’on constituait à l’époque des colonies car, comme l’affirme lui-même Michel Ocelot dans une interview, au moins « les gens » s’intéressaient « à d’autres vies que la leur ». Le plus terrible, ce sont les préjugés et les racismes. La petite Dilili ne se sent nulle part tout à fait chez elle, sa peau de métisse semble trop claire aux autres kanaks et trop foncée aux Parisiens dont certains se croient obligés de l’aborder en lui parlant « petit nègre » !
Grande est leur surprise, à ceux-là, lorsqu’ils se rendent compte que la petite fille possède à la perfection la langue de Molière et la parle mieux qu’eux ! C’est que Dilili a été à bonne école ! Son institutrice ne fut rien moins que Louise Michel en personne au temps où elle dut vivre en déportation en Nouvelle-Calédonie. Louise Michel que la petite Dilili retrouve à présent à Paris pour son plus grand bonheur !
Car Michel Ocelot prend le parti de nous faire visiter le Paris de ce début du XXème siècle en compagnie de Dilili et d’Orel, un garçon, livreur de profession, qui s’est pris d’amitié pour elle. Filant à toute allure sur le triporteur de ce dernier, les deux amis multiplient les rencontres les plus inouïes. Certes, leur chemin de découverte démarre avec un Ernest Renan renfrogné, incapable de les renseigner sur le Paris de son époque, mais il se poursuit avec les rencontres fabuleuses des plus grands savants et artistes de ces années. La Ville-lumière en regorge, de ces grands noms : Louis Pasteur, Gustave Eiffel, Alberto Santos-Dumont, Toulouse-Lautrec, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Pablo Picasso, Auguste Rodin, Claude Debussy, Erik Satie (jouant une de ses « Gnossiennes »), Marcel Proust, etc. Impossible de tous les citer. Ils sont tous là et c’est un des bonheurs de ce film que de les y repérer.
En les énumérant, j’ai laissé à dessein de côté les noms des femmes, non pas pour les ignorer, au contraire, mais pour souligner leur rôle dans ce film. Car Michel Ocelot ne se contente pas d’aligner des vignettes ni de nous faire feuilleter le somptueux album des célébrités de la Belle Époque. Ce ne serait déjà pas mal, mais il fait bien davantage, il raconte une histoire en nous faisant entrevoir la face cachée de la Ville-lumière, celle des bas-fonds, celle des égouts, celle qui se complaît dans ses ténèbres. Pour ce faire, il puise dans un héritage qui semble droit venu des romans-feuilletons ou des romans populaires tels qu’en écrivaient, par exemple, un Eugène Sue, un Paul Féval ou un Ponson du Terrail. Et il le fait avec autant de talent que ces derniers, car, bien sûr, les genres littéraires que privilégiaient ces écrivains n’ont pas moins de grandeur que les autres.
Le Paris de la Belle Époque, Michel Ocelot l’imagine assombri par les machinations sordides d’une société secrète dont les membres se font appeler les « mâles-maîtres », société qui s’est jurée d’anéantir toute émancipation des femmes et qui, pour ce faire, s’emploie à enlever des petites filles afin de les asservir. Avec cette histoire, le cinéaste oriente son film non seulement du côté des romans populaires mais aussi du côté d’un cinéma clairement engagé en faveur de la cause des femmes. Et ce sont ces dernières, justement, qui ont le beau rôle pour accompagner Dilili et Orel dans la résolution de leur enquête et dans la mise en échec des « mâles-maîtres » esclavagistes. Des femmes émancipées, précisément, du genre de Louise Michel dont j’ai déjà parlé, mais aussi de Colette, de Camille Claudel, de Sarah Bernhardt, de Marie Curie et d’Emma Calvé, une des grandes cantatrices de cette époque, celle qui s’engage la plus résolument aux côtés de Dilili et Orel. Face à de telles femmes les kidnappeurs de petites filles n’ont aucune chance d’avoir le dernier mot !
Bien sûr, en racontant une histoire qui se déroule au temps de la Belle Époque, Michel Ocelot nous parle tout autant d’aujourd’hui. La cause de l’émancipation féminine que le cinéaste défend doit encore mener bien des combats. Les petites filles que les « mâles-maîtres » revêtent d’un habit noir et obligent à marcher à quatre pattes nous renvoient à des images très contemporaines. Certes notre regard se tourne aujourd’hui du côté du sort réservé aux femmes chez les islamistes radicaux, mais le film de Michel Ocelot nous rappelle aussi que notre histoire d’occidentaux est loin d’être exemplaire. Nous aussi, nous avons à changer nos regards et à convertir nos manières d’être, ce film d’un homme indigné par ce que l’on fait encore trop souvent subir aux femmes nous y invite à bon escient.
9/10
PS.: Quand on demande à Michel Ocelot pour quel public il destine ses films, il répond invariablement qu’il ne fait pas des films pour enfants. Il veut dire par là que ses films s’adressent à tous les publics et à tous les âges.
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180924 – Cinéma
FORTUNA
Un film de Germinal Roaux.
« Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit ». Cette citation de l’Evangile selon saint Jean (3,8) convient si parfaitement à ce film que le réalisateur, le franco-suisse Germinal Roaux, a cru bon de l’y insérer à deux reprises.
En effet, le vent qui souffle sur le monastère des Alpes suisses qui sert de cadre à cette œuvre de toute beauté provoque de l’inattendu. La petite communauté de cinq moines, si retirée dans un endroit si paisible, a fait des choix audacieux qui l’ébranlent et l’obligent à des remises en cause. Ces moines, guidée par leur père abbé (admirablement interprété par Bruno Ganz), ne se sont pas dérobés face aux exigences de l’Evangile. « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » : la phrase prononcée par Jésus en l’Evangile selon saint Matthieu (25,35), ils ont eu l’audace de l’appliquer à la lettre, sans se chercher de faux prétextes pour ne rien faire. Et ils hébergent donc, dans leur grand bâtiment conventuel, un groupe de réfugiés.
Fortuna (Kidist Siyum Beza), une jeune Ethiopienne de 14 ans toujours hantée par le traumatisme endurée lors de sa périlleuse traversée de la Méditerranée, fait partie de ce groupe. Elle est chrétienne, elle est encore une enfant naïve qui parle aux animaux, mais elle est aussi et surtout une adolescente qui aime se retirer dans une chapelle creusée dans la roche pour y prier Marie. C’est à la Vierge qu’elle préfère se confier, tout en se demandant ce qui lui arrive. Car, au monastère, elle a rencontré un homme, un musulman du nom de Kabir, et la voilà enceinte. De ce fait, elle ne veut pas entendre parler d’un foyer d’accueil, au point de s’enfuir lorsqu’il est question de l’y conduire. Candide comme elle l’est, elle espère que, malgré son jeune âge, elle pourra se marier avec Kabir.
Tout ne se passe pas aussi simplement, on le devine, et le paisible monastère devient le théâtre d’évènements qui le perturbent grandement : non seulement du fait de Fortuna et de sa grossesse, mais aussi parce que les autorités du pays ont jugé qu’il fallait intervenir en ce refuge pour vérifier les identités des migrants et en emmener manu militari dans d’autres centres d’accueil. De ce fait, Fortuna se trouve séparée de Kabir, ce dernier étant l’un de ceux qui sont emmenés par les policiers.
Toutes ces péripéties ont de quoi déstabiliser la petite communauté des moines. A deux reprises, l’une aussitôt après la venue des policiers, l’autre lorsque se pose de manière cruciale le cas de Fortuna, le père abbé réunit la communauté afin de débattre et de décider de ce qu’il convient de faire. Dans ces moments, il faut le dire, c’est la parole de l’abbé, celui qui, à la fois, se montre le plus audacieux et fait preuve de la plus grande sagesse, c’est sa parole qui prévaut. Il trouve les mots pour apaiser les craintes des frères dont la vocation même est dérangée, eux qui se sont retirés dans un monastère pour y être à l’abri des bruits du monde. Mais cela suffit-il à se soustraire aux exigences de l’Evangile ? Quant à Fortuna, à qui un des frères, affolé, a conseillé d’avorter, ne doit-elle pas elle-même, malgré son jeune âge, prendre son destin en mains ? Pour le père abbé, en tout cas, c’est sûr, chaque fois que des membres de l’Eglise ont voulu imposer leur volonté aux autres au nom de leur foi, ils se sont gravement fourvoyés. Que de mal on a pu commettre, dans l’Eglise, en contraignant autrui à faire ce qu’on estimait être bon pour lui !
Photographe autant que cinéaste, Germinal Roaux a eu le bon goût de tourner ce film en noir et blanc. Un choix qui rend cette oeuvre encore plus belle et plus fascinante. Un film à ne pas manquer !
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180924 – Littérature
LA NEUVIÈME HEURE
Un roman de Alice McDermott.
À l’occasion de la rentrée littéraire de ce mois de septembre 2018, le magazine « La Vie » proposait récemment tout un dossier sur le « retour du héros religieux ». Il est remarquable, en effet, de constater que, parmi l’abondante édition de romans encombrant les étals des libraires, il en est plusieurs qui accordent une place non négligeable à des figures chrétiennes. Il y a de quoi s’interroger à ce sujet. Dans le monde déboussolé et vacillant qui est le nôtre, il semble que des écrivains aient recours à des personnages incarnant, avec plus ou moins de bonheur mais avec conviction, l’engagement d’une vie donnée au nom de Jésus-Christ.
Le plus souvent, les romanciers imaginent, pour ce faire, des figures de prêtres. Mais il est une exception notable, celle de la romancière américaine Alice McDermott qui préfère, dans « La Neuvième Heure », donner la part belle à une communauté de religieuses de l’ordre des Petites sœurs soignantes des pauvres malades, implantée dans le quartier de Brooklyn au début du XXème siècle, quitte à écorner au détour d’une phrase les « curés » qui, selon Mme Tierney, l’un des personnages du livre, sont des « enfants gâtés » au regard des religieuses. « Ce sont elles qui s’occupent de tout », ajoute-t-elle.
Il y a du féminisme chez Alice McDermott, aucun doute, mais un féminisme de bon aloi, qui vient à point nommé et qui rend justice aux communautés de religieuses et à leur dévouement envers les plus pauvres. Plusieurs œuvres, en particulier au cinéma, ces dernières années, ont mis en lumière le rôle peu reluisant joué par certaines communautés de religieuses dans l’exploitation éhontée de jeunes femmes soi-disant fautives qui leur étaient confiées (ainsi « The Magdalene Sisters » en 2003 et « Philomena » en 2014). Mais si d’aussi injustifiables dérives ont bel et bien eu lieu, il serait totalement abusif d’en faire porter l’opprobre sur toutes les communautés de religieuses. La plupart d’entre elles, fort heureusement, mériteraient bien davantage d’ovations que de réprobation.
Le roman d’Alice McDermott, très habilement construit, a, pour fil rouge de son récit une « enfant de couvent » prénommée Sally. Et tout commence par le suicide de son père, Jim, un employé d’une société de transport qui vient de perdre son emploi. Bien que Annie, sa femme, lui a fait savoir, peu de temps avant, qu’elle est enceinte, Jim rentre chez lui, calfeutre toutes les issues et ouvre le gaz. Et c’est tout juste si, en rentrant chez elle, sa femme ne fait pas tout exploser.
C’est peu de temps après ces évènements tragiques qu’intervient l’une des religieuses de la communauté implantée dans ce quartier, Sœur Saint-Sauveur, qui passait par là et offre aussitôt ses services, essayant, entre autres choses, mais sans y parvenir, de déguiser le suicide en accident pour que le défunt puisse avoir droit à un enterrement en terre consacrée. Efficace, la religieuse obtient, quoi qu’il en soit, l’admission de la jeune veuve à la blanchisserie du couvent où elle est invitée à travailler en compagnie d’une certaine Sœur Illuminata.
C’est donc dans ce cadre que naît et grandit Sally, l’enfant de Annie. Une « enfant de couvent » qui fait le bonheur de la communauté (tout en créant aussi quelques rivalités, car la romancière s’est bien gardée de décrire des religieuses totalement infaillibles et parfaites). Toujours est-il que, une fois devenue suffisamment grande, Sally estime être appelée à cette vie-là : elle pense avoir une vocation à la vie religieuse. Mais que connaît-elle d’autre, elle qui a grandi entre les murs d’un couvent ? Que devient sa résolution lorsqu’elle est mise à l’épreuve ? Dans un train qui l’emmène vers le noviciat à Chicago, la jeune fille fait des rencontres pour le moins troublantes. Et lorsqu’elle accompagne l’une des religieuses au chevet des personnes malades, que devient sa vocation ? C’est facile de concevoir un idéal entre les murs d’un couvent, c’est autre chose quand il s’agit de se mettre au service de malades à l’aspect déplaisant, voire même répugnant. Et quand, de plus, la jeune fille se trouve témoin des incartades de sa propre mère…
Ce beau sujet d’une vocation supposée mais rudement mise à l’épreuve, Alice McDermott le raconte avec une qualité de narration qui rend le roman très convaincant. La romancière sait parfaitement caractériser non seulement chaque religieuse mais chaque personnage de l’histoire. On n’oublie pas de sitôt Sœur Saint-Sauveur qui, revenant du cimetière où le suicidé a dû être enterré en dehors du terrain consacré, affirme : « Si c’était moi qui dirigeais l’Eglise, elle serait bien différente » ! Ou Sœur Jeanne qui, choquée par les malheurs du monde, s’étonne de « la folie avec laquelle la souffrance est distribuée dans le monde », folie qui « défie toute logique » (la même Sœur Jeanne racontant, dans un autre chapitre du roman, l’histoire de Jeanne Jugan). Ou Sœur Dymphna qui garde dans un album des exemples de vie religieuse, au centre desquels elle a placé Mère Marianne Cope et le Père Damien qui donnèrent leur vie au service des lépreux de Molokaï (ce qui vaut au lecteur une belle page sur ces grandes figures de sainteté). Mais on n’oublie pas non plus les autres personnages du roman, qui n’appartiennent pas à la communauté des religieuses : M. Costello le laitier et sa femme recluse à la maison pour infirmité, et tous les membres de la famille Tierney, dont Mme Tierney qui estime que, tout de même, la sainteté est « ennuyeuse » et lui préfère « le chaos, l’activité, l’agitation… » « Elle aimait les histoires de péchés, ajoute malicieusement la romancière, plus que les contes de vertu » ! Une romancière qui sait de quoi elle parle, car que seraient les romans sans histoires de péchés ?
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180917 – Cinéma (documentaire)
LE TEMPS DES FORÊTS
Un film de François-Xavier Drouet.
Quand il est question des désastres écologiques et environnementaux qui se multiplient sur notre planète, il ne vient sans doute pas à l’esprit de grand monde l’exemple des forêts de chez nous. On sait bien que, de par le monde, la déforestation fait des ravages en de nombreux pays. En France, on peut, par ignorance, supposer que les forêts sont préservées, mais il n’en est rien, comme le montre, de manière évidente, ce documentaire. Certes, comme cela est expliqué dès le début du film, ce n’est pas tellement de déforestation que souffre notre environnement, mais c’est de « mal-forestation », ce qui ne vaut guère mieux. Autrement dit, on a tendance, de plus en plus, à gérer l’espace forestier en usant de la même logique que celle qui prévaut pour l’agriculture intensive. Partout où on le peut, on abat la forêt traditionnelle, composée d’un mélange harmonieux de diverses essences, feuillus et résineux, pour y faire pousser une seule espèce d’arbres, en privilégiant bien sûr ceux dont la croissance est la plus rapide, c’est-à-dire les résineux. Or, dans ces forêts, si l’on peut encore parler de forêts, hormis les arbres qu’on fait pousser à coup d’engrais et sans ménager les pesticides, il n’y a plus de vie : plus de végétaux, plus d’animaux, plus d’oiseaux. Rien que des arbres dont l’abattage est déjà programmé. Seule compte encore une logique de rentabilité, qui se moque comme d’une guigne tant de l’équilibre écologique que du bien-être des personnes, y compris de ceux qui travaillent dans ce secteur.
Le constat fait par le réalisateur, François-Xavier Drouet, qui a sillonné la France en diagonale, depuis les landes de Gascogne jusqu’au massif des Vosges en passant par le plateau de Millevaches et par le Morvan, le constat est accablant. Les engins utilisés dans les exploitations forestières pour y faire des coupes rases, c’est-à-dire pour abattre tous les arbres d’une parcelle en un temps record, ces engins surpuissants et d’un coût faramineux dévastent tout l’environnement, défoncent les chemins et détruisent les cours d’eau. Mais, même là où de tels engins ne sont pas utilisés, les forestiers sont incités à ne plus produire que des arbres standard, dont le diamètre doit se situer entre 30 à 40 cm. Autrement dit, il y a de moins en moins de gros arbres dans nos forêts. Quant aux forestiers (qu’on voit, lors d’une séquence, manifester et exprimer leur mal-être devant l’Office National des Forêts de l’avenue Saint-Mandé à Paris), ils ont le sentiment de faire leur travail en dépit du bon sens et d’être traités par le mépris. Ceux qui décident de l’exploitation des forêts françaises ne connaissent pas la réalité du terrain. Et chez les forestiers, le mal-être est parfois si grand qu’il se solde par un suicide.
Fort heureusement, comme a pris soin de le montrer aussi le réalisateur, il est des forestiers qui résistent, autant qu’ils le peuvent, à la logique de rentabilité qui a tendance à prévaloir aujourd’hui. C’est à eux, « les forestiers résistants », que le film est dédié. Puissent-ils tenir bon, pour qu’il reste des forêts dignes de ce nom dans notre pays de France !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180906 – Cinéma
INVASION
Un film de Kiyoshi Kurosawa.
« Que ferais-tu si c’était bientôt la fin du monde ? » A cette question qui lui est posée par son mari Tetsuo, Etsuko, une ouvrière du textile, apporte le même genre de réponse que celle qu’on prête à saint Dominique Savio : « Rien, probablement, répond-elle. Je continuerai simplement à vivre. » Cependant, dans le film du prolifique cinéaste japonais Kiyoshi Kurosawa, si la question est formulée, c’est parce qu’une menace réelle pèse sur l’humanité et pourrait la détruire. L’invasion, qui donne son titre au film, n’est rien moins que celle d’extra-terrestres qui, avant de prendre possession de notre globe, se sont infiltrés sur terre en se camouflant sous des apparences humaines.
Le même sujet avait déjà été traité par Kurosawa l’an dernier dans un film intitulé « Avant que nous disparaissions », mais d’une manière plus fantaisiste. Dans « Invasion », le cinéaste ose le pari de la sobriété, de l’épure, du dépouillement le plus radical possible. Pas ou quasiment pas d’effets spéciaux à grand tapage. Toute l’angoisse générée par le film repose sur le jeu des acteurs, sur des signes inquiétants, des bruits soudains, des murs qui se mettent à trembler, des coups de vent, des courants électriques qui semblent se transmettre dans des poignées de main, des corps qui s’écroulent sur le sol et une bande-son rigoureusement et excellemment conçue (tant du point de vue des bruitages que de celui de la musique). Cela suffit à fabriquer des séquences de frayeur quasi palpable et à la communiquer irrésistiblement aux spectateurs.
Cette manière de faire me convient totalement (le seul bémol étant, à mon avis, la longueur excessive du film), je la préfère de loin aux débauches d’effets spéciaux qui encombrent tant d’autres films. Mais à cela s’ajoutent des subtilités de scénario tout à fait intéressantes et séduisantes. En voyant le film de Kurosawa, je songeais, par moments, à « Rhinocéros », la pièce fameuse de Ionesco dans laquelle un des personnages parvient à résister à la déshumanisation qui s’empare de tous les autres. Il y a quelque chose du même ordre dans « Invasion », dans la mesure où les extra-terrestres ayant pris des apparences humaines ont pour but de voler aux humains leurs concepts et, donc, de les priver d’une part d’eux-mêmes (autrement dit de les déshumaniser) et de les détruire (ce qui donne lieu aux scènes les plus impressionnantes du film, celle où les humains s’écroulent par terre). Seule Etsuko parvient à résister à l’emprise des extra-terrestres qui ne réussissent à l’amputer d’aucun de ses concepts. Mais ce que suggère le film est encore plus intéressant et plus beau qu’une simple opposition dont on ne connaîtrait pas la cause. Ce qu’indique le film, c’est que c’est l’amour qui sauve Etsuko, le seul concept dont ne peuvent s’emparer les extra-terrestres. Parce que précisément il s’agit de bien davantage que d’un concept. L’amour est vivant, il est incarné, il est fort et il peut même être combatif. Et il rend libre, même quand l’oppresseur vient d’ailleurs et est doté de pouvoirs extraordinaires.
7,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180901 – Litérature
UNE HISTOIRE DES ABEILLES
Un roman de Maja Lunde.
Souvent, quand il est question des menaces qui pèsent sur les abeilles en provoquant leur surmortalité, revient, sous la plume des commentateurs, la fameuse citation selon laquelle « si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre ». Cette phrase étant attribuée à Einstein, le lecteur est évidemment incité à la prendre très au sérieux. Sauf que le célèbre physicien, qui n’avait sans doute pas de compétence particulière dans les questions d’écologie, n’a jamais ni prononcé ni écrit cette phrase. Beaucoup plus intelligemment, plutôt que d’adhérer sans y réfléchir à la teneur de cette pseudo-citation, la romancière norvégienne Maja Lunde a enquêté et s’est informée auprès de personnes qualifiées afin de rédiger un roman dont la lecture est à la fois instructive et passionnante. Un triple récit, en vérité, qui ne néglige aucun des signaux d’alarme environnementaux (dont l’effondrement des colonies d’abeilles qui en est, en quelque sorte, l’archétype) risquant de compliquer drastiquement la vie des humains sur la terre, mais un récit qui, subtilement, ne cède pas totalement au catastrophisme, un récit qui ménage donc (je le dis sans en révéler la nature) une lueur d’espoir.
Triple récit, écrivais-je, car la romancière a réussi le pari audacieux d’imbriquer trois histoires dans son ouvrage, mais trois histoires dont on découvre, au fil des pages, que, même si elles semblent éloignées les unes des autres à la fois dans le temps et dans l’espace, elles n’en possèdent pas moins des liens ou, si l’on préfère, des dominateurs communs, le plus important relevant de l’apiculture, l’autre étant du domaine de la transmission.
Trois personnages supervisent chacun des trois récits. William est le premier dans l’ordre chronologique : il vit en Angleterre en 1851, aux côtés de sa femme Thilda qui lui a donné une ribambelle de filles (qu’il peine à distinguer les unes des autres) et un garçon, Edmund, sur qui il fonde beaucoup d’espoir. Se relevant péniblement d’une dépression, l’homme vit chichement d’un commerce de grains mais, surtout, sous l’égide de son mentor Rahm, se passionne pour l’apiculture, cherchant à inventer de nouvelles méthodes de travail avec, pour objectif principal, la construction d’un nouveau type de ruches, des ruches « dont on pourrait ôter les rayons sans devoir tuer les abeilles ni même troubler leur repos », mais sans savoir, qu’au même moment, en Amérique, un certain pasteur Langstroth exécute le même genre de recherches.
Le deuxième récit, dont le narrateur se prénomme George, se déroule en 2007 aux Etats-Unis, dans l’Ohio. George, qui est marié à Emma, est le père de Tom, un étudiant qu’il va chercher à la gare au début du roman, dont il découvre bientôt qu’il est devenu végétarien et, surtout, à qui il espère transmettre sa ferme et sa passion pour l’apiculture, le problème étant que le jeune homme, lui, de son côté, caresse d’autres ambitions. Mais le pire arrive à George lorsque, plus tard, il découvre, impuissant, qu’une bonne partie de ses ruches se sont vidées de leurs occupantes. Lui, qui espérait en être préservé, assiste à ce désastre de la disparition pure et simple des abeilles.
Le troisième récit, enfin, nous transporte dans un futur relativement proche. Tao, la narratrice, est chinoise et son histoire se déroule en 2098. La jeune femme, comme beaucoup de ses consoeurs, est contrainte de travailler dans les vergers afin de polliniser manuellement les arbres fruitiers, les insectes qui faisaient cette besogne s’étant totalement évanouis. Mais le drame, pour son mari Kuan et, plus encore, pour elle, c’est ce qui survient à leur fils Wei-Wen, retrouvé inconscient, victime d’un mal étrange et inexpliqué. L’alerte aussitôt donné, les autorités du pays subtilisent l’enfant et établissent un périmètre interdit autour du lieu où celui-ci a été retrouvé. S’engage alors pour Tao, en mère qui ne peut se contenter d’attendre d’hypothétiques nouvelles, une quête éperdue afin de savoir où a été emmené son fils et ce qui lui est arrivé, quête qui, passant par Beijing, la conduit de surprise en surprise et, étrangement, lui fait même repérer la trace de William, le narrateur du premier récit dans l’ordre chronologique.
Je n’en dis pas davantage pour ne pas dévoiler les intrigues des trois histoires entrecroisées et qui, étonnamment, comme je viens de l’indiquer, se rejoignent et se répondent. Construit avec art et habileté, ce roman non seulement tient en haleine, non seulement diffuse un enseignement sur la vie des abeilles et sur l’apiculture, mais aussi conduit inévitablement le lecteur à se coltiner quelques redoutables questions. Qu’adviendra-t-il si, comme le suppose le roman en s’appuyant sur beaucoup de signes alarmants de notre actualité, les insectes pollinisateurs en viennent à disparaître de la surface de notre planète ? Faudra-t-il polliniser à la main, comme le fait Tao dans le roman ? Trouvera-t-on d’autres solutions pour pallier le manque d’insectes ? Quoi qu’il en soit, ce qui est sûr, c’est que, avant qu’il ne soit trop tard, il faudrait mettre tout en œuvre pour enrayer, voire stopper, le déclin des colonies d’abeilles. Un déclin qui pourrait devenir un effondrement planétaire, comme l’imagine la romancière, ce qui entraînerait un vrai désastre. Autrement dit, c’est aujourd’hui qu’il faut agir !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180829 – Cinéma
BURNING
Un film de Lee Chang-dong
Dans « Poetry », son film somptueux et bouleversant sorti en 2010, le coréen Lee Chang-dong mettait en scène une dame âgée, atteinte par un début de maladie d’Alzheimer et s’inscrivant néanmoins à un cours de poésie proposant, comme objectif, la rédaction d’un poème. Aujourd’hui, avec « Burning », le cinéaste raconte l’histoire de Jongsu, un jeune garçon qui se rêve en écrivain, se promettant d’écrire sans tarder un roman, à l’instar de William Faulkner, son auteur de prédilection. Or, si, tout au long du film, on ne voit pas le garçon écrire une seule ligne de ce livre fantasmé, on a aussi le sentiment que c’est peut-être bien le film lui-même qui est le roman projeté par Jongsu. Lui-même devient personnage de son propre roman, lui ainsi que Haemi, la jeune fille qu’il rencontre par hasard et qui se fait reconnaître à ses yeux comme une amie d’enfance que le garçon trouvait autrefois « moche » mais qu’il avait néanmoins sauvée d’un puits dans lequel elle était tombée (c’est du moins ce qu’elle prétend, car Jongsu ne garde aucun souvenir de l’événement).
« Moche », Haemi l’était peut-être dans le passé, mais elle ne l’est certes plus aujourd’hui, bien au contraire et Jongsu ne tarde pas à être séduit et à passer dans son lit. Cependant, si la jeune fille est belle, joyeuse, attractive, elle n’en révèle pas moins ses zones de mystère et ses fêlures d’âme, ainsi que ses aspirations. Et puis, elle a, pourrait-on dire, une fâcheuse tendance à l’évaporation. Elle disparaît une première fois pour un voyage en Afrique, laissant à Jongsu le soin de s’occuper de son chat (un chat dont on se demande, pendant une bonne partie du film, s’il est ou non réel !). A son retour, le garçon découvre avec effarement qu’Haemi n’est pas seule. Elle revient accompagnée de Ben, curieux jeune homme riche et oisif dont elle s’est manifestement éprise. Commence alors un triangle amoureux bourré d’étrangeté et d’ambiguïté. Non seulement Ben ne congédie pas Jongsu mais il semble comme attiré par lui, allant jusqu’à lui faire des confidences, lui révélant qu’il brise parfois son oisiveté en incendiant un de ces serres couvertes de plastique extrêmement abondantes dans la campagne de Corée.
Le mystère, diffus tout au long du film, s’épaissit lorsque disparaît une deuxième fois Haemi, non plus pour un voyage, mais sans que personne ne sache (apparemment, en tout cas) ce qu’elle est devenue. Elle s’est comme évaporée. Tout en s’occupant de la ferme paternelle, travail qu’il doit exécuter du fait que son père a des démêlés avec la justice, Jongsu mène ses investigations afin de découvrir la vérité à propos d’Haemi dont il est toujours éperdument amoureux. Pour ce faire, soupçonneux quant à l’implication de Ben, il le prend parfois en filature. Mais ce dernier n’est pas le moins du monde effarouché et semble avoir gardé plus que de l’affinité pour Jongsu.
Inspiré d’une nouvelle de l’écrivain japonais Haruki Murakami (« Les Granges brûlées »), écrivain qui s’est spécialisé dans l’écriture de récits mêlant subtilement l’étrangeté au quotidien le plus banal, le film en conserve indéniablement l’empreinte. Comment le définir ? Mélodrame, thriller, film social, film symboliste, il est tout ça à la fois. Ce qui est sûr, c’est qu’une telle œuvre ne peut convenir à ceux qui n’apprécient que les histoires à la Sherlock Holmes, c’est-à-dire s’achevant par la résolution de tous les mystères. Dans « Burning », la tension accumulée au cours du film conduit vers une inéluctable violence qui non seulement ne résout rien mais augmente encore les incertitudes. Comme l’explique lui-même Lee Chang-dong dans une interview, « dans un polar, généralement, tout mystère s’éclaire à la fin. Je crois, moi, que nos vies sont des énigmes que le temps n’éclaircit jamais vraiment. » Son film en donne la démonstration et, de ce fait, accorde un grand espace d’imagination pour le spectateur. Comme Jongsu, chaque spectateur se demande ce qu’est devenue Haemi, pourquoi elle a disparu. D’autant plus que, comme Jongsu également, chaque spectateur garde en mémoire les deux scènes les plus belles du film, toutes deux se focalisant sur le personnage d’Haemi : l’une la montrant mimant avec gourmandise et sensualité l’épluchage et la dégustation d’une mandarine, l’autre la montrant poitrine dénudée dansant à la manière des femmes du désert du Kalahari, en Afrique. C’est la danse des « little hungers » et des « big hungers », autrement dit de la petite faim corporelle et de la grande faim de l’esprit, la faim de qui cherche un sens à la vie. Pas sûr que ce film ait l’ambition de définir ce sens, mais il met si bien en scène le mystère que cela suffit amplement à combler les appétits et à fasciner les regards.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180822 – Cinéma
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN
Un film de Spike Lee.
Sorti sur les écrans en 1915, « Naissance d’une nation » de D. W. Griffith est généralement considéré par les historiens et les spécialistes comme un jalon marquant de l’histoire du 7ème art. Film à grand spectacle, novateur d’un point de vue formel, il mêle savamment la grande et la petite histoire, racontant la naissance de l’Union du Nord et du Sud au lendemain de la guerre de sécession du point de vue de deux familles parmi d’autres comme du point de vue de la collectivité dans son ensemble. Or, dans sa deuxième partie, ce film ne fait rien moins que l’apologie du Ku Klux Klan, imaginant des justifications à la création de cette organisation et tâchant de prouver que l’Union n’a pu se créer et perdurer qu’en pratiquant le rejet d’éléments considérés comme étrangers à l’identité américaine, au premier rang desquels les Noirs. Le film connut un tel succès qu’il contribua à la réémergence de l’organisation raciste. Aujourd’hui, comme le montre, lors de deux séquences impressionnantes, le film de Spike Lee, même si plus d’un siècle s’est écoulé depuis son tournage, « Naissance d’une nation » reste une référence pour les suprémacistes blancs des États-Unis qui se le projettent volontiers en éructant de plaisir chaque fois qu’apparaissent les membres du KKK et que sont molestés, voire assassinés, des Noirs à l’écran.
Heureusement, il se trouve de nos jours des cinéastes qui ne s’en laissent pas conter et qui s’efforcent de remettre les pendules à l’heure et l’histoire à l’endroit. La « naissance d’une nation », les États-Unis, repose sur un génocide, celui des Indiens, et sur les souffrances insupportables infligées à ceux qui étaient perçus comme inférieurs du point de vue de la race, en particulier les Noirs. Cette gangrène qui ronge l’Amérique n’a jamais totalement disparu. Spike Lee, pour les besoins de son film, raconte une histoire qui se déroule en 1978 à Colorado Springs, celle de Ron Stallworth (John David Washington) qui fut le premier policier noir américain de cette ville.
La suite est bien plus stupéfiante mais, aussi étonnante soit-elle, elle est basée sur des faits réels. Ce policier noir, en effet, réussit l’inimaginable : infiltrer le Ku Klux Klan. Pour ce faire, évidemment, il lui fallut adopter un stratagème : c’était lui en personne qui établissait tous les contacts par téléphone avec les membres du KKK, mais ce fut un de ses collègues, Flip Zimmerman (Adam Driver), qui se fit passer pour lui afin d’intégrer réellement l’organisation. Or, on le devine à son nom véritable, ce policier se faisant passer pour un raciste du nom de Ron Stallworth était un Juif, ce que subodora sans pouvoir le prouver un des adeptes du KKK, société qui déteste les Juifs (« tueurs du Christ ») presque autant que les Noirs. Ironie de l’histoire : ce fut précisément à cause de toute cette aventure que Flip Zimmerman, qui ne s’en souciait guère jusque là, prit réellement conscience de sa judéité.
Il faut le reconnaître, Spike Lee ne fait pas dans la dentelle. Les membres du KKK, dans son film, apparaissent particulièrement bas du plafond et l’on peut se demander dans quelle mesure leurs propos haineux sont caricaturaux. Reste cependant ce que vise avant tout le cinéaste : l’efficacité. Et, sur ce terrain, le film est indéniablement réussi. Après tout, quand on a affaire à une organisation aussi détestable que le KKK, les précautions et les nuances n’ont rien d’obligatoire, me semble-t-il. Le cinéaste tape fort et néanmoins tape juste, se posant clairement la question de la riposte nécessaire face à la haine raciste des suprémacistes blancs. Question qui demeure d’actualité comme le montrent les séquences de la fin du film tournées lors des émeutes de Charlottesville qui, le 12 août 2017, virent s’affronter des tenants de l’extrême droite et des militants antiracistes. Car, bien sûr, si la majeure partie du film de Spike Lee raconte des faits s’étant déroulés en 1978, celui-ci interpelle ouvertement l’Amérique d’aujourd’hui, celle qui a donné la victoire à Donald Trump. Lui non plus ne fait pas dans la dentelle, n’est-ce pas, c’est le moins qu’on puisse dire !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180804 – Cinéma
ARYTHMIE
Un film de Boris Khlebnikov.
Comme dans « My Lady », le film de Richard Eyre qui vient de sortir sur les écrans, il est question, au cours de ce film-ci, d’une personne malade ayant besoin d’une transfusion sanguine alors qu’elle fait partie des Témoins de Jéhovah ! Sauf qu’ici il s’agit d’une femme âgée et que c’est sa fille qui émet de sérieuses protestations. Et puis il ne s’agit, dans « Arythmie », que d’un épisode parmi bien d’autres : les cas difficiles, les décisions à prendre sans attendre, c’est le quotidien des personnages d’urgentistes d’une ville de Russie que met en scène Boris Khlebnikov avec un talent considérable.
La magistrate du film de Richard Eyre peut se permettre de suspendre une audience afin d’aller au chevet d’un malade et de se mettre à son écoute. Pour les urgentistes d’ « Arythmie », pas question de prendre le temps d’une pause : c’est, comme l’indique fort bien leur nom, dans l’urgence qu’il faut prendre les décisions, y compris quand se présentent de terribles dilemmes. Que faire quand on doit intervenir auprès d’une malade faisant une crise d’asthme aiguë alors que, dans le même temps, on reçoit un appel ordonnant de se rendre auprès d’un autre malade risquant de mourir ? Que faire quand on se trouve devant une fillette électrocutée qui ne peut être sauvée que si l’urgentiste fait une opération sur place, mais au risque d’une hémorragie qui pourrait être fatale ?
Tout cela, parmi bien d’autres interventions compliquées, les urgentistes ne demandent qu’à le gérer au mieux, mais il faut tenir compte aussi de l’administration des hôpitaux et d’une direction qui applique à la lettre des consignes qui se soucient davantage de la rentabilité que du bien-être des personnes. Oleg (Alexandre Yatsenko), comme tous ses collègues urgentistes, en est indigné. Ses décisions, il persiste à les prendre selon sa conscience et en fonction de ce qu’il considère bénéfique pour le rétablissement des malades et des accidentés, quitte à devoir supporter ensuite le mécontentement du directeur de l’hôpital.
Boris Khlebnikov dresse un portrait infiniment touchant de ce personnage, un personnage pétri d’humanité mais toujours vacillant, non seulement du fait de la dureté de son métier, mais aussi du fait de sa vie privée, de son histoire de couple avec Katia (Irina Gorbatcheva), une jeune femme qui exerce, elle aussi, le métier d’urgentiste. Que reste-t-il de leur vie commune ? Trouvent-ils encore le temps de se parler ? Au début du film, c’est par SMS que Katia annonce à Oleg qu’elle veut divorcer ! Pourtant, lorsque tous deux se retrouvent et essaient de se parler, on devine que leur histoire commune n’est pas nécessairement finie. Qui sait si, malgré les apparences, ils n’ont pas terriblement besoin l’un de l’autre ? Mais il faudrait peut-être qu’Oleg boive moins d’alcool et essaie de se mettre à l’écoute de Katia, plutôt que de faire le fanfaron au risque de provoquer sa colère… Sinon, lui qui s’acharne à sauver les vies d’autrui pourrait perdre la sienne !
Malgré son titre, « Arythmie » est un film formidablement rythmé, doté d’une superbe mise en scène, et surtout c’est un film très émouvant qui, j’en fais le pari, ne laissera insensible aucun de ses spectateurs.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180725 – Cinéma
CONTES DE JUILLET
Un film de Guillaume Brac.
Après « L’île au trésor », séduisant documentaire se déroulant tout entier à la base de loisirs de Cergy-Pontoise, voici la fiction ou plutôt les fictions, car le film se subdivise en deux parties distinctes. Le titre rappelle irrésistiblement Éric Rohmer, qui s’était plu à tourner, parmi son abondante filmographie, quatre films se référant à chacune des quatre saisons. Manifestement donc, Guillaume Brac a voulu rendre hommage à son illustre aîné, tout en ne se départant pas d’une nécessaire modestie : « juillet est le tiers d’un été », rappelle-t-il, sans doute pour indiquer qu’il ne cherche pas à rivaliser avec le réalisateur de « Conte d’été » (1996).
De fait, les deux sketches qui composent « Contes de juillet » n’ont rien de spectaculaire, ils se contentent de raconter une journée parmi d’autres de quelques personnages durant le mois de juillet de 2016. S’il s’agissait de littérature, ce serait deux nouvelles, deux courts récits d’apparence très simple, mais qui, comme dans les meilleures histoires de cette sorte, révèleraient, l’air de rien, bien des subtilités. Et c’est ce que réussit parfaitement Guillaume Brac, preuve, s’il est besoin, qu’on peut faire de l’excellent cinéma sans s’encombrer de gros moyens.
Dans le premier sketch, « L’Amie du dimanche », le réalisateur raconte la sortie de deux collègues de travail se proposant de passer une journée de détente à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Mais, une fois sur place, les choses se gâtent, l’une des filles se laissant séduire assez facilement par un agent de sécurité qui lui promet la visite de quelques endroits secrets du parc après sa fermeture, l’autre fille se sentant délaissée et décidant de partir de son côté pour, en fin de compte, faire, elle aussi, une rencontre, celle d’un garçon qui s’entraîne à l’escrime.
Dans le deuxième sketch, c’est Hanne, une étudiante norvégienne, qui vit sa dernière journée à Paris avant son retour au pays. Cela se passe le 14 juillet. La jeune fille veut profiter de cette journée de fête, mais ses projets se trouvent perturbés par des garçons séducteurs (un collègue étudiant italien et un aguicheur qui s’était mis à la suivre tandis qu’elle essayait d’apercevoir le défilé des troupes). À ces deux-là, viennent s’ajouter, au cours du film, une étudiante en physique quantique et un pompier appelé à la rescousse, suite à une altercation entre les deux galants.
Si, dans « L’île au trésor », Guillaume Brac faisait la part belle à la joie de vivre et exaltait l’esprit d’enfance, il donne à ces deux sketches un contenu plus mélancolique, voire plus grave. Tous les protagonistes qui s’y croisent aspirent, eux aussi, à la joie de vivre, sans nul doute, et il leur arrive de s’y adonner. Cependant, leurs maladresses, et parfois même leurs goujateries, détériorent toujours, au bout du compte, l’esprit de fête. Il faut d’ailleurs remarquer que c’est, le plus souvent, du côté des garçons que surgissent les balourdises et les impudences. Mine de rien, avec ses histoires toutes simples et limpides, Guillaume Brac suggère avec habileté les dissemblances et les incompréhensions qui finissent, presque fatalement, par éloigner les êtres les uns des autres. Comme il est facile de se mentir à soi-même et de tromper (ou de chercher à tromper) les autres ! Et comme c’est dur, comme c’est triste et insupportable, d’entendre à la radio, au soir du 14 juillet 2016, l’annonce de l’attentat de Nice qui a anéanti l’esprit de fête ! Dans ces moments-là, il n’y a plus qu’à pleurer !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180722 – Cinéma
L’ÎLE AU TRÉSOR
Un film de Guillaume Brac.
La base de loisirs de Cergy-Pontoise est un lieu que tous les cinéphiles connaissent, en tout cas tous ceux qui apprécient Éric Rohmer, puisque ce dernier y a tourné des scènes de l’un de ses meilleurs films (« L’amie de mon amie » en 1987). Guillaume Brac, lui, s’y est tellement plu qu’il y a tourné deux films : une fiction (« Contes de juillet », bientôt sur les écrans) et ce documentaire, projeté dans les cinémas depuis début juillet.
L’endroit mérite bien qu’on lui consacre ces deux nouveaux films : la base de loisirs de Cergy-Pontoise se présente comme une île au milieu des étangs, une île recelant de multiples possibilités que, bien sûr, le cinéaste se fait une joie d’explorer tout en déjouant allégrement la ronde des clichés qu’on se plaît à égrener dès qu’il est question de la banlieue. Certes, dès le début du film, Guillaume Brac filme des adolescents parvenant à entrer dans la base de manière frauduleuse (car les mineurs non accompagnés n’y sont pas admis), deux d’entre eux essayant à nouveau, dans une autre scène, d’y pénétrer en escaladant un portique, mais ce ne sont là que des gamineries, ce que comprennent parfaitement les gardiens qui, chaque fois, les refoulent en douceur.
C’est sur les modes de la découverte et des rencontres que se déroule le film, comme s’il fallait explorer chaque recoin du parc tout en ne manquant aucune occasion de donner la parole aux uns et aux autres. En filmant le temps qui passe lors de belles journées d’été (sauf à la fin du film où la survenue d’un orage annonce la saison suivante et donc la fermeture de la base de loisirs), le cinéaste se déplace de lieu en lieu, offrant à nos regards les multiples aspects de son champ d’investigation : la plage où l’on vient se prélasser en famille et se baigner, la diversité des jeux proposés (pédalo, toboggan, plongeoirs, jetlev flyer, etc.), mais aussi les endroits plus secrets, plus retirés, voire plus sauvages, où l’on peut s’isoler de la foule. Guillaume Brac va même jusqu’à glisser sa caméra dans le bureau de la direction où le directeur et son adjoint débattent de questions de sécurité : des emplacements qui conviennent le mieux pour l’installation de nouvelles caméras de surveillance ou de ce qu’il faut faire si l’on repère des individus ayant réussi à entrer dans le parc avec un NAC (c’est-à-dire un Nouvel Animal de Compagnie, rat, perroquet, serpent ou autres espèces n’étant ni des chiens ni des chats) !
On rencontre de tout à la base de loisirs de Cergy-Pontoise : des jeunes hommes occupés à draguer des jeunes filles, des sportifs qui se livrent à des exploits, des enfants qui jouent, des nostalgiques qui se mettent à l’écart pour essayer de retrouver un peu de ce qu’était le lieu avant qu’il ne devienne, comme le dit l’un d’eux, « un luna-park », des femmes chantant d’une voix stridente lors d’une fête portugaise, un homme expliquant comment il est parvenu à sortir d’une geôle de Conakry, un Afghan ayant échappé à la griffe des Moudjahidines et expliquant combien sa femme et lui ont eu du mal à apprendre le français et à s’intégrer lorsqu’ils sont arrivés dans l’hexagone…
Cette énumération non exhaustive pourrait donner à croire que l’on a affaire à un film fourre-tout, mais il n’en est rien. Si Guillaume Brac s’est laissé surprendre par des rencontres imprévues, il n’en a pas moins réussi, assez subtilement, à indiquer une sorte de fil conducteur ou, si l’on préfère, un thème sous-jacent à tout le long-métrage. Ce thème est d’ailleurs énoncé clairement par un jeune homme faisant la démonstration de ses talents de plongeur avant de raconter sans vergogne ses libertés concernant la réglementation du parc : chaque fois, le garçon exulte non pas tant à cause de ses exploits mais, simplement, parce qu’il s’émerveille d’être vivant. Ses actions éclatantes lui procurent davantage que d’ordinaire ce sentiment d’être doté du plus beau des cadeaux, celui de la vie !
Mais ce sont les enfants, très présents dans le film, qui magnifient le mieux le don de la vie : leurs jeux, leurs rires et leurs émerveillements en sont la manifestation la plus authentique. Le cinéaste se plaît tant à les filmer qu’il s’attarde assez longuement sur deux d’entre eux, deux frères qui, avec trois fois rien, des bouts de bois, une flaque d’eau, des broussailles, un chemin pentu, s’inventent le plus trépidant des terrains d’aventure. Ces deux-là, sans le savoir, ont trouvé le trésor de l’île, le fameux trésor : il a pour nom la joie de vivre !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180627 – Cinéma
PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN
Un film de Nora Twomey.
Il faut ne pas manquer d’audace pour aborder, sous forme de film d’animation (destiné, en priorité, à un public d’enfants), un sujet tel que celui qui est ici proposé : l’histoire d’une fillette de 11 ans sous le régime des talibans. Grâce à un scénario écrit avec beaucoup d’habileté, la gageure s’avère totalement relevée. On a affaire à un film prenant, intelligemment conçu et réalisé, et qui devrait plaire, en réalité, à toutes les tranches d’âge (à partir de 8 ans, de préférence).
Voici donc l’histoire de la petite Parvana, une histoire que la réalisatrice prend bien soin de situer dans le temps et dans l’espace. Car si l’Afghanistan d’aujourd’hui fut, au cours des siècles, une terre convoitée, conquise, rougie par le sang de nombreux guerriers tombés au combat, elle connut aussi des périodes de calme et de prospérité qui permirent l’éclosion de talents dans des domaines aussi divers que ceux de la littérature (des contes) et que ceux des sciences. Les femmes elles-mêmes, il n’y a pas si longtemps, commençaient de s’émanciper en ayant accès, par exemple, aux champs de la culture.
Par malheur, cette évolution fut radicalement stoppée par l’arrivée au pouvoir des talibans. Et, bien sûr, comme toujours quand s’instaure quelque part un régime de terreur, les maitres ont aussitôt entrepris de détruire les livres (soupçonnés de perversion des esprits) et de mettre au pas des catégories de personnes (en l’occurrence, les femmes, mais aussi les détenteurs d’un savoir, quel qu’il soit). C’est ainsi que, dans le film, la petite Parvana assiste, impuissante, à l’arrestation de son père, un homme qui aime les livres, qui raconte volontiers des histoires et travaille comme écrivain public : bien des raisons de le rendre suspect aux yeux des talibans qui s’en débarrassent en le faisant emprisonner.
Pour Parvana et les autres membres de sa famille, la vie s’en trouve extrêmement compliquée. Comment faire pour subvenir à tous les besoins quand il est interdit aux femmes de se déplacer sans être accompagnées par un homme ? C’est la raison pour laquelle Parvana imagine un subterfuge : se faire couper les cheveux et s’habiller en garçon afin de pouvoir se déplacer comme elle veut, non seulement afin de chercher de l’eau ou de faire des courses au marché, mais aussi afin d’essayer de secourir son père.
Tout entière polarisée par cet objectif, la fillette multiplie les actes de bravoure. Mais ce qui lui donne du courage, c’est précisément l’un des domaines exécrés par les talibans, celui du pouvoir de l’imagination. Car, tout en poursuivant son chemin semé de périls, la fillette raconte une histoire légendaire, celle d’un prince nommé Souleymane qui dut combattre la férocité d’un roi éléphant. Et le film prend les couleurs de l’enchantement, se parant de la beauté des miniatures, tout en conservant ses références aux dures réalités de la vie quotidienne d’une petite fille afghane.
Il faut saluer et même acclamer le travail accompli par Nora Twomey, la réalisatrice du film. Quoique irlandaise, l’hommage qu’elle rend aux femmes afghanes et à la culture de ce pays ne se départ jamais ni de justesse ni d’émotion tout en suggérant, en fin de compte, la possibilité d’un espoir.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180622 – Cinéma
BÉCASSINE !
Un film de Bruno Podalydès.
Faire un film sur Bécassine, héroïne créée par Jacqueline Rivière et dessinée par Emile Pinchon, dont les aventures firent le bonheur de générations d’enfants sous forme de BD durant la première moitié du siècle dernier, cela peut sembler à priori une initiative saugrenue et malvenue. Saugrenue parce que ce personnage de bonne à la fois brave et étourdie paraît terriblement daté. Malvenue parce que la naïve créature a acquis, depuis longue date, le don d’agacer ceux qui, parmi les Bretons, estiment qu’elle est « l’incarnation du mépris dont les Bretons ont souvent souffert » (James Eveillard et Ronan Dantec). Certains indépendantistes n’ont d’ailleurs pas manqué d’appeler au boycott du film !
En vérité, cette polémique n’a pas lieu d’être. Elle ne tient aucun compte du dépoussiérage qu’a accompli Bruno Podalydès en donnant ou en redonnant à l’héroïne une fraîcheur et une perspicacité qui non seulement ne devraient froisser aucun Breton mais devraient plutôt provoquer leur enthousiasme. La Bécassine du film n’a rien d’offensant pour qui que ce soit ; au contraire, elle procure un plaisir simple, bon enfant, mais sans rien de stupide, qui devrait réjouir tous les spectateurs.
Il faut dire que Bruno Podalydès a trouvé en Emeline Bayart l’actrice idéale pour incarner ce rôle. Dès qu’elle apparaît à l’écran, après quelques scènes introductives et très drôles qui exaltent la complicité de Bécassine enfant puis adolescente avec son oncle Corentin (Michel Vuillermoz), on est aussitôt captivé par le talent dont elle fait preuve. On ne pourrait rêver meilleure interprétation d’une héroïne en qui s’affirment paradoxalement la simplicité et la malice.
Partie sur les routes pour monter à la capitale y trouver un travail (et y voir la Tour Eiffel !), Bécassine en vérité ne va pas bien loin. C’est la marquise de Grand-Air (Karin Viard) et son homme de confiance Mr Proey-Minans (Denis Podalydès) qui, alors qu’ils viennent de se séparer de la nounou (Vimala Pons) chargée du soin de la petite Loulotte, un bébé, engagent à sa place Bécassine et la ramènent en leur château dont on découvre rapidement qu’il perd littéralement de son lustre. La marquise, en effet, est fort désargentée, même si elle peut encore se targuer d’avoir un peu de domesticité. Mais le film acquiert toute sa saveur lorsque, quelques années plus tard, surgit Mr Rastaquoueros (Bruno Podalydès), un marionnettiste qui charme son public au point de s’installer à demeure. On se demande à qui on a affaire : un enchanteur ou un escroc… Quelqu’un, en tout cas, qui apporte du rêve, de l’illusion et un semblant de liberté (thèmes qu’affectionnent le réalisateur).
Quant à Bécassine, elle, elle fait preuve de sagacité et d’inventivité au point de surprendre tout le monde. Car ce qui est remarquable, dans ce film, c’est qu’on a affaire à une Bécassine fort différente, en fin de compte, de son image classique de bonne naïve et quelque peu ridicule. Ce qui la caractérise, chez Bruno Podalydès, ce n’est certes pas la sottise, mais bien plutôt ce qu’on pourrait appeler l’esprit d’enfance ou, si l’on préfère, l’aptitude à l’émerveillement. De ce point de vue, on peut même la considérer comme un modèle que nous serions très avisés de prendre tous en exemple. Si, comme elle, nous étions capables de nous émerveiller des plus simples choses (ou de ce qui nous paraît tel), de l’eau qui coule d’un robinet ou une ampoule qui s’allume parce que nous avons appuyé sur un interrupteur, si nous cessions d’être blasés, ce ne serait pas mieux ? Il me semble bien que si ! Allons ! Allons ! Soyons tous un peu « Bécassine » et le monde s’en portera mieux !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180614
Bonjour à tous!
Ci-dessous un article de mon blog, consacré non pas au cinéma ni à la littérature ni à la musique, mais à une exposition de photographies de Willy Ronis.
Bien amicalement.
Luc Schweitzer, ss.cc.
WILLY RONIS PAR WILLY RONIS
Une exposition de photographies.
L’exposition est gratuite et elle se tient au Pavillon Carré de Baudouin 121, rue de Ménilmontant à Paris 20ème jusqu’au 29 septembre 2018. Elle rassemble une quantité impressionnante d’œuvres de Willy Ronis (1910-2009), un photographe auquel on attribue parfois l’étiquette d’ « humaniste ». Mais peu importe les vocables forcément réducteurs dont on se plaît à affubler les artistes, comme s’il était rassurant de les classer dans des catégories. Ce qui est sûr, par contre, c’est que Willy Ronis a porté un regard complice et attentif sur les humains, oui, et, en particulier, sur les plus obscurs, ceux à qui on n’est que trop tenté de ne prêter aucune attention. Willy Ronis, lui, les a vus, il est allé à leur rencontre et il les a immortalisés en les photographiant.
C’est à partir d’albums conçus par le photographe lui-même qu’a été réalisée l’exposition du Carré Baudouin. Elle met à l’honneur, bien évidemment, le magnifique ensemble de photographies prises dans les quartiers de Belleville et de Ménilmontant à la fin des années 40 et au début des années 50. Ces œuvres composent comme une partition irremplaçable sur le Paris populaire de ces deux quartiers, sur les bistrots, les petits métiers et les petites gens, comme on dit. Nul besoin de préciser que tout ce qu’a photographié Willy Ronis a aujourd’hui quasiment disparu. Ce qu’il en reste, ce sont précisément ces photographies. On ne peut les regarder sans en ressentir une profonde émotion.
Bien sûr, Willy Ronis a photographié beaucoup d’autres lieux et beaucoup d’autres sujets, mais son regard s’est toujours porté, de manière privilégiée, sur le monde populaire. Même dans ses autoportraits, le regard change au fil du temps : après s’être photographié lui-même dans des poses presque précieuses, l’artiste un peu dandy a laissé la place à l’homme « nu » si l’on peut dire, même quand il s’expose portant des flashes. Mais son sujet privilégié, c’est le monde du travail : son regard, il le tourne volontiers vers les ouvriers en lutte et il le fait toujours avec une chaleureuse empathie et, parfois, avec une sorte de clin d’œil de complicité.
Willy Ronis a beaucoup photographié Paris (et pas seulement les quartiers de Belleville et Ménilmontant), mais il a également voyagé, fixant sur la pellicule de nombreuses vues de province et d’autres prises à l’étranger. Partout, on le devine attentif aux petits miracles de la vie ordinaire, à ce qui transforme une scène qui pourrait paraître banale en un tableau admirable et précieux. Tout est dans le regard, bien sûr. Et dans la patience de l’artiste qui a su attendre le moment opportun, le jeu de lumière qui convenait, la petite touche d’inattendu qui étonne et qui émerveille. Partout, le photographe sait percevoir ce qui mérite d’être fixé, à Marseille, en Provence, en Italie, à Prague, dans le Nord, dans le Sundgau alsacien ou encore à Richemont et dans ses environs (c’est-à-dire en Moselle, dans ma région d’origine !) où, par exemple, il photographie, vus de dos et emmitouflés sous leur cape, trois enfants allant à l’école. À Bruges, il se plaît malicieusement à photographier une procession de béguines et, dans une église d’Italie (si je ne me trompe), des dévotes. Le regard est amusé, mais jamais offensant.
Car la dignité jamais ne fait défaut à Willy Ronis. On le devine, on le perçoit, il aime les êtres qu’il photographie et il s’excuse presque d’avoir, en quelque sorte, volé des scènes d’intimité (celles qui montrent des amoureux, par exemple). Ou encore, lorsqu’il photographie des instants de vie familiale (son enfant endormi, par exemple). Ou, enfin, lorsqu’il photographie des nus. Le corps féminin, il le pérennise pour sa beauté et pour les superbes jeux de lumière qui en révèlent la magnificence, mais jamais de manière impudique. Son fameux « nu provençal », qui reste peut-être sa photographie la plus célèbre, provoque à juste titre l’émerveillement.
En grand photographe, toujours attentif aux petits riens de la vie, Willy Ronis nous invite tous à changer de regard. Et si, nous aussi, nous regardions autrement notre environnement. Et si nous étions davantage capables d’attention et de patience. Et si percevions enfin tous les petits miracles qui jalonnent nos journées.
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180611 – Cinéma
LA MAUVAISE RÉPUTATION
Un film de Iram Haq.
Qu’il y ait, sur nos écrans, des films de pur divertissement, censés nous faire oublier, le temps qu’ils durent, les âpres réalités de notre monde, pourquoi pas ? Il m’arrive d’aller voir des films de ce genre et, parfois, d’y trouver du plaisir. Heureusement, cependant, que l’offre cinématographique propose également d’autres films que ceux-là ! On ne saurait se contenter d’un cinéma d’évasion. Il me paraît nécessaire de se confronter aussi et surtout aux films qui rendent compte, d’une manière ou d’une autre, du réel, y compris lorsque le réel est dérangeant ou oppressant. Ainsi du sort que l’on réserve à certaines jeunes filles soupçonnées d’être « fautives » au point d’entacher, soi-disant, l’honneur de leur famille.
C’est le cas dans « La Mauvaise Réputation », un film dans lequel la réalisatrice Iram Haq raconte sa propre histoire. Prénommée Nisha dans le film, la jeune fille d’origine pakistanaise vit avec ses parents, son frère et sa petite sœur en Norvège et, bien sûr, au contact de ses camarades d’école, s’expose à des influences différentes de, voire contraires à, celles que lui ont inculquées ses parents. Ses premiers troubles d’adolescente, elle les expérimente au contact des jeunes Norvégiens qu’elle fréquente au collège. Mais le soir où son père la surprend dans sa chambre en compagnie d’un garçon qu’elle y a fait entrer clandestinement, tout s’effondre. Dans la famille pakistanaise qui est la sienne, on ne plaisante pas avec ce genre d’incartades. La peur du déshonneur, la crainte du regard des autres familles de même origine, le risque d’être mis au ban de leur communauté d’appartenance et de voir les clients de son magasin diminuer de façon drastique, c’est trop de pression et trop de honte pour le père de Nisha qui, même s’il affirme qu’elle compte pour lui plus que tout au monde, décide de la mettre au pas de manière intraitable.
Pour ce faire, rien de tel, selon sa logique, que de forcer sa fille à quitter la Norvège afin de la confier à sa famille restée au Pakistan. Là-bas, au pays, loin des tentations inhérentes à l’Occident, le père de Nisha estime qu’elle sera sous bonne garde et qu’on saura l’éduquer selon les coutumes du pays. On imagine ce qu’éprouve l’adolescente, contrainte de faire ce voyage, puis se retrouvant sous surveillance de sa famille du Pakistan. Mais c’est se tromper lourdement que de croire que, parce qu’elle est dans son pays d’origine, la jeune fille ne saurait plus être cause d’aucun scandale. Il suffit d’un beau jeune homme et d’une petite frasque de rien du tout pour que tout recommence, d’autant plus que des policiers véreux ne demandent pas mieux que d’en profiter brutalement et vénalement. Nisha n’est pas au bout de ses peines ni son père au bout de sa honte. Comment un père peut-il aimer sa fille (car il ne fait pas de doute qu’il aime) tout en lui faisant subir autant d’avanies ?
De ce point de vue, certaines scènes de ce film sont particulièrement bouleversantes, voire extrêmement choquantes. Mais on sent bien que la réalisatrice est restée au plus près de ce qu’elle a elle-même vécu, de ce qu’elle a dû supporter. Son film, cependant, ne bascule ni dans l’accusation ni, encore moins, dans la condamnation. Il est plutôt du registre du questionnement. Pourquoi ? Le père de Nisha n’est pas un monstre, dans ses yeux se devinent la peine et le doute. Pourquoi ? Mais pourquoi donc se comporte-t-il aussi durement avec sa propre fille ? Une question qui ne cesse de hanter Iram Haq, sans nul doute.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180528 – Théatre
Deux pièces sont proposées, cette année, par la troupe « Réplic’Pus » de Réseau Picpus :
LA MOUETTE d’Anton Tchékhov : lundi 18 et samedi 23 juin à 20h à l’Espace Bernanos 4, rue du Havre 75009 Paris
(N. B. : je joue moi-même, dans cette pièce, le rôle de Sorine !)
https://www.billetweb.fr/la-mouette-anton-tchekhov
LE SCHPOUNTZ de Marcel Pagnol : vendredi 15 et mercredi 20 juin à 20h à l’Espace Bernanos 4, rue du Havre 75009 Paris
https://www.billetweb.fr/le-schpountz-pagnol
LA MOUETTE
Une pièce en 4 actes de Anton Tchékhov.
Cette pièce, dont la première représentation, le 17 octobre 1896, au théâtre Alexandrinski de Saint-Pétersbourg, se solda par un échec, n’en connut pas moins rapidement le succès qu’elle méritait. Dès 1898, dans une mise en scène de Constantin Stanislavski à Moscou, elle fut copieusement acclamée et ne cessa, depuis, d’être considérée, à juste titre, comme l’une des pièces les meilleures et les plus représentatives d’Anton Tchékhov.
Pour la désigner, ce dernier employait le mot de « comédie », ce qui ne laisse pas de surprendre, dans la mesure où nous n’employons plus ce mot qu’à propos des divertissements qui provoquent nos rires. Dans ce sens-là, évidemment, le vocable ne convient ni à « La Mouette » ni à aucune autre pièce de Tchékhov. Mais c’est négliger les autres significations du mot « comédie » qui peut aussi bien s’appliquer à la description ou à la mise en scène de multiples types de personnages et de leurs comportements, à la manière de Balzac qui rassemblait toute son œuvre sous l’expression de « comédie humaine ».
Précisément, d’une certaine façon, les pièces de Tchékhov sont l’équivalent théâtral de l’œuvre romanesque de Balzac. Elles sont la « comédie humaine » mise sur scène. Les personnages qui évoluent dans les pièces du dramaturge russe sont certes typés, mais ne sont jamais caricaturaux, et l’on pourrait trouver sans peine leurs équivalents dans la vie réelle. Tchékhov, sans nul doute, était un observateur minutieux du théâtre de la vie et ses personnages, très probablement, lui ont été inspiré par des individus qui lui étaient proches, qu’il a fréquentés ou dont il a entendu parler.
Dans « La Mouette », on a ainsi affaire à un conseiller d’état à la retraite (Sorine), à sa sœur Arkadina, une comédienne de grand renom, au fils de cette dernière (Constantin Tréplev), un jeune homme qui se targue d’être un grand auteur de théâtre, à Nina, la jeune fille dont ce dernier est éperdument amoureux, à Chamraev, le gérant du domaine, à sa femme Paulina Andréevna et à leur fille Macha, à Trigorine, un homme de lettres réputé, au médecin Dorn et à l’instituteur Medvédenko. Presque des gens ordinaires, pourrait-on dire, en tout cas des personnages davantage préoccupés d’eux-mêmes, de leurs propres rêves ou de leurs propres déceptions, de leur orgueil, de leurs aspirations, voire de leur médiocrité, que de ce qu’éprouve autrui. Chacun reste plus ou moins le prisonnier de ses obsessions et se débat comme il peut pour apaiser son mal de vivre. On se parle, on échange, on s’occupe, mais avec plus ou moins de superficialité et donc sans être capable de soulager autrui, encore moins d’enrayer l’inéluctable drame qui se prépare. Hormis lors de quelques sursauts de lucidité qu’ils s’empressent de minimiser, les protagonistes semblent ne rien percevoir de ce qui se passe vraiment dans le cœur d’autrui. Ou, s’ils en ont la perception, ils font comme s’ils ne l’avaient pas.
Ainsi va la « comédie humaine » chez Tchékhov. On essaie de donner le change, de faire bonne figure, en se vantant, en courtisant, en rêvant, en se croyant talentueux, en énumérant ses regrets, mais au fond, quasiment tous ces personnages souffrent de solitude et cherchent une reconnaissance qui ne leur est accordée (si c’est le cas) que sur de mauvaises bases. Or ce qui ajoute à la force du théâtre de Tchékhov, c’est que, malgré, ou peut-être à cause de, leurs limites humaines, voire de leur médiocrité, ces personnages restent touchants. Ils sont même bouleversants. Ils le sont parce qu’ils sont vrais, parce qu’on peut se reconnaître en eux, parce que, comme eux, nous savons qu’il nous est difficile de nous préoccuper davantage d’autrui que de nous-mêmes. Et ils le sont aussi parce que, comme toujours chez Tchékhov, il ne faut pas se fier aux apparences : ce que disent les personnages et le peu qu’ils font, leurs paroles et leurs actes, leurs maladresses, laissent deviner, malgré eux, les remous de leur âme. Mieux, peut-être, que tout autre auteur de théâtre, Tchékhov a su respecter les complexités des âmes humaines. Sous leurs dehors de simplicité, de limpidité, ses pièces, et en particulier « La Mouette », mettent les cœurs à nu.
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180518 – Cinéma
EN GUERRE
Un film de Stéphane Brizé.
Après avoir adapté avec talent Guy de Maupassant dans « Une Vie » (2016), un film injustement snobé par une grande partie des critiques, Stéphane Brizé opte pour la voie de la prudence en revenant à ce qui a fait son succès, le drame à caractère social. Comme dans « La Loi du Marché » (2015), le seul acteur professionnel apparaissant dans le film est Vincent Lindon, mais le personnage qu’il incarne dans « En guerre » diffère assez sensiblement de celui qu’il jouait dans le film précédent. Au lieu d’être un homme rabaissé, voire même écrabouillé, par « la loi du marché », il interprète, dans ce nouveau film, un leader syndicaliste particulièrement déterminé à se battre et à ne rien lâcher.
Pour raconter son histoire de lutte, Stéphane Brizé, bien plus qu’il ne l’avait fait pour le film de 2015, lui a résolument donné une forme quasi documentaire, alternant les séquences de reportages télévisés et les scènes prises sur le vif ou donnant, en tout cas, cette impression. Le dispositif mis en place par le cinéaste et son équipe ont clairement pour but de mettre le spectateur comme en immersion dans cette réalité des salariés en lutte contre un système qui les broie impitoyablement. Seules quelques scènes de la vie privée, en famille, du personnage joué par Vincent Lindon, nous rappellent le caractère fictif de l’œuvre, mais elles sont trop rares pour changer quoi que ce soit à la perception globale des spectateurs. Le film s’inscrit dans un certain courant très réaliste qu’adoptent volontiers certains cinéastes contemporains, un courant qui, je dois le dire, provoque toujours, chez moi, un peu de gêne, un peu d’insatisfaction. Un cinéaste comme Stéphane Brizé, qui a adapté un roman de Maupassant, ne devrait pourtant pas se méfier de la fiction… Or, ici, tout le dispositif vise à réduire à presque rien la dimension fictionnelle pour donner l’illusion d’une plongée dans une réalité déterminée. J’emploie le mot « illusion » car, en fin de compte, personne n’est dupe et l’on sait bien, quand on est spectateur d’un tel film, ne serait-ce que parce qu’on est assis dans son fauteuil, qu’on a affaire à du cinéma, avec tout ce que cela comporte du point de vue des choix de mise en scène, d’éclairage, de montage, etc. D’une certaine façon, on est en présence d’un cinéma qui voudrait se faire passer pour autre chose que ce qu’il est.
Avec Stéphane Brizé, néanmoins, malgré la réserve que je viens d’énoncer, ni l’efficacité du film ni son impact ne sont en rien diminués. L’entreprise Perrin, dont il est question dans le film, ainsi que l’usine de sous-traitance automobile d’Agen que l’on projette de délocaliser, sont fictives, mais la lutte (voire la guerre, comme l’affirme le titre) que l’on voit se dérouler sous nos yeux ne correspond que trop à ce dont l’actualité se fait régulièrement l’écho. Il faut savoir gré au réalisateur d’avoir pris soin de dépasser l’aspect médiatique de cette sorte d’événements en mettant en parallèle, tout au long du film, des scènes de reportages télévisés et des scènes (les plus nombreuses) auxquelles n’assistent pas les journalistes et dont rien ne paraît sur les petits écrans. Or ce sont ces scènes-là qui sont les plus intéressantes, car elles nous font percevoir la complexité des discussions, des tractations, des débats. Elles s’opposent au caractère réducteur de ce que présentent les médias. Elles prennent soin aussi, et il faut complimenter le réalisateur à ce sujet, d’éviter le basculement dans un manichéisme qui serait simpliste et décevant. Il n’en est rien, les représentants patronaux étant eux-mêmes manipulés et, de ce fait, incapables de sortir de la logique qui leur est imposée.
Même s’il dénonce clairement (et à juste titre) les dérives et les violences insupportables d’un système ultra-libéral qui se soucie comme d’une guigne des ravages qu’il cause sur les salariés, sur leur vie, sur leur devenir, pour ne se focaliser que sur des questions de rentabilité, le film évite d’autant mieux le manichéisme qu’il montre la guerre non seulement du point de vue classique salariés contre patrons, mais aussi à l’intérieur même du groupe des ouvriers en lutte. C’est là que le film s’imprègne de toute sa dureté, de toute sa dimension tragique, en mettant en scène, comme conséquence de la sournoiserie du système libéral relayée par les discours des représentants patronaux, les divisions qui se creusent, de manière très brutale, au sein même du groupe des salariés. Entre ceux qui veulent poursuivre la lutte jusqu’au bout afin d’essayer de sauver les emplois et ceux qui, pris à la gorge par leurs soucis financiers du moment, préfèrent baisser les armes afin de toucher le chèque promis par le patronat, le dialogue s’avère de plus en plus tendu.
Comme je le disais précédemment, dans ce film, contrairement au personnage qu’il joue dans « La Loi du Marché », Vincent Lindon, tout comme ceux qui luttent à ses côtés, faire figure de battant, d’homme presque constamment en colère, ne cessant de se faire le porte-parole des salariés en détresse et de leur devenir. Pourtant, en fin de compte, les deux films se rejoignent dans un même constat très amer qui ne peut laisser insensible qui que ce soit. Les scènes finales de « En guerre », de ce point de vue, sont particulièrement terribles.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180507 – Cinéma
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
Un film de Lars Kraume.
Les films venus d’Allemagne ne sont pas légion sur nos écrans et, bien souvent, quand il en paraît un, il s’agit d’un film basé sur des faits réels survenus au cours du passé trouble et compliqué de ce pays et, en particulier, de celui de l’ex-RDA. C’est le cas, à nouveau, avec cette œuvre de Lars Kraume dont l’action se situe dans le Berlin-Est de 1956. Le Mur n’ayant pas encore été construit, il est encore relativement facile (quoique toujours risqué, car les contrôles sont automatiques) de passer du secteur est au secteur ouest de la ville. C’est ce que font, régulièrement, Kurt et Leo, deux lycéens qui, prétextant une visite au cimetière où est enterré le grand-père de l’un d’eux, vont voir au cinéma des films interdits de diffusion du côté de Berlin-Est.
C’est au cours d’une de ces escapades qu’ils découvrent à l’écran des images de l’insurrection de Budapest et de la répression soviétique. De retour dans leur lycée, ils persuadent sans trop de peine leurs camarades de classe d’observer une minute de silence en hommage aux victimes de Budapest au début du cours d’histoire. Votée à la majorité des voix, cette décision est adoptée et mise à exécution, au grand désarroi du professeur. Cela aurait pu en rester là, mais non, dans un pays tel que l’ex-RDA, la rébellion silencieuse des élèves entraîne de terribles conséquences. L’affaire ne parvient pas seulement aux oreilles du directeur, mais met en branle une enquête des plus répressives et des plus insidieuses afin de repérer les meneurs et de les sanctionner. Cela prend de telles proportions que le ministre de l’éducation nationale en personne se croit tenu d’intervenir.
En s’inspirant de ces faits aux lourdes répercussions, Lars Kraume a réalisé un film de facture très classique, presque académique. Néanmoins, malgré son allure très conventionnelle, l’histoire passionne, ne serait-ce qu’à cause des nombreux dilemmes et enjeux qui y interviennent. Pour plusieurs des lycéens de cette époque et de ce lieu, c’est le rapport au père qui se révèle extrêmement complexe, l’Allemagne sortant à peine d’une guerre à laquelle ont participé de nombreux hommes. Les enfants savent-ils vraiment ce qu’ont fait leurs pères pendant les années de guerre ? La grande question qui traverse tout le film, c’est celle de la vérité et du mensonge. Non seulement parce que les pères ont peut-être menti à propos d’eux-mêmes, mais parce que les lycéens eux aussi, harcelés par les enquêteurs qui veulent savoir les noms des meneurs de la minute de silence, se trouvent confrontés au choix de la vérité et du mensonge. À plusieurs reprises, au cours du film, il suffirait peut-être de mentir pour que cessent les poursuites à l’encontre des élèves. Placés devant ce dilemme, quels choix font-ils ? Jusqu’où sont-ils capables d’aller au nom de la vérité ? Parmi eux se trouvent deux sœurs dont l’une porte une croix autour du cou. À l’enquêtrice qui la questionne à ce sujet tout en essayant de ridiculiser la foi chrétienne et qui lui demande si elle croit en Dieu, elle ne craint pas de répondre par l’affirmative. Car, en fin de compte, quoi qu’on fasse, c’est toujours la vérité qui a le dernier mot !
7,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180504 – Cinéma
CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT
Un film de Yann Le Quellec.
Place à l’imagination sans limite, place à la fantaisie la plus débridée ! En allant chercher son inspiration chez le romancier Arto Paasilinna, Yann Le Quellec a pu laisser s’exprimer à volonté ses penchants pour l’excentricité, l’écrivain finlandais étant réputé pour ses récits tissés d’extravagance.
Voici donc l’histoire étrange de Cornélius (Bonaventure Gacon), un garçon costaud sortant de nulle part, enfin pas tout à fait de nulle part, d’une plage d’où il surgit à la manière d’un crabe ou d’une tortue, et, après des errances, parvenant à un éperon rocheux qui lui semble un lieu idéal pour y implanter un moulin. Ah ! Mais c’est qu’il va falloir compter avec le village qui se trouve juste en dessous ! Qu’à cela ne tienne ! Les habitants sont braves, ils l’accueillent comme un messie, et le maire Cardamome (Gustave Kervern) ne se fait pas prier pour lui céder le terrain. Un meunier au village ! Quelle aubaine ! Carmen (Anaïs Demoustier), la jolie fille du maire, quant à elle, ne tarde pas à être séduite : ni les manières du garçon ni sa longue barbe ne la rebutent, au contraire !
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes… Non, pas vraiment, car, rapidement, se font entendre la nuit des hurlements qu’on attribue d’abord à des loups errants avant de se rendre à l’évidence. Ce ne sont pas des canidés qui hurlent, mais le meunier en personne, empêchant les braves gens de dormir. Il n’en faut pas davantage pour que les regards et pour que la bienveillance laissent place à l’hostilité, voire à l’agressivité. Seule Carmen, plus enamourée que jamais, ne cède pas au trouble. Mais pourquoi le meunier crie-t-il ainsi et que peut-il devenir face à la méfiance, à la fatigue et à l’animosité de tout un village ?
Même si l’on peut relever l’une ou l’autre scène un peu plus faible, un peu moins inspirée que les autres, le film de Yann Le Quellec ne manque pas de qualités. La réalisation multiplie les scènes fantasques et drôles, comme il se doit pour un film de ce genre. Les acteurs et actrices conviennent plutôt bien au ton le plus souvent burlesque de l’histoire. Quant à celle-ci, malgré les apparences, elle ne repose pas uniquement sur de la simple divagation. L’air de rien, l’aventure et les personnages loufoques invitent à une réflexion sur la raison et la déraison, la sagesse et la folie. Qu’est-ce que la folie ? Qui considère-t-on comme fou ? Le meunier, parce qu’il hurle chaque nuit ? Le film suggère que la folie n’est pas réservée à quelques-uns, qu’elle est présente en chacun. N’y a-t-il pas, à des degrés divers, des grains de folie présents en chaque être humain ? En fin de compte, ceux qu’on considère comme fous ne sont peut-être que ceux qui ne savent pas dissimuler leur grain de folie ou dont le grain a tant grossi qu’ils ne peuvent plus le garder au fond d’eux. Les braves gens, les gens sensés, les gens qui se croient normaux (comme si cela avait une signification !) ne supportent pas de voir (ni d’entendre) leur propre folie extériorisée chez autrui. La folie, il faut la masquer, sans quoi on risque de vous enfermer à l’asile ! Comme on le constate, avec sa fable d’allure extravagante, Yann Le Quellec nous interroge tous et toutes sur notre rapport à la folie, la nôtre et celle des autres !
7,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180418 – Cinéma
MES PROVINCIALES
Un film de Jean-Paul Civeyrac.
Comparables au Lucien de Rubempré imaginé par Honoré de Balzac, la plupart sinon tous les protagonistes de ce superbe film sont des provinciaux montés à Paris (comme on dit) pour y faire des études et y concrétiser leurs rêves. Un commentaire entendu à la radio lors d’une des premières scènes nous divulgue une datation assez précise des événements puisqu’il y est question du « candidat » Emmanuel Macron. Cela étant dit, et même si les personnages communiquent beaucoup par l’entremise de smartphones ou d’ordinateurs, il se dégage du film, peut-être parce qu’il est tourné en noir et blanc, quelque chose de presque intemporel. Disons que chaque génération possède son lot de personnages semblables à ceux que met ici en scène Jean-Paul Civeyrac.
L’un d’eux, d’emblée, se détache : il se prénomme Étienne (Andranic Manet) et a quitté Lyon pour entreprendre des études de cinéma à Paris-VIII. C’est sur son cheminement que se focalise le cinéaste. Le garçon fait la connaissance de Valentina (Jenna Thiam), sa colocataire, avec qui se noue assez rapidement un jeu de séduction, et surtout il rencontre d’autres étudiants tout aussi passionnés de cinéma que lui et, en particulier, Jean-Noël (Gonzague Van Bervesselès) et Mathias (Corentin Fila). Avec eux, et surtout avec ce dernier, les débats sont houleux. Fort de ses convictions, Mathias ne rate pas une occasion d’en faire état, quitte à critiquer sévèrement le travail des autres. Tout le film est imprégné de discussions et de controverses à propos de cinéma, mais aussi de points de vue sur l’actualité, sur la littérature, la musique, etc.
Sans qu’on puisse le moins du monde le taxer ni de pédantisme ni de préciosité, le film multiplie les références à la littérature : à « Hurlevent des Monts » d’Emily Brontë dont Étienne offre en gage un exemplaire à Lucie (Diane Rouxel), sa petite amie de Lyon qu’il a laissée pour monter à Paris, à Gérard de Nerval, à Novalis et, surtout, à Blaise Pascal. Le titre même du film ne rappelle-t-il pas les lettres écrites par celui-ci en vue d’éreinter les Jésuites de son temps, fauteurs d’hypocrisie et de petits arrangements avec la morale ? Vérité et mensonge, loyauté et hypocrisie : ces thèmes irriguent tout le film. On les retrouve dans les jugements tranchés de Mathias, toujours prêt à dénoncer les compromissions, mais aussi et surtout dans les controverses passionnées qui opposent les férus de cinéma à Annabelle (Sophie Verbeeck), la nouvelle colocataire d’Étienne, activiste humanitaire, femme engagée sur le terrain, pour qui ne compte que l’action. Est-ce qu’un film peut changer quoi que ce soit à un monde en déroute ? Ne vaut-il pas mieux être résolument dans l’action plutôt que de se complaire dans des illusions artistiques ? Ces questions résonnent fortement sans, bien sûr, trouver leurs solutions. Étienne, quant à lui, qui se trouve toujours un peu en marge des débats, est bien obligé d’admettre ses petitesses lorsqu’il est question de ses rapports avec les femmes.
Mais c’est surtout lorsque le parcours de Mathias prend une direction inattendue et tragique que l’on sent vaciller Étienne. Qui était-il, en vérité, ce Mathias qui semblait si solide, si sûr de ses convictions ? Connaît-on jamais vraiment autrui ? Ou ne se contente-t-on que des apparences ? « Le soleil noir de la mélancolie », qu’avait entrevu Nerval, darde ses sombres rayons sur le film, c’est vrai, mais sans vraiment l’écraser ni l’envahir. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne fait pas d’apprentissage sans passer par des épreuves et des remises en question. Étienne, lui, poursuit son chemin, concevant des films qui, peut-être, seront nourris de ce qu’il a expérimenté et de ce dont il a été témoin. Le film en mouvement de Jean-Paul Civeyrac, en tout cas, remarquable à tout point de vue, a sûrement été nourri, fortement nourri, de vécu.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180412 – Cinéma
L’ÎLE AUX CHIENS
Un film de Wes Anderson.
Il se dégage des films réalisés en stop-motion, c’est-à-dire mettant en scène des figurines fabriquées à la main en pâte à modeler (ce que fait le studio Aardman) ou selon la technique des marionnettes et filmées image par image dans des décors en modèles réduits, un charme particulier. Ce procédé, qui semble avoir quelque chose d’archaïque mais qui, en vérité, garde tout son pouvoir de fascination, Wes Anderson le maîtrise à la perfection comme il l’avait déjà démontré en 2010 avec « Fantastic Mr Fox ». Avec son nouveau film, « L’île aux chiens », il atteint même des sommets d’inventivité qui font merveille et qui ont été récompensés à Berlin où il a obtenu l’Ours d’Argent du meilleur réalisateur.
L’imagination n’ayant pas de bornes chez Wes Anderson, le cinéaste nous propose, cette fois-ci, un voyage dans un Japon dystopique, futuriste, réinventé, où le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne fait pas bon y vivre, surtout si l’on appartient à l’espèce des canidés. Kobayashi, le maire de Megasaki, mégalopole totalement fictive, a en effet décrété le bannissement de tous les chiens, devenus dangereux parce que porteurs d’une grippe qui pourrait se transmettre à l’homme. En conséquence, ceux-ci sont impitoyablement pourchassés, arrêtés et transférés sur une île-poubelle où règne l’insalubrité et où ils sont abandonnés à leur sort, réduits à ne manger que des détritus. C’est là que décide de se rendre un jeune garçon de 12 ans, Atari, qui n’est autre qu’un neveu et fils adoptif de Kobayashi (ses parents ayant été tués accidentellement). Peu soucieux de provoquer la colère de son potentat de père adoptif, le garçon se fait un devoir de retrouver son propre chien, Spots, qui fut le premier des canidés déportés sur l’île. Or son expédition lui fait rencontrer une bande de cinq chiens qui ne tardent pas à s’attacher à lui au point de devenir ses alliés.
On n’en finirait pas de raconter toutes les péripéties d’un film qui ne lésine pas dans les rebondissements de toutes sortes. Le scénario multiplie les flash-back (parfois, peut-être, un brin trop explicatifs) et les détours, comme dans un récit à tiroirs. Même si l’on a affaire à un film d’animation, il ne s’agit nullement d’une œuvre destinée aux enfants, mais plutôt à un public d’adultes. On peut d’ailleurs en faire une interprétation clairement politique (ce qui est une totale nouveauté dans la filmographie de Wes Anderson). Le maire Kobayashi et ses conseillers ne sont pas sans évoquer les leaders populistes qui n’ont que trop tendance à pulluler à notre époque, des gens capables des pires manigances et mensonges pour conquérir et consolider leur pouvoir. Heureusement, quelques courageux osent les défier en prenant parti pour les chiens. Quant à un scientifique mettant au point un sérum pouvant guérir les animaux de leur maladie, il représente une gêne plus qu’un espoir pour ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change.
Les chiens, eux, parqués sur leur île qui, à elle seule, illustre tous les maux de notre temps, toutes les menaces environnementales, toutes les pollutions, les chiens eux-mêmes prennent une dimension politique qui ne manque pas de similitude avec notre actualité. Abandonnés à leur triste sort sur une île-poubelle, ils font penser aux migrants contraints de survivre dans des « jungles » comme ils font penser à tous les parias du monde (et, pourquoi pas, aux lépreux de l’île Molokaï à l’époque de saint Damien). Doués de paroles, ces chiens de conte nous disent, bien évidemment, quelque chose de notre humanité : ils symbolisent toutes les exclusions. Eux-mêmes d’ailleurs, ces chiens, ne manquent pas de personnalité ni de connotations politiques. Dans la bande des cinq canidés qui assistent le jeune Atari dans sa quête, il en est un qui se distingue. Il s’appelle Chief et, contrairement aux quatre autres, ne veut pas entendre parler de maître ni d’obéissance à qui que ce soit. C’est l’anarchiste de la bande, le rebelle, l’indigné. Et pourtant, bien que personnage de film d’animation, son regard finit par changer. Non pas qu’il accepte d’obéir à un maître, mais parce qu’il découvre une autre forme de relation, fondée non sur la dépendance, mais sur la bienveillance.
Oui, même dans un film de ce genre, on peut aborder les sujets les plus graves et faire évoluer les personnages de la plus belle des manières. Tout le film, ajoutons-le, est un régal pour les yeux autant que pour l’intelligence. Chaque plan, chaque scène, abondent de mille détails et de surprises à n’en plus finir. Le travail réalisé par Wes Anderson et ses collaborateurs mérite tous les éloges.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180411 – Cinéma
LUNA
Un film de Elsa Diringer.
Pour son premier film, Elsa Diringer a fait appel à Rod Paradot, un jeune acteur déjà confirmé tant il avait impressionné en jouant le personnage central de « La Tête Haute » (2015) d’Emmanuelle Bercot, et à Laëtitia Clément, une débutante qui livre une prestation confondante de justesse dans un rôle qui exige pas mal de subtilité.
Elle, c’est Luna, et lui, Alex, et leur première rencontre se déroule dans un lieu sordide et de la manière la plus avilissante qui soit. Luna a pour petit ami Ruben (Julien Bodet), un macho dont on devine qu’il ne fait pas grand cas de sa conquête, sinon peut-être dans la mesure où elle flatte son petit orgueil de mâle. Toujours est-il que c’est à l’occasion de l’anniversaire de ce dernier que tout dérape et qu’intervient l’événement qui marque de son empreinte tout le film. Ruben, ses potes ainsi que Luna, tous ont abusé de l’alcool lorsqu’ils s’en prennent à Alex, rencontré par hasard dans un lieu retiré. Excité, enivré, le groupe s’en prend à l’intrus au point de l’humilier et de le violenter : c’est Luna elle-même qui baisse le pantalon du garçon tandis que Ruben entreprend son viol.
Or, quelques semaines plus tard, alors qu’elle a pris ses distances d’avec Ruben et qu’elle est tout heureuse d’avoir trouvé un emploi stable dans une exploitation maraîchère, Luna retrouve le garçon qu’elle avait contribué à outrager. Alex, lui aussi, a été embauché dans ce même lieu. La reconnaît-il ou pas ? On ne le sait pas, d’autant plus que la jeune femme a quelque peu changé de style ou, en tout cas, de coiffure. Néanmoins, la première réaction de Luna est la peur, au point qu’elle essaie d’éloigner le garçon en lui faisant perdre son travail.
Mais les choses changent rapidement : Alex se manifeste comme quelqu’un de sensible et d’affable, capable de délicatesse, passant ses loisirs avec un ensemble de musiciens amateurs, etc. Tout le contraire de Ruben ! Entre Luna et Alex se noue une idylle. Les instants de complicité, les gestes de tendresse se multiplient. Du côté de Luna, on le pressent tout de même, cette intimité ne va pas de soi : la jeune femme culpabilise, elle ne peut gommer de son esprit les blessures et les humiliations infligées au garçon et, d’une certaine façon, il y a dans son aventure avec Alex quelque chose de l’ordre d’une réparation.
Comment une telle idylle peut-elle perdurer tant qu’elle reste fondée sur du mensonge ou, en tout cas, sur du non-dit ? La réalisatrice conduit habilement son récit vers de nécessaires aveux et, qui sait, un chemin de pardon. Alex, le garçon offensé, s’il ressent en son être un penchant vers la revanche, démontre surtout son aptitude à la bienveillance. Tout en se fondant sur un événement douloureux et très sombre, le film avance de la manière la plus habile vers quelque chose de lumineux et de beau, tout simplement.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180322 – Cinéma
LA PRIÈRE
Un film de Cédric Kahn.
Le critique d’une célèbre revue de cinéma qui s’interroge sur l’opportunité de la réalisation de fictions « bienveillantes avec la foi » et qui s’inquiète d’un possible « chemin des Croisades » n’a manifestement rien compris ni à « L’Apparition » de Xavier Giannoli ni à ce film de Cédric Kahn. Dans les deux cas, on n’a nullement affaire à des œuvres apologétiques ni même à des histoires édifiantes à proprement parler, ce dont je me réjouis. Les deux cinéastes questionnent les rivages de la foi, certes, mais sans rien résoudre de manière évidente. Ils suggèrent plutôt que d’assener des « vérités ». Parler de « croisades » à propos de ces films est, à mon avis, un évident contresens.
Dans « La Prière », un garçon prénommé Thomas (Anthony Bajon), au visage tuméfié, se dirige, dès le premier plan, vers le lieu de sa dernière chance de se libérer de sa dépendance à l’héroïne, un lieu totalement isolé dans la montagne. Dès son arrivée, Marco (Alex Brendemühl) lui en explique le règlement : « Ici, on prie et on travaille. Pas d’alcool, pas de tabac, pas de filles » (ces dernières ayant leur propre centre non loin de là). La discipline quasi monacale imposée aux membres de la communauté ne va pas de soi. Même si « un ange gardien », en l’occurrence Pierre (Damien Chapelle), est chargé de veiller sur son bien-être, Thomas ne tarde pas à craquer. Au point de prendre la fuite. Une fuite qui le conduit jusqu’à Sybille (Louise Grinberg), une jeune archéologue qui parvient à le raisonner et à le ramener au bercail.
A partir de ce moment, Thomas parvient à s’intégrer davantage à la communauté et même à s’y épanouir de plus en plus. Il travaille et prie comme les autres, au point d’apprendre les psaumes par cœur. Une des seules distractions possibles semble être de représenter sur une scène la résurrection de Lazare, ce dont s’acquittent les comédiens improvisés avec un peu de ridicule. Quant à Thomas, il a beau avoir appris ses prières, il n’en a pas moins droit à des paroles pour le moins sévères de la part de sœur Myriam (Hanna Schygulla), la fondatrice du centre.
Cédric Kahn a pris bien soin d’autoriser plusieurs lectures des événements et de conserver une certaine ambiguïté à son personnage. Qu’en est-il de son chemin de foi ? Ses prières sont-elles sincères ? Viennent-elles du cœur ? Ou ne s’agit-il que d’une sorte de mimétisme ? Ces questions, à mon avis, ne se résolvent jamais d’une manière évidente, même après qu’ait eu lieu une scène de « miracle » et même quand Thomas en vient à se demander s’il n’est pas appelé à devenir prêtre ! Si Thomas a effectué un chemin de foi (qu’on peut tout de même supposer réel), en fin de compte il a surtout trouvé son « salut » dans la fraternité et dans la solidarité de ceux avec qui il a vécu. Sa foi est indissociable de l’expérience de bienveillance de ses frères. Et elle a peut-être aussi quelque chose à voir avec Sybille. Comme le note très justement Pierre Murat dans Télérama, on peut comparer le chemin parcouru par Thomas avec celui du personnage central de « Pickpocket » (1959) de Robert Bresson, un film dont la réplique finale est célèbre : « Pour aller jusqu’à toi, dit ce personnage à la femme qu’il aime, quel drôle de chemin il m’a fallu prendre ».
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180314 – Cinéma
HOSTILES
Un film de Scott Cooper.
Les westerns ne sont plus légion sur les grands écrans et c’est fort dommage. On se consolera néanmoins de leur rareté en découvrant ce film superbe à tout point de vue, signé Scott Cooper. Certes, il ne s’agit pas d’une œuvre qui révolutionne le genre, mais qu’importe. Le film est admirable, terrible et beau à la fois.
Son attrait, il le doit, entre autres, à ses paysages et à sa photographie, la quasi-totalité de l’œuvre étant tournée en extérieur. Mais ce qui séduit par-dessus tout, ce sont les personnages, car le film est excellemment écrit et dialogué. Dès le début, deux scènes successives nous mettent dans le bain de violence qui dévastait la colonisation de l’Amérique à la fin du XIXème siècle. Dans la guerre qui oppose les Indiens et les Blancs, on ne fait pas de quartier : d’un côté comme de l’autre, la cruauté est de rigueur et elle est si abominable qu’elle exacerbe des haines qui semblent ne plus pouvoir s’atténuer.
Dans ce théâtre de barbarie, néanmoins, ce sont les Blancs, plus nombreux, mieux armés et mieux organisés, qui détiennent la supériorité. Pourtant, des voix s’élèvent, et peut-être quelques scrupules, réclamant un peu de commisération pour les Indiens. Le Président des USA lui-même intervient et donne l’ordre de libérer un groupe de Cheyennes dont le chef est malade afin de le ramener jusqu’aux terres de leurs ancêtres, la Vallée des Ours dans le Montana. Or, celui qui connaît bien les pistes et qui pourra le mieux guider le convoi est un soldat, un capitaine, du nom de Joseph Blocker (Christian Bale), un homme qui a déjà beaucoup combattu les Indiens et ne ressent que haine à leur encontre. Menacé d’être traduit en cour martiale s’il n’accepte pas cette mission, le voilà donc contraint d’obéir.
Accompagné d’un petit groupe de soldats (parmi lesquels un Noir et un Français !), Blocker se met en chemin et, très bientôt, exige que, parmi les Peaux Rouges, les hommes soient enchaînés. Leur parcours les conduit à une ferme incendiée dans laquelle ne reste qu’une survivante, Rosalee Quaid (Rosamund Pike), tout le restant de sa famille ayant été massacré par un raid de Comanches. Il faut donc poursuivre l’itinéraire avec cette femme qui s’effraie de voir des Indiens (même enchaînés pour ce qui concerne les hommes) dans le convoi. Quant au petit groupe de Comanches rebelle, il risque à tout moment de surgir et d’attaquer.
Avant de parvenir au terme du voyage, bien des périls surviennent, on s’en doute. Nul besoin de tout relater. Je veux surtout insister sur un des aspects du film, celui qui m’a le plus touché et même bouleversé et qui en fait une œuvre de toute beauté. En effet, malgré la violence qui peut survenir à tout instant, malgré les rencontres d’hommes peu scrupuleux et prêts à tout pour garder des terres mal acquises, malgré tous les périls, ou peut-être à cause d’eux, quelque chose change dans les rapports des personnages. Affrontés aux mêmes dangers, les membres du convoi ne peuvent survivre qu’au prix d’une évolution de leurs relations. S’ils veulent s’en sortir, il leur faut, pour le moins, non seulement surmonter leurs divisions mais faire preuve de solidarité.
Or le film propose quelque chose d’encore plus admirable qu’une simple union (qui ne pourrait être que temporaire) face à l’adversité, il met en scène une véritable transformation des mentalités. Les regards changent : la haine, la peur et la rancœur laissent place à d’autres sentiments. Lors d’une des scènes du film, alors que Joseph Blocker est en train de lire sa Bible, un dialogue s’engage : « Vous croyez en Dieu ? », lui demande Rosalee. « Oui, madame, répond-il, je crois. Mais Dieu a abandonné depuis longtemps ces contrées. » « J’espère que nos épreuves nous rapprocheront de Lui », rétorque la femme. Et, plus loin dans le film, alors que le groupe a subi bien des vicissitudes, Rosalee s’approche du capitaine songeur et lui dit : « Dieu nous conduit par des chemins tortueux ».
Il me semble que ces répliques donnent une des clés de lecture du film, il n’est pas interdit de le penser en tout cas. Dieu est là, oui, on peut l’affirmer, lorsque, au lieu des actes de violence et de haine, des personnages osent les gestes du partage ou ceux de la miséricorde. Une femme indienne qui offre des vêtements à Rosalee et qui, lors d’une scène ultérieure, lui peigne les cheveux ; les mains d’un Indien se joignant à celles de Joseph Blocker : ces signes si simples expriment à eux seuls, sans besoin de paroles, les changements qui s’opèrent dans les cœurs. Même dans les westerns, ce n’est pas nécessairement la violence qui a le dernier mot.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180301 – Cinéma
LADY BIRD
Un film de Greta Gerwig.
Un film n’est-il intéressant ou n’est-il bon qu’à condition de raconter des événements qui sortent de l’ordinaire ? Je ne le crois pas et, de ce fait, je m’oppose totalement au jugement sans mesure porté sur ce film par un critique d’une célèbre revue de cinéma qui estime que nous n’avons affaire qu’à quelque chose de « finalement anecdotique ».
Il est vrai que ce que raconte Greta Gerwig (une réalisatrice surtout connue jusqu’ici en tant qu’actrice, en particulier dans les films de Noah Baumbach) peut sembler extrêmement banal. Mais ce prosaïsme n’est qu’apparence : la qualité de la mise en scène et la justesse des personnages révèlent des trésors d’humanité qu’il serait bien peu astucieux de trouver quelconques.
C’est une chronique adolescente qui nous est contée, celle de Christine (Saoirse Ronan), une jeune fille de 17 ans qui ne supporte ni son prénom (elle veut être appelée Lady Bird) ni la ville de Sacramento où elle habite ni les contraintes de toutes sortes et, en particulier, celles que veut lui imposer sa mère (Laurie Metcalf). Tout ce que connaît Lady Bird, son entourage, le lycée catholique où elle étudie, sa famille, tout lui semble médiocre et elle ne rêve que de pouvoir partir. Son projet, c’est d’être acceptée dans une université de la côte est, loin de Sacramento, afin de gagner son indépendance.
Nous sommes dans l’Amérique de 2002 et l’on peut supposer que Greta Gerwig a mis beaucoup d’elle-même dans le personnage de Lady Bird ; il y a sans doute une part plus ou moins grande d’autobiographie dans le film. Mais peu importe, ce qui compte, c’est que la cinéaste a su dépeindre avec énormément de subtilité les différents protagonistes du film. Aucun n’est caricatural, aucun n’est monolithique. Une religieuse découvrant l’auteure d’une farce dont elle a été la victime, loin de s’offusquer, réagit avec humour. Les deux amies que fréquentent Lady Bird, ainsi que ses deux petits amis successifs (le premier ayant bien du mal à s’avouer son homosexualité) et tous les autres personnages ne se laissent jamais enfermer dans des définitions simplistes. Cela est vrai surtout des parents de Lady Bird : son père cachant comme il peut sa désolation de ne pouvoir soutenir autant qu’il le voudrait sa fille, du fait de son chômage et de sa précarité, mais faisant preuve de trésors de tendresse envers elle ; et sa mère avec qui elle est en conflit presque permanent.
C’est dans ces relations mère/fille que le film atteint des sommets de finesse, échappant à tout reproche de banalité. Il n’y a rien de moins anecdotique que des rapports conflictuels ainsi que la recherche du pardon. Car c’est de cela dont il s’agit, en fin de compte. La mère et la fille sont capables de partager des émotions, on le sait dès la première scène du film où toutes deux se mettent à pleurer après avoir écouté le texte enregistré des « Raisins de la Colère » de Steinbeck. Malheureusement, hormis quelques moments d’apaisement et même de confidences (en particulier à propos du père), le fossé sembler se creuser de plus en plus entre mère et fille au cours du film. Incompréhensions et mensonges altèrent les relations. Pourtant, rien n’est joué une fois pour toutes, rien n’est définitif. On le sait, on le perçoit, derrière les apparences, derrières les airs butés et même, parfois, les colères, l’amour est vivace. Mais il lui faut trouver les moyens de s’exprimer : et c’est là toute la difficulté.
Avec intelligence et finesse, Greta Gerwig fait advenir une issue possible au conflit mère/fille et elle y parvient en recourant, entre autres moyens, à Shakespeare et, en l’occurrence, à « La Tempête ». Le premier des deux garçons dont a été amoureuse Lady Bird y joue le rôle de Prospéro et une courte scène du film nous le montre déclamant la tirade finale de la pièce se résolvant en une offre de pardon. Et aussitôt après, c’est Lady Bird elle-même qui demande à sa mère de lui pardonner. Parmi toutes les qualités de ce film qui n’en manque pas, c’est sans nul doute l’une des plus grandes et des plus bouleversantes que d’esquisser ce chemin-là, celui du pardon.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180223 – Cinéma
LA FORME DE L’EAU
Un film de Guillermo Del Toro.
S’il est un cinéaste qui invite au changement de regard, à ne jamais se fier aux apparences comme à combattre tous les préjugés, c’est bien le cinéaste mexicain Guillermo Del Toro. Ses films abondent en personnages d’aspect horrifiant, tel « Hellboy » (2004), qui font néanmoins preuve de générosité et de noblesse. Mais avec « La Forme de l’eau », le réalisateur atteint un niveau d’excellence qui laisse pantois : ce film mérite, ô combien, ses treize nominations aux Oscars. C’est une œuvre sublime !
On peut dater précisément l’action de ce film dont l’héroïne habite dans un appartement situé juste au-dessus d’un cinéma où l’on projette, entre autres, « L’Histoire de Ruth », un film de Henry Koster sorti sur les écrans en 1960. Toute la paranoïa de cette époque-là, celle où la guerre froide battait son plein, est au rendez-vous. Nous avons donc affaire à une fable sur fond d’espionnage mettant en opposition américains et russes, les premiers complotant dans un laboratoire ultrasecret que, bien sûr, les seconds cherchent à infiltrer. Or c’est là qu’est détenue une créature mi-homme mi-poisson que les militaires américains ont ramenée d’Amérique Latine (et en qui tous les cinéphiles reconnaîtront l’amphibien qui hantait un film de Jack Arnold de 1954, « L’étrange créature du lac noir »).
Autour de l’être à l’aspect monstrueux s’agite tout un ensemble de personnages extrêmement divers : les militaires américains qui en sont les geôliers, le plus brutal d’entre eux, le colonel Richard Strickland (Michael Shannon), prenant un malin plaisir à le torturer au moyen d’un gourdin électrique ; le docteur Robert Hoffstetler (Michael Stuhlbarg) qui dévoile petit à petit la véritable raison de sa présence en ce lieu et sa personnalité d’homme compatissant ; et les deux femmes de ménage, l’une noire, l’autre latina, cette dernière, Elisa Esposito (Sally Hawkins), s’imposant rapidement comme l’héroïne du film. Elle, qui est muette, n’en tarde pas moins à entrer en relation avec la créature et à se laisser toucher par sa détresse. Et c’est donc elle qui, avec l’aide, entre autres, d’un affichiste homosexuel, va tout entreprendre pour sauver l’homme-poisson des griffes de ses gardiens et bourreaux.
Avec tous ces personnages, les laissées-pour-compte de la société que sont les femmes de ménage, l’espion russe au grand cœur, le dessinateur homosexuel, etc., Guillermo Del Toro, pour notre plus grand plaisir, exalte sans retenue les humbles, les opprimés et les exclus face à l’arrogance et au puritanisme d’une frange d’américains blancs et racistes (dont l’exemple type se nomme aujourd’hui Donald Trump !). Mais surtout, comme je l’indiquais dès le début, il incite à changer de regard et à ne surtout pas se fixer sur les apparences. Le colonel Strickland, qui ressemble en tout point à un homme distingué, ayant une jolie femme et de jolis enfants, n’en est pas moins un tortionnaire de la pire espèce ainsi qu’un homme qui pourrit de l’intérieur après avoir été mordu par la créature. A contrario, cette dernière, malgré son aspect hideux, cache des trésors d’émotivité, de générosité et même d’affection, voire d’amour. Elisa ne s’y trompe pas, elle perçoit aussitôt, dès le premier regard, autre chose qu’une physionomie répugnante. Elle sait, elle qui est muette, entrevoir le cœur même de cet être étrange qui, lui aussi, voit en elle sa beauté. De là à donner au film l’allure d’une inimaginable romance d’amour, il n’y a qu’un pas qu’il aurait été dommage de ne pas franchir. Eh bien, Guillermo Del Toro ne se prive de rien, il ose tout, et c’est un ravissement. Sa mise en scène audacieuse et belle, qui s’autorise même une sorte d’hommage bref mais superbe au couple mythique Fred Astaire et Ginger Rodgers, emporte irrésistiblement l’adhésion.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180217 – Cinéma
L’APPARITION
Un film de Xavier Giannoli.
La vérité et le mensonge, l’imposture qui n’en est pas tout à fait une, ce sont des thèmes que Xavier Giannoli se plaît à explorer de film en film. Mais aujourd’hui, l’approche qu’il adopte pour les aborder n’a rien de banal, on peut même la trouver audacieuse, puisque c’est celle de supposées apparitions de la Vierge Marie.
Dans une petite ville du sud-est de la France, une jeune fille prénommée Anna (Galatéa Bellugi) prétend avoir vu, à plusieurs reprises, la Vierge Marie. Il n’en faut pas davantage pour provoquer, en ce lieu, l’affluence de pèlerins venus du monde entier, au point que les autorités civiles s’en inquiètent. L’Église n’est pas en reste et, comme elle le fait toujours dans ces cas-là, manifestant une extrême prudence, elle diligente une enquête canonique. Comme l’affirme un des membres de l’autorité ecclésiastique : « L’Église préférera toujours passer à côté d’un véritable miracle plutôt que de valider une imposture. »
Un petit groupe de clercs et de laïcs se trouve donc en charge de l’enquête. Parmi eux, contrastant dans cet ensemble, est missionné un journaliste prénommé Jacques (Vincent Lindon), tout juste revenu (rescapé, pourrait-on dire) d’un théâtre de guerre où l’un de ses compagnons a perdu la vie. Lui qui vient d’échapper à l’enfer et qui en est resté meurtri au point de se calfeutrer chez lui en recouvrant les fenêtres de son domicile avec des cartons, le voilà envoyé enquêter sur le paradis ou, en tout cas, sur une prétendue manifestation qui en émane. Au prêtre qui lui demande s’il est croyant, il répond vaguement qu’il a fait sa communion mais qu’il a cessé de pratiquer depuis longtemps.
Or toute la force et l’intérêt du film viennent précisément de la rencontre de personnages qui n’ont, à priori, rien de commun : un journaliste qui s’attelle à la tâche d’enquêteur qui lui a été confiée et une toute jeune fille qui affirme ne pas mentir lorsqu’elle déclare avoir vu la Vierge Marie. C’est donc un vrai film d’enquête qui nous est proposé, un film pas très différent de ceux qui mettent en scène des policiers ou des journalistes cherchant à faire la vérité à propos d’une affaire illégale. Les investigations menées par Jacques le conduisent d’ailleurs à faire la lumière sur des supercheries et des manipulations. L’entourage de la supposée « voyante », s’il n’est jamais présenté avec mépris par le cinéaste, n’en est pas moins tenté de profiter de l’événement à des fins que l’on aurait du mal à justifier.
Cependant, et c’est là que le film atteint des sommets, même si les investigations de Jacques lui permettent de faire des découvertes étonnantes, le menant, en particulier, sur la piste d’une amie d’Anna dont le rôle, dans toute cette histoire, a peut-être été déterminant, il reste, au bout du compte, quelque chose de l’ordre d’un mystère insondable. Dans le compte-rendu qu’il fait parvenir aux autorités du Vatican, il le reconnaît lui-même, il ne lui est pas possible de faire la lumière sur tout. Disons qu’il a résolu des mystères, mais que le Mystère (avec un M majuscule) est resté entier. Lui qui cherchait des preuves, il s’est heurté à ce qui le dépasse, à quelque chose de l’ordre de la foi. Anna elle-même, avec son surprenant regard, avec ses gestes de tendresse, l’a ébranlé, bien plus qu’il ne veut peut-être l’avouer. À sa façon, tout en nous captivant presque comme un thriller, ce film nous interroge en nous faisant entrevoir autre chose que les apparences.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
LE RETOUR DU HÉROS
Un film de Laurent Tirard.
Le point de départ du film pourrait être formulé à la manière d’une question très classique de morale telle qu’on en propose à l’examen de philosophie du baccalauréat, quelque chose comme « est-il permis de mentir pour sauver la vie d’autrui ? ». La comparaison s’arrête là car, bien sûr, suggérer des réponses à cette question dans un film, et qui plus est dans une comédie, se révèle mille fois plus agréable que la lecture de n’importe quelle copie, y compris celle de l’élève le plus doué en matière de raisonnements philosophiques. On ne sera pas étonné, d’ailleurs, de découvrir que l’énoncé du mensonge initial, dans le film, même formulé avec les meilleures intentions du monde, entraîne quasi automatiquement la survenue d’un deuxième mensonge, puis d’un troisième, et ainsi de suite dans un enchaînement d’affabulations sans fin. Autrement dit, proférer un mensonge, même pour le bien d’autrui, peut avoir des conséquences redoutables que, bien sûr, on n’avait pas prévues.
Pourtant, lorsque Elisabeth (Mélanie Laurent) ose son premier mensonge pour le salut de sa sœur Pauline (Noémie Merlant), elle semble avoir conscience de s’aventurer dans quelque chose d’insensé qu’elle ne saura pas maîtriser. La suite du film ne lui donne que trop raison. Pauline étant tellement affligée de n’avoir aucune nouvelle de son fiancé le capitaine Neuville (Jean Dujardin), censé être parti combattre dans les armées de Napoléon, Elisabeth a cru bon de rédiger une lettre signée du nom de ce dernier. Le résultat ne se fait pas attendre : Pauline reprend goût à la vie. Certes, mais que peut faire Elisabeth, sinon d’écrire et d’écrire encore, faisant passer, au fil des lettres, le disparu pour un véritable héros ?
Cela pourrait continuer longtemps encore, lorsque l’impensable se produit : le prétendu héros des batailles napoléoniennes est de retour ! Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne ressemble guère au portrait qu’a imaginé Elisabeth en rédigeant de fausses lettres ! C’est alors que le film prend une dimension nouvelle, les mensonges d’Elisabeth engendrant l’imposture de Neuville. Car, pour ce dernier, le choix est vite fait : la famille d’Elisabeth et de Pauline ne demande qu’à croire à son héroïsme, tandis qu’ailleurs il n’a d’autre statut que celui d’un vagabond dérobant du poisson cru à l’étal des marchands pour le dévorer à pleines dents ! Mieux vaut, évidemment, parader et faire le bravache chez ceux qui ne demandent qu’à croire au récit de ses invraisemblables exploits. Sous les yeux effarés d’Elisabeth (elle seule sachant la vérité), de Neuville s’en donne à cœur joie, entraînant l’histoire dans des scènes de fanfaronnade et de marivaudage aux dialogues ciselés comme il le faut.
Le film est si bien écrit, dirigé et joué qu’on se régale d’un bout à l’autre. Nul besoin de souligner les qualités de jeu de Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Mais on remarquera aussi l’excellente prestation de Noémie Merlant qui, de film en film, s’affirme comme une actrice très talentueuse et très complète, capable de se distinguer dans le drame (par exemple dans « Le Ciel attendra » de Marie-Castille Mention-Schaar en 2016) comme dans la comédie.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180205 – Cinéma
UNE SAISON EN FRANCE
Un film de Mahamat-Saleh Haroun.
« J’étais un étranger et tu m’as accueilli ». Cette phrase, Abbas (Eriq Ebouaney) l’a écrite dans la lettre qu’il a laissée à Carole (Sandrine Bonnaire), la femme qu’il a rencontrée en France et qui, en effet, lui a ouvert non seulement sa porte mais son cœur. Abbas, tout comme son frère Etienne (Bibi Tanga), ont dû fuir leur pays, la République centrafricaine en proie à la guerre civile. Tous deux sont des lettrés, ils aiment la littérature (parmi leurs livres, on aperçoit, entre autres, « Les Essais » de Montaigne et « Ulysse » de James Joyce). À Bangui, le premier enseignait la littérature et le second la philosophie. Mais en France, le pays où ils ont trouvé un refuge précaire, que faire sinon exercer un travail de survie ? Abbas doit se contenter de travailler sur un marché (là même où il rencontre Carole) et Etienne ne trouve rien de mieux que de faire le vigile.
Tous deux tentent comme ils peuvent de reconstruire leur vie. Abbas donne, dans un premier temps, l’impression de s’en sortir, lui avec ses deux enfants qu’il a réussi à scolariser. Mais ses nuits sont hantées de cauchemars, il voit et revoit sa femme morte au cours de leur fuite. Quant à ses enfants, il n’a rien à leur faire manger que sempiternellement des omelettes. La vie devient de plus en plus difficile au point qu’il faut se résoudre à quitter un bel appartement pour se contenter d’un studio loué par un marchand de sommeil, un studio qui semble un palais si on le compare à la misérable cabane construite sur un terrain vague que Etienne a élu pour domicile. Mais un studio qui n’est peut-être bien, lui aussi, qu’un asile très précaire.
La seule planche de salut pour pouvoir vraiment reconstruire sa vie, ce serait d’obtenir le droit d’asile. Mais dans la France d’aujourd’hui, ce n’est pas quelque chose qu’on obtient si facilement. Y a-t-il un espoir de régularisation ou faudra-t-il vivre encore et encore en se cachant et en prenant la fuite ? Même le secours de Carole, l’amie, l’hôtesse bienveillante, risque de ne pas suffire à éviter les drames.
En filmant cette histoire ô combien d’actualité, le Tchadien Mahamat-Saleh Haroun n’a nullement cherché à nous faire pleurer à bon compte. Le but n’est pas de faire verser des larmes de crocodile, mais de changer les regards. Bien sûr qu’il y a des drames et de l’émotion dans ce film, mais il y a aussi de la douceur et de la tendresse, et il y a aussi et surtout de la dignité. Quand Abbas et ses deux enfants se mettent autour d’une table pour fêter l’anniversaire de Carole, aussi pauvres soient-ils, chacun d’eux offre son cadeau. Une scène comme celle-là, d’apparence toute simple, en dit long sur la dignité de ces personnes.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180131 – Cinéma
SPARRING
Un film de Samuel Jouy.
Je ne sais pourquoi l’on désigne parfois la boxe par l’expression de « noble art ». Ce qui est certain, c’est qu’au sortir de ce film on n’est pas le moins du monde tenté de parler de noblesse. Ici, ça frappe et ça cogne et il n’y rien d’exaltant là-dedans. De plus, pour la majorité des boxeurs, comme pour Steve (Mathieu Kassovitz), il faut se résoudre à perdre la plupart des combats. La quarantaine passée, le voilà qui, dès le début du film, sort du ring après un nouvel échec, le visage tuméfié par les coups. Pourtant, rentré chez lui, la violence laisse place à la plus grande douceur : Steve s’introduit dans la chambre où dorment ses deux enfants et prend le temps de les border.
Toute l’authenticité et même la beauté du film de Samuel Jouy, après tant d’autres films qui ont déjà traité du monde de la boxe et souvent avec talent, vient de là, de cette antinomie entre une réalité brutale et une autre réalité faite de bienveillance, d’amour paternel. À son âge, Steve sait qu’il va devoir cesser les combats et il s’apprête à raccrocher les gants après avoir boxé une cinquantième fois. Mais c’est sans compter sur l’amour débordant qu’il ressent pour sa fille Aurore (Billie Blain). Les supposés dons de pianiste de cette dernière ne pourront s’épanouir que dans la mesure où elle pourra jouer quotidiennement à la maison. Or ce n’est pas la maigre rémunération que Steve reçoit en faisant le serveur dans un restaurant qui peut lui suffire pour acheter un piano.
Afin de gagner l’argent nécessaire, Steve en vient donc à proposer ses services en tant que sparring-partner, autrement dit en servant de partenaire à un champion de boxe pendant ses entraînements : un boulot risqué qui en a conduit plus d’un à perdre définitivement sa santé. La réaction de Marion (Olivia Merilahti), la femme de Steve, ne se fait pas attendre : « Si tu finis ta vie comme un légume, lui dit-elle, ne compte pas sur moi pour te servir d’infirmière ! ».
Rien n’y fait, Steve est déterminé à tout donner à sa fille. Pourtant, quand cette dernière lui demande d’assister à ses entraînements, il s’y refuse. Le monde de la boxe n’est pas seulement violent : s’il n’y avait que les coups à endurer, ce ne serait pas si grave ! Mais le pire, ce sont les humiliations inhérentes à un sport qui se présente d’abord et avant tout comme un spectacle. Quand un champion peut rabaisser son partenaire, il y a peu de chance qu’il s’en prive.
On n’oubliera pas de sitôt les regards croisés du père et de la fille. Les scènes les plus émouvantes du film s’inscrivent dans les yeux de l’un et de l’autre : dans le regard d’Aurore passant de l’admiration pour un père à la prise de conscience des réalités les plus cruelles lui étant réservées ; le regard de Steve épris de tendresse pour sa fille au point de chercher à la préserver de trop de désillusions. Grâce à sa mise en scène toujours juste, le film nous touche irrésistiblement.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180117 – Cinéma
LE RIRE DE MA MÈRE
Un film de Colombe Savignac et Pascal Ralite.
« Les enfants nous regardent ». Le titre de ce film de Vittorio De Sica, de 1944, était présent dans mon esprit tandis que je découvrais cette oeuvre mêlant subtilement gravité et légèreté sous les yeux d’un jeune garçon prénommé Adrien (Igor Van Dessel). Les enfants regardent et perçoivent bien davantage que ce qu’on veut leur dire. Dans les deux films, on a affaire à un enfant dont les parents sont séparés, mais la comparaison s’arrête là. Le vrai ressort dramatique du « Rire De Ma Mère » ne se trouve pas tant dans la mésentente des parents d’Adrien, mésentente d’ailleurs très relative, ni dans le fait que le père (Pascal Demolon) ait une nouvelle compagne, Gabrielle (Sabrina Seyvecou), mais dans une réalité plus insidieuse et, en l’occurrence, fatale qui s’appelle cancer.
Marie (Suzanne Clément), la mère d’Adrien, s’affirme, dès la première scène du film, comme une femme de caractère qui n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Elle manifeste un désir de vivre sans compter, quitte à brûler sa vie par les deux bouts, tout en prenant soin de cacher à Adrien la vérité, c’est-à-dire le cancer, le mal qui la ronge et la détruit. Mais le jeune garçon de 11 ans n’est pas dupe ; son regard a perçu autre chose que ce qu’on veut lui montrer et il a compris qu’il se passe quelque chose de grave. Il l’a si bien compris et il en est si perturbé qu’il devient de plus en plus introverti et imprévisible dans ses réactions. Son travail scolaire s’en ressent.
Faire un film sur un sujet aussi cruel que celui de la maladie et de la mort d’une mère est risqué. Pourtant les deux cinéastes qui en signent la réalisation ont parfaitement réussi à éviter de la rendre pesante. Au contraire, malgré son sujet et ne serait-ce qu’à cause du caractère entier de la mère, le film est plein de vitalité, sans cependant éluder aucune des tensions dramatiques qu’on est en droit d’attendre. Tous les personnages sont criants de vérité. D’une certaine façon, la maladie de Marie est l’occasion d’un rapprochement de tous les protagonistes. Et c’est aussi l’occasion d’une recherche de vérité. Le psychologue consulté a beau jeu de dire au père d’Adrien qu’il faut préparer l’enfant à l’inéluctable, mais comment trouver les mots et les phrases qui conviennent ? Il y a de quoi être déboussolé.
Bien des remarques seraient à faire sur les subtilités du scénario. Je me contente de n’en relever qu’une seule. C’est une excellente idée, m’a-t-il semblé, que d’avoir ponctué le film avec la préparation et la représentation de « L’Oiseau bleu », la pièce féerique et symboliste de Maurice Maeterlinck (1908). Adrien s’étant inscrit à un cours de théâtre, c’est en effet cette pièce qui est proposée et répétée, pièce qui raconte la recherche par deux enfants d’un oiseau fabuleux censé guérir une petite fille de sa maladie. Y a-t-il aussi un « oiseau bleu » dans la vie réelle ? Et que peut-il accomplir si on le trouve ? Guérir la mère d’Adrien ? Ou plutôt aider à surmonter les peurs ? N’est-ce pas là le meilleur des cadeaux pour délivrer le jeune garçon de ses blocages ?
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20180106 – Cinéma
CŒURS PURS
Un film de Roberto De Paolis.
« Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Parmi les jeunes gens qui fréquentent assidûment leur paroisse d’un des quartiers de Rome ou de sa périphérie, il en est qui arborent fièrement cette béatitude imprimée sur leur t-shirt comme un slogan. Le prêtre chargé de leur catéchèse ne manque d’ailleurs pas de leur expliquer que cette pureté du cœur n’est pas sans lien avec la pureté du corps. Autrement dit, pas de rapports sexuels avant le mariage !
En vérité, fort heureusement, ce prêtre, qui réapparaît plus tard au cours du film, commentant l’épisode de la femme adultère, se révèle capable de tenir un discours de bienveillance et de miséricorde et non pas uniquement de fermeté. Et c’est l’un des points forts de ce film que de mettre en scène des personnages bien plus complexes que ce que pourrait faire craindre la simple lecture du synopsis. Il en est ainsi d’Agnese, l’une des jeunes filles membres de cette paroisse, par ailleurs l’un des deux personnages principaux du long-métrage. Sa volonté de rester intacte jusqu’au mariage, elle la tient davantage de sa mère que du prêtre. Ou, en tout cas, c’est par le canal de sa mère, une femme possessive, autoritaire, voire brutale, que se transmet à elle l’obsession de la pureté.
Pourtant l’on sait, dès la première scène du film, que, bien qu’elle apparaisse ensuite fervente pratiquante comme sa mère, Agnese peut aussi s’adonner à des actes faibles, voire indignes. Sa rencontre avec Stefano, un garçon un peu plus âgé qu’elle, elle la doit précisément à cela. Lui, on devine aussitôt qu’il a déjà dû pratiquer plus d’un délit, tout en essayant de se racheter en vivant d’un travail stable. Mais lui aussi, comme Agnese, il n’est pas possible de l’enfermer dans un seul mot ou une seule catégorie: on le devine capable de dureté et on le découvre capable d’indulgence.
Il est vrai que sa relation avec Agnese, quand elle se concrétise, ne tarde pas à tourner à la romance. Dans le cadre du travail, c’est autre chose : car le voilà gardien d’un parking séparé d’un camp de gitans par un simple grillage. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les rapports avec ces derniers sont tendus. Or, semblable à Agnese qui a affaire à une mère autoritaire, Stefano doit tenir compte d’un chef qui n’a pas l’intention de lui faire de cadeaux.
On peut affirmer, me semble-t-il, que le principal sujet du film est la peur de l’autre, la peur de l’étranger qui risque d’enfreindre un interdit et de pénétrer un espace vierge : peur d’Agnese qui, bien que séduite par Stefano, ne veut pas perdre son hymen au risque d’encourir la colère de sa mère ; peur de Stefano qui, bien qu’ayant vu avec stupéfaction Agnese et sa mère venir en aide aux gitans au nom de leur charité chrétienne, ne veut pas laisser ces derniers pénétrer sur le parking au risque de s’attirer les foudres de son chef et de perdre son emploi. Mais qu’advient-il précisément lorsque les barrières sont franchies et les territoires vierges pénétrés ? C’est ce que l’on découvre dans ce film tourné au plus près des personnages et servi par des acteurs d’un naturel stupéfiant.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.