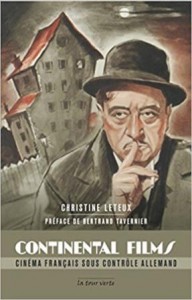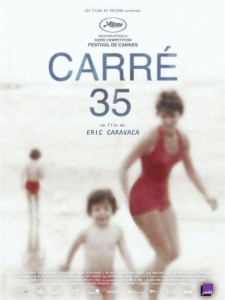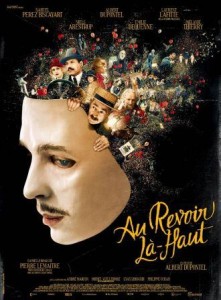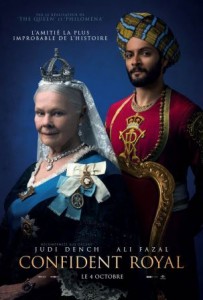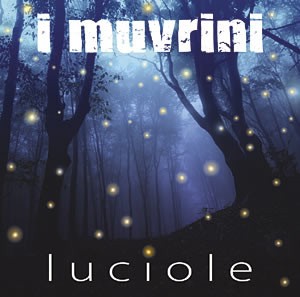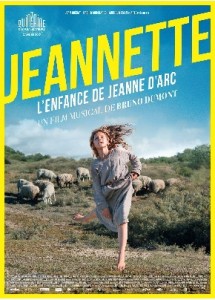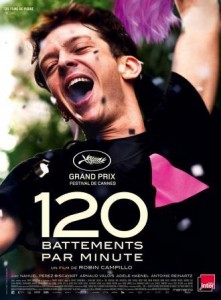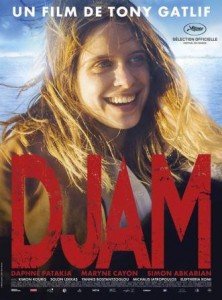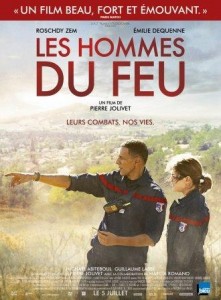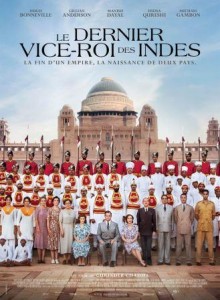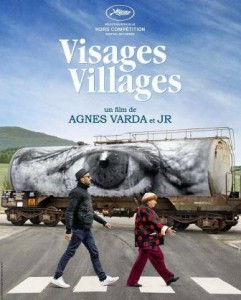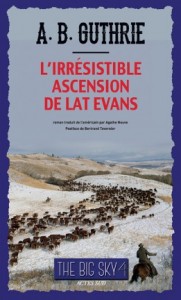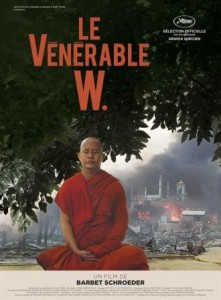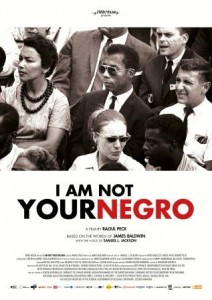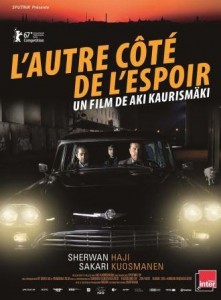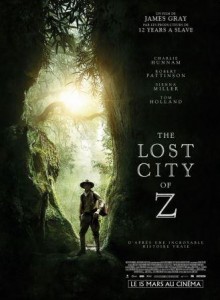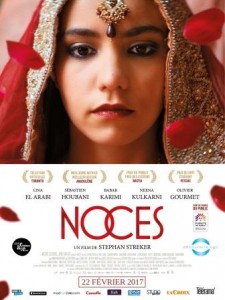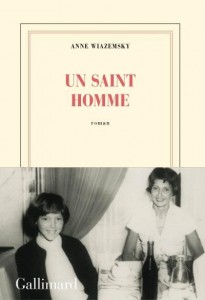Le blog du Père Luc – Films, livres, musiques, etc.
[où il est question de films, de livres, de musiques, etc. par un religieux de la Congrégation des Sacrés-Coeurs (Picpucien)]
=> http://lucschweitzer.over-blog.com/
20180101 – Cinéma
Bonjour et très bonne année 2018 à vous tous (avec plein de bons films si possible!)
L’année 2017 restera, quoi qu’il en soit, mémorable.
J’ai vu beaucoup de films et j’en ai apprécié un grand nombre (mon blog et les sites qui accueillent mes critiques en témoignent).
Voici donc mes 30 films préférés de l’année qui vient de s’achever.
Mes seules hésitations concernent les documentaires. En fin de compte, je les ai tous conservés dans ma liste (sauf « I am not your negro » de Raoul Peck non pas parce que c’est un film mineur, au contraire; mais parce qu’il n’est quasiment fait que d’images d’archives). Tous les autres documentaires présents dans ma liste sont, sans nul doute, des films à part entière au même titre que les oeuvres de fiction. Il faut d’ailleurs noter que les documentaires de qualité sortant sur grand écran sont de plus en plus nombreux et je n’ai malheureusement pas pu tous les voir.
Voici ma liste:
- The lost city of Z, de James Gray
- Silence, de Martin Scorsese
- 120 battements par minute, de Robin Campillo
- La Villa, de Robert Guédiguian
- Carré 35, de Éric Caravaca
- Une femme fantastique, de Sebastián Lelio
- Faute d’amour, de Andrei Zviaguintsev
- Les fantômes d’Ismaël, de Arnaud Desplechin
- Ava, de Léa Mysius
- La la land, de Damien Chazelle
- Sage femme, de Martin Provost
- Certaines femmes, de Kelly Reichardt
- Visages villages, de Agnès Varda
- Loving, de Jeff Nichols
- Jeannette, de Bruno Dumont
- Djam, de Tony Gatlif
- L’Opéra, de Jean-Stéphane Bron
- Song to song, de Terrence Malick
- Le musée des merveilles, de Todd Haynes
- Dunkerque, de Christopher Nolan
- L’échange des princesses, de Marc Dugain
- Emily Dickinson – a quiet passion, de Terence Davies
- Le portrait interdit, de Charles de Meaux
- Simon et Théodore, de Mikaël Buch
- Au revoir là-haut, de Albert Dupontel
- L’autre côté de l’espoir, de Aki Kaurismäki
- Après la tempête, de Hirokazu Kore-eda
- L’amant double, de François Ozon
- Nos années folles, de André Téchiné
- Valerian et la cité des mille planètes, de Luc Besson
Bien amicalement et à bientôt pour de nouvelles critiques!
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171231 – Cinéma
L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
Un film de Marc Dugain.
Dès l’ouverture de ce film adapté du roman éponyme de Chantal Thomas, on en a le pressentiment, ce sont les ailes sombres de la mort qui s’étendent au-dessus des cours de France et d’Espagne. Et c’est elle qui, en quelque sorte, mène la danse. Les servantes endormies près du lit où repose le tout jeune Louis XV semblent mortes et, lorsqu’elles s’éveillent, c’est comme si elles reprenaient vie afin de chasser les intrus qui se présentent, en l’occurrence des médecins que l’une d’elles ne se gêne pas de traiter non seulement de charlatans mais de semeurs de mort : leur soi-disant thérapie a déjà provoqué le décès de plus d’un à la cour et il n’est pas question qu’ils examinent le futur roi de France, trop jeune pour régner encore, au risque de le tuer, lui aussi. Lorsque celui-ci, un peu plus tard, entre au château de Versailles, que réintègre la cour, c’est, dans un premier temps, pour y errer comme dans une vaste nécropole sur les murs de laquelle sont accrochés les portraits d’illustres défunts. La mort est partout, elle obsède Louis XV, malgré son jeune âge. Et la barque conduisant la fille du Régent sur l’île où a lieu l’échange des princesses fait songer à l’embarcation de Charon emportant les morts sur le fleuve Styx. Quant à la cour d’Espagne, elle semble gagnée elle aussi par la mort, tant elle est comme figée dans les piétés et les dévotions imposées par le roi Philippe V, un roi neurasthénique hanté par les guerres qu’il avait ordonnées.
C’est dans cette ambiance funèbre qu’a lieu l’échange des princesses. L’idée vient du Régent Philippe d’Orléans pour qui celles-ci, femme ou même petite fille, ne sont que monnaie d’échange pour sceller la paix : la petite Anna Maria Victoria, âgée d’à peine 4 ans, doit quitter la cour d’Espagne afin d’épouser Louis XV tandis que la propre fille du Régent, Louise Elisabeth, est sommée de franchir les Pyrénées afin de convoler avec le futur roi Don Luis. Ces effarantes tractations ne s’embarrassent pas des personnes : l’une est une fillette qui joue à la poupée, l’autre une adolescente en révolte qui n’a guère l’intention de se conformer aux usages des grands d’Espagne. Celle-ci est sans nul doute l’un des personnages les plus intéressants du film. Quand, à son arrivée sur le sol espagnol, on la questionne sur ses goûts en matière de divertissements, elle stupéfie par ses réponses négatives. « Que voulez-vous faire ? lui demande-t-on. À quoi voulez-vous occuper votre temps ? » « À rien ! répond-elle. Je ne veux rien faire ! ».
Car, bien sûr, comme l’a si bien écrit Blaise Pascal dans une de ses plus fameuses pensées, pour ne pas penser à sa finitude et à sa mort inéluctable, il faut tâcher de se divertir. Chasser, danser, broder, voire brûler les hérétiques (comme l’affirme, lors d’une scène, Philippe V d’Espagne), tout ce qui amuse les autres déplaît à Louise Elisabeth la révoltée.
Marc Dugain ne s’est pas contenté de filmer habilement les intrigues des cours de France et d’Espagne, il l’a fait en adoptant un véritable point de vue de cinéaste, imprimant sur le film la marque de la mort, ce qui ne supprime aucunement la beauté de l’oeuvre (la photo est superbe). Et c’est elle encore, la mort, qui, lorsqu’elle frappe certains des principaux protagonistes de cette histoire, change du tout au tout les destinées : il n’est pas question de demander leur avis aux princesses, l’une connaîtra donc un sort plutôt enviable, tandis que l’autre sera purement et simplement sacrifiée !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171222 – Cinéma
LE PORTRAIT INTERDIT
Un film de Charles de Meaux.
Ce film étonnant a été inspiré à son auteur, Charles de Meaux, par un tableau exposé au musée de Dole (Jura), un portrait peint par le jésuite Jean-Denis Attiret à la fin du XVIIIème siècle représentant Ulenara, une concubine de l’empereur de Chine Qianlong devenue impératrice après la mort de la première femme de ce dernier. En 1768, année durant laquelle se déroule la majeure partie de l’action du film, les jésuites sont présents en Chine depuis presque déjà deux siècles et un de leurs plans de mission consiste à essayer de séduire les élites politiques et intellectuelles du pays. Les religieux estiment en effet que s’ils parviennent à convertir au christianisme les classes dirigeantes, le peuple ne tardera pas à suivre le même chemin, une méthode qui se révèle, en fin de compte, assez peu efficace.
Toujours est-il que, en cette année 1768, les jésuites ont trouvé place au palais de l’empereur. Ils y sont admis par la grâce de leurs multiples talents, entre autres celui de la peinture, un art très prisé mais aussi très codifié dans la Chine de cette époque. D’où la surprise de l’empereur le jour où Ulenara (Fan Bingbing) lui demande, après l’avoir battu à un jeu, la faveur de se faire faire par le jésuite Jean-Denis Attiret un portrait « à l’occidentale » ! Le souverain ayant consenti, le religieux est introduit dans l’intimité de l’impératrice pour de nécessaires séances de poses. Une intimité toute relative cependant puisque sont toujours présents servantes et conseillers. C’est une étrange relation qui s’instaure néanmoins entre le peintre et son modèle, entre le jésuite et la femme délaissée, car son empereur de mari lui préfère déjà d’autres concubines.
Le film raconte une histoire de regards et de fascinations réciproques. Pour la peindre, Attiret a demandé à Ulenara l’autorisation de contempler ses yeux. Mais quelque chose de trouble fait son chemin dans les regards qui se croisent et les longues séances de pose ne sont pas totalement innocentes, même si elles ont lieu devant des témoins qui, parfois, s’effraient d’un geste, d’une petite audace du jésuite. Ce dernier comprend qu’il joue avec le feu, c’est-à-dire avec ses sens, avec l’émoi que suscite en lui sa propre œuvre, sa propre peinture. Car c’est elle qui le perturbe, plus encore que l’être de chair qui en est le modèle.
Fragile et conscient de sa fragilité, Jean-Denis Attiret n’en donne pas moins le sentiment d’être, dans ce film, le jésuite le plus lucide, celui qui perçoit le mieux les erreurs de jugement de ses frères. Ni l’empereur ni les courtisans ne sont dupes : ils savent que les religieux veulent les convertir au christianisme. Mais sont-ils prêts à faire une telle démarche ? Rien n’est moins sûr. Dans des décors somptueux encore hantés par le fantôme de l’impératrice défunte, les regards échangés sont habités de doute et de méfiance. Très beau, très esthétique et, par moments, audacieux dans sa réalisation, ce film passionne aussi du point de vue de ses thématiques et, en particulier, de celle qui concerne la mission dans la lointaine Chine d’un point de vue chrétien et, en l’occurrence, jésuite.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171130 – Cinéma
LA VILLA
Un film de Robert Guédiguian.
Retrouver, une fois de plus, la famille d’acteurs que Robert Guédiguian a déjà mis en scène dans quantité de films, cela donne le sentiment de renouer avec des amis. Et comme, de plus, le film qui les réunit à nouveau est une œuvre qui mérite tous les applaudissements, que demander de mieux ? Voici donc les fidèles de Guédiguian rassemblés pour former, à l’écran, une fratrie : Angèle (Ariane Ascaride), Joseph (Jean-Pierre Darroussin) et Armand (Gérard Meylan), tous trois au chevet de leur père qui, alors qu’il s’était abandonné au plaisir du tabac, a été terrassé par un AVC. Rentré dans sa villa de bord de mer, il ne peut plus ni parler ni se déplacer et se trouve donc dépendant de ses enfants. Armand n’a pas eu grand chemin à faire : c’est lui qui tient le petit restaurant que lui a légué le père et qu’il gère selon les principes qui lui ont été transmis (bien manger pour pas cher !). Joseph, en homme désabusé qui vient d’être licencié de l’entreprise qui l’employait, est arrivé dans la villa accompagné de Bérangère (Anaïs Demoustier), sa maîtresse beaucoup plus jeune que lui. Quant à Angèle, qui fait carrière en tant qu’actrice renommée, elle reconnaît n’être venue à la villa que contrainte par les circonstances.
Exceptée Bérangère, tous ces personnages expriment soit de la nostalgie, soit des regrets, soit des souffrances enfouies. Tout a changé dans ce coin de littoral : les maisons ont été vendues les unes après les autres à des riches propriétaires qui n’y résident qu’occasionnellement. Comment ne pas regretter l’époque pas si lointaine où ça grouillait de monde et où l’on partageait les joies et les peines les uns des autres, où, par exemple, l’on ne décorait qu’un seul sapin de Noël pour tout le monde ? Et comment ne pas pleurer lorsque reviennent des souvenirs de drame et, en particulier, celui qui a causé la mort de la fille, encore toute jeune, d’Angèle ? Les retrouvailles autour du père malade sont l’occasion de dire ce qui était resté caché, de mettre des mots sur des douleurs toujours à vif.
Certes, une grande part de ce film est marquée par le passé, mais on n’a pas affaire pour autant à une œuvre uniformément mélancolique. Les mots durs laissent place à d’autres sentiments, surtout quand on se tourne vers les quelques voisins qui s’accrochent encore à ce recoin de littoral : un couple âgé et démuni, trop fier pour accepter l’aide de leur fils médecin et dont le sort émeut jusqu’aux entrailles ; ou ce pêcheur joué par Robinson Stevenin, énamouré jusqu’à être drôle, n’en revenant pas de voir Angèle, dont il est follement amoureux depuis qu’il l’a vue sur scène, et avec qui il se plaît à réciter du Claudel !
Et puis il y a, chez tous ces personnages, malgré leurs fragilités, un point commun que Robert Guédiguian fait poindre habilement tout au long du film avant de l’exposer de manière explicite : une qualité que l’on ne peut désigner que par un seul mot, et tant pis s’il paraît un peu désuet, la bonté. Cette qualité mise en avant lorsqu’apparaissent quelques-uns de ceux que cherchent, tout au long du film, des militaires, c’est-à-dire des migrants échoués par là avec leur embarcation. « Ils peuvent être dangereux », avait même affirmé l’un des soldats, au grand étonnement de Bérangère. Ceux que l’on finit par découvrir n’ont rien de redoutable assurément : ce sont des enfants ! Et c’est à leur contact que chacun des personnages du film laisse jaillir ce qu’il a de meilleur.
Avec ce film beau et émouvant, c’est sûr, Robert Guédiguian a signé l’une de ses meilleures œuvres, du même acabit que « Marius et Jeannette » (1997), « Les Neiges du Kilimandjaro » (2011) et quelques autres titres encore.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171128 – Littérature
CONTINENTAL FILMS
Cinéma français sous contrôle allemand
Un livre de Christine Leteux.
Récemment, à l’occasion de la mort de Danielle Darrieux, parmi le concert des louanges unanimes (et tellement méritées), il n’a pas manqué de se glisser, chez certains commentateurs, la mention d’une petite note de soupçon, d’un petit bémol, d’une soi-disant zone d’ombre ayant entachée le parcours exemplaire de l’immense actrice. C’est que, en effet, en mars 1942, Danielle Darrieux fit partie d’un convoi de gens de cinéma français envoyés séjourner à Berlin, ce qui fut considéré comme un symbole de la collaboration des artistes hexagonaux avec l’Occupant. La vérité est évidemment tout autre, ce que démontre Christine Leteux dans le passionnant ouvrage qu’elle vient de faire paraître sur le cinéma français durant les années de guerre. Les acteurs et gens de cinéma présents dans ce fameux train de Berlin n’étaient, nous explique-t-elle, « pas nécessairement des traîtres à leur patrie, mais probablement plus des jouets entre les mains de l’Occupant » (page 133). Pour ce qui concerne Danielle Darrieux, elle était, de plus, fiancé à un diplomate de la République Dominicaine emprisonné en Allemagne et qu’elle espérait revoir par le biais de ce voyage (ce qui fut d’ailleurs le cas).
Christine Leteux ayant eu accès à beaucoup de documents et les ayant minutieusement compulsés, elle peut ainsi, dans son remarquable ouvrage, lever une bonne partie du voile qui recouvrait cette période trouble et sombre de l’histoire et démontrer, autant que faire se peut, qu’il convient de se garder de tout jugement à l’emporte-pièce. Elle raconte avec précision dans quelles conditions furent produits les films de la « Continental », la firme de cinéma voulue et contrôlée par les Allemands et ayant pour dirigeant l’un d’eux, Alfred Greven, un homme complexe à la « personnalité bien trempée » (page 38). Sous sa gouverne furent tournés un certain nombre de navets, mais aussi de bons films, voire d’excellents, le meilleur de tous étant probablement « Le Corbeau » (1943) d’Henri-Georges Clouzot, un film considéré aujourd’hui comme un chef d’œuvre mais qui fut, à sa sortie, mal perçu aussi bien par l’Occupant et ses collaborateurs que par la Résistance.
Il est passionnant de découvrir par le menu, sous la plume avisée de Christine Leteux, les destinées de tous ceux qui ont eu à traverser cette période dans le milieu du cinéma. Certains firent preuve de courage et d’obstination, comme Pagnol qui refusa de travailler avec Greven (page 183) ou Henri Decoin qui persista à travailler avec un scénariste juif (page 61) à l’heure même où le sombre critique et écrivain Lucien Rebatet appelait à « désenjuiver » le cinéma français (page 61) ! D’autres se comportèrent avec bassesse et lâcheté, comme le cinéaste Léo Joannon coupable de crapulerie envers Raymond Bernard, un réalisateur pourtant réputé pour sa gentillesse et qui ne manqua pas de bravoure puisqu’il était juif. Beaucoup s’arrangèrent comme ils purent, sans trop se compromettre tout en continuant à travailler.
La destinée la plus touchante, la plus émouvante, fut celle que connut l’un des meilleurs acteurs français (sinon le meilleur) des années d’avant-guerre, Harry Baur. Quiconque l’a vu jouer le rôle de Jean Valjean dans l’adaptation des « Misérables » que fit Raymond Bernard en 1933 ne l’oubliera jamais ! Or cet immense acteur connut une fin atroce le 8 avril 1943, des suites des tortures que lui firent subir ses bourreaux allemands. Ayant déplu aux autorités en place et soupçonné d’être juif, il fut dénoncé, arrêté et battu impitoyablement par la Gestapo au point qu’après sa libération, alors qu’il avait été prouvé qu’il n’était pas juif, affaibli et amaigri, il mourut des suites des sévices endurés. Ainsi s’éteignit le meilleur interprète de Jean Valjean.
Cette histoire terrible, Christine Leteux la raconte avec précision, comme toutes les autres histoires et destinées qu’elle a pu glaner pour ce passionnant ouvrage, un livre dont Bertrand Tavernier affirme dans sa préface qu’il l’attendait depuis des années !
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171115 – Cinéma
LE MUSÉE DES MERVEILLES
Un film de Todd Haynes.
Que peut-il y avoir de commun entre Rose, une enfant de 1927, et Ben, un garçon vivant 50 ans plus tard en 1977 ? Pour commencer, tous deux souffrent de la même infirmité, la surdité, la fillette parce qu’elle est née ainsi, le garçon parce qu’un accident lui a fait perdre l’ouïe. Tous deux rêvent aussi d’étoiles, Rose se focalisant sur une star du cinéma qui n’est autre que sa mère, Ben ayant le regard attiré vers le ciel constellé d’étoiles (« nous sommes tous dans le même caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles », nous rappelle une citation d’Oscar Wilde au début du film). Or, pour aller vers leurs étoiles, les deux enfants doivent échapper à la grisaille de leur quotidien : Rose veut se libérer de son univers d’enfant mal-aimée, Ben (qui a perdu sa mère) espère trouver trace de son père qu’il ne connaît pas.
Commencent donc deux aventures qui sont aussi deux fugues de deux enfants à New-York, côté Manhattan pour la fillette et côté Queens pour le garçon. Deux univers, deux époques, celle de 1927 qui donne l’occasion à Todd Haynes d’un vibrant hommage au cinéma muet (avec une séquence qui semble tout droit venue du « Vent », un film de Victor Sjöström de 1928) et celle de 1977, totalement différente, et pas seulement parce que la première est tournée en noir et blanc et la deuxième en couleurs. Or, malgré les années qui les séparent, les destinées des deux enfants se croisent : leur errance et leur quête les conduisent à des musées remplis de merveilles et même, comme surgi d’on ne sait où, à un cabinet de curiosités.
Il peut paraître étrange que Todd Haynes, qui s’est illustré jusqu’ici tout spécialement en tournant des mélodrames (« Loin du Paradis » en 2002 et le somptueux « Carol » en 2016), ait choisi d’adapter à l’écran un roman pour la jeunesse de Brian Selznick. Il faut croire cependant que ce genre aussi lui convient, car ce film est parfaitement réalisé et l’on perçoit sans peine combien le réalisateur a su s’approprier une histoire un peu abracadabrante en lui conférant une intense crédibilité. Il est impressionnant de voir avec quelle maîtrise le cinéaste a su mettre en scène deux récits parallèles vécus par des enfants sourds. Et l’on a bien le sentiment, tout au long du film, de ressentir la même difficulté et les mêmes épreuves que les deux petits protagonistes. Quant aux merveilles annoncées par le titre, elles surgissent de mille manières jusqu’à culminer au beau milieu d’une maquette géante de New-York puis, enfin, à la faveur d’une obscurité inattendue, avec l’apparition d’un fascinant ciel étoilé.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171108 – Cinéma
LA MÉLODIE
Un film de Rachid Hami.
Quelle merveilleuse surprise que ce film ! Le résumé comme la bande-annonce m’avaient fait craindre une œuvre dégoulinante de bons sentiments, mais ce n’est pas le cas. En tout cas, le film vaut bien davantage qu’une simple exaltation des bons sentiments et l’on aurait tort de le ranger trop rapidement au rayon des œuvres sympathiques ou aimables qui font du bien sans déranger personne. Il y a bien plus de subtilité que cela dans cette histoire de talents fort bien mise en scène et habitée par d’excellents acteurs (qu’ils soient confirmés ou amateurs).
L’acteur vedette de ce film, c’est Kad Merad qui, sans doute après avoir produit un travail acharné, réussit parfaitement à se glisser dans la peau d’un professeur de violon. Envoyé pour prodiguer son enseignement à des élèves de 6ème d’un collège réputé difficile, il se trouve en effet aussitôt mis en présence d’enfants pour le moins turbulents. Accompagnés par un de leurs professeurs, joué par l’excellent Samir Guesmi, les violonistes en herbe semblent d’abord dépourvus de toute faculté pour la musique. Or le projet de l’établissement, ce n’est rien de moins que d’intégrer, en fin d’année scolaire, le groupe d’enfants à un orchestre qui devra jouer « Shéhérazade » de Rimski-Korsakov à la Philharmonie de Paris ! Le pari n’est-il pas perdu d’avance ?
Pour relever une telle gageure, quoi qu’il en soit, il faut faire preuve de patience, d’audace et de perspicacité. Tout le film montre intelligemment par quels moyens il est possible de transformer des enfants apparemment dénués de talent (pour la musique, en tout cas) en de vrais passionnés capables de relever le défi qui leur est proposé. Il faudrait souligner bien des aspects du film, chacun d’eux constituant un des éléments éducatifs permettant d’atteindre l’objectif fixé. La chance du groupe d’enfants, ce sont les leaders : leur professeur pour commencer, mais aussi l’un d’eux, un des élèves, tellement séduit par l’exercice du violon qu’il entraîne les autres à sa suite.
Le film montre aussi, toujours de manière judicieuse, quels sont les pièges à éviter et les tentations à repousser. L’une d’elles, que le professeur de violon ne tarde pas à envisager, consiste à éliminer les éléments les plus faibles pour ne garder que les plus doués : une éventualité que rejette catégoriquement le professeur joué par Samir Guesmi pour qui ce sont précisément les enfants les plus talentueux qui communiqueront leur enthousiasme et unifieront le groupe en l’entraînant vers le meilleur.
Une autre tentation survient pour le professeur de violon : il ne s’agit de rien de moins que d’abandonner le travail d’enseignant en cours d’année pour se consacrer à une tournée de concerts avec un quatuor. C’est à ce moment-là qu’intervient quelque chose de décisif : le plaisir ! Où trouver le plaisir le plus grand : en se produisant avec des musiciens confirmés ou en transmettant l’amour de la musique à des enfants réputés difficiles au point de les conduire jusqu’à leur prestation à la Philharmonie ? On peut deviner la réponse.
Enfin, il faut indiquer la place des parents dans cette histoire. Elle n’est pas négligeable, ils ont leur mot à dire et leur rôle à jouer. Ce film superbe et émouvant ne les a bien évidemment pas oubliés.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171102 – Cinéma
CARRÉ 35
Un film de Éric Caravaca.
C’est en se trouvant devant le carré des enfants d’un cimetière de Suisse qu’Éric Caravaca (connu surtout jusqu’ici comme acteur), ressentant un trouble profond, a éprouvé la nécessité de sonder un lourd secret de famille. Ce film transcrit la substance de l’enquête qu’il a menée sur les traces de Christine, une fillette morte en 1963 à l’âge de 3 ans et reposant dans un cimetière de Casablanca. L’enfant est sa sœur, qu’il n’a jamais connue car lui et son frère sont nés en France après le décès de Christine. Non seulement il ne l’a pas connue mais il n’a jamais vu ne serait-ce qu’une photo de l’enfant ! En vérité, c’est comme une chape de silence qui s’est abattue sur elle dès après sa mort. Jamais ses parents ne parlaient d’elle et aucune trace, pas même une photo, ne semblait subsister de son passage sur la terre.
Que s’est-il passé ? Pourquoi ce silence et ces dénis ? Car Éric Caravaca découvre rapidement que c’est surtout sa mère qui s’est inventée une autre vie et une autre identité comme si elle avait voulu gommer l’existence de son premier enfant. Et quand, pour les besoins du film, elle est interrogée, elle semble toujours se réfugier dans de surprenants démentis. Son père, lui, peu avant sa mort, et du bout des lèvres, laisse entrevoir un pan de vérité. Éric Caravaca ne tarde pas à découvrir que sa sœur est morte de ce qu’on appelait la « maladie bleue », maladie provoquée par une malformation cardiaque et le plus souvent associée à la trisomie 21.
Ce point est assez rapidement dévoilé au cours du film. Le but du réalisateur n’est pas d’entretenir un mystère à ce sujet mais de chercher à faire mettre des mots et des phrases sur ce qui s’est passé. Autrement dit à en finir avec le silence et à redonner une identité à une fillette morte qui n’en avait plus. Pour ce faire, Éric Caravaca utilise les documents de famille (ce qu’il en reste) et part à la recherche non seulement des lieux mais surtout des témoins. N’y a-t-il pas d’autres personnes que les parents à pouvoir parler des événements ? Un oncle ? Une femme mystérieuse qui entretient la tombe de Casablanca ?
Est-il judicieux, comme on le dit volontiers, de simplement tourner la page et d’enfouir sous le silence les douloureux événements du passé ? N’est-il pas préférable, au contraire, de les désigner par les mots qui conviennent ? Éric Caravaca conforte son propos en s’appuyant sur d’autres non-dits, sur les faits historiques qui ont ébranlé l’Afrique du Nord (Maroc et Algérie) où ont vécu ses parents et qu’on a mis beaucoup de temps à désigner du seul nom qui convenait, celui de guerre ! Son film bouleversant explore des secrets et des hontes et le fait avec une remarquable économie et une justesse de ton jamais prise en défaut. Il n’y a besoin que d’un peu plus d’une heure pour nous toucher au plus profond et nous dire l’essentiel qui est que toute vie mérite d’être vécue !
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171028 – Cinéma
Autres critiques, disponibles sur le blog:
« Un beau soleil intérieur » 3/10
« Money » 7/10
« Happy end » 1/10
« Blade runner 2049 » 6/10
« L’Atelier » 7/10
« La Belle et la Meute » 8/10
« The Square » 3/10
« Corps et âme » 6/10
Etc. Etc.
20171028 – Cinéma
AU REVOIR LÀ-HAUT
Un film de Albert Dupontel.
Adapté du roman éponyme de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013, (un roman que je n’ai pas lu), le film d’Albert Dupontel, après une brève scène introduisant un flashback, commence sous les auspices d’une des plus gigantesques horreurs de l’histoire de l’humanité, celles de la guerre de 14-18. La séquence se déroule dans les derniers jours de la boucherie, peu avant l’armistice. Les soldats, sachant que la guerre est sur le point de s’achever, imaginent qu’ils n’auront plus à combattre. Si ce n’est qu’ils ont affaire à un gradé qui se délecte des combats et qui est bien décidé à les envoyer jusqu’au bout au casse-pipe. Ce qui nous vaut des scènes de combats parmi les plus impressionnantes qu’on ait vues au cinéma. L’officier, Henri d’Aulnay-Pradelle (Laurent Lafitte), se comporte comme un fou furieux, tandis que deux soldats en réchappent, mais pas indemnes : Albert Maillard (Albert Dupontel) parce qu’il est le témoin de la bassesse de son supérieur et Édouard Péricourt (Nahuel Pérez Biscayart) parce qu’il est soufflé par un obus qui lui a arraché la mâchoire.
Cette ouverture magistrale cède aussitôt la place à une aventure totalement romanesque, mais dont tous les ingrédients concourent à la rébellion contre la fatalité de la guerre, rébellion qui culmine lors d’une scène brève mais stupéfiante se déroulant à l’hôtel Lutécia. Au milieu d’une fête, les masques de tous les fauteurs de guerre, de ceux qui l’ont voulue, de ceux qui l’ont conduite et de ceux qui en ont profité, sont abattus à coups de bouchons de champagne ! Mais c’est tout le film qui, à sa façon, prend le parti de la révolte.
Certes, pour ce faire, le récit emprunte des chemins rocambolesques, se focalisant en particulier sur l’invraisemblable arnaque aux monuments aux morts imaginée par Albert et Édouard, les deux rescapés dont le deuxième, le « cerveau » de l’escroquerie, doit dissimuler son visage de « gueule cassée ». Tout cela est aussi peu crédible que les feuilletons imaginés jadis, au temps du cinéma muet, par un Louis Feuillade ou, plus récemment, au temps du parlant, par un Georges Franju. Mais qu’importe la vraisemblance quand les films sont réalisés avec brio et procurent un plaisir de tous les instants. Et c’est bien le cas avec ce film qu’Albert Dupontel, ne lésinant pas sur les moyens, a réalisé avec un indéniable talent.
Les bonnes idées de mise en scène se succèdent et ravivent sans arrêt le contentement du spectateur. Ainsi de l’incroyable collection de masques dont Édouard se sert non seulement pour dissimuler sa disgrâce mais pour manifester ses pensées et ses sentiments. Ainsi de la jeune Louise (Héloïse Balster) qui, nullement rebutée par la laideur d’Édouard, se fait son porte-parole et son interprète, puisque celui-ci ne peut s’exprimer que par des grognements. Ainsi des retrouvailles d’un père et de son fils, si éphémères et si émouvantes, à la fin du film.
Et que d’autres excellentes surprises tout au long d’une œuvre servie par un remarquable casting. Il faut d’ailleurs remarquer que, hormis le personnage joué par Laurent Lafitte qui n’est qu’une fripouille abjecte, tout le reste de la distribution ne manque ni de nuances ni de subtilité. C’est le cas du père d’Édouard (Niels Arestrup), de sa sœur (Émilie Dequenne) et de la femme de service, lumineuse, jouée par Mélanie Thierry. Et tout est à l’avenant dans ce film dont pas une scène n’est superflue.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171009 – Cinéma
CONFIDENT ROYAL
Un film de Stephen Frears.
Au registre des comédies, on peut distinguer, grosso modo, deux façons de s’y prendre. La plus simple, c’est de lorgner du côté de l’humour facile, des mots d’esprit qui, même s’ils sont totalement éculés, font toujours rire le public, voire de la simple grivoiserie, et cela donne – prenons un film au hasard – quelque chose comme « Le Sens de la Fête » de Éric Toledano et Olivier Nakache. C’est drôle, dans une piètre mesure, mais il n’y a vraiment pas de quoi fouetter un chat ! L’autre manière, c’est celle qui emprunte les voies de la subtilité, voire de la finesse, si ce n’est de la délicatesse ou de l’élégance et cela donne, par exemple, cet attachant nouveau film de Stephen Frears. Je n’ai pas besoin de préciser, je suppose, où va ma préférence.
Nous voilà donc transporté à la cour d’Angleterre à la fin du XIXème siècle, alors que s’achève le plus long règne de la couronne britannique, celui de la reine Victoria. Incarnée à l’écran (et avec quel talent !) par Judi Dench, la souveraine n’est pas seulement reine de Grande-Bretagne main impératrice des Indes. C’est pourquoi l’idée vient aux proches de Victoria (qui s’en mordront les doigts) de faire venir d’Inde deux serviteurs chargés de lui remettre un cadeau à l’occasion de son jubilé. L’un des deux se nomme Abdul Karim et il ne passe pas inaperçu. Sa prestance et son élégance font impression, y compris sur la reine. Il faut dire que l’homme a contrevenu aux ordres stricts qu’il avait reçus : il a osé regarder Victoria ! Un coup d’œil qui n’a pas échappé à cette dernière, au point que, se moquant totalement de l’étiquette et des bienséances, elle va faire d’Abdul un conseiller, un proche et même un maître chargé de lui enseigner la langue (ou plutôt une des langues) de son pays.
Si cette amitié inattendue donne à Victoria un regain d’énergie et de bonne humeur, il n’en va pas de même, loin s’en faut, du côté du premier ministre, des différents conseillers, voire même des serviteurs de la reine. C’est l’affolement. Que la reine (dont on a découvert, dès les premières scènes, qu’elle se soucie peu des convenances) s’éprenne d’un intrus venu d’une lointaine colonie, cela passe la mesure ! On s’amuse beaucoup, tout au long du film, en découvrant les mines scandalisées de ceux qui assistent, impuissants, à la naissance et au développement d’une amitié non seulement inattendue mais extrêmement choquante (à leurs yeux, bien évidemment). Les intrigues vont bon train, mais on a beau faire : même les quelques déconvenues qui émaillent l’histoire de cette surprenante proximité ne découragent pas la reine ! Elle agit en véritable souveraine qui n’a que faire des visages renfrognés de ses proches (y compris de celui de son fils, le futur Edouard VII) et ne cède jamais aux ni au dédain ni au racisme de son entourage. Belle leçon de la part d’une reine en fin de parcours : une leçon qui donne à cet excellent film une empreinte de subtile noblesse !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20171007 – Chansons
LUCIOLE
Un album de chansons de I Muvrini.
Il n’est pas nécessaire, je le suppose, de vanter longuement les qualités artistiques et, en particulier, vocales du groupe corse I Muvrini. Beaucoup de mes lecteurs, j’imagine, ont déjà eu l’occasion d’écouter l’une ou l’autre de leurs compositions et de les apprécier. Certains ont même peut-être eu l’occasion d’assister à un de leurs concerts et je ne doute pas qu’ils en gardent un grand souvenir. C’est en 1979 que le groupe I muvrini publiait son premier album et celui qui vient de sortir arrive en 20ème position. Beaucoup de chemin a été parcouru et les frères Bernardini, leaders du groupe, après avoir été les porte-paroles des revendications nationalistes corses (toujours sous l’égide de convictions résolument non-violentes), se sont, depuis, largement ouverts aux autres traditions et aux autres cultures, privilégiant la rencontre, l’accueil, le dialogue, l’harmonie des peuples, l’universalité.
Le nouvel album, superbe, ayant pour titre « Luciole », se reçoit comme une invitation à guetter tous les points de lumière qui brillent encore, çà et là, dans les ténèbres de ce monde. Les chanteurs d’I Muvrini n’ont de cesse de mettre en avant ce qui est lumière et chacune des chansons de l’album trouve sa place en cette perspective. De plus en plus, au fil de leurs créations, les membres d’I Muvrini, spécialement Jean-François Bernardini qui écrit les textes, choisissent de chanter aussi bien du français que du corse, plusieurs chansons mêlant assez habilement les deux langues. Quant à ce qui est écrit et chanté en corse, on peut le comprendre d’autant plus facilement que tout est traduit dans la pochette de l’album.
Venons-en aux lucioles, à chacun des points de lumière, que nous propose le groupe aujourd’hui. Chaque chanson est magnifiquement peaufinée, pas une n’est négligeable. Mais il en est qui sont habitées d’une force et d’une beauté particulières parce qu’elles rejoignent nos préoccupations, notre actualité, et parce qu’elles mettent en avant le respect d’autrui, parce qu’elles ont l’ambition de chanter l’espoir et la paix là où l’un et l’autre sont en danger d’anéantissement. La rencontre et les échanges entre les cultures et les traditions se concrétisent dans des bien des chansons, avec, à chaque fois, le souci renouvelé non seulement du respect mais de l’estime pour les différences. Dans « Culomba negra », se fait entendre le dialogue entre les voix corses et celles du Gospel, « musiques d’insurrection dans leur force spirituelle ». La chanson « Ses enfants sur l’eau » a trouvé son origine, quant à elle, du côté d’une poétesse somalienne (Warsan Shire) « qui a dû fuir son pays en pleine guerre civile ». « L’amore di a to vita » s’inspire d’une photo montrant « une infirmière palestinienne allaitant un bébé palestinien pour le sauver ». Deux chansons se réfèrent au drame vécu par les Syriens : « Alep » qui est dédiée « à Ghiath Matar, le Gandhi syrien, à tous les résistants non-violents de Daraya, au peuple syrien » ; et « Janna », chanson écrite peu après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, à l’occasion d’un concert qui rassemblait I Muvrini et une chorale de réfugiés syriens.
Mais il est deux chansons qui sont peut-être les deux plus beaux points de lumière de ce nouvel album, les deux lucioles qui brillent d’un éclat tout particulier. L’une fait référence, elle aussi, aux attentats nombreux, trop nombreux, qui ont ensanglanté l’Europe depuis plusieurs mois. La chanson a pour titre « Ma sœur musulmane » et elle s’élève contre les intégristes, les « esprits égarés », qui pervertissent jusqu’aux paroles des prières. « Allahou-akbar », « Dieu est plus grand » : la prière de paix a été dénaturée pour en faire « un cri de guerre et de massacre ». La chanson d’I Muvrini, magnifique, se rebelle contre cette insupportable altération et elle est dédiée à « ma sœur musulmane, et pour toi : ma sœur juive, athée, chrétienne… ». Car, bien sûr, les perversions de sens ne sont pas l’apanage des musulmans ! Enfin, pour couronner le tout, lumière la plus belle qui soit, la chanson intitulée « Madre » est un hymne à Marie, Mère universelle. Comment mieux rassembler la beauté de l’album d’I Muvrini, comment mieux signifier l’appel à la paix qui s’y fait entendre qu’en confiant tout à « Marie, océan de tendresse » ?
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170927 – Cinéma
ESPÈCES MENACÉES
Un film de Gilles Bourdos.
Ils se marient dans l’allégresse mais, dès la nuit de noces, quelque chose d’étrange et de menaçant se révèle. Le jeu bizarre qu’impose Tomasz (Vincent Rottiers) à Joséphine (Alice Isaaz) durant leur lune de miel (qui serait plutôt lune de fiel) aurait dû lui mettre la puce à l’oreille et l’avertir d’un potentiel danger. Mais comment pourrait-elle admettre, alors qu’elle vient à peine de se marier, que l’individu avec qui elle doit partager sa vie ne va pas tarder à la faire entrer en enfer ? Un an plus tard, le piège s’est refermé et la voici incapable de se libérer d’un mari violent et de renouer avec ceux qui voudraient la sauver, à commencer par son père Joseph (Grégory Gadebois).
Gilles Bourdos et son coscénariste Michel Spinosa ont puisé cette histoire tragique dans un ensemble de nouvelles écrites par l’Américain Richard Bausch. Et ils y ont trouvé la matière d’autres récits tout aussi émouvants, faisant s’entrecroiser et, parfois, se rencontrer les destinées des différents protagonistes. Outre l’histoire commune de Tomasz et Joséphine, l’on croise aussi celle d’un couple de parents (Eric Elmosnino et Agathe Dronne) en instance de séparation et apprenant, atterrés, que leur fille (Alice de Lencquesaing) souhaite se marier avec un universitaire de 40 ans plus âgé qu’elle (il a 63 ans !) qui l’a déjà mise enceinte. Et l’on découvre aussi le portrait touchant d’un étudiant timide (Damien Chapelle) devant prendre soin de sa mère hospitalisée en psychiatrie et cherchant à combler le vide de son existence en trouvant l’âme sœur (y compris en recourant absurdement et désespérément à un service de téléphone rose !).
Grâce aux formidables talents conjugués des actrices et acteurs (il n’y a pas la moindre fausse note), ces récits de solitudes, de maladresses, de souffrances données ou reçues procurent de constantes émotions. Le film prend même, parfois, une allure quasi fantastique (comme lorsque des milliers d’insectes s’échappent d’un lampadaire que réparent des cantonniers). Les destinées entremêlées des personnages ne peuvent qu’émouvoir fortement, la plus large part étant consacrée au couple formé par Tomasz et Joséphine. La détresse de celle-ci est le pivot du film. Que faire quand on est le témoin de violences conjugales, quand on sait qu’une épouse est la victime d’un mari violent et qu’elle ne trouve pas l’énergie de se révolter ? Et comment s’y prendre quand on est le père de la jeune femme en question ? Dans ce rôle d’un père qui veut à tout prix protéger sa fille, Grégory Gadebois fait une prestation particulièrement bouleversante.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170917 – Cinéma
Ci-dessous ma critique de
FAUTE D’AMOUR
Un film de Andreï Zviaguintsev.
« Sans amour, on ne peut pas vivre » : telle est la parole de vérité de l’homme que Genia a pris pour amant et à qui elle vient d’expliquer qu’elle n’a jamais voulu de son fils Aliocha, qu’elle ne l’a jamais aimé, comme elle-même n’a jamais été aimée par sa propre mère. Une absence d’amour que le garçon de 12 ans, Aliocha, perçoit comme une blessure d’autant plus ravageuse que ses parents, Genia et Boris, tout accaparés par leurs disputes et leur projet de divorce, ne le considèrent plus, lui leur enfant, que comme quelqu’un de si encombrant qu’ils n’imaginent pas d’autre alternative que de s’en débarrasser en le plaçant dans un pensionnat. Caché derrière une porte, le garçon verse toutes les larmes de son corps et ses parents ne s’en rendent même pas compte. Pire : quand Aliocha disparaît de la maison, ce n’est qu’après plus de 24 heures que sa mère en fait le constat et prend contact au téléphone avec le père pour le lui annoncer.
Après « Léviathan » (2014), film implacable sur les dérives étatiques de la Russie d’aujourd’hui, Andreï Zviaguintsev, toujours aussi inspiré, propose cette œuvre magistrale, Prix du Jury à Cannes, une œuvre qui ne peut laisser indifférent. Que devient un enfant lorsque ses parents sont incapables d’aimer ? Genia et Boris veulent divorcer et tous deux sont déjà impliqués dans de nouvelles histoires dont on peut parier qu’elles seront aussi pitoyables que celle qui les a réunis. Genia a reconnu elle-même qu’elle ne sait pas aimer. Quant à Boris, sa seule préoccupation semble être de ne pas déplaire à son patron, un orthodoxe intégriste à la morale si rigoureuse qu’il ne supporterait pas qu’un de ses employés soit divorcé ! Ce qui n’empêche pas Boris d’avoir déjà trouvé une nouvelle compagne et de l’avoir déjà mise enceinte (une future mère et un futur enfant qui, probablement, ne connaîtront pas des sorts plus enviables que Genia et Aliocha).
Ce film, si ancré dans la réalité russe, n’en garde pas moins un grand pouvoir d’interpellation qui nous atteint tous, quels que soient notre origine et notre pays. Il est frappant de constater combien les principaux protagonistes du film de Zviaguintsev sont dépendants de leurs écrans. A tout instant, leurs yeux sont rivés sur celui d’un smartphone, d’un ordinateur, voire même d’un tapis de course qui en est doté. Comme s’il n’y avait plus d’expression possible pour eux que par l’intermédiaire de Facebook et des selfies qu’on s’échange de l’un à l’autre. En vérité, à l’image des scènes d’introduction du film qui montrent des enchevêtrements d’arbres recouverts de neige, ce sont les cœurs eux-mêmes qui semblent figés dans une sorte de glaciation. Chez Zviaguintsev, même la disparition d’un enfant, en l’occurrence d’Aliocha, ne suffit pas à réchauffer les cœurs, à y remettre ce dont ils manquent terriblement, c’est-à-dire de l’amour.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
————————————————
D’autre part, pour ceux que cela peut intéresser, voici un lien vers un article de la revue Rustica, qui est en fait une interview de mon frère Paul sur d’éventuels miels et fleurs toxiques:
https://www.rustica.fr/blog-redaction/miels-et-fleurs-toxiques-l-avis-paul-schweitzer,13943.html
20170918 – Cinéma
LES GRANDS ESPRITS
Un film de Olivier Ayache-Vidal.
Mais pourquoi nomme-t-on systématiquement les professeurs débutants dans les établissements scolaires réputés les plus difficiles ? Ne vaudrait-il pas mieux y envoyer des enseignants expérimentés ? Qui ne s’est jamais posé ces questions ? Dans le film de Olivier Ayache-Vidal, c’est François Foucault (Denis Podalydès), un professeur qui enseigne dans un collège des plus côtés (Henri IV), qui les exprime à voix haute, sans se douter qu’il parle en présence d’une employée du Ministère de l’Éducation Nationale. Pris au mot, le voilà qui, tout dépité, se retrouve muté au collège Barbara de Stains dans la Seine-Saint-Denis. Le changement est brutal, on s’en doute, et il va falloir bien de l’ingéniosité à François Foucault, tout qualifié et aguerri qu’il soit, pour mettre au travail des élèves pour le moins indisciplinés.
Difficile d’éviter tous les clichés quand on fait un film sur ce sujet, un sujet que le cinéma a déjà exploré maintes fois. Olivier Ayache-Vidal n’a bien sûr pas réussi à échapper à tous les lieux communs, mais peu importe. Son film n’en est pas moins remarquable pour de multiples raisons. D’abord parce qu’il a fait un choix d’acteur des plus judicieux : dans ce rôle de professeur qui lui va comme un gant, Denis Podalydès fait une prestation éblouissante. Il crève l’écran pendant toute la durée du film et l’on se délecte de chacune de ses interventions, d’autant plus qu’il n’y a que très peu de scènes exemptes de sa présence. Ensuite, parce que le réalisateur a su choisir et diriger à la perfection les jeunes acteurs qu’il a dénichés sur les lieux mêmes, au collège de Stains où il a pris le temps de s’immerger pendant plusieurs mois avant d’entreprendre le tournage du film. De ce fait, celui-ci prend une coloration semi-documentaire qui en accroît la pertinence. Tous les élèves intervenant au cours du film sont criants de vérité, avec une mention particulière pour Abdoulaye Diallo dans le rôle de Seydou.
Enfin, même si « Les Grands Esprits » n’est pas une œuvre très innovante sur le plan de son scénario, elle offre quand même, si l’on y est attentif, des plages de subtilité. Derrière ses apparences de film quelque peu convenu sur un professeur qui, après un temps de doute, voire de découragement, trouve des moyens et une pédagogie renouvelés capables de séduire des élèves récalcitrants, entre autres en leur faisant goûter « Les Misérables » de Victor Hugo, derrière cela se révèlent des instants de finesse qui en font toute la beauté. Ainsi, quand François Foucault comprend qu’il lui est nécessaire de se mettre, en quelque sorte, à hauteur des adolescents à qui il est chargé d’enseigner le Français. Sans aucunement se rabaisser, en gardant sa stature de professeur, il parvient à trouver des moyens de se faire comprendre de ceux à qui il s’adresse, et bien sûr la relation professeur/élèves en est progressivement transformée. Et puis, à la fin du film, une séquence très réussie met en lumière la générosité et la mansuétude de ce professeur qui, s’il est un fonctionnaire, n’en fait pas moins preuve des qualités humaines les plus louables. S’opposant au directeur de l’établissement et à certains enseignants qui, au sujet d’un élève passant en conseil de discipline, n’ont que les termes de « procédure » et de « loi » à la bouche, il est celui qui remet de l’humanité là où il risque de ne plus y en avoir, quitte à prendre à leur propre piège ceux qui ne jurent que par l’autorité. Une leçon dont nous ferions bien tous de nous inspirer et qui clôt en beauté ce film à la fois plaisant et intelligent.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170907 – Cinéma
DANS UN RECOIN DE CE MONDE
un film de Sunao Katabuchi.
Les films d’animation japonais ont ceci de particulier que, nonobstant leur indéniable beauté du point de vue esthétique, ils abordent souvent et sans détour les sujets les plus graves, allant parfois jusqu’à mettre à nu les souffrances, les épreuves et les errements humains les plus terribles. C’est le paradoxe de beaucoup de ces films : les dessins sont admirables, les images somptueuses, tandis que ce qu’elles racontent est marqué de grandes douleurs. Il n’y a jamais, ou presque jamais, de mièvrerie dans ces films, même lorsqu’ils sont destinés à un public d’enfants.
Le film qui nous intéresse aujourd’hui convient davantage aux adolescents et aux adultes qu’aux enfants puisque, comme « Le tombeau des lucioles » (1988) d’Isao Takahata mais de façon moins désespérée, il aborde le drame de la guerre, prenant en compte le traumatisme le plus indélébile qu’ait connu le Japon, celui de l’anéantissement d’Hiroshima par une bombe atomique le 6 août 1945.
Cela étant dit, le film de Sunao Katabuchi ne se limite pas à ce terrible événement, mais il l’englobe en quelque sorte en s’attachant au cheminement de son personnage principal, Suzu. Du début des années 30 jusqu’à la fin des années 40, c’est son parcours qui est conté, celui d’une fillette, puis d’une adolescente, puis d’une jeune femme aimant s’exprimer (et de façon talentueuse) par le dessin et mariée très tôt et sans son consentement, ce qui la contraint à résider à Kure, à une vingtaine de kilomètres d’Hiroshima, en compagnie du mari qui lui a été imposé et de sa belle-famille.
Tout en égrenant les années, le réalisateur parvient, grâce à la force de son art, à nous faire ressentir la vie de cette toute jeune femme (un personnage dont les traits gardent immuablement la fraîcheur de l’enfance) forcée de vivre dans son « recoin » du Japon de ces années-là. Son engouement pour le dessin, Suzu le garde précieusement comme un trésor (ce qui occasionne de superbes séquences poétiques) jusqu’à ce que le malheur survienne, le drame qui la prive de sa joie. Les années de guerre ne laissent personne indemne, pas plus Suzu que les autres. Pourtant, pour elle comme pour tant d’autres Japonais, il faut chercher et trouver, malgré tout, une raison de vivre…
Oui, ce film est triste et grave, mais il est également beau et surtout, bien que mettant en scène des personnages de dessin animé, il est touchant, voire même bouleversant. Il témoigne, à sa façon, des dures épreuves, mais aussi des ressources d’espoir, des petits de ce monde, des oubliés, de celles et ceux qui vivent dans leur « recoin ».
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170830 – Cinéma
JEANNETTE
un film de Bruno Dumont.
L’an dernier, à la fin de ma critique du film précédent de Bruno Dumont (« Ma Loute ») que j’avais trouvé irritant et grotesque, je me référais à une interview dans laquelle le cinéaste indiquait que son film suivant serait sur Jeanne d’Arc et j’exprimais mes craintes et mon sarcasme. J’avais tort. Il est vrai que je n’imaginais pas une seconde, à cette date-là, que le projet de Bruno Dumont était d’adapter des textes de Charles Péguy (en l’occurrence de son « Jeanne d’Arc » écrit en 1897 et du « Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc » écrit en 1910). Je n’imaginais pas non plus qu’il s’agirait d’une comédie musicale chorégraphié par Philippe Decouflé et mise en musique (électro métal) par un certain Igorrr dont j’ignorais jusqu’au nom.
Une fois informé, on peut certes avoir l’impression de rêver ou d’avoir affaire à une mauvaise farce, ce qui va bien avec les orientations facétieuses prises par le cinéaste depuis le tournage de la série télévisée « P’tit Quinquin » (2014). Faire dialoguer et s’accorder des univers aussi dissemblables et lointains que ceux de ces différents artistes, ce n’est pas une gageure, cela ressemble plutôt à un projet totalement insensé et casse-gueule. Qui aurait misé un centime d’euro sur la réussite d’une telle entreprise ?
Eh bien, étrangement, il m’a semblé que le résultat fonctionne assez bien ! Il n’y a pas besoin de faire un gros effort pour se laisser prendre au jeu. Malgré son dépouillement extrême, ses décors minimalistes (le cinéaste n’a pas jugé utile de tourner en Lorraine, mais il s’est contenté des dunes et des moutons de sa région de prédilection, le Nord) et ses moyens limités, le film provoque, ou peut provoquer en tout cas, un effet de séduction assez irrésistible. Son charme et sa beauté, il les doit au texte de Péguy qui, même s’il peut sembler, par moments, encombré de quelques archaïsmes, se prête formidablement à la déclamation et au chant, et à la grâce (et à l’innocence, pourrait-on dire) de ses interprètes, ainsi qu’à quelques bonnes idées de mise en scène assez simples mais judicieuses (comme de faire se dédoubler le personnage de Madame Gervaise, joué par deux actrices).
Le film doit beaucoup à la grâce émanant des deux actrices en herbe sur qui repose le rôle titre : Jeannette à 9 ans jouée par Lise Leplat Prudhomme et Jeanne à 15 ans (qui ne veut plus être désignée par son diminutif) jouée par la bien nommée Jeanne Voisin. Toutes deux ont beau être totalement novices au cinéma, elles excellent, elles convainquent sans peine et ce à cause même de leur manque d’expérience. Il fallait ne pas manquer d’audace pour leur faire dire et chanter les textes de Péguy. Or elles le font avec une sorte de fraîcheur et de pureté qui s’accorde très bien avec les écrits du poète. Même leur semblant de gaucherie, quand elles dansent ou quand elles chantent, convient à leur rôle. Elles, ainsi que les quelques autres acteurs amateurs qui interviennent au cours du film, lui donnent, comme de façon naturelle, la marque de la candeur et de la simplicité, au point que l’on a le sentiment d’assister à la version modernisée d’un Mystère semblable à ceux qui avaient cours au Moyen-Âge (ce n’est pas par hasard si, précisément, l’un des textes de Péguy porte ce titre de « Mystère »). En somme, en dépit de quelques maladresses de mise en scène (totalement assumées par le réalisateur) ou peut-être aussi à cause d’elles, en dépit de l’aspect tonitruant de la musique d’Igorrr et en dépit des déhanchements parfois surprenants auxquels se soumettent les actrices pendant les chorégraphies, ce qui émane du film, par-dessus tout, c’est la grâce de l’enfance. Même si l’expression semble un peu galvaudée, oui, on peut le dire, ce film, qui nous arrive après tant d’autres productions sur Jeanne d’Arc, n’en est pas moins marqué du sceau de l’originalité et surtout est touché par la grâce.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170823 – Cinéma
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
un film de Robin Campillo.
Grand prix du Jury au dernier festival de Cannes où il a fait sensation, ce film de Robin Campillo vibre tout entier de la passion et de l’engagement de son réalisateur. Nul doute que ce dernier a largement puisé dans son expérience de militant du mouvement Act-Up Paris au début des années 90 pour bâtir ce film. Il a su le faire cependant sans jamais le figer en une sorte de photographie d’un passé proche qui néanmoins sentirait déjà la naphtaline. Le film ne s’encombre pas de nostalgie, il interpelle, il nous interpelle parce que, paradoxalement, alors qu’il y est beaucoup question de mort, il célèbre la vie, le désir de vivre, l’envie d’être en vie, de fêter, d’aimer, de se battre contre le néant. Les claquements de doigts qui le scandent (car à Act-Up on exprime son assentiment de cette manière et non par des applaudissements, pour ne pas ralentir les débats) le disent et l’approuvent : oui, il faut se battre pour la vie en réveillant les endormis, qu’ils fassent partie de l’opinion publique, de la classe politique ou de la communauté des chercheurs et des scientifiques.
Sur ce point, à Act-Up, tout le monde est d’accord. L’envie de se battre pour vivre semble unanime. Ce qui l’est moins, ce sont les modalités. Si tous les militants s’accordent dès leur entrée dans le mouvement sur une charte commune (elle est présentée à des nouveaux venus dès l’ouverture du film), on perçoit rapidement qu’il n’en est pas de même ni quant aux méthodes à employer ni même quant aux actions à mener. Sur ces sujets, les débats sont souvent houleux. Robin Campillo ne dissimule aucunement ces difficultés, tout en soulignant par ailleurs les points de cohésion du groupe. Restent cependant des blessures, des incompréhensions, voire des colères et des fâcheries, comme lorsqu’il est question de faire intervenir ou non la justice, au risque d’envoyer des « coupables » en prison.
Les nombreuses scènes d’assemblée générale et de débats donnent au film un ton quelque peu didactique, il est vrai, mais, même s’ils se déroulent dans une salle de classe, ces débats ne sont pas véritablement scolaires (il ne s’agit pas de faire un cours sur le sida et ses conséquences), ils s’incarnent dans des êtres concrets, des visages avec qui on a tôt fait de se familiariser. On découvre d’ailleurs, par ce biais, que le mouvement rassemble non seulement des homosexuels, non seulement des séropositifs, mais aussi des militants qui n’appartiennent ni à l’une ni à l’autre de ces catégories. Tous se retrouvent dans un même combat contre le silence et la mort. Tous veulent en finir avec les mensonges et les hypocrisies et tous les dénoncent lorsqu’ils sont repérés, y compris dans des ouvrages de « sommités » !
Mais ce qui donne sa force au film, ce qui en fait une œuvre à la fois subtile et touchante, c’est l’art avec lequel le réalisateur a su intégrer l’histoire singulière et intime au sein de l’histoire collective, y insérant des éléments de poésie parfois surprenants sans jamais être incongrus. Car c’est aussi une histoire d’amour que raconte le film, celle qui naît, grandit et s’épanouit entre Sean et Nathan, deux garçons qui se sont rencontrés et appréciés sur les bancs de la salle de réunion du mouvement. Sans jamais verser ni dans le voyeurisme ni dans la complaisance, mais sans pourtant faire l’hypocrite, la caméra s’attarde, respire, se poétise en quelque sorte et donne de l’espace aux spectateurs en accompagnant le cheminement de ces garçons, jusque dans l’inévitable tragédie. Amour et mort, une fois de plus, marchent ensemble, et se recréent dans de nouveaux combats.
Et ce film, lui aussi, après « Une Femme fantastique » de Sebastián Lelio et « Lola Pater » de Nadir Moknèche, invite à changer les regards, à en chasser les idées reçues et les jugements à l’emporte-pièce. Il est le bienvenu.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170810 – Cinéma
DJAM
un film de Tony Gatlif.
Il suffit parfois d’une actrice (ou d’un acteur) pour qu’un film séduise irrésistiblement le spectateur, voire même le fasse chavirer de bonheur, tant la synergie entre la volonté du réalisateur et la prestation de l’interprète est parfaite. Manifestement, pour jouer le rôle-titre de ce film, Tony Gatlif a trouvé en Daphné Patakia son actrice rêvée, idéale, parfaite. Cela se ressent tout au long de l’œuvre et cela procure, en effet, un plaisir de tous les instants. La caméra ne cesse de suivre l’actrice et nous communique l’enthousiasme et la fascination qui, sans nul doute, ont prévalu chez le cinéaste.
Le film n’est pourtant pas dénué de gravité. On le saisit dès le début puisque Kakourgos (Simon Abkarian), empêtré dans des difficultés financières et ne voulant pas, par peur des huissiers, quitter l’établissement qu’il gère sur l’île de Lesbos, envoie sa nièce Djam à Istanbul afin de lui ramener une pièce pour le moteur de son bateau. C’est ce périple de la jeune femme et son retour à Lesbos qui font l’objet du film, périple au cours duquel elle prend bien des libertés et fait de multiples rencontres, la plus décisive étant celle d’Avril (Maryne Cayon), une jeune Française partie en Turquie pour apporter son concours à l’aide aux migrants mais se retrouvant complètement paumée et sans argent. Djam lui ayant tendu la main, les deux jeunes femmes se trouvent dès lors comme liées l’une à l’autre, ce qui ne va pas sans disputes ni chamailleries qui se résolvent toujours par des réconciliations.
Entre Grèce et Turquie, sur fond de crise financière et de crise migratoire, Djam et Avril croisent de nombreuses vies en souffrance et sont les témoins impuissantes des drames dont ces lieux ont été les théâtres : carcasses d’embarcations abandonnées après avoir servi au transport de migrants, monceaux de vêtements et de gilets de sauvetage… Même pour les habitants de Lesbos, île désertée par les touristes, il n’y a plus moyen de vivre décemment.
Cela étant dit, le film ne laisse une impression ni de pesanteur ni de désespoir. D’une part à cause de son actrice principale dont j’ai déjà souligné les mérites : sa beauté, son rayonnement, ses emportements, sa fougue, son aisance, ses irrévérences mêmes et sa façon bien à elle et très impertinente de dire non à ceux dont l’ambition est de restreindre les libertés, tout chez elle est ensorcelant. D’autre part à cause de la musique : car le film est musical, tout entier traversé de chants, de rythmes et de danses. Tout est prétexte à faire résonner les instruments locaux, faire entendre les chants typiques de ces régions et se mettre à danser. Djam excelle dans ce domaine, mais on a le sentiment que c’est tout un peuple qui se passionne pour le chant. Et puis chanter, c’est peut-être aussi une façon comme une autre de retrouver de la dignité quand on n’a plus rien. En témoignent la fin du film mais aussi, auparavant, une scène bouleversante montrant, dans un café, un homme au visage détourné et baigné de larmes tandis que retentissent les instruments et les voix qui couvrent, autant qu’ils le peuvent, les abîmes des grandes détresses. Quand on a tout perdu, il reste au moins cela, que personne ne peut dérober : la capacité de chanter.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170725 – Cinéma
DUNKERQUE
un film de Christopher Nolan.
Parmi les nouvelles glanées ces jours-ci sur le net, il en est une nous montrant un vétéran de la bataille de Dunkerque, aujourd’hui âgé de 97 ans, les yeux baignés de larmes après avoir vu le film de Christopher Nolan. C’est la preuve, s’il en est besoin, de la crédibilité de ce que ce dernier a choisi de montrer sur nos écrans. Sa reconstitution de cette bataille, à la fois déroute totale des forces anglaises et françaises contraintes de se replier sur la plage de Dunkerque et entreprise de sauvetage des soldats piégés, laisse pantois. C’est le cas de le dire, le réalisateur a clairement pour ambition de mettre les spectateurs en immersion dans une réalité à la fois terrible parce qu’elle a le caractère d’une défaite et parce qu’elle est sanglante (et parfois mortelle) et pleine d’espoir parce qu’elle incite certains protagonistes à la vaillance et au dépassement de soi pour le salut d’autrui. Dans une telle aventure se révèlent les petitesses et les grandeurs, les peurs et les lâchetés qui conduisent des soldats anglais à repousser des soldats français par exemple, mais aussi les héroïsmes et les intrépidités qui gouvernent ceux qui, au péril de leur propre vie, s’engagent pour ramener en Angleterre les hommes pris au piège.
Cela étant dit, même quand un cinéaste a cette prétention de mettre en immersion les spectateurs, il ne peut pour autant tout englober dans son film, il est contraint de faire des choix et d’adopter des points de vue et, donc, d’être partial. Christopher Nolan ne s’en cache d’ailleurs pas, il l’annonce clairement, il veut nous montrer la réalité des combats, de la débâcle et du sauvetage des soldats selon trois angles différents et trois unités de temps : une semaine en compagnie des soldats anglais sur la plage de Dunkerque, sur la jetée d’embarquement et sur les embarcations de secours, un jour en compagnie de volontaires portant assistance à ces derniers au moyen de bateaux et une heure en compagnie des aviateurs anglais affrontant dans les airs leurs homologues allemands.
Le film passe donc constamment d’un point de vue à un autre, chacun d’eux révélant la tension extrême éprouvée par les différents intervenants engagés dans cette aventure. Le danger est tel qu’il s’agit, pour beaucoup d’entre eux, de trouver des moyens de survivre plus encore que de combattre : on peut presque affirmer qu’on a affaire à un film de survie davantage qu’à un film de guerre ! Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que le réalisateur a fait le choix de privilégier les scènes d’action, ne laissant aucun répit aux spectateurs et réduisant les dialogues au strict minimum.
Ces options radicales de mise en scène donnent au film ses qualités indéniables, son rythme haletant et sa tension permanente, mais aussi ses limites. La plus flagrante d’entre elles a déjà été abondamment soulignée par un certain nombre de commentateurs du film, mais je ne peux que la reprendre à mon compte. Elle concerne les personnages évoluant dans le film, des personnages qui, hormis peut-être ceux qui se portent au secours des soldats sur un bateau, ne sont, pour ainsi dire, jamais caractérisés. Ils sont, en quelque sorte, interchangeables avec tous les autres soldats apparaissant à l’écran. C’est un peu comme si le réalisateur en avait choisi quelques-uns au hasard sans jamais chercher à les distinguer vraiment de la masse des autres. En tant que spectateurs, on aimerait en savoir davantage sur chacun d’eux, mais non, le cinéaste a préféré ne leur accorder que si peu de dialogues qu’on en reste frustré.
Cette réserve étant écrite, on est quand même en droit de saluer la maîtrise stupéfiante avec laquelle ce film a été réalisé. Il y a largement de quoi être ébahi et je le dis avec d’autant plus de conviction que je n’avais, jusqu’à présent, apprécié aucun des films de Christopher Nolan !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170718 – Cinéma
UNE FEMME FANTASTIQUE
un film de Sebastián Lelio.
Les films qui ont pour ambition de nous inviter à changer nos regards sur autrui, à abandonner nos regards de défiance pour adopter ceux de la bienveillance, sont toujours les bienvenus, dans la mesure où ils sont réalisés avec talent. C’est incontestablement le cas de cette œuvre du chilien Sebastián Lelio qui y dresse le portrait d’une transsexuelle, non pas d’une manière militante mais précisément pour bonifier, voire pour réparer si besoin est, nos regards si facilement encombrés de préjugés et de doutes dès qu’ils se posent sur ce qu’ils estiment différent.
En vérité, c’est un couple d’amoureux qui constitue le pivot de ce film et ce couple est formé de Marina (Daniela Vega) et d’Orlando (Francisco Reyes), un homme beaucoup plus âgé que sa compagne. Mais qu’importe la différence d’âge ! Quand Orlando regarde Marina chanter sur la scène d’un club, on comprend aussitôt que ces deux-là s’aiment d’un amour vrai et sincère. Et qu’importe que Marina soit une transsexuelle comme on le découvre rapidement ! Cela ne brouille aucunement le regard d’amoureux d’Orlando qui projette de l’emmener bientôt visiter les chutes d’Iguazú. Malheureusement, il est une autre invitée qui se plaît à tout perturber : elle s’appelle la mort ! Pris de malaise durant la nuit et ayant fait une chute dans des escaliers, Orlando est emmené d’urgence par Marina jusqu’à une clinique, mais en vain. L’homme décède d’une rupture d’anévrisme.
C’est alors que commence pour Marina la lugubre ronde des regards mauvais. Les regards de ceux qui jugent, les regards de ceux que la différence effraie. Le corps d’Orlando étant couvert de bleus et sa tête étant marqué d’un hématome du fait de sa chute, la police ne tarde pas à se mêler de l’affaire. Apparaît donc le regard suspicieux d’une inspectrice, son regard déshumanisant qui ne se réfère qu’aux procédures à suivre et son regard de curiosité malsaine lorsque Marina est examinée jusque dans son intimité !
Viennent aussi les regards méfiants, hautains, rancuniers, voire haineux, des proches du défunt (ou, en tout cas, de sa famille, le mot « proches » n’étant peut-être pas le plus indiqué). Hormis le frère d’Orlando qui n’est pas dénué d’élans de compassion, les autres n’ont qu’un désir, se débarrasser de celle qu’ils considèrent comme une intruse, ne plus la voir, la chasser et, bien sûr, sans lui accorder quoi que ce soit. C’est le cas de l’ex-femme d’Orlando, qui ne cache pas son mépris, comme celui de son fils pour qui Marina n’est rien d’autre qu’une sorte de monstre. Terribles regards que ceux dont se targuent ces gens-là !
Heureusement, Marina n’est pas du genre à courber l’échine ni à se laisser piétiner par les humiliations. La force de se battre, elle la puise non seulement en elle-même mais surtout dans le regard de ceux pour qui elle n’a rien d’excentrique : non seulement sa sœur, qui intervient lors d’une des scènes du film, mais, bien davantage encore, Orlando lui-même à qui la magie du cinéma permet de donner une présence au-delà de la mort. Le temps d’échanger un regard d’amoureux et le temps d’un baiser sont les plus précieux qui soient. Marina y trouve une vitalité et une volonté insoupçonnées. Jusqu’à une sorte d’apothéose finale toute remplie d’espoir. Car Marina, qu’on a entendu chanter, au début du film, une chanson de cabaret, prend aussi des cours de chant lyrique au point de se produire sur la scène d’un théâtre et de chanter, de sa voix qu’on peut associer, me semble-t-il à une voix de haute-contre, l’air fameux du « Xerxès » de Haendel, « Ombra mai fu ». Comment mieux terminer ce film bouleversant et mêlangeant judicieusement les genres (drame, psychologie, policier, fantastique…) que par ce moment de pure grâce et d’exquise beauté ? Qui osera encore regarder Marina avec les yeux inquisiteurs de qui la considère comme un phénomène ? Marina n’est pas un être étrange, elle n’est rien de plus qu’une femme, mais « une femme fantastique » !
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170713 – Cinéma
SONG TO SONG
un film de Terrence Malick.
Considéré pendant longtemps comme un cinéaste rare ne tournant que très peu, Terrence Malick semble vouloir rattraper le temps perdu et, depuis 2011, date de la sortie de « The Tree of Life », palme d’or à Cannes cette année-là, il enchaîne les films. En outre, il le fait en usant d’un style renouvelé qui a déçu certains de ses admirateurs tout autant qu’il en a enchanté d’autres et en ressassant les mêmes thèmes ou les mêmes obsessions. Du coup, bien sûr, certains critiques lui reprochent de ne plus servir et resservir qu’une recette identique et de moins en moins alléchante. Ce n’est pas mon sentiment. Terrence Malick ne fait pas autre chose que ce qu’ont fait beaucoup de créateurs, et parmi les plus grands, avant lui, en ruminant, d’oeuvre en œuvre, les mêmes idées, les mêmes hantises, et il le fait avec un talent qui ne faiblit pas.
« Song to Song » peut donc être perçu comme une variation sur un sujet que le réalisateur a déjà exploré et mis en scène dans ses deux films de fiction précédents, « A la Merveille » (2012) et « Knight of Cups » (2015). A nouveau, Terrence Malick se focalise sur une histoire d’attirance amoureuse et de déchirures chez quelques protagonistes, mais on ne peut pas prétendre qu’il ne se renouvelle pas du tout, car il aborde ce sujet de manière nettement plus narrative et peut-être un peu moins poétique que dans les deux opus précédents. Et il le fait dans un environnement singulier, celui de la scène musicale d’Austin dans le Texas. Le chassé-croisé amoureux se noue et se dénoue entre quatre personnages : un producteur de musique (Michael Fassbender), des musiciens et chanteurs (Rooney Mara et Ryan Gossling) et une serveuse (Natalie Portman).
En vérité, le récit importe assez peu. Ce qui intéresse le réalisateur, c’est de mettre en scène la recherche existentielle de personnages à la fois étourdis par le monde du divertissement dans lequel ils baignent, tourmentés par leurs passions et obsédés par une inlassable quête d’autre chose, de ce qu’on ne sait pas très bien nommer, de ce qui donne un sens à la vie et révèle chaque être à lui-même. Pour y parvenir, Terrence Malick reste un maître hors pair. Sa science du découpage et du montage est stupéfiante. Chaque plan, ou presque, ressemble à un joyau ciselé par un orfèvre. Même la bande-son surprend par sa beauté et son inattendu : étant donné le cadre dans lequel se déroule le film, on pouvait parier qu’elle se composerait essentiellement de morceaux de rock, mais ce n’est pas le cas. Si Iggy Popp et Patti Smith sont réellement présents dans certaines scènes, on n’en entend pas moins davantage de morceaux de musique dite classique (Malher et Saint-Saëns parmi d’autres) que de rock.
Cela étant dit, le projet du cinéaste n’est bien évidemment pas de réaliser un film purement esthétique, le plus important restant la quête de sens qui hante les personnages de ses œuvres les plus récentes. Celle-ci est sous-jacente à tout le long-métrage, tout en apparaissant plus nettement lors de certaines scènes (celles qui sont filmées dans des églises par exemple). On peut dire aussi que cette recherche trouve enfin sinon une réponse, en tout cas un point de lumière ou, si l’on préfère, une piste. Dans « Knight of Cups », le cinéaste racontait l’histoire d’une perle précieuse qui était perdue et qu’il fallait retrouver. Eh bien, c’est peut-être Patti Smith qui, au moyen d’une de ses chansons, indique, à la fin de « Song to Song », ce qu’est cette perle égarée. Elle a pour noms miséricorde et amour. Rooney Mara l’affirme, jusque là la miséricorde n’était pour elle rien de plus qu’un mot. Et voilà qu’elle découvre que c’est ce dont elle a le plus besoin. Quant à l’amour, Terrence Malick le filme comme personne : quand ses personnages échangent des gestes de tendresse, des caresses ou des étreintes, c’est comme s’ils étaient à chaque fois réinventés, c’est comme si on les voyait pour la première fois. Le cinéma de Terrence Malick est non seulement beau, mais il est porteur de questionnements et d’une recherche de sens qui nous intéresse tous ! Je ne m’en lasse pas.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170711 – Cinéma
LES HOMMES DU FEU
un film de Pierre Jolivet.
Tourné dans une véritable caserne de pompiers, à Bram, près de Carcassonne (Aude), ce film de Pierre Jolivet paraît si réaliste qu’on se demande, en le voyant, s’il ne s’agit pas d’un documentaire. Les visages bien connus de Roschdy Zem et d’Emilie Dequenne nous rappellent, certes, qu’on a affaire à des acteurs, mais ils sont si convaincants, si justes, si investis dans leurs rôles respectifs, qu’ils nous le font quasiment oublier. Le premier joue le rôle de Philippe, celui qui dirige la brigade des sapeurs-pompiers, la deuxième incarne Bénédicte, une adjudante-chef qui, ayant dû déménager, y a demandé son intégration.
Seule femme dans ce milieu non seulement masculin mais volontiers viril au point d’être machiste, elle cherche aussitôt à montrer qu’elle est dotée d’autant de capacités que ses confrères. Elle prend sa place, et même plus que nécessaire, et se trouve bientôt en première ligne lors d’une intervention sur un accident de la route. Or c’est précisément au cours de cette action, effectuée de nuit sous une pluie battante, qu’elle commet une faute, la première de sa carrière. Elle n’a pas vu un des blessés qui avait été éjecté du véhicule accidenté. L’homme a été retrouvé plus tard par la police et se trouve à l’hôpital, plongé dans le coma. Une des conséquences, c’est qu’il risque d’y avoir une enquête dont les résultats pourraient entraîner la fermeture d’une brigade déjà menacée du fait d’une politique de regroupement des effectifs.
Il ne s’agit que d’un des évènements auxquels nous confronte le film, mais il révèle à lui seul les caractères et les préjugés des uns et des autres. Le cinéaste a pris soin de ne pas mettre en scène des héros, mais des hommes comme les autres, aussi fragiles que tout un chacun. La plupart d’entre eux sont ébranlés par une vie de famille difficile ou une vie de couple compliquée. Et quand il s’agit de préserver ses intérêts, il en est qui sont capables de bassesses.
Pourtant ce sont ces hommes ordinaires, si l’on peut dire, qui sont appelés à se surpasser dès que l’alarme retentit : il faut désincarcérer un accidenté de la route, entrer dans un appartement où se trouve une femme pendue, éteindre un feu dans un quartier en révolte où l’on se fait caillasser, combattre un feu de broussaille d’origine criminelle, et même accoucher une femme sur la route avant d’arriver à l’hôpital.
En symbiose parfaite avec les combats de ces hommes et de cette femme confrontés au pire, le film captive irrésistiblement. Il met l’accent sur deux évènements, celui que j’ai relaté plus haut, l’autre étant la recherche menée par Philippe pour retrouver l’auteur d’un feu criminel, ce qui donne lieu à une des scènes les plus fortes et les plus tendues de l’oeuvre, plus intense, plus expressive et plus efficace que tous les discours moralisateurs du monde. Les « hommes du feu » ne sont rien de plus que des humains, en effet, au sens négatif du mot (les fragilités, les indignités) comme en son sens positif (la grandeur d’âme, l’engagement, la générosité). A la suite de Bertrand Tavernier, qui avait dépeint de façon exemplaire le quotidien de la brigade des stupéfiants de Paris dans « L 627 » (1992), Pierre Jolivet réussit magistralement son immersion dans celui d’une brigade de pompiers de l’Aude.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
201704708 – Cinéma
LE DERNIER VICE-ROI DES INDES
un film de Gurinder Chadha.
Après 300 ans de suprématie anglaise, l’heure est enfin venue pour l’Inde d’accéder à l’indépendance. Nous sommes en mars 1947 à Delhi à l’heure où le palais du vice-roi s’apprête à accueillir avec faste Lord Moundbatten et sa famille. Nommé dernier vice-roi des Indes, celui-ci est chargé de préparer cette transition et d’en négocier les conditions afin que, si possible, tout se déroule sans violence. Malheureusement, dans un pays aussi complexe que l’Inde, la tâche s’avère rapidement très ardue. Des conflits interreligieux ne tardent pas à éclater, des exactions sont commises ici et là, des émeutes se propagent. Il faut négocier âprement avec Nehru, Gandhi et Jinnah, le leader des musulmans. On le sait, malgré la volonté de Gandhi d’en sauvegarder l’unité, l’Inde ne se libèrera pas de la présence anglaise sans se diviser en créant un nouvel état, le Pakistan. Mais quelles dimensions lui donner ? Où le situer ? Sur quels territoires ? Comment en tracer les frontières ? Lord Moundbatten et ses conseillers ne sont pas au bout de leurs peines….
Cette grande fresque historique, la réalisatrice, s’appuyant sur le prodigieux savoir-faire des productions de la BBC, l’a parfaitement reconstituée, dirigée et filmée. Tout est rigoureusement agencé et l’on ne peut qu’être impressionné par les images projetées sur l’écran. Il y a néanmoins un gros risque à éviter quand on fait un film de ce genre : c’est celui de la reconstitution si précise qu’elle paraît empesée, affectée, sans âme. Or ce piège, la cinéaste le contourne assez habilement en accordant une part importante du scénario non seulement à Lord Moundbatten (très bien interprété par Hugh Bonneville, un acteur que tous ceux qui ont vu et apprécié la série télévisée « Downtown Abbey » auront un grand plaisir à retrouver), mais aussi à son épouse Edwina (Gillian Anserson), une femme dont le regard empli d’humanité et de compassion enrichit grandement le film et suscite l’empathie.
Et puis, dans cette grande histoire de tractations politiques qui entraînent les déplacements de millions de personnes d’un territoire à un autre, il y a l’histoire de deux individus, de deux des serviteurs du palais du vice-roi, un jeune homme hindou et une jeune femme musulmane : Jeet et Aalia. Ils s’aiment, mais ont-ils la possibilité de concrétiser leur amour par un mariage et une vie commune ? Le père de la jeune femme a beau avoir séjourné en prison au point d’en avoir perdu la vue mais aussi d’y avoir reçu les secours de Jeet, non seulement il ne lui vient pas à l’esprit que ce dernier puisse épouser sa fille, mais il a déjà élu un autre prétendant. L’histoire d’amour contrariée à laquelle nous confronte le film peut paraître très peu originale, elle n’en est pas moins touchante et apporte ce qu’il faut en termes d’émotion à ce qui risquerait, sans cela, de n’être qu’une intimidante et froide reconstitution de l’Histoire avec un grand H. Tel qu’il est, ce film, au contraire, paraît assez équilibré et suscite tout du long un constant intérêt.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170630 – Cinéma (Documentaire)
VISAGES VILLAGES
un film de Agnès Varda et JR.
Tout en restant fidèle à elle-même et avant tout à son insatiable curiosité, et malgré ses 88 printemps, Agnès Varda n’a pas fini de surprendre. Pour ce nouveau documentaire, elle a volontiers accepté de s’associer à un artiste beaucoup plus jeune qu’elle, JR, un photographe de 33 ans qui s’est fait une spécialité d’afficher ses œuvres géantes sur les façades les plus diverses (murs de maisons ou de granges, château d’eau, wagons, bunker, etc., etc.). Etonnante alliance (le film commence d’ailleurs par évoquer toutes les bonnes raisons qu’ils avaient de ne jamais se rencontrer), mais qui fonctionne à merveille et se révèle formidablement fructueuse. A bord du camion-photomaton de JR, les voilà donc tous deux, aussi facétieux que des enfants, sillonnant les routes de la campagne française et allant à la rencontre des uns et des autres. Car ce qui impressionne d’emblée, c’est la complicité malicieuse (et parfois taquine) qui ne tarde pas à lier la cinéaste et le photographe.
Tous deux sont manifestement habités par le même appétit de découverte et de rencontre. Ils ne sont jamais repus, n’ont jamais fini de s’enthousiasmer pour de nouveaux lieux et de nouvelles personnes. Il n’y a pas assez de villages pour les rassasier ni suffisamment de visages pour en faire des blasés. Partout Agnès Varda et son partenaire JR s’exaltent et partout ils n’ont de cesse d’aller plus loin ou plus profond que ce qui se voit du premier coup d’oeil. Les portraits géants qu’affiche JR ne s’affirment-ils pas comme une invitation à regarder autrement que de façon superficielle ? Aider à changer les regards, à ne pas se contenter des apparences : n’est-ce pas là un beau projet ?
Cette intention est perceptible tout au long du film : toutes les personnes qui apparaissent à l’écran semblent donner davantage que l’apparence, même quand elles se contentent de se faire photographier. La femme du début du film qui semble décidée à ne pas quitter sa maison menacée d’être détruite avec les autres maisons d’un des corons du Nord, les ouvriers d’une usine de fabrication d’acide chlorhydrique, les éleveurs de chèvres qui se refusent à couper les cornes des animaux comme font les autres, les visiteurs d’un jour d’un village fantôme, tant de personnes et tant de visages et pas un seul instant de banalité. Tout est provisoire certes, tout est éphémère et tout disparaît – une visite sur la tombe de Cartier-Bresson occasionne quelques propos sur la mort et la photo géante que JR appose sur un bunker est aussitôt emportée par la mer – mais tout recèle de secrètes beautés qui se transmettent et qui, de cette façon, perdurent.
C’est le regard qui compte, et ce film ne parle de rien d’autre. Non sans finesse d’ailleurs car, avec malice, les deux associés nous font bien comprendre que c’est avec le cœur plus qu’avec les yeux que l’on regarde bien. Pour ce qui est des yeux, Agnès Varda, qui est affectée par une maladie oculaire et qui voit de plus en plus trouble, semble très désavantagée. Quant à son complice JR, il n’y a pas moyen, apparemment, de lui faire quitter ni son chapeau ni ses lunettes noires (ce qui agace Agnès Varda qui se jure de les lui faire ôter, comme elle l’avait réussi avec Jean-Luc Godard il y a fort longtemps!). Quoi qu’il en soit, fort heureusement, tous deux n’ont pas seulement besoin de leurs yeux pour voir juste et bien. Ils ont l’acuité de ceux qui regardent avec le cœur et ils ont la générosité de ceux qui aiment les rencontres. Leur film est un régal.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170621 – Cinéma
AVA
un film de Léa Mysius.
Que peut-il se passer dans la tête et dans le cœur d’une adolescente de 13 ans le jour où un ophtalmologue lui fait savoir qu’elle est atteinte d’une maladie qui la menace de cécité ? Déjà son champ de vision s’est rétréci et, bientôt, elle ne pourra plus rien distinguer quand la lumière sera trop faible. A terme, elle risque de perdre totalement la vue. Tel est le diagnostic auquel doit se confronter Ava (Noée Abita, formidable révélation de ce film). Or, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, ce ne sont ni l’accablement ni la peur qui la submergent mais plutôt un grand élan de vivre, de découvrir, de profiter de ce qui lui reste de lumière sans trop songer au lendemain.
Ava n’est pas pour autant une écervelée : ses craintes, elle les apprivoise, d’une certaine façon, en peignant des cadres noirs qui semblent figurer le champ de sa vision qui s’amenuise. Elle les rend également dociles, suggère le film, en adoptant le grand chien noir qui, dès la première scène, fend la foule des estivants s’ébattant sur une plage pour venir se repaître de la portion de frites qu’elle avait posée sur son ventre. Un animal qu’elle ira jusqu’à kidnapper, faisant de lui le guide imprévisible qui l’accompagne et la conduit de l’enfance à une vie plus adulte.
Pour accomplir ce passage, il faut qu’Ava se risque à extérioriser ses sentiments, quitte à se montrer, par moments, maladroite. La richesse de sa vie intérieure est attestée par les notes rédigées sur les pages de son journal intime, mais il lui est nécessaire de mettre de la distance entre sa mère (Laure Calamy) et elle. Une mère intrusive, « libérée », étouffante, excessive, qui, cherchant à la « décoincer », risque de provoquer l’effet contraire.
Son épanouissement, Ava le trouve finalement davantage au contact de celui à qui appartient le chien noir qu’elle a essayé de dérober, Juan (Juan Cano), un gitan obligé de vivre à l’écart de sa propre communauté. L’adolescente se rapproche de plus en plus de lui, découvrant à cette occasion un autre rétrécissement de champ de vision, social et politique celui-là, se fondant sur les préjugés et les traitements humiliants réservés aux gitans et autres gens du voyage.
Avec habileté, tout en accompagnant les transformations physique et mentale d’Ava, la réalisatrice ne craint pas de passer d’un genre à un autre au fil du récit, partant d’une approche quasi naturaliste pour parvenir jusqu’à des scènes d’action dans le camp des gitans en passant par des séquences oniriques et ludiques, et même parfois surréalistes. Le lien entre ces genres se fait tout naturellement, grâce à la jeune actrice Noée Abita : sa performance est époustouflante. Malgré son sujet empreint de gravité, le film déborde d’énergie et de vitalité presque du début à la fin : qu’elle se baigne, soigne Juan qui s’est blessé, joue avec lui à détrousser des nudistes (!), se mette à danser ou s’introduise dans le camp des gitans, Ava, tout en se libérant de ses angoisses, se donne sans compter et insuffle partout son appétit de vivre, de réenchanter un monde qu’elle apprend à appréhender non plus grâce à la vue mais au moyen de ses autres sens.
Plein de superbes idées de mise en scène, ce premier film de Léa Mysius passionne et séduit irrésistiblement.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
N.B. : Il convient de préciser tout de même que quelques scènes du film sont susceptibles de heurter la sensibilité de certains spectateurs.
20170617 – Littérature
Ci-joint ma critique non pas d’un film mais d’un roman: « L’irrésistible ascension de Lat Evans » de A. B. Guthrie.
Au cinéma, rien de très passionnant ces derniers temps.
- « Ali, la chèvre et Ibrahim » de Sherif El Bendary: 6/10
- « Creepy » de Kiyoshi Kurosawa: 7/10
- « Ce qui nous lie » de Cédric Klapisch: 7/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION DE LAT EVANS
un roman de A. B. Guthrie.
Avec ce quatrième volume de la saga « The Big Sky » se confirme l’immense talent d’écrivain de A.B. Guthrie. J’ai déjà vanté les qualités d’écriture des trois premiers récits (« La Captive aux Yeux Clairs », « La Route de l’Ouest » et « Dans un si Beau Pays »), qualités réaffirmées et renouvelées dans ce roman. Avec Guthrie, les histoires de western se colorent d’une profondeur et d’une densité qui leur donnent des dimensions d’universalité. On aurait tort de les qualifier de mineures. L’auteur de cette saga est un romancier de premier ordre, cela ne fait pas l’ombre d’un doute.
Le style et le ton adoptés par Guthrie pour ce quatrième volume diffèrent sensiblement des trois premiers. Nous ne sommes plus en 1832 comme dans « La Captive aux Yeux Clairs », mais en 1880 et, dès la première page, c’est le désenchantement qui gagne. Déjà, dès cette époque-là, en Oregon, force est de constater le gâchis, ce qu’on appellerait aujourd’hui le désastre écologique, les terres abîmées, les rivières polluées, etc. Plus rien n’est comme avant et, s’il est encore permis de rêver, il faut le faire en quittant ce pays-là pour chercher asile ailleurs, sur une autre terre, là où peut-être l’on peut trouver de quoi être heureux.
C’est à quoi se résout Lat Evans, d’autant qu’il en a assez de supporter son père, son Pa comme il dit, un homme dont le moralisme étroit le rend à ses yeux à la fois aimable et haïssable, mais dont il ne peut plus supporter les colères. L’accablement de Ma ne suffit pas à le retenir, il faut chercher autre chose, et Lat Evans profite de la constitution d’un convoi de bétail pour partir et chercher fortune sous d’autres cieux. Un jour, se dit-il, il aura, lui aussi, ses troupeaux et ses terres et il sera riche. Avant cela, néanmoins, il faut passer par bien des épreuves, que Guthrie décrit avec un incroyable talent, nous faisant sentir presque physiquement les souffrances des hommes, leur solitude (car si l’on s’associe avec des partenaires, on ne noue jamais de véritables amitiés), la rude compagnie des Indiens et, surtout, les terribles rigueurs de l’hiver.
Aucun de ces périls ne peut arrêter Lat Evans qui, à force de conviction, d’habileté, voire de tricherie, réussit, là où il a trouvé racine, à conquérir le statut dont il rêvait. Cela dit, avec Guthrie, on ne saurait se contenter d’un simple récit de conquête sociale. D’abord, parce que, chez cet auteur, les rêves ne peuvent se limiter aux succès d’ordre matériel : au contraire, ils sont toujours habités de recherche mystique et de métaphysique (cf. le magnifique échange entre Lat et sa fiancée Joyce à la page 239). Est-ce parce que les protagonistes sont méthodistes ? Toujours est-il que la Bible imprègne ce roman (comme les trois précédents de la série) de sa marque. Une présence forte mais qui est à double tranchant, les protagonistes étant d’un côté habités de véritable faim spirituelle mais de l’autre tentés par un moralisme étriqué. On trouve cette ambivalence chez Lat qui reste marqué par l’étroitesse d’esprit de son père qui pourtant l’avait fait fuir !
Cela se retrouve également dans un autre grand point fort du roman, celui de la beauté, de la singularité et de la profondeur de ses personnages. Lat ne tarde pas à se trouver pris entre deux appels contradictoires : celui de Callie, une prostituée avec qui il a vécu les moments les plus heureux qui soient tant elle s’est mise à l’aimer jusqu’à ne pas hésiter une seconde à l’aider financièrement quand il était dans le besoin, et celui de Joyce Sheridan, la jeune fille de bonne famille qu’on lui a présentée en vue d’un mariage tout en lui recommandant fortement de cesser de fréquenter la première. Le personnage de la prostituée au grand cœur pourrait sembler quelque peu convenu mais ce n’est pas le cas. Guthrie n’a pas besoin de grands développements ni de lyrisme excessif pour nous faire sentir à qui l’on a affaire et nous faire comprendre les tiraillements de Lat, engoncé dans ses principes et son désir de respectabilité tout en sachant, au fond de lui, que personne ne l’aimera jamais autant que Callie. Quelques notations suffisent et l’on sait qu’aucune des expressions dédaigneuses dont on use pour la désigner ne peut entacher l’âme de la prostituée. Quoi qu’elle fasse, Lat lui-même ne peut l’évoquer qu’en parlant d’une fille « étrangement pure ». Et quand, à la fin du roman, il se confesse littéralement à Joyce, celle qui est devenue sa femme et qui lui a donné un enfant, quand il lui avoue sa relation avec Callie et quand il ajoute qu’il y a eu une rencontre entre eux après le mariage, il ajoute cette parole énigmatique, surprenante, paradoxale et néanmoins justifiable : « Parfois il faut pécher pour faire le bien » (p. 323).
9,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
N.B. : Ce superbe roman, précisons-le pour finir, a été adapté au cinéma en 1959 par Richard Fleischer sous le titre français de « Duel dans la boue ». Un film qui ne manque pas de qualités mais qui édulcore quelque peu le roman, si l’on en croit la postface de Bertrand Tavernier. Il est disponible dans la formidable collection « westerns » des éditions Calysta/Sidonis.
20170617 – Cinéma (Documentaire)
LE VÉNÉRABLE W.
un film de Barbet Schroeder.
Après avoir enquêté sur le général Idi Amin Dada en 1974, puis sur « l’avocat de la terreur » (alias Jacques Vergès) en 2007, le cinéaste Barbet Schroeder est allé achever une sorte de trilogie du mal en allant prospecter du côté de la Birmanie. Le portrait qu’il en a ramené, celui du vénérable moine bouddhiste Ashin Wirathu fait froid dans le dos. Sous son visage placide et ses allures débonnaires se révèle un effroyable manipulateur de masses prêchant une véritable croisade anti-musulmane.
Composée essentiellement de l’ethnie Rohingya, les musulmans ne représentent pourtant que 4% de la population du pays. Quel risque font-ils courir ? Quelle menace font-ils planer sur la Birmanie ? Ils ne paraissent guère dangereux et cependant sont persécutés depuis déjà bien des années, ce que montre Barbet Schroeder en insérant dans son documentaire un grand nombre d’images d’archives.
Les Rohingyas ont connu bien des déboires et ont subi bien des attaques, mais ils ne s’attendaient sans doute pas à être les victimes désignées d’un bourreau ayant revêtu la défroque des moines bouddhistes. On imagine volontiers ces derniers affables et pacifiques, on l’imagine d’autant plus que la religion qu’ils pratiquent semble inviter au détachement et à la conciliation. Mais, comme nous le dit la voix off de Bulle Ogier intervenant à plusieurs reprises dans le film, le mal peut s’insinuer partout, même sous cet habit-là.
Et le mal s’est glissé jusque dans l’âme du vénérable Wirathu et a tellement grandi que l’homme s’est investi de la mission de débarrasser son pays des musulmans. C’est un véritable nettoyage ethnique qu’il prêche non seulement à ses partisans mais à tous ceux qui viennent l’écouter lors de ses déplacements. L’islamophobie la plus primaire ne lui fait pas peur, il la diffuse et prend prétexte de tout pour fomenter des actes de violence.
Terrible vérité que celle que nous fait voir ce film, nous informant sur un projet génocidaire que peut-être nous ignorions, la presse de chez nous ne s’étant guère attardée sur ces évènements. Barbet Schroeder, lui, le fait avec précision et netteté et, ce faisant, nous met en garde contre nos propres peurs et nos propres préjugés. Même si, fort heureusement, elle ne provoque pas autant de violence, la propagande insidieuse et dévastatrice du moine Wirathu a aussi ses adeptes chez nous. Ce qu’indique d’ailleurs le réalisateur lorsqu’il met en parallèle la vérité des chiffres et celle du ressenti. Ainsi, en France, si les musulmans ne représentent que 7,5% de la population, le ressenti équivaut à 31%. Ne nous laissons donc impressionner ni par les discours mensongers ni par les propos affabulateurs : il n’y en a que trop, ils ne peuvent rien produire de bon !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170602 – Cinéma
L’AMANT D’UN JOUR
un film de Philippe Garrel.
« La philosophie n’est pas un divorce d’avec la vie ». C’est cette phrase, prononcée par Gilles (Eric Caravaca), son professeur de philosophie, qui, selon Ariane (Louise Chevillotte), a tout déclenché. Tout en la disant, Gilles avait posé son regard sur son élève et celle-ci avait aussitôt été saisie, sinon par l’amour, en tout cas par le désir.
Après « La Jalousie » (2013) et « L’Ombre des Femmes » (2015), Philippe Garrel persiste, fort heureusement, à faire des films de plus en plus fluides et de plus en plus limpides. Servies par une belle photo en noir et blanc, les histoires qu’il raconte, clairement inspirées par sa propre vie et ses propres expériences, touchent juste et vont droit à l’essentiel, bien plus que dans les films qu’il faisait auparavant.
Certes, même s’il est question d’un professeur de philosophie, il ne faut pas attendre de Philippe Garrel ce qu’avait si parfaitement réussi à réaliser la cinéaste Mia Hansen-Løve dans son film intitulé « L’Avenir » (2016), dans lequel elle parvenait à donner corps, en quelque sorte, à la matière susdite. Dans « L’Amant d’un Jour », Gilles pourrait exercer n’importe quel autre métier sans que le film s’en ressente beaucoup. Ce qui intéresse Philippe Garrel, ce sont les atermoiements des corps et des cœurs, plus que le cadre dans lequel ils se manifestent. Le cinéaste cherche inlassablement, de film en film, à sonder l’énigme de l’amour, de ses joies et de ses peines, à comprendre un peu plus pourquoi on s’accorde et pourquoi on ne s’accorde plus.
Pour ce faire, dans ce nouveau film, il met en présence Gilles, le professeur de philo, Ariane, son élève qui, à force de séduction, est devenue son amante, et sa fille Jeanne (Esther Garrel) qui, après avoir rompu avec son compagnon, est revenue vivre chez son père. Autrement dit, voici que cohabitent l’amante et la fille de Gilles qui ont, toutes deux, à peu près le même âge. Or, contrairement à ce qu’on pourrait supposer, toutes deux non seulement s’entendent mais il se noue entre elles, assez rapidement, une sorte de complicité.
Pourtant, toutes deux n’ont pas le même idéal. Ariane, comme un Don Juan au féminin, estime que, puisque les hommes se permettent toutes les infidélités qu’ils veulent tout en ne supportant pas que leurs compagnes fassent de même, elle aurait bien tort de se priver de quelque plaisir que ce soit. Jeanne au contraire, inconsolable après sa rupture, ne rêve que de renouer avec celui qu’elle a quitté et de vivre avec lui un amour profond et durable. Quant à Gilles, il se trouve pris entre l’une et l’autre, oscillant, un peu perdu et parfois absent. Chez Philippe Garrel, c’est toujours aux femmes que sont confiés les meilleurs rôles.
La subtile alchimie composée par le cinéaste prend et captive à nouveau (un peu moins, tout de même, que dans « L’Ombre des Femmes »). En filmant le singulier et l’intime, Philippe Garrel touche sans peine à l’universel puisqu’il interroge sur la seule question qui compte : qu’est-ce qu’aimer ?
7,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170528 – Info Théatre – Réplic’ Pus
Bonjour à tous!
Le succès rencontré par Réplic’ Pus, la troupe de théâtre de Réseau Picpus, ne se dément pas.
Cette année, les participants sont si nombreux que nous ne proposons pas moins de trois pièces.
Elles seront, toutes trois, jouées durant le mois de juin. En voici les dates:
- « L’Invitation au château » de Jean Anouilh les mercredi 7 et vendredi 9 juin à 20h au « Passage vers les Etoiles » 17 Cité Joly 75011 Paris.
- « Tailleur pour dames » de Georges Feydeau les 16 et 17 juin à 20h au théâtre « Les feux de la rampe » 34 rue Richer 75009 Paris.
Et enfin la pièce à laquelle j’ai davantage participé et dans laquelle je joue:
- « La Tempête » de William Shakespeare les 23 et 24 juin à 20h à l’espace Bernanos 4 rue du Havre 75009 Paris.
Pour cette dernière pièce, voici un lien qui permet d’acheter son billet en ligne:
https://www.billetweb.fr/la-tempete-shakespeare
Venez nombreux!
Bien amicalement.
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170519 – Cinéma
LES FANTÔMES D’ISMAËL
un film de Arnaud Desplechin.
Projeté en ouverture du festival de Cannes, ce nouveau film d’Arnaud Desplechin n’est curieusement exploité que dans une version courte (amputée d’une vingtaine de minutes) dans la plupart des salles françaises. La version longue n’étant proposée que dans de très rares cinémas, je n’ai donc vu moi-même que le film le plus court et je me demande si ce n’est pas là la cause de mon léger désappointement. Léger parce que le film m’a globalement séduit, mais désappointement quand même car, dans sa version courte en tout cas, il laisse une sensation d’inachèvement, comme si le réalisateur s’était encombré de trop de récits s’imbriquant les uns les autres sans qu’il sache lui-même comment les relier sinon de manière presque artificielle et trop abrupte. Je gage que, dans sa version longue, le film donne une autre impression, plus satisfaisante pour l’esprit du spectateur.
Reste néanmoins, même dans sa version brève, un film qui ne manque pas de qualités, Arnaud Desplechin étant un réalisateur qui a déjà largement démontré son talent, un talent atteignant des sommets de perfection dans le très émouvant « Trois souvenirs de ma jeunesse » (2014). Autant ce dernier film était marqué par l’influence de François Truffaut, autant c’est du côté d’Alfred Hitchcock et d’Ingmar Bergman qu’il faut chercher les sources d’inspiration des « Fantômes d’Ismaël ».
L’argument de ce film est assez simple, mais sa construction narrative ne l’est pas du tout. Les fantômes du titre, ce sont d’abord et avant tout ceux qui hantent les œuvres cinématographiques d’Arnaud Desplechin : des acteurs (à commencer par Mathieu Amalric) et des personnages qu’on identifie aussitôt à sa production. Il en est un, en particulier, appelé Dédalus, qu’on a déjà rencontré dans plusieurs de ses films et qu’on retrouve ici, joué cette fois par Louis Garrel. C’est lui, le premier des fantômes qui tourmentent l’esprit d’Ismaël (Mathieu Amalric), un fantôme dont on découvre vite qu’il est le personnage d’un film dans le film, mais un personnage qui semble échapper même à l’emprise de son propre créateur. Car s’il est un thème qui imprègne toute cette œuvre, c’est celui de l’identité mystérieuse des personnages, identité qui échappe aux définitions et à toutes les simplifications, qui se dérobe dès qu’on cherche à la cerner de quelque façon que ce soit.
Ismaël est donc un « fabricant de films », ainsi qu’il se définit lui-même, écrivant la nuit plutôt que le jour et vivant avec Sylvia (Charlotte Gainsbourg) tout en restant poursuivi par le deuxième fantôme du film, Carlotta (Marion Cotillard), la femme avec qui il a vécu vingt ans auparavant et qui l’a quitté soudainement sans plus donner signe de vie, au point qu’il l’a crue morte. Or voilà que Carlotta (un prénom que tous les cinéphiles associent aussitôt à « Sueurs froides » d’Alfred Hitchcock) réapparaît aussi soudainement qu’elle avait disparu. Ce qui, évidemment, ne manque pas de semer le trouble et dans l’esprit d’Ismaël et dans celui de sa nouvelle compagne Sylvia.
Ce qui passionne, ce qui fascine, dans ce film, c’est ce qui se devine et se dissimule aussitôt qu’on croit l’avoir compris. Tous les personnages, « fantômes » ou non, sont traversés de mystères : quand on a le sentiment de les cerner, ils s’échappent. A de nombreuses reprises, on les voit se refléter dans un miroir (une fois même dans un miroir ébréché) ou dans le reflet d’une vitre, comme pour indiquer qu’il n’y a d’autre connaissance d’autrui que très partielle et imparfaite. Pour reprendre les termes de Paul dans sa Première Lettre aux Corinthiens (1Co 13,12), « nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure ». Les regards portés sur autrui se heurtent à d’insondables mystères. Et lorsque, au début du film, Ismaël et le père de Carlotta se disputent à propos de cette dernière, c’est parce que l’un et l’autre n’ont jamais perçu qu’un reflet ou qu’une fraction de la jeune femme, tout en restant persuadé, chacun de son côté, d’être le seul à la connaître vraiment. Qui a raison ? Qui a tort ?
Malgré ses imperfections, en tout cas dans sa version courte, et malgré la complexité de ses mises en abyme, ce film n’en demeure pas moins une œuvre assez fascinante et qui gagnera, probablement, à être revue pour en percevoir encore davantage toutes les beautés.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170516 – Cinéma (Documentaire)
I AM NOT YOUR NEGRO
un film de Raoul Peck.
C’est sur la base d’un inédit de l’écrivain noir américain James Baldwin (1924-1987) que Raoul Peck, cinéaste haïtien, a réalisé ce très impressionnant documentaire. La sélection d’images d’archives, formidablement montée par celui-ci, donne au texte de l’écrivain, lu dans sa version originale en voix off par Samuel L. Jackson, une puissance d’interpellation qui ne devrait laisser personne indifférent. Que nous soyons américains ou non, ces mots et ces phrases, et les images choisies par le réalisateur, nous atteignent, nous qui sommes tous tentés par les facilités destructrices des stéréotypes et qui avons si vite fait d’user de mots ou de termes méprisants envers les minorités.
Dans son texte, James Baldwin se réfère à sa propre histoire, lui qui est né en 1924 dans le quartier de Harlem à New York et qui, dès l’âge de 24 ans, choqué par les actes de discrimination dont il fut le témoin ou la victime (double discrimination, d’ailleurs, puisque l’écrivain est noir et homosexuel), prend la décision de quitter son pays pour s’établir en France. Pourtant, en 1957, il estime que son devoir est de retourner chez lui, aux Etats-Unis, d’être aux côtés de ses frères en lutte, de s’impliquer dans le combat pour les droits civiques envers ceux qui en sont les exclus. James Baldwin se rapproche alors de trois des militants les plus célèbres pour la cause des Noirs aux Etats-Unis, Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King.
Tous trois, et en particulier les deux derniers, sont longuement évoqués dans le texte de Baldwin et donc également par le biais des images d’archives réunis par Raoul Peck. Mais le documentaire ne se cantonne pas à la simple commémoration de ces quelques figures iconiques, ni aux extraits de conférences et d’interviews données par l’écrivain, il a également l’ambition de montrer comment l’histoire du pays est inséparable de celle de sa minorité noire. L’histoire des Etats-Unis et celle des Noirs se confondent, explique Baldwin, et ce n’est pas une belle histoire. Il n’y a vraiment pas de quoi s’enorgueillir !
L’écrivain va encore plus loin, comparant le sort réservé aux Indiens d’Amérique, en grande partie massacrés ou entassés dans des réserves, à celui qui pèse sur la communauté noire, jamais vraiment intégrée dans le pays, même sous la présidence de Barack Obama. L’Amérique a toujours pris soin de privilégier les clichés lorsqu’il s’agit des Noirs, l’image diffusée étant délibérément caricaturale, afin de pouvoir mieux sinon les haïr en tout cas s’en méfier. Les Noirs eux-mêmes, évidemment, ne se sont jamais reconnus dans ces images de « Nègres » qu’ont leur mettait sous les yeux, y compris dans les spectacles, au cinéma ou à la télévision. Pour James Baldwin, l’Amérique ne sait comment se comporter envers les Noirs qu’elle a fait venir, contraints et forcés, pour travailler dans les champs de coton. Au fond, plus d’un, aujourd’hui, qu’il se l’avoue ou non, aimerait pouvoir se débarrasser d’eux (comme on s’est « débarrassé » des Indiens!).
Quant à nous, Européens, Français, ne nous contentons pas d’écouter le texte de Baldwin et de voir les images rassemblées par Raoul Peck à la manière de simples spectateurs qui n’ont rien à voir avec ça ! Ce n’est certes pas notre histoire que celle de l’Amérique, mais notre histoire est-elle plus glorieuse et plus belle que celle des USA ? Pas sûr ! Que faisons-nous de nos propres minorités ? Comment nous sommes-nous comportés envers elles ? Quel sort réservons-nous aux Roms ? Quels clichés nous plaisons-nous à diffuser au sujet des Musulmans ? Comme dit Jésus, ne nous complaisons pas à enlever la paille qui se trouve dans l’oeil de notre voisin d’Amérique alors qu’il se trouve peut-être une poutre dans notre œil de Français !
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170505 – Cinéma
DE TOUTES MES FORCES
un film de Chad Chenouga.
Au retour d’une virée dans la nature avec des amis de son âge, Nassim, un lycéen scolarisée en Première, trouve sa mère décédée. Dès la fin des obsèques, il est placé dans un foyer par l’Aide Sociale à l’Enfance. Le voilà plongé dans un milieu qu’il a du mal à accepter et où il ne se sent pas vraiment à sa place. Révolté et malheureux, il souffre d’un sentiment de culpabilité, sa mère, avant d’avaler la surdose de médicaments qui a entraîné sa mort, ayant essayé en vain de le joindre sur son téléphone portable. Mais il n’avait pas décroché, tant il était captivé par une activité de plein air.
Obligé dorénavant de vivre dans le foyer où il a été placé, il parvient cependant, au fil du temps, à créer des liens plus ou moins complexes avec les autres jeunes qui y résident. Il en vient même à s’associer en quelque sorte avec une des filles du groupe, lui la soutenant pour ses études de médecine, elle l’aidant en retour sur le plan des mathématiques. Dans le même temps, il souffre de crises de désespoir et n’hésite pas à fuguer, quand il le peut, pour rejoindre ses amis du lycée et, en particulier, une fille à qui il n’ose pas dire la vérité. Heureusement, il a aussi affaire à des éducateurs et à la directrice du foyer, Madame Cousin (Yolande Moreau), qui savent doser fermeté, sanctions, soutien et compréhension.
Impossible de ne pas comparer ce film avec d’autres œuvres cinématographiques qui abordent des sujets du même ordre : « La Tête haute » (2015) d’Emmanuelle Bercot ou la mini série télévisée « 3 x Manon » (2014) de Jean-Xavier de Lestrade par exemple. Force est de reconnaître que, pour ce qui concerne l’écriture du scénario ainsi que le jeu des acteurs, « De toutes mes forces » reste un cran au dessous des exemples que je viens de citer. On est même en droit d’estimer un brin caricatural le groupe des autres membres du foyer dans lequel se retrouve Nassim et assez peu crédibles quelques-unes des répliques qui leur sont accordées. Ces défauts sont néanmoins compensés par la force et par l’aura qui se dégagent de trois des personnages principaux du film : Nassim bien sûr, dont on perçoit parfaitement combien il est tiraillé entre sa culpabilité, la souffrance qu’elle engendre et le désir de s’en sortir pour atteindre à une vie meilleure ; l’amie qu’il aide à réviser ses cours et dont le rêve de devenir médecin malgré sa condition d’origine, au point qu’elle y passe tout son temps, ne peut qu’être bouleversant ; et Madame Cousin, la directrice, elle aussi partagée entre son devoir de fermeté, voire d’intransigeance, et ses désirs de proximité, de compréhension, voire d’indulgence, même avec une tête dure comme est celle de Nassim. « Si tu étais moins jeune et moins con, je t’épouserais ! », lui dit-elle lors d’une des scènes de la fin du film !
7,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170427 – Cinéma
APRÈS LA TEMPÊTE
un film de Hirokazu Kore-Eda.
Après une parenthèse mineure (« Notre petite soeur » – 2015), Hirokazu Kore-Eda renoue avec ce qu’il avait déjà parfaitement réussi dans des films précédents comme « Tel père tel fils » (2013), le portrait de famille et les relations complexes qui en unissent ou en désunissent les membres.
Se rêvant écrivain depuis qu’il a fait éditer un roman à succès, Ryôta, incapable de poursuivre sur cette voie, a dû se résoudre à exercer un autre emploi, en l’occurrence celui de détective privé. Le voilà donc contraint d’espionner les faits et gestes d’autrui, activité peu honorable dont il se satisfait tout en rêvant de gagner une cagnotte grâce à sa passion pour le jeu (la loterie ou le pari sur des courses cyclistes). Avec son visage mal rasé, il ressemble à un vagabond, à un homme errant en quête d’une vie meilleure. De temps à autre néanmoins, il renoue avec son fils de 11 ans Shingo, ce qui lui donne aussi l’occasion de revoir son ex-femme à qui il n’arrive pas à verser les sommes qu’il doit.
Mais il est un autre personnage important dans ce film : celui de la mère de Ryôta et, par conséquent, grand-mère de Shingo.Une femme qui n’a pas sa langue dans sa poche et dont chaque parole semble nourrie de bon sens jusqu’à, parfois, prendre le risque de paraître sentencieuse. Un beau personnage que cette femme dénuée de résignation et dans l’appartement de qui se déroule une bonne partie du film. Son mari venant de décéder, les enfants, Ryôta et sa sœur, se disputent déjà son héritage. Chacun cherche à s’approprier les objets les plus précieux du défunt ou ce qu’il en reste, ce dernier en ayant déjà déposé en grand nombre dans un établissement de prêt.
Toujours est-il que c’est dans l’appartement de la grand-mère que se retrouvent les principaux protagonistes du film pour une séquence qu’on peut considérer comme en étant le point d’orgue. Elle se déroule durant une nuit de tempête, tandis que se déchaînent les vents violents d’un typhon. C’est à cette occasion, dans l’appartement mais aussi dans le refuge où s’abritent Ryôta, son fils et son ex-femme, après être sortis malgré le mauvais temps, que se dévoilent les intentions cachées, les secrets les plus enfouis. Les cœurs, pendant un moment, sont comme mis à nu.
Malheureusement il est quelque chose qui détruit tout, qui fausse les relations et dévoie les personnages (sauf la grand-mère). Ce quelque chose, c’est l’argent, omniprésent tout au long du film au point qu’il pourrait en être le titre (comme il le fut pour le dernier film de Robert Bresson en 1983). L’Argent, qu’on peut écrire avec un grand A, on pourrait presque écrire Mammon comme dans la Bible : une divinité maléfique qui corrompt les esprits et les cœurs. Et le plus affligeant, c’est que même Shingo, le garçon de 11 ans, en est déjà une sorte d’adorateur, au point qu’il voit partout des billets de loterie potentiellement gagnants, même là où il n’y en a pas ! Semblable à son père, il rêve de l’opulence qui pourrait advenir un jour plutôt que de profiter du temps présent.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170424 – Cinéma (documentaire)
RETOUR À FORBACH
un film de Régis Sauder.
C’est à Forbach, commune de Moselle, située sur le bassin houiller de Lorraine, à deux pas de la frontière allemande, que Régis Sauder, le réalisateur de ce documentaire, a passé son enfance. Il y a 30 ans, dès qu’il a pu voler de ses propres ailes, il est parti ailleurs, loin d’un environnement dont il n’avait jamais pu s’accommoder. Pourtant, après tout ce temps et après avoir vainement tenté de tirer un trait sur son passé forbachois, le voilà qui revient, non seulement parce que le pavillon habité par ses parents vient d’être cambriolé mais, à la faveur du film qu’il a l’intention de réaliser, pour se confronter à la fois au passé et au présent de la ville.
A Forbach, comme dans beaucoup de communes de Moselle et d’Alsace, on évite, autant que faire se peut, de ressasser les pages les plus sombres de l’histoire. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, les drapeaux à croix gammée étaient omniprésents et la rue principale portait le nom d’Adolph Hitler-Strasse ! Sur le monument aux morts, aucun nom n’est indiqué pour ne pas faire de distinctions entre ceux qui furent enrôlés de force dans l’armée allemande et ceux qui se rebellèrent.
Mais ce qui a marqué la ville, ce fut, bien sûr, après la guerre, l’exploitation des mines de charbon. A l’époque, tout le monde avait du travail : ceux qui en avaient les capacités faisaient des études, les autres étaient mineurs de fond. Il y avait même tant d’emplois à fournir qu’on fit venir, par vagues successives, des Italiens, des Polonais, des Algériens, des Marocains… Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) s’occupaient de tout au point que beaucoup n’avaient pas même de permis de conduire. Pourquoi faire puisque les employeurs fournissaient des bus pour transporter les travailleurs ? Quant aux vacances, la plupart n’avaient pas de ressources suffisantes pour en prendre…
Mais ce paternalisme n’a eu qu’un temps. Les mines ont fermé les unes après les autres, laissant un sous-sol de galeries qui rendent instables les terrains et risquent d’endommager les maisons. Les emplois se sont faits de plus en plus rares, les magasins ont fermé les uns après les autres et l’espoir d’une vie meilleure n’y ressemble plus aujourd’hui qu’à une folle illusion. Forbach n’est plus qu’une commune sinistrée et ceux qui y vivent, parce qu’ils n’ont pas le choix, parce qu’ils n’ont pas la possibilité d’aller ailleurs, se considèrent comme abandonnés de tous, à commencer par les politiques. L’une des conséquences, c’est que, là comme ailleurs, quand ont lieu des élections, c’est le FN qui arrive en tête des scores (au premier tour de la Présidentielle de ce dimanche 23 avril, Marine Le Pen y récolte 29,65% des voix).
On a honte (ou plutôt « hante » car en Moselle les « on » se prononcent « an »), mais on est si déçus, si désespérés, si méfiants qu’on ne voit pas d’autre façon d’exprimer son mécontentement. Ce qui fait des ravages dans les esprits, c’est la peur. Le mot revient souvent dans ce documentaire : au lieu de vivre à peu près en bonne entente les uns avec les autres comme au temps de l’exploitation du charbon, on se laisse aller au soupçon, à l’amertume et à la peur de l’autre. Le FN non seulement en profite outrageusement mais alimente ces craintes : l’étranger, ou celui qui est perçu comme tel, n’est plus considéré que comme un voleur de travail ! Les drapeaux nationalistes qui sont exposés sous les fenêtres de bien des maisons en témoignent : chacun se replie sur ce qu’il estime être son identité et regarde les autres avec défiance. La peur a gagné les esprits et elle est la pire des conseillères.
Pour l’attester, Régis Sauder donne la parole à quelques-uns des habitants de la ville. Cela dit, le réalisateur s’est gardé de faire un tableau uniformément sombre du Forbach d’aujourd’hui. Heureusement, il y a glissé aussi quelques lueurs d’espoir et de bienveillance. A Forbach aussi, bien évidemment, on peut trouver des personnes hospitalières et généreuses : en témoigne, à la fin du film, une femme qui s’est engagée dans l’accueil d’une famille de migrants et qui nous explique que c’est précisément de cette façon-là, dans la rencontre et le soutien des autres qu’on évacue toutes les peurs. Puisse ce message être entendu !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170413 – Cinéma (documentaire)
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
un film de Otto Bell.
Dans les montagnes de l’Altaï, en Mongolie, se transmet la tradition séculaire de la chasse à l’aigle. De génération en génération, les pères apprennent à leur fils à capturer un aiglon encore au nid pour le dresser afin d’en faire un chasseur. C’est un art qui, comme je viens de l’indiquer, est strictement réservé aux hommes, les femmes étant occupées aux travaux du ménage et à la confection des repas.
Or voici qu’une adolescente de 13 ans du nom d’Aisholpan vient bousculer cet ancestral ordonnancement ! Elle aussi veut apprendre à chasser à l’aigle ! Et comme elle a la chance d’avoir pour père un homme compréhensif et ouvert d’esprit, elle ose, encouragée par lui, braver les interdits de sa communauté. Elle a l’audace des femmes qui s’émancipent. Guidée par un père qui fait également office de mentor, elle capture, elle aussi, au risque de s’y rompre le coup, un aiglon dans son aire, elle le dresse et se prépare à concourir à un festival.
Mais, si Aisholpan a la chance d’avoir un père qui la soutient et qui l’encourage, il n’en est pas de même du côté des anciens de la communauté. La bienveillance n’est pas leur fort. Pour eux, la chasse à l’aigle est, depuis toujours, une affaire d’hommes et ils ne voient pas d’un bon œil l’irruption d’une adolescente venant bouleverser la tradition.
On aime dire et répéter comme un lieu commun qu’il faut toujours se mettre à l’écoute des anciens, que ce sont eux qui détiennent la sagesse et que leur point de vue, par conséquent, est déterminant. Ce film prouve, s’il est besoin, que cela ne se vérifie pas à chaque fois : la prétendue sagesse des aînés équivaut, dans bien des cas, à l’immobilisme ou au conservatisme et l’on serait bien inspiré, dans beaucoup de circonstances, de se laisser chahuter par l’audace des jeunes gens plutôt que de ronronner avec les têtes chenues. En rédigeant ces lignes, il me vient à l’esprit le superbe film d’Eugène Green, « La Sapienza » (2014), qui, se déroulant dans un cadre très différent de celui de « La jeune fille et son aigle », tient néanmoins un propos similaire. On a autant, sinon plus, d’intérêt à écouter les jeunes gens que les anciens !
Quoi qu’il en soit, ce splendide documentaire non seulement nous fait découvrir des contrées belles et rudes peu montrées au cinéma mais nous propose un inoubliable portrait de jeune fille. On a donc affaire en outre, on peut le dire, à un film féministe au meilleur sens du terme : les hommes et leurs préjugés ne font pas le poids face à la détermination d’une telle adolescente et c’est tant mieux !
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170407 – Cinéma (documentaire)
L’OPÉRA
un film de Jean-Stéphane Bron.
Ce n’est pas parce que nous sommes encore en carême qu’il faut s’infliger la pénitence d’aller voir « A bras ouverts », le dernier navet en date de Philippe de Chauveron qui, fort du succès de « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » (autre navet farci de clichés grotesques), se croit autorisé à en prolonger la recette avec un film stupide et nauséabond sur la communauté des Roms ! Combien il est préférable, croyez-moi, de faire, en compagnie de la caméra de Jean-Stéphane Bron, la visite de cette institution prestigieuse qu’est l’Opéra de Paris, avec ses deux lieux que sont Garnier et Bastille ! Ceux qui, comme moi-même, sont des passionnés d’art lyrique, seront sans aucun doute séduits. Mais même ceux qui ne sont amateurs ni de Wagner ni de Verdi pourront y trouver de l’intérêt et, peut-être précisément, laisser surgir et grandir en eux une passion nouvelle et imprévisible pour un art ô combien attrayant !
Le documentaire réalisé par Jean-Stéphane Bron, qui s’est immergé pendant toute une saison dans cet univers qu’est l’Opéra de Paris, nous en révèle tous les aspects, avec plus ou moins d’insistance, mais sans rien ignorer de ce qui le fait vivre, depuis les hautes sphères dirigeantes jusqu’au personnel de l’ombre, jusqu’à celles et ceux dont le travail ne se remarque pas forcément mais qui n’en méritent pas moins de la gratitude. Cela dit, bien sûr, le réalisateur s’attarde beaucoup sur ceux qui détiennent les pouvoirs de décisions les plus importants : le directeur de l’Opéra de Paris Stéphane Lissner, le directeur musical Philippe Jordan ou le directeur de la danse Benjamin Millepied. Il est d’ailleurs passionnant de les voir et de les entendre discuter et débattre avec leurs collaborateurs et partenaires, surtout quand adviennent des difficultés, voire des crises, et qu’il faut prendre des décisions cruciales. Que faire quand survient une grève qui risque de paralyser toute l’institution ? Comment pallier la défection d’un chanteur, deux jours avant une représentation ? Diriger l’Opéra de Paris n’a certes rien d’une sinécure…
Mais ce qui rend ce film encore plus attrayant, c’est qu’il nous donne à voir quelques moments forts, choisis parmi beaucoup d’autres probablement, des préparatifs de plusieurs spectacles lyriques et de danse. Que d’efforts, que de recherches, que de trouvailles ! Pour la représentation de « Moïse et Aaron »d’Arnold Schönberg, ce n’est rien moins qu’un véritable et imposant taureau qui a dû être sélectionné et préparé pour figurer sur scène ! D’autres moments forts nous montrent les répétitions de « La Damnation de Faust » d’Hector Berlioz, puis des « Maîtres Chanteurs de Nuremberg » de Richard Wagner. On découvre ainsi, lors d’une représentation, qu’une chanteuse d’opéra ne peut se passer de son assistante toujours prête à lui tendre mouchoirs et bouteille d’eau dès qu’elle quitte la scène. Et que dire des spectacles de danse dont on découvre, ébahi, quelques instants volés ? Ainsi d’une danseuse qui, après avoir accompli sa prestation sur scène, s’écroule littéralement de fatigue et d’essoufflement dans les coulisses !
Hormis Stéphane Lissner, le directeur de l’Opéra de Paris, qui apparaît dans un grand nombre de scènes, celui qu’on voit le plus à l’écran, m’a-t-il semblé, est un jeune chanteur venu de Russie (du sud de l’Oural, précise-t-il) pour proposer sa candidature dans la capitale française après être passé par l’Allemagne. Impossible de ne pas être touché par ce jeune homme, par ses rêves, son ébahissement lorsqu’il apprend qu’il est admis à l’Opéra de Paris, mais aussi ses doutes quand il a le sentiment de n’avoir pas donné sa pleine mesure.
On ne peut qu’être ému, enfin, par une classe d’enfants qu’on voit, à plusieurs reprises, apprenant à jouer du violon ou du violoncelle et qu’une scène de la fin du film montre se produisant sur scène devant un public composé essentiellement de leurs parents.
Superbe film qui mériterait d’être plus long pour nous faire découvrir encore d’autres actrices et acteurs intervenant, d’une manière ou d’une autre, dans la réalisation des opéras ou des spectacles de danse. On ne s’en lasse pas.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170331 – Cinéma
PARIS LA BLANCHE
un film de Lidia Leber Terki.
Ne serait-ce que parce qu’elle a choisi de faire un film sur ceux qu’on ne voit que très rarement au cinéma, Lidia Leber Terki mérite d’être saluée. Et puisque, en outre, elle a conçu et réalisé un film en tout point délicat, sensible et touchant, elle mérite encore davantage que nous remarquions son travail et lui adressions notre gratitude. Ceux dont il est question ici et qui n’apparaissent que parcimonieusement dans les films, ce sont les immigrés venus du Maghreb pour travailler en France au cours des années 60 et 70 et qui donc aujourd’hui sont à l’âge de la retraite.
L’un d’eux, prénommé Nour, a passé 48 ans en France, dans une cité de la banlieue parisienne, il a travaillé dans le bâtiment, et, durant tout ce temps, il n’a cessé d’envoyer de l’argent à sa femme Rekia et à ses enfants restés en Kabylie. Et voilà que plus rien ne leur parvient, ni argent ni nouvelles, depuis plusieurs mois. Inquiète, mais sans rien révéler de ses intentions à ses enfants, Rekia décide de faire le voyage, de venir en France, à Paris, de retrouver son mari et de le ramener au pays.
C’est ce voyage que raconte le film, un voyage qui ressemble un peu à une errance car Rekia ne sait pas exactement où trouver Nour. Heureusement pour elle, lorsque, épuisée, elle s’effondre sur un trottoir, il se trouve des « bons samaritains » pour la secourir. Et, en particulier, Tara, une « bonne samaritaine » qui, émue par la détresse de cette femme, se donne sans compter pour la soutenir et l’aider dans sa recherche. Le lieu commun selon lequel on ne fait pas de bons films avec des bons sentiments se trouve parfois contredit et il l’est ici de la façon la plus remarquable. Car, manifestement, la réalisatrice croit en la force de la compassion et en celle de la solidarité, et ce qu’elle propose à notre regard est de toute beauté.
Grâce au secours indéfectible de Tara et de ses amis, il est donc possible que Rekia retrouve l’homme qu’elle aime, son mari qui ne lui donne plus de nouvelles. Mais pourquoi ce silence précisément ? Que s’est-il passé ? Les années et la lassitude ont-elles usé la tendresse de l’homme ? Acceptera-t-il de rentrer au pays avec Rekia ? De quelle identité peuvent se prévaloir les immigrés quand ils ont passé la majeure partie de leur vie en France ?
Sans faire de discours, habilement, en contant une histoire toute simple et néanmoins riche en émotions, le film nous invite à nous poser ces questions et d’autres encore. Gardons-les en mémoire quand nous verrons, ici ou là, l’un ou l’autre de ces travailleurs immigrés, trop souvent ignorés ou négligés.
7,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170328 – Cinéma
FIXEUR
un film de Adrian Sitaru.
En attendant de devenir à son tour un grand reporter, Radu (Tudor Istodor) doit se contenter d’un rôle de fixeur. Autrement dit, après avoir repéré un sujet intéressant dans son pays, la Roumanie, c’est lui qui fait le guide pour une équipe de journalistes étrangers (en l’occurrence français) et parlemente avec les personnes concernés afin de pouvoir obtenir des autorisations de filmer. Pour les deux reporters de la télévision française qu’il fait venir sur le terrain, il a trouvé un sujet qu’il juge de premier ordre. Il ne s’agit de rien de moins que de filmer l’interview d’une adolescente qui vient d’être rapatriée en Roumanie et placée dans une institution religieuse après avoir été enlevée et envoyée en France pour la contraindre à se prostituer.
Le film met peut-être un peu trop de temps à vraiment démarrer, mais, dès qu’il entre dans le vif du sujet, il le fait de façon remarquable. Car, bien évidemment, l’interview que Radu a promise n’est pas si simple à concrétiser. Il y a des obstacles, il y a des refus. Et il y a aussi l’entêtement de journalistes bien décidés à ne pas repartir bredouille. Chacun a ses raisons qu’il juge inattaquables. Pour la mère supérieure du couvent dans lequel a été placée l’adolescente, il est impensable de réaliser cette interview, même avec les meilleures intentions du monde. La jeune victime, juge-t-elle, a été bien trop ébranlée pour lui faire raconter à nouveau ses traumatismes. Les journalistes ont beau expliquer qu’ils n’ont pour objectif que d’alerter l’opinion publique sur ce scandale des mineures que des gens sans scrupules obligent à se prostituer, rien n’y fait. On ne fera pas céder la religieuse.
Mais nous sommes en Roumanie, dans un pays où ce qu’on n’a pu obtenir par un moyen peut éventuellement l’être par un autre. Et la confrontation avec l’adolescente a lieu : c’est la séquence la plus forte, mais aussi la plus dérangeante du film, car on découvre le visage d’une jeune fille de quatorze ans ! Pour Radu, en particulier, la gêne devient visible. Lui qui avait fait aux journalistes français la promesse d’obtenir cette interview, maintenant que le voici devant une quasi enfant, comment se comporte-t-il ? Jusqu’où est-il prêt à aller pour faire céder l’adolescente, pour la faire parler devant un micro et une caméra ? N’y a-t-il pas, dans cette insistance et dans cette intrusion, quelque chose de moralement douteux ?
Servi par une mise en scène d’une grande efficacité, ce film nous confronte à de redoutables questions, sans donner de réponses toutes faites. Quelles limites doit-on s’imposer quand on est journaliste d’investigation ? Quelle éthique respecter, surtout quand on s’adresse à des personnes mineures ? La question n’est d’ailleurs pas posée uniquement aux journalistes, mais aussi aux parents ou aux éducateurs. Certaines scénes de « Fixeur » montrent Radu non plus en tant qu’apprenti reporter mais en tant que beau-père d’un garçon qu’il incite, quand il l’accompagne à la piscine, au dépassement de soi mais jusqu’à l’excès ! Jusqu’à trop exiger !
7,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170324 – Cinéma
SAGE FEMME
un film de Martin Provost.
Les deux Catherine (Frot et Deneuve) pouvaient-elles rêver mieux que ce film pour leur première réunion à l’écran ? Le réalisateur, en tout cas, l’affirme, c’est pour ces deux actrices (ainsi que pour Olivier Gourmet) qu’il en a écrit le scénario. Le résultat est là, maintenant, dans nos salles obscures, et il est formidable. On se délecte de les voir dans leurs scènes communes et de les entendre se donner la réplique et, qui plus est, dans un film aussi beau et émouvant que celui-ci.
L’histoire imaginée par Martin Provost s’imprègne tout entière de grands élans contradictoires (offense et pardon, égoïsme et générosité, frivolité et don de soi) sans jamais faire la leçon cependant. Au contraire, tout y est incarné, à la fois marqué de vraisemblance et se dotant des accents d’une fable.
La « sage (-) femme » du titre, avec ou sans le tiret, c’est Claire (Catherine Frot), une femme d’une quarantaine d’années, mère d’un fils, Simon (Quentin Dolmaire), et travaillant dans une petite maternité qui doit bientôt fermer ses portes au profit d’une plus grosse structure (au passage, le film milite, à sa façon, pour le maintien des petites unités de proximité à taille et à visage humains plutôt que pour les grands ensembles hospitaliers ne fonctionnant qu’en termes d’efficacité et de rentabilité). Claire, tout en étant attachée à des principes et à des valeurs, apparaît rapidement comme une femme d’une extrême générosité, se donnant sans compter pour les autres, que ce soit dans son milieu professionnel ou ailleurs.
Or sa grandeur d’âme se trouve mise à l’épreuve lorsque réapparaît dans sa vie une femme perdue de vue depuis longtemps, Béatrice (Catherine Deneuve), celle qui, après avoir été la maîtresse de son père, l’avait quitté, ce qui avait causé le désespoir et le suicide de ce dernier. A Paul (Olivier Gourmet), un voisin de son carré de jardin avec qui Claire ne tarde pas à nouer une relation plus qu’amicale, elle pose la question : « Que ferais-tu si quelqu’un ressurgissait dans ta vie ? Quelqu’un qui t’a fait beaucoup de mal ? » – « Je changerais de trottoir ! », répond ce dernier.
Mais ce n’est pas ce que fait Claire : non seulement elle ne change pas de trottoir, mais elle provoque la rencontre avec Béatrice et sans intention de vengeance. La femme que redécouvre Claire est son exacte opposée, une femme frivole qui gagne sa vie en jouant à des jeux louches dans des salles clandestines. Pourtant il se noue entre elles quelque chose d’inattendu, comme si chacune, sans le vouloir, apportait à l’autre une part manquante de ce qui contribue à l’épanouissement de la vie. D’une certaine façon, Béatrice trouve en Claire une fille et celle-ci une mère de substitution. Bien sûr, tout n’est pas aussi simple que cela, les relations humaines demeurent complexes, d’autant plus que Béatrice est fragilisée par un cancer.
Le réalisateur s’est bien gardé de trop simplifier ses personnages. Béatrice a beau être une femme légère et plutôt égoïste, elle n’en est pas moins capable de générosité. Quant à Claire, elle s’engage dans un tel dévouement au service de celle qu’en toute logique elle devrait haïr qu’elle en devient quelque peu énigmatique. On peut affirmer, me semble-t-il, qu’elle fait découvrir à Béatrice ce que c’est que d’aimer son prochain. Et l’on peut dire de ce film, je crois, qu’il est une célébration de la découverte de l’autre, du service d’autrui et du bonheur d’être ensemble. Les deux ou trois séquences au cours desquelles les protagonistes écoutent (et, parfois aussi, chantent) des chansons du cher et regretté Serge Reggiani en sont peut-être l’apogée.
Mais d’autres grands moments du film sont ceux qui exaltent le don de la vie. Les scènes d’accouchement qui l’émaillent m’ont semblé particulièrement belles et émouvantes, d’autant plus qu’elles ont été tournées sans trucages. Et Catherine Frot y apparaît particulièrement superbe : dans son rôle de sage-femme, elle est bien celle qui aide et accompagne afin qu’advienne le cadeau de la vie. Que peut-on montrer de plus beau que cela ?
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170318 – Cinéma
L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR
un film de Aki Kaurismäki.
Le finlandais Aki Kaurismäki fait partie de ces cinéastes dont on reconnaît tout de suite les films. Il suffit d’en voir une scène pour savoir à qui on a affaire. Il y a un style Kaurismäki comme il y a aussi des sujets et des personnages qui semblent passer d’une œuvre à une autre et se répondre, même quand les acteurs changent. C’est encore le cas avec ce nouveau film qui reprend la thématique déjà abordé en 2011 dans « Le Havre ». Le décor et les acteurs changent, on passe de la ville normande à la capitale de la Finlande, Helsinki, mais pour y retrouver une problématique semblable. Dans les deux cas, on a affaire à un migrant cherchant refuge sur une terre nouvelle : dans « Le Havre » c’était un Gabonais, cette fois c’est un Syrien prénommé Khaled.
En Finlande comme ailleurs, on peut trouver de sombres racistes prêts à en découdre avec les clandestins. Mais en Finlande comme ailleurs, on peut aussi trouver des gens qui, même s’ils n’ont pas grand chose, sont capables de donner sa chance à plus misérable qu’eux. Dans les fables de l’humaniste Kaurismäki, les humbles se reconnaissent et s’entraident.
C’est le cas, à nouveau, puisque le chemin de Khaled croise celui d’un certain Wikström, un homme ayant quitté sa femme et vendu tout ce qu’il avait pour le miser au jeu. Par chance, il gagne et rachète un piteux restaurant. Et c’est lui qui tend la main à Khaled, lui et ses employés, car chez Kaurismäki, la solidarité et le partage l’emportent sur tout le reste.
On n’a pas affaire néanmoins à un film déconnecté du monde réel. La violence des racistes, que j’ai déjà indiquée, fait son œuvre, tout comme les autorités du pays qui ne voient pas d’un bon œil ce Syrien qui débarque chez eux. Mais c’est la générosité des humbles qui l’emporte et, chez Kaurismäki, elle se décline avec de bonnes doses d’humour et de chansons. Ce qui rend le film à la fois touchant et agréable.
8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170316 – Cinéma
THE LOST CITY OF Z
un film de James Gray.
Ce film, de loin le plus ambitieux de son auteur, avait beau être en projet depuis longtemps déjà, on n’en est pas moins surpris de le voir enfin sur les écrans (il a fallu une longue obstination au cinéaste pour le mener à bien) et de le voir tel qu’il est, c’est-à-dire échappant totalement au cadre qui était celui de tous les films précédents de James Gray. Comme on a affaire à un cinéaste new-yorkais jusqu’au bout des ongles, on était en droit de mettre en doute sa capacité à filmer autre chose que cet environnement-là, environnement qui lui a inspiré une série de films remarquables (jusqu’à ce chef d’oeuvre qu’est « The Immigrant », sorti en 2013).
A présent qu’est projeté sur nos écrans « The lost city of Z » qui n’a plus rien à voir avec New-York, force est de constater que les doutes qu’on pouvait avoir sont balayés. Et de quelle façon ! Car, sous ses allures de film d’aventures classique, se révèle une œuvre subtile et ambitieuse parfaitement réussie et qui recèle de multiples niveaux d’interprétation. En vérité, comme James Gray l’explique lui-même dans une interview, il n’a pas voulu faire un film d’aventures « mais un film d’aventuriers ». Ce n’est donc pas tant l’aventure en tant que telle qui intéresse le réalisateur, mais les hommes qui la suscitent et qui s’y trouvent mêlés. Pour dire les choses clairement, il ne faut pas s’attendre à voir sur l’écran un sosie d’Indiana Jones !
Le personnage qui est au cœur du film de James Gray est un officier de l’armée britannique et il se nomme Percy Fawcett (Charlie Hunnam). Le film commence en 1906, à l’heure où l’on apprend qu’une guerre risque d’éclater entre la Bolivie et le Brésil pour des questions de frontières. Percy Fawcett est désigné pour explorer une région inconnue de la forêt amazonienne afin de la cartographier. S’il accepte cette mission à risques, bien qu’il soit marié et père de famille, ce n’est pas uniquement parce qu’un militaire doit se soumettre à un ordre, mais c’est parce que la réussite de cette expédition lui vaudrait de retrouver l’estime de ses pairs, perdue ou entachée à cause d’une faute paternelle. Dans la bonne société anglaise de cette époque-là, où tout est corseté et codifié, la faute d’un père rejaillit sur ses enfants.
Dès lors, le film se partage en allers et retours entre l’Angleterre et les trois expéditions menées par Percy Fawcett dans la jungle amazonienne, sans oublier néanmoins la séquence tragique de la Grande Guerre (durant laquelle l’officier est envoyé au combat dans la Somme). Or, très rapidement, ce n’est plus son propre retour en grâce au sein de la bonne société anglaise qui obsède l’explorateur, mais la recherche d’une cité qui serait cachée au cœur de l’immense forêt et qu’il désigne par la lettre Z. L’homme qui revient de sa première exploration en Amazonie n’est plus tout à fait le même. Son aventure n’a pas été que physique, mais aussi intérieure : elle a ébranlé ses convictions, lui a fait découvrir d’autres peuples et d’autres cultures qu’on s’empressait trop rapidement et trop superficiellement à qualifier de sauvages. Le regard de Fawcett se transforme et son obsession ne se limite pas à la recherche d’une cité perdue au cœur de l’immense forêt, elle se traduit aussi par son obstination à vouloir changer les à priori de ses coreligionnaires.
Je passe rapidement sur les qualités purement formelles du film, du point de vue de l’image et de celui du son (cf. les superbes séquences montées avec des extraits de « Daphnis et Chloé » de Maurice Ravel) : elles sont sans reproche. Ce qui m’intéresse davantage, ce sont les différents niveaux d’interprétation qu’offre le film. Bien sûr, aucun de ces niveaux n’est imposé par le réalisateur, mais il serait dommage de les ignorer pour ne voir dans cette œuvre qu’un simple film d’aventures qui, du coup, pourrait sembler presque banal.
Je voudrais seulement distinguer deux des niveaux d’interprétation du film (qui, si nous les intégrons et les méditons, en font une œuvre passionnante et géniale). Le premier est politique et je l’ai déjà indiqué en parlant de changement de regard. Le film évoque une longue période de l’histoire, une période de conquêtes et de colonisation, qui s’est soldée par des injustices, des blessures, voire des massacres sans nombre. Combien d’hommes sont partis d’Europe à la découverte de terres et de peuples nouveaux en ayant la certitude de porter la civilisation là où, selon eux, il n’y avait que sauvagerie ? Comme si les « sauvages » n’étaient pas, eux aussi, transmetteurs d’une civilisation, différente certes, mais tout aussi valable que celle des Européens ! C’est cette funeste arrogance des hommes blancs convaincus de devoir civiliser les autres « races » que fustige, à juste titre, ce film. Il le fait de façon subtile mais claire. Percy Fawcett, tout en restant marqué par les préjugés de son pays et de sa classe sociale (il oppose, par exemple, un refus sans appel à sa femme qui souhaiterait l’accompagner lors d’une de ses expéditions), se laisse petit à petit transformer par ses rencontres avec les Indiens d’Amazonie et ose exposer ce changement de regard à ses compatriotes anglais, quitte à susciter l’incompréhension, voire le rejet, de la plupart d’entre eux. Une séquence du milieu du film indique on ne peut plus clairement que non, décidément, les Européens n’ont pas de leçons à donner aux Indiens : la prétendue sauvagerie de ces derniers a-t-elle jamais atteint le niveau de violence et de barbarie des hommes engagés dans la guerre de 1914-1918 ? Je pense que chacun mesurera aussi combien ce sujet garde sa pertinence, cent ans après les faits rapportés dans le film, à l’heure où, un peu partout dans le monde, à l’instar de l’élection de Donald Trump, on assiste à la montée en puissance de ceux qu’on appelle populistes et qui brandissent comme un étendard le rejet de ceux qui sont différents.
Mais je veux terminer ma critique en indiquant un autre niveau d’interprétation de « The lost city of Z », qui ne s’oppose d’ailleurs nullement au premier mais le complète. C’est le niveau qu’on peut désigner, sans vouloir employer de grand mot, du nom de « mystique ». Un poète comme Charles Péguy nous a appris que politique et mystique peuvent aller de concert. Dans le film de James Gray, ce niveau « mystique » est signifié par son titre lui-même et se voit confirmé, dès le début du premier voyage en Amazonie de Fawcett, par la lecture d’un poème de Kipling que lui avait confié son épouse. Qu’est-ce que la cité perdue que recherche obstinément l’explorateur ? Telle est la question qui traverse le film en son entier. Certes, il peut s’agir d’une cité réelle, au sens où on peut la situer sur une carte et en retrouver, éventuellement, les ruines. Il est à remarquer cependant qu’au cours du film, chaque fois que Fawcett semble en trouver une trace, celle-ci se dérobe aussitôt à son regard, cachée par exemple par le rideau d’une cascade. Vient alors à l’esprit une autre interprétation, qui n’est nullement incongrue. La cité perdue ne désigne pas seulement un lieu précis, situé dans la forêt, mais une profondeur du cœur humain. En vérité, Fawcett voyage autant à l’intérieur de lui-même, au plus profond de son être, qu’à l’extérieur. La cité perdue, ce pourrait être aussi bien, un jaillissement de pardon, de paix, d’amour, qui vient du secret du cœur et qui fait se tourner l’un vers l’autre un père et un fils enfin réunis et qui peuvent se dire les mots les plus simples du monde « Je t’aime, mon fils », « Je t’aime, papa ». Comment mieux conclure, comment mieux signer un film qui, décidément, se révèle extraordinairement fécond pour la sensibilité, pour l’esprit et pour le cœur des spectateurs ?
10/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
20170313 – Cinéma
LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE
un film de Kiyoshi Kurosawa.
Les histoires de fantômes, au cinéma, sont assez souvent décevantes, soit parce que, par souci de véracité, elles manquent de mystère, soit, au contraire, parce qu’elles en regorgent au point de paraître grotesques. D’une manière générale, ce genre sied davantage aux britanniques qu’aux français (réputés trop cartésiens comme chacun le sait) ! Il s’agit pourtant ici d’un film français, mais réalisé par un japonais qui, pour la première fois de sa carrière, est venu planter sa caméra chez nous.
Kiyoshi Kurosawa a déjà prouvé maintes fois qu’il excelle dans le genre du film fantastique. Il sait parfaitement doser ses films en y mettant juste ce qu’il faut d’étrangeté, ni trop ni trop peu. Pour « Le secret de la chambre noire », il a choisi un cadre qui nous est des plus familiers, celui d’une cité de la banlieue parisienne, mais c’est pour le détourner aussitôt en y dénichant une vieille maison bourgeoise qu’on ne s’attend peut-être pas à trouver là. L’homme qui s’y présente se prénomme Jean (Tahar Rahim) et il est à la recherche d’un emploi. Stéphane (Olivier Gourmet), le maître de la maison, l’engage. C’est un photographe, mais dont les recherches et les idéaux échappent totalement à la banalité. Ce que découvre Jean, dans le cabinet de curiosités de l’artiste, c’est un appareil rescapé d’un autre siècle, l’ancêtre de l’appareil photographique, une machine à faire des daguerréotypes.
Les portraits qu’on capture par ce moyen paraissent précisément fantomatiques, évanescents, comme s’ils avaient capturé non seulement l’image corporelle mais l’âme du modèle. Pour les obtenir, il n’y a pas d’autre moyen que rester totalement immobile face à l’objectif pendant de longues minutes, ce qui exige d’être fixé à une armature évoquant un chevalet de torture. Or c’est Marie (Constance Rousseau), la propre fille du photographe, qui doit se plier à cette terrible exigence. L’épreuve est telle qu’elle en ressort parfois comme morte.
La maison tout entière donne d’ailleurs une impression d’irréalité, impression d’autant plus forte que la demeure est habitée non seulement par le souvenir mais par la présence errante de l’épouse défunte de Stéphane. Quelle est la limite entre la réalité et l’illusion ? Qu’est-ce qui est réel ? Ce sont les questions qui viennent aux lèvres de Marie dans une de ses discussions avec Jean ?
Dommage que le réalisateur ait cru bon de rajouter au film une histoire de tractation immobilière qui ne lui apporte pas grand chose. Le meilleur de ce long-métrage, c’est Constance Rousseau qui le donne : elle est dotée d’une beauté et d’une apparente fragilité qui conviennent à merveille à son personnage et elle donne une âme à cette histoire, oui, bien plus qu’en étant un simple modèle de daguerréotypes.
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20170309 – Cinéma
LA CONFESSION
un film de Nicolas Boukhrief.
Si Béatrix Beck (1914-2008) était encore de ce monde, il n’est pas sûr du tout qu’elle applaudirait à cette nouvelle adaptation de « Léon Morin, prêtre », son roman (d’inspiration autobiographique) paru en 1952, pas plus qu’elle n’avait donné son entier satisfecit au film qu’en avait tiré Jean-Pierre Melville dès 1961. Elle s’estimait trahie tout en appréciant le jeu de Jean-Paul Belmondo. Mais la déception étant le lot commun de quasiment tous les romanciers lorsqu’ils découvrent le sort réservé à leur œuvre sur grand écran, on est tout à fait en droit, en tant que spectateurs, d’avoir un avis différent.
Hormis une ou deux faiblesses scénaristiques assez peu importantes, il me semble, quoi qu’il en soit, que cette nouvelle adaptation ne démérite pas par rapport à la première. Romain Duris, tout en se gardant bien évidemment de prendre pour modèle son illustre prédécesseur, n’en réussit pas moins à incarner de manière très convaincante le rôle du prêtre. Quant à Marine Vacth, dans celui de Barny, elle déploie avec finesse une nouvelle facette de son talent d’actrice, bien différente de celles dont elle a fait preuve avec François Ozon ou Jean-Paul Rappeneau.
Pour ceux qui n’ont connaissance ni du roman de Béatrix Beck ni du film de Jean-Pierre Melville, rappelons le cadre de ce récit. Cela se déroule pendant l’Occupation dans une petite ville française à l’heure où arrive le nouveau prêtre chargé du service de cette paroisse. Aussitôt, dans la bourgade, c’est l’effervescence : Léon Morin ne passe pas inaperçu, il est jeune et ne manque ni d’agrément ni de charisme. Tant et si bien qu’on ne parle que de lui. Il en est de même à la Poste où toutes les employées n’ont que son nom à la bouche, ce qui agace considérablement Barny, une communiste affirmant volontiers son athéisme et qui élève seule sa fille, son mari ayant été retenu prisonnier en Allemagne. Elle s’irrite tellement de n’entendre parler que du prêtre qu’elle se résoud à se rendre à l’église et à lui parler au confessionnal, non pour lui avouer ses fautes bien sûr mais, au contraire, pour lui faire savoir qu’elle s’oppose à ses convictions. Or la réaction de Léon Morin ne s’accorde nullement avec les préjugés qu’elle pouvait avoir : non seulement le prêtre ne se formalise pas, mais il l’invite à lui rendre visite au presbytère afin de lui remettre un livre (ce sera « Les quatre Evangiles ») et d’aller plus avant dans leur dialogue. Commence alors une série d’entrevues et d’échanges qui bouleverseront le cœur et l’esprit de la jeune femme et, sans doute aussi, ceux du prêtre lui-même.
Il faut souligner la qualité d’écriture des dialogues de ce film. Je ne sais dans quelle mesure ils ont été puisés dans le livre de Béatrix Beck, mais ils sont remarquables de profondeur et de justesse. Ils ont le son et le ton du véridique, pourrait-on dire, tout en paraissant étonnamment modernes si l’on tient compte de l’époque durant laquelle ils sont censés avoir été prononcés. Les propos tenus par Léon Morin, certains d’entre eux en tout cas, pourraient, aujourd’hui encore, paraître audacieux pour quelques oreilles.
Ce prêtre manque-t-il de sagesse ou de prudence en osant une proximité trop grande avec une jeune femme qui certes se montre rapidement avide d’éclaircissements quant à la foi chrétienne (elle qui, au départ, réclamait des preuves!), mais en qui grandit aussi une fascination qui n’est pas que spirituelle ? Chacun en pensera ce qu’il voudra ! Ce qui est sûr, c’est que cette rencontre, qui, d’une certaine façon, se doit de finir assez brutalement, aura mis en lumière deux amours : l’un qui ne peut aboutir, mais l’autre qui surpasse et englobe tout le vivant. Une scène du milieu du film l’indique fortement et en donne le sens (dans un moment tragique, devant plusieurs cercueils de fusillés) : on y voit Léon Morin lire des passages de l’hymne à la Charité de la Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (1Co 13, 1-13). Il n’est pas sûr du tout que Barny ait réellement trouvé la foi au contact de Léon Morin, mais à coup sûr, elle a trouvé l’amour. Sauf que ce n’est pas l’amour qu’elle avait souhaité. Léon Morin, lui, l’avait deviné ou pressenti : « cette jeune femme, avait-il affirmé, est plus proche de Dieu que la plupart de mes autres paroissiens ! ». Gageons qu’il avait vu juste !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20170225 – Cinéma
NOCES
un film de Stephan Streker.
Dès la première scène de ce film, le ton est donné et l’on sait aussitôt que l’on est en présence d’une actrice d’exception (dont c’est pourtant le premier grand rôle au cinéma). Nous sommes en Belgique et la jeune fille que l’on voit à l’écran se prénomme Zahira (Lina El Arabi). Sa famille est d’origine pakistanaise. Tout ce que l’on apprend sur elle, dans cette première scène, c’est qu’elle est enceinte et qu’il est question d’un éventuel avortement. La gynécologue avec qui elle s’entretient (et qui n’est jamais filmée) l’oriente manifestement vers ce choix en essayant de le banaliser. Mais l’on découvre aussi, à cette occasion, qu’on a affaire à une jeune fille volontaire qui ne s’en laisse pas conter si facilement. « Est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu la situation qui est la mienne ? », demande-t-elle avec insistance à son interlocutrice.
Il faut en effet que Zahira fasse preuve de beaucoup de détermination, étant donné le poids des coutumes et des traditions auxquelles les membres de sa famille restent très attachés. Il y a son père, sa mère, son frère et ses deux sœurs (dont l’une, l’aînée, a déjà été mariée à quelqu’un qu’elle n’a pas choisi). Pour ses parents, non seulement Zahira doit avorter, mais elle doit se plier sans tarder au rite du mariage traditionnel. On veut bien lui laisser le choix entre trois garçons, tous trois habitant au Pakistan, et avec qui elle ne peut s’entretenir que par le biais de Skype sur son écran d’ordinateur. L’un d’eux parle français et lui semble un peu plus cordial que les deux autres, mais de là à se marier avec lui ! Zahira se trouve comme écartelée entre ses désirs d’indépendance et son attachement réel et profond à sa famille. Son frère fait office de confident, mais pour lui non plus ce n’est pas facile. Peut-il prendre totalement le parti de sa sœur, alors qu’il est témoin des souffrances et des déchirements des parents ? Car, pour eux, il est inconcevable de déroger ausx traditions ; le faire, ce serait se couper de toute relation au Pakistan, être montré du doigt et ne plus pouvoir y mettre les pieds.
Il n’y a manifestement aucune caricature dans ce film. Personne n’est mauvais, personne ne veut le malheur de l’autre. Les parents de Zahira sont persuadés d’agir pour son bien. Pour eux, il n’existe d’autre façon d’agir que celle qu’ils ont toujours pratiquée. Quant à la jeune fille, tout en se révoltant contre l’idée même d’un mariage arrangé, elle ne souhaite d’aucune manière nuire à sa famille. Avec grand talent et beaucoup de subtilité, le réalisateur met en scène tous ces tiraillements. Et ils sont encore accrus lorsque, petit à petit, Zahira tombe réellement sous le charme d’un garçon, mais un garçon de son entourage, qui n’a pas été choisi par ses parents et qui n’a rien d’un Pakistanais !
Ajoutons, pour finir, que ce film n’a pas seulement pour thème le choc des cultures, mais que c’est aussi une ode à l’amitié. Car il y a un personnage dont je n’ai encore rien dit et dont pourtant le rôle n’est pas minuscule : c’est celui d’Aurore (Alice de Lencquesaing), l’amie fidèle de Zahira, celle qui répond toujours présente et qui ne rechigne jamais à lui venir en aide. Un beau personnage, de même que celui que joue Olivier Gourmet, l’ami qui essaie, autant qu’il le peut, d’apaiser toutes les tensions.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20170223 – Cinéma
CERTAINES FEMMES
un film de Kelly Reichardt.
Il me semble avoir lu (peut-être dans le « Journal » de Julien Green) que, contrairement aux lecteurs français qui n’en sont guère friands, les anglo-saxons apprécient grandement ce qu’ils appellent la « short story », en français la nouvelle. Ce dont je suis sûr, en tout cas, c’est qu’il n’est pas moins difficile, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, d’écrire des histoires courtes de 20 ou 30 pages que des romans de 200 ou 300 pages, voire plus encore. En raconter suffisamment tout en restant économe, entrouvrir un peu du secret des êtres tout en gardant une grande part de mystère, c’est tout l’art de qui écrit des nouvelles et il faut être doté de beaucoup de talent pour y parvenir. Et il faut aussi, quand on est auteur de nouvelles, miser sur le lecteur, sur sa sensibilité, son intelligence et son imagination qui sauront pallier tous les manques.
Eh bien, les films de Kelly Reichardt me donnent immanquablement une impression du même ordre. Même si ce sont des longs-métrages, ils sont conçus et réalisés sur le mode minimaliste de la nouvelle (le qualificatif « minimaliste » n’ayant rien de péjoratif sous ma plume, bien au contraire). Que ce soit dans « Old Joy » (2006), dans « La dernière piste » (2010) ou même dans « Night moves » (2013), la réalisatrice américaine ne s’encombre ni de discours ni d’explications. Avec elle, il faut se contenter de peu, elle filme comme personne ce qu’on pourrait appeler « les temps morts », des temps qu’il faudrait plutôt appeler des tranches de vie sans événement particulier. Or ce sont précisément pendant ces moments-là qu’il faut scruter les personnages : ce qu’ils laissent deviner d’eux-mêmes, sur leurs visages, à travers leurs gestes et leurs rares paroles, n’a rien d’insignifiant, mais au contraire en révèle beaucoup sur ce qu’ils sont.
Ces appréciations semblent encore plus exactes aujourd’hui, puisque, pour ce nouveau film, Kelly Reichardt a adapté trois nouvelles de l’écrivaine Maile Meloy. Nous voilà transportés au cœur du Montana et invités à la découverte de quatre femmes. Trois récits nous sont proposés successivement, chacun d’eux ayant droit à une petite reprise à la fin du film. Le premier, le plus riche en événements, met en présence une avocate (Laura Dern) et son client mécontent. Le deuxième se focalise sur Gina (Michelle Williams), une femme mariée qui, avec son mari, cherche à s’approprier les briques d’un grès rare appartenant à un voisin. Enfin, le troisième narre la rencontre de deux femmes issues de deux univers très éloignés l’un de l’autre : une ouvrière agricole amérindienne (Lily Gladstone) travaillant dans un ranch et une avocate (Kristen Stewart) venu donner un cours à quatre heures de voiture de chez elle.
Excepté peut-être dans la première de ces trois histoires, il n’est rien raconté ici d’extraordinaire. Ce ne sont que des petites tranches de vie, des portraits de femmes ni plus ni moins intéressantes que d’autres mais qui, comme dans les nouvelles les mieux écrites, laissent deviner des réalités cachées et des secrets enfouis. Fautes, culpabilité, remords, pardon, désirs inavoués : derrière les apparences, pour le spectateur attentif, tout cela se laisse deviner. Faisant la preuve, une fois encore, de toute sa subtilité de metteuse en scène et de tout son art de la suggestion plutôt que de la démonstration, Kelly Reichardt fait manifestement partie de ces cinéastes qui, lorsqu’ils réalisent un film, ne le font pas pour la satisfaction de leur propre ego, mais pour le spectateur, en se mettant, en quelque sorte, à sa place, et en lui octroyant un espace dans la conception même de l’oeuvre. Cela donne un cinéma exigeant, qui n’est certes pas adapté aux spectateurs paresseux, mais qui, pour les autres, offre mille occasions de mettre à l’oeuvre ses émotions comme son intelligence et son imagination. Je l’ai déjà dit en commentant d’autres cinéastes, mais je le répète à nouveau : j’aime ce cinéma-là !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20170217 – Cinéma
LOVING
un film de Jeff Nichols.
Après son échappée assez peu inspirée du côté de la science-fiction (« Midnight Special » – 2016), fort heureusement, Jeff Nichols nous revient à présent avec ce qui lui convient le mieux, le film dramatique se basant sur des réalités américaines, à l’exemple du captivant « Mud – Sur les rives du Mississippi », sorti en 2013, qui semblait tout droit venu d’un récit de Mark Twain.
Mais le film qui sort aujourd’hui, lui, s’inspire de faits réels, ceux qui ébranlèrent les bien nommés époux Loving, Richard (Joel Edgerton) et Mildred (Ruth Negga). Un couple qui aurait pu, qui aurait dû, mener une vie sans histoire si l’on n’avait eu affaire à un Blanc marié à une Noire à la fin des années 50 en Virginie, un Etat encore fortement marqué par le ségrégationnisme. A peine se sont-ils mariés à Washington et sont-ils de retour chez eux qu’ils sont arrêtés, emprisonnés et traduits en justice. On ne plaisante pas sur ce sujet en Virginie dans ces années-là et Richard et Mildred sont sommés de ne plus paraître ensemble sur le territoire de cet Etat durant les 25 ans à venir. Leur combat ne s’achèvera que près de 10 ans plus tard après avoir été médiatisé et présenté à la Cour Suprême des Etats-Unis.
Avec un sujet comme celui-là, il était tentant de réaliser un film-dossier ultra classique (comme on a pu en voir un l’an dernier avec « Spotlight » par exemple), mais heureusement Jeff Nichols a fait un autre choix, bien plus judicieux et, en fin de compte, bien plus intéressant. Les scènes de procédure judiciaire, d’entrevues avec des hommes de loi, de comparutions au tribunal n’occupent qu’une toute petite partie du film et c’est tant mieux. Il n’y a pas besoin de beaucoup plus que d’une sentence se référant à une prétendue loi divine (Dieu qui aurait créé les races et les aurait dispersées sur la surface de la Terre pour qu’elles ne se rencontrent pas!) pour faire comprendre l’aberration des lois de ségrégation appliquées en Virginie. De même, le réalisateur de « Loving » se garde de mettre en scène les poncifs de la haine raciale. Une des scènes qui semble orienter le film vers un déchaînement de violence n’aboutit, en fin de compte, qu’à une fausse piste.
Mais alors, si le film n’accorde qu’une place restreinte aux questions judiciaires et s’il se garde de mettre en spectacle des débordements de haine raciale, de quoi est-il fait, quel en est la matière, si l’on peut dire ? Eh bien, ce sur quoi le cinéaste met l’accent, c’est la vie du couple Loving, tout simplement. Un couple qui met au monde des enfants, les élève et tâche de mener une vie, pourrait-on dire, normale. La métaphore qui revient, comme un leitmotiv, tout au long du film, c’est celle de la maison qu’il faut construire. Richard et Mildred n’ont d’autre ambition que de construire leur maison et c’est en les montrant ainsi, fidèles à ce projet, que Jeff Nichols met aussi en lumière, par contraste, les égarements des tenants de la ségrégation.
Il faut dire aussi, pour finir, que la réussite du film repose, pour une grande part, sur le jeu plus que convaincant des deux acteurs principaux. Joel Edgerton fait de Richard Loving un homme plutôt bourru mais déterminé à aller jusqu’au bout, jusqu’à construire la maison qu’il veut offrir à celle qu’il aime. Quant à Ruth Negga, elle éclaire tout le film par sa présence, en femme décidée à emprunter tous les chemins possibles pour faire reconnaître ses droits, pour changer la vie de plein d’autres couples mixtes, pour en finir avec les lois liberticides. Enfin, il n’est nul besoin de le souligner, mais on peut quand même affirmer que ce film vien à point nommé à l’heure où les Etats-Unis viennent d’élire leur nouveau président en la personne de Donald Trump !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20170211 – Cinéma
SILENCE
un film de Martin Scorsese.
Que penser du nouveau film de Martin Scorsese, film dont le cinéaste caressait le projet depuis bien des années et qu’il a donc eu le temps de longuement mûrir ? Je n’ai nullement la prétention, bien évidemment, d’assener un jugement catégorique : que chacun se fasse sa propre opinion sans trop tenir compte des réactions assez vives que l’on peut glaner ici et là dans les magazines ou sur le net. Les uns parlent d’un film pénible et éprouvant, allant jusqu’à affirmer que le vrai martyre du film est pour le spectateur ! D’autres, au contraire, estiment que l’on a affaire à un chef d’oeuvre et à un réalisateur en état de grâce.
Laissons de côté tout ce qui est excessif. Le film n’est pas parfait, on est en droit de le trouver trop long et de juger que quelques ficelles scénaristiques auraient pu être évitées (y compris la scène ultime du film, en forme de pirouette, qui peut sembler superflue). Cela étant dit, si je peux comprendre que ce film paraisse pénible à ceux qui sont totalement rétifs aux questions qu’il soulève, je ne partage pas du tout le point de vue de ceux qui le trouvent raté sur le plan de la forme. Au contraire, il m’a semblé que cette œuvre si longuement préparée par le cinéaste a été réalisée avec un grand sens de la mise en scène, si grand que, malgré sa durée (2h41), le film m’a littéralement fasciné du début à la fin.
Mais venons-en à ce qui nous touche au plus profond de l’être, aux questions de foi, de charité, de mission que soulève ce film. L’histoire ici contée, inspirée de faits réels, a été imaginée par le grand romancier catholique Shûsaku Endô (1923-1996) et elle avait déjà été adaptée au cinéma par Masahiro Shinoda en 1971. Ayant moi-même lu le roman il y a une dizaine d’années, j’en avais gardé un souvenir très fort et j’étais donc curieux et quelque peu inquiet de le voir adapté sur grand écran par Scorsese. Toute mon appréhension a été balayée : le cinéaste est resté fidèle au livre et, lui qui avait déjà abordé, mais jusqu’ici maladroitement, la problématique de la foi dans sa filmographie, le fait ici d’une manière convaincante, interrogative plutôt qu’affirmative.
La foi mise à l’épreuve, la foi confrontée à la souffrance et à la mort : c’est ce dont il s’agit. Les deux jésuites, le le père Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) et le le père Francisco Garupe (Adam Driver), qui se font un devoir de partir au Japon à la rencontre des chrétiens pourchassés et martyrisés et dans le but de retrouver leur mentor, le père Ferreira (Liam Neeson), suspecté d’apostasie, ne peuvent imaginer par quelles épreuves ils vont devoir passer. Ce qu’ils vont avoir à supporter, Scorsese l’indique avec pas mal d’habileté, n’est pas sans rappeler la Passion du Christ. Il ne s’agit pas d’une copie de cette dernière, mais de souffrances et d’épreuves qui s’y réfèrent. Il y a une sorte de Judas dans le film de Scorsese, mais son comportement n’est pas totalement identique à celui des Evangiles. Il y a surtout des interrogatoires, d’atroces souffrances et l’épreuve la plus difficile, celle de la déréliction. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », tel fut le cri de Jésus sur la croix (Mt 27,46), tel est l’appel qui monte du cœur du père Rodrigues face aux souffrances qu’il faut endurer et à celles dont il est le témoin effaré. Le silence, qui donne au film son titre, c’est le silence de Dieu. Où est-il, que fait-il, quand ses enfants endurent les pires tribulations ? Le film de Scorsese pose la question sans imposer de réponse mais en indiquant une piste : si Dieu semble se taire, c’est peut-être parce qu’il est, lui aussi, en train de souffrir avec l’humanité…
Tout le film est construit sur ce modèle : il pose de redoutables questions, il les pose adroitement, mais en se gardant de donner des réponses simples qui pourraient rapidement apparaître simplistes. Les questions abordées par le film sont nombreuses et trop complexes pour qu’on puisse s’autoriser à donner des réponses toutes faites, Scorsese l’a bien compris. Quand, par exemple, l’on débat au sujet de l’annonce de la foi chrétienne à des peuples qui lui sont culturellement très éloignés, il n’est pas admissible de répondre avec légéreté. Les Japonais convertis le sont-ils vraiment, la foi est-elle enracinée en eux ? Dans ses échanges avec le père Rodrigues, l’inquisiteur émet de sérieux doutes à ce sujet et personne ne peut lui répliquer de façon péremptoire.
Quant à la troublante question de l’apostasie de quelques-uns, à commencer par le père Ferreira, elle ne saurait se résoudre, elle non plus, ni par un rejet pur et simple, ni par un décret, ni par une condamnation. L’Eglise catholique honore les martyrs, c’est vrai, mais doit-elle pour autant honnir les apostats ? Le film de Scorsese, fidèle au roman de Shûsaku Endô, montre que rien n’est simple. Ceux qui ont cédé lors de la cérémonie du fumi-e, autrement dit ceux qui ont accepté de piétiner une image sacrée, l’ont-ils fait par peur, pour sauver leur propre peau, ou plutôt pour sauver celle des autres, pour faire cesser leurs insupportables souffrances ? Dans ce cas, le reniement public à la foi chrétienne n’est-il pas assimilable à un acte de charité, de compassion, de miséricorde ? Qui se permettra de juger ?
Je ne peux, dans le cadre restreint de ma critique, restranscrire toutes les questions soulevées par ce film. Mais je ne peux qu’encourager à aller le voir (en mettant en garde, toutefois, ceux pour qui les scènes de violence seraient insupportables) et à en débattre. Car, oui, ce film est important, il est réalisé avec grand talent et il peut susciter bien des échanges chez tous ceux que les questions de la foi et de son annonce interpellent. De plus, et je le dis pour finir, « Silence » met en scène des personnages qui ne sont ni des archétypes ni des symboles : on ne peut les réduire à leur fonction. Pour le dire sans détour, on n’a pas affaire aux bons jésuites contre les méchants persécuteurs japonais. Chaque personnage garde son mystère et sa complexité et l’inquisiteur lui-même ne peut être réduit à un rôle de tortionnaire. Ses motivations ne se limitent certes pas à des instincts de cruauté. De ce point de vue aussi, du point de vue de la complexité des personnages, le film de Scorsese est une réussite.
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
20170208 – littérature – nouveau livre de Anne Wiazemsky (‘Un saint homme’)
UN SAINT HOMME
un récit de Anne Wiazemsky.
Dans les écrits autobiographiques d’Anne Wiazemsky, jusqu’à présent, il était essentiellement question de personnalités plus ou moins célèbres du monde culturel : on y rencontrait, bien évidemment, son illustre grand-père, François Mauriac, mais aussi le cinéaste Robert Bresson avec qui la toute jeune fille de 18 ans avait commencé une carrière d’actrice (« Au hasard Balthazar » en 1965), puis Jean-Luc Godard qui lui avait donné un rôle dans « La Chinoise » en 1967 et qu’elle avait épousé la même année et bien d’autres célébrités comme Francois Truffaut ou le philosophe Francis Jeanson. Cela, Anne Wiazemsky l’a raconté avec talent dans trois ouvrages tout à fait passionnants (« Jeune fille », « Une année studieuse » et « Un an après »).
Aujourd’hui cependant, dans le nouvel ouvrage de celle qui a fait le choix de laisser son métier d’actrice pour se consacrer à la littérature, ce n’est pas d’une célébrité dont il est question mais d’un religieux, d’un prêtre, d’un homme dont le nom ne dira rien à la plupart des lecteurs et qui le découvriront par la grâce de ce récit. Le «saint homme » qui lui donne son titre, c’est le Père Marcel Deau, religieux de la congrégation des Fils de Marie Immaculée, ordonné prêtre en 1958 et envoyé dès 1959 au Venezuela en tant que professeur de français et de latin au Colegio Francia de Caracas. C’est là qu’il apprend que l’une de ses élèves est la petite-fille de François Mauriac : « Enseigner le français à la petite-fille du Grand Mauriac, comme il l’écrira plus tard, ça flatte son homme ! »
Mais le Père Deau n’est pas du genre à se laisser impressionner et ce qui va rapidement le lier à son élève ne dépend nullement de la réputation de l’illustre ancêtre. Comment nommer le lien qui, sans tarder, l’unit à la collégienne ? Le Père Deau perçoit que dans le cœur et dans l’esprit de l’adolescente germent de beaux talents qui ne demandent qu’à s’épanouir ; il prend figure de père, de guide, de mentor, de conseiller,… Très vite, quotidiennement, au vu et au su de tous, le professeur et l’élève passent de longs moments à échanger des idées, à parler de littérature essentiellement car c’est leur passion commune. Hélas ! Il se trouve toujours, dans ces cas-là, des regards soupçonneux et des langues malveillantes, des dénonciateurs, des accusateurs, des calomniateurs ! Le Père Deau n’y échappe pas et, du jour au lendemain, interdiction lui est faite de voir son élève en dehors de la salle de classe. La jeune élève, elle, qui ne sait rien de ces méchancetés, s’étonne de constater que le professeur a cessé de converser avec elle.
Ce n’est que bien plus tard qu’elle apprend la vérité de la bouche même du Père Deau, qu’elle retrouve après des années de séparation. Elle a quitté le Venezuela pour la France, tandis que le Père Deau est envoyé en mission au Cameroun. Ni l’un ni l’autre n’ont totalement oublié la belle complicité qui les liait. Même au Cameroun, le Père Deau découvre à la faveur d’une séance de cinéma ambulant que son ancienne élève est devenue la jeune actrice d’un film de Robert Bresson ! Plus tard encore, après le retour du Père Deau en France, tous deux, enfin, se retrouvent et reprennent le fil intermittent de leurs rencontres et de leurs échanges.
C’est ce que raconte, avec simplicité et gratitude, Anne Wiazemsky, dans ce beau livre. Entrevues et échanges de lettres émaillent les années et entretiennent la flamme d’une grande amitié. Le Père Deau est présent, autant qu’il est possible, à des moments clés de la vie de celle qui est devenue romancière. Il n’est pas homme à juger, il est homme à conseiller. Chaque livre écrit et publié par l’écrivaine lui donne l’occasion d’affirmer son soutien indéfectible. Il est assis au premier rang chaque fois qu’a lieu une rencontre de la romancière avec son public et, quand un prix est décerné à celle-ci (le Grand Prix de l’Académie Française pour « Une poignée de gens » en 1998), il a un peu le sentiment que c’est lui aussi qui est récompensé. Il est également présent, bien sûr, en tant que religieux prêtre, non seulement parce qu’il répond à des demandes spécifiques (celle d’un baptême par exemple), mais parce qu’il se confie volontiers sur les missions qui lui sont confiées et sur ses tâches d’homme d’Eglise. On devine, au détour de quelques phrases, que l’écrivaine est impressionnée par la foi de cet homme.
Un homme, un religieux, un prêtre, qui s’est donné sans mesure à ceux qui lui ont été confiés et qui, cependant, est resté indéfectiblement fidèle à l’amitié, à l’affection qui le liait d’une manière toute particulière à celle qui fut son élève, jusqu’à sa mort en 2006. Un religieux prêtre qui a donné sa vie au service d’autrui peut-il, sans contradiction, entretenir la flamme d’un attachement privilégié (avec une femme, qui plus est!) ? Oui, bien sûr que oui, c’est la réponse évidente qui saute aux yeux à la lecture de ce livre. N’y verront le mal que les pharisiens d’aujourd’hui ! Les pages que consacre Anne Wiazemsky au Père Deau sont extrêmement touchantes. Elle décrivent un « saint homme », oui, un homme qui, bien que bavard impénitent, est à l’écoute du cœur d’autrui, un homme de foi, un homme limpide. « Il est dans ce qu’il dit de lui, il est transparent », écrit Anne Wiazemsky en commentant une des lettres qu’elle a reçues de lui. Mon sentiment, je le dis pour conclure, c’est que le Père Deau était un cœur pur. « Votre âme est pure », avait-il dit un jour à la romancière. Cela s’appliquait aussi à cet homme, à ce religieux prêtre, pour qui convient, sans nul doute, la 6ème Béatitude : « Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. » (Mt 5, 8).
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20170127 – Cinéma
LA LA LAND
un film de Damien Chazelle.
Dans quel pays se trouve-t-on quand on est en La La Land ? L’expression (typiquement américaine) désigne à la fois un lieu bien précis, une ville très exactement, Los Angeles (qu’on se contente généralement de nommer par son acronyme L. A.), et plus précisément encore Hollywood, et ce qu’on y fabrique. Quoi donc ? Eh bien, l’expression « usine à rêves » qu’on emploie parfois pour nommer les studios hollywoodiens le dit clairement : on y fabrique du rêve. Être en La La Land, par conséquent, c’est se trouver au pays des rêves, c’est-à-dire dans un environnement plus ou moins déconnecté du monde réel.
Le troisième film de Damien Chazelle (après « Whiplash » – 2014, qui ne m’avait pas du tout convaincu!) a donc pour ambition de rendre hommage au genre cinématographique qui s’accorde le mieux avec l’onirisme, c’est-à-dire la comédie musicale, genre qu’Hollywood a porté jusqu’à d’extraordinaires sommets pendant son âge d’or. Il est clair, pour qui possède un minimum de culture cinématographique (et, plus encore, pour tous ceux qui – comme moi-même – raffolent des films musicaux), que la plupart des scènes chantées et/ou dansées de « La La Land » ont été directement inspirées à Damien Chazelle par des scènes de films aussi prestigieux que « Chantons sous la pluie » (1952) ou « Un Américain à Paris » (1951) et d’autres films encore. Sur le net a d’ailleurs circulé un montage mettant en parallèle des extraits de « La La Land » et les extraits des films musicaux hollywoodiens qui leur ont servi de modèles.
Si l’on ne se focalisait que sur ce petit jeu des comparaisons, on serait en droit de n’accorder au film de Damien Chazelle qu’un timide satisfecit. Hormis la scène d’ouverture de « La La Land », qui méritera d’être citée dans les anthologies, et peut-être la scène quasi finale (qui s’inspire clairement d’ »Un Américain à Paris »), rien, dans le film de Damien Chazelle, n’atteint le niveau d’excellence des grandes comédies musicales des années 40 et 50. Le gros défaut de « La La Land », il faut bien le dire, ce sont ses deux acteurs principaux : Ryan Gosling et Emma Stone. Ni l’un ni l’autre ne sont en mesure de rivaliser avec leurs illustres aînés : le premier fait bien pâle figure si on le compare à Fred Astaire ou Gene Kelly, la seconde paraît bien pâlotte en regard d’une Ginger Rogers ou d’une Judy Garland.
Pourtant, malgré ce défaut et bien que je sois un fervent admirateur des acteurs et actrices que je viens de nommer, le film de Damien Chazelle m’a plutôt séduit : le réalisateur a su pallier les manques de ses deux acteurs principaux (qui, sans être ridicules bien sûr, ne sont ni l’un ni l’autre, des virtuoses du chant ni de la danse) par un sens aigu de la mise en scène et par de séduisants choix musicaux. Les décors m’ont paru judicieusement sélectionnés et, surtout, j’ai été impressionné, à plus d’une reprise, par d’impressionnants mouvements de caméra. Tout cela donne au film, dans ses épisodes musicaux, un rythme et une apparence des plus plaisants.
Enfin, ce qui augmente de beaucoup l’intérêt que suscite « La La Land », c’est qu’il déborde de beaucoup le cadre de la simple comédie musicale. On n’a pas affaire (pas uniquement en tout cas) à un film hommage qui sentirait la naphtaline. En racontant l’histoire de Sébastien (Ryan Gosling), un pianiste de jazz, et de Mia (Emma Stone), une serveuse de bar qui caresse l’espoir de devenir actrice, Damien Chazelle veut faire se confronter deux mondes : celui du rêve dont j’ai déjà parlé et celui des dures réalités de l’existence. Les deux se heurtent sans vraiment se rencontrer. Pour aller du côté du rêve, il faut, par exemple, trouver refuge dans un observatoire astronomique et s’échapper vers les étoiles. Mais il faut bien aussi, tôt ou tard, retomber sur terre, retrouver les réalités de la vie quotidienne et déchanter. Dans le monde du rêve, la romance peut unir sans fin Mia et Sébastien, mais en est-il de même dans la vie réelle ? Rien n’est moins sûr.
Le plus souvent applaudi et acclamé, « La La Land » a néanmoins été également accueilli ça et là par des critiques des plus sévères. Je le comprends et j’ai moi-même souligné les limites du film. Cependant, à mes yeux, ce sont les qualités qui l’emportent sur les défauts, qualités de mise en scène, de choix des décors, de choix musicaux et d’inventivité du scénario, et c’est pourquoi je lui accorde volontiers un
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20170120 – Cinéma
UN SAC DE BILLES
un film de Christian Duguay.
Le récit autobiographique de Joseph Joffo, grand succès de librairie à sa parution en 1973, fut talentueusement adapté au cinéma par Jacques Doillon dès 1975. On peut dès lors se demander s’il était pertinent d’en faire un remake. Pour moi, la réponse est clairement positive. Je suppose qu’aux yeux du réalisateur, Christian Duguay, il était non seulement utile mais nécessaire de proposer à nouveau cette histoire en guise de témoignage de ce que furent les terribles réalités de la deuxième guerre mondiale pour les Juifs. Il n’y aura jamais assez ni de films ni de témoignages écrits pour faire œuvre de transmission aux jeunes générations de ce que fut la terreur nazie et de ce que furent les souffrances des Juifs, c’est ma conviction.
Ce film est d’autant plus le bienvenu qu’il est réalisé avec un soin et une maîtrise qui n’ont rien à envier à ceux dont avait fait preuve Jacques Doillon. Dès les scènes d’ouverture et, en particulier, dès l’irruption de la sombre menace diffusée par les nazis au sein de la famille Joffo, nous voilà pris à la gorge. Une famille tranquille et heureuse jusque là mais dont le père (Patrick Bruel), coiffeur de son métier, et la mère (Elsa Zylberstein) pressentent rapidement que, s’ils veulent en sortir sains et saufs, il va falloir non seulement fuir mais le faire séparément : les parents d’un côté, les enfants de l’autre, tout le monde devant se retrouver en zone libre, à Nice.
Leur père leur ayant au préalable rudement appris que dorénavant il leur faudra dissimuler à tous qu’ils sont juifs, commencent pour les deux plus jeunes enfants de la famille, Maurice et Joseph (Batyste Fleurial et Dorian Le Clech), des mois et des années d’incertitude, de peur, de souffrance. Difficile de garder l’insouciance des enfants quand il faut sans cesse être sur ses gardes. Même les retrouvailles de Nice ne dureront pas bien longtemps, tant la menace ressemble à une bête féroce qui, quand on croit l’avoir semé, surgit à nouveau dans la nuit.
Par quels miracles ces deux enfants réussirent-ils à se sortir des embûches, à ne pas être lacérés par les griffes ni dévorés par la gueule de l’hydre nazie, c’est ce que raconte ce film, toujours tendu par la corde de l’émotion mais sans jamais trop en faire. On notera tout particulièrement qu’à deux reprises les deux enfants doivent leur salut à des prêtres qui, au mépris de leur propre sécurité, ont eu l’audace de s’entremettre pour eux. Ces prêtres-là méritent d’être désignés du nom de justes, sans aucun doute.
Enfin, l’on se réjouit quand le jeune Joseph, qui avait trouvé refuge au sein d’une famille redoutablement pétainiste et, bien sûr, en cachant son identité, peut, dès l’annonce de la libération (tandis que malheureusement, au milieu de la liesse, se déroulent des scènes de vengeance) clamer haut et fort « Je suis juif ! Je suis juif ! ». Finie la terreur et puisse-t-elle ne jamais ressurgir !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20170116 – Cinéma
BORN TO BE BLUE
un film de Robert Budreau.
N’étant pas un grand amateur de jazz, je connaissais certes le nom du trompettiste Chet Baker mais rien de plus. Ce film, qui évite les écueils du biopic pour ne relater que quelques mois de la vie du musicien, me le fait découvrir dans toute sa fragilité. L’homme que l’on voit à l’écran (formidablement interprété par Ethan Hawke) ne ressemble à rien de plus qu’à une épave. Un musicien de génie a descendu les marches de l’enfer, il s’est détruit à force de drogues et, en particulier, d’héroïne, il vient de sortir de prison et se fait tabasser et fracasser la mâchoire par les hommes de main de son dealer.
Or ce qui intéresse le réalisateur Robert Budreau, c’est de montrer la tentative de salut, de rédemption, de résurrection pourrait-on dire, de cet homme. C’est un mort qui essaie de revenir à la vie. Ou plutôt c’est un mort à qui une main secourable est tendue, une main qui s’ingénie à le sortir de la mort pour le ramener à la vie.
Tombé au fond du gouffre, tout le monde l’a abandonné à son sort sauf une personne : Jane (Carmen Ejogo), une actrice qui, par amour pour lui, se dévoue sans compter pour le soigner et le sauver. Le ramener à la vie, lui qui est méprisé par tous, y compris par son père pour qui il n’est qu’un homme qui a sali son nom.
Le film, réalisé avec grand talent, faisant alterner des séquences en couleurs et d’autres en noir et blanc, nous touche, nous bouleverse en entretenant une sorte de suspens : l’amour de Jane peut-il sauver Chet Baker ? Et ce dernier, malgré sa mâchoire brisée, peut-il à nouveau renouer avec l’excellence de son talent de trompettiste ? L’indulgence n’est pas de mise dans le milieu artistique.
Une autre question se pose aussi, lancinante, dérangeante : le génie du musicien ne repose-t-il pas sur l’usage de la drogue ? Autrement dit, sevré d’héroïne, Chet Baker a-t-il encore la capacité d’être un grand musicien ?
Le réalisateur, bien sûr, se garde de donner des réponses toutes faites à ces questions. Elles restent présentes, tout comme continue de nous toucher au plus profond du cœur la beauté de l’amour de Jane pour cet homme brisé.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
JAMAIS CONTENTE
un film de Emilie Deleuze.
S’étonner, s’émerveiller, se laisser surprendre : le cinéma sinon le meilleur en tout cas le plus attachant ne se trouve pas forcément là où on le pressentait. Une fois encore, c’est un film dont je n’espérais pas grand chose sauf un peu de détente qui, en fin de compte, me séduit. Adapté d’un roman pour la jeunesse de Marie Desplechin (« Le Journal d’Aurore ») et excellemment réalisé par Emilie Deleuze (qui n’est autre que la fille du philosophe Gilles Deleuze), ce film sur une pré-adolescente de 13 ans m’a irrésistiblement conquis dès les premières scènes et m’a charmé tout au long.
Bien sûr, Aurore (formidablement jouée par Léna Magnien), sur bien des points, ressemble à la plupart des adolescentes de son âge : elle se trouve moche, se demande si elle ne ferait pas mieux d’être enfermée en haut d’une armoire pour n’être sortie qu’une fois par an, déteste tout le monde ou presque, à commencer par ses parents et ses deux sœurs, et se demande avec angoisse si elle pourra un jour aimer un garçon. Néanmoins la réalisatrice a su habilement ne pas s’empêtrer dans les clichés sur l’adolescence. Si Aurore partage quelques caractéristiques avec un grand nombre de jeunes filles de son âge, elle n’en reste pas moins singulière, elle ne représente pas à elle seule l’Adolescence avec un grand A, mais elle est simplement une adolescente parmi d’autres.
La mise en scène souligne cette singularité en insistant sur la dimension relationnelle. Ce qui fait qu’Aurore ne peut nullement être confondue avec qui que ce soit d’autre, c’est son jeu de relations, les personnes à qui elle a affaire et le regard que celles-ci portent sur elle. J’ai déjà mentionné les parents et les sœurs, mais il convient d’ajouter la grand-mère (la personne de sa famille à qui l’adolescente peut se confier, car si Aurore adopte volontiers le ton bougon, voire méchant, lorsqu’elle parle, elle est aussi une adolescente avide d’être conseillée et rassurée).
Ayant redoublé sa 5ème, elle a également affaire, bien évidemment à des professeurs : une sorte de ronde les met brillamment en scène en pleine classe, récitant leurs enseignements comme on enfilerait des perles ! Parmi ceux-ci se détache le professeur de français (Alex Lutz), un rempaçant qui s’empresse de faire lire à ses élèves l’incontournable et inénarrable « Princesse de Clèves » et d’interroger Aurore. Ce professeur n’en est pas moins plutôt bien inspiré, allant jusqu’à conseiller à la jeune Aurore la lecture du poète Francis Ponge, ce dont elle saura tirer bénéfice.
Et, bien sûr, on ne saurait oublier les autres adolescents : ceux de son âge, mais aussi un groupe de trois garçons un peu plus âgés dont l’un d’eux lui propose d’intégrer leur groupe de rock pour en être la chanteuse. Difficile de monter sur scène et de s’exposer au regard de tous quand on a 13 ans, mais qui sait si ce n’est pas précisément ce lieu et cette audace qui engendreront un peu d’épanouissement chez la jeune Aurore ? La superbe scène finale nous la montre, en tout cas, comme transformée, subitement mûrie, ayant passé le cap de ses dégoûts de pré-adolescente.
Ce film qui, peut-être, sera qualifié par certains de petit ou d’anodin, n’en est pas moins, à mes yeux, la bonne surprise de ce début d’année 2017. Pas une seule des scènes qui le composent ne m’a semblé banale et il en est même plus d’une qui m’ont amusé, intrigué, interpellé. Ainsi quand Aurore, à l’approche de Noël, au grand étonnement de son père qui précise qu’il est sans religion, se met à fabriquer une crèche et à réclamer un « petit Jésus ». Ou encore lorsque la grande sœur d’Aurore annonce qu’elle veut se marier avec un Russe, à l’église et selon le rite orthodoxe ! Autant de scènes qui, si elles ne sondent pas les mystères à la façon des philosophes (ou des théologiens) n’en sont pas moins à la fois judicieuses et savoureuses. Comme l’est d’ailleurs tout le film !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.