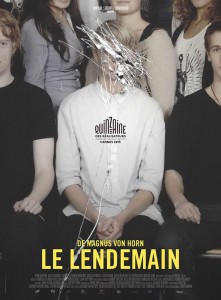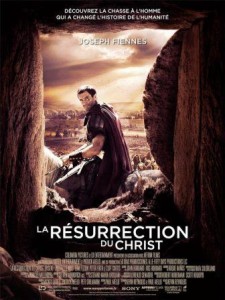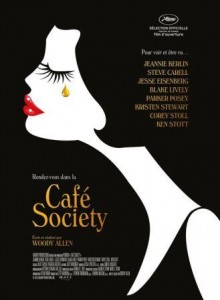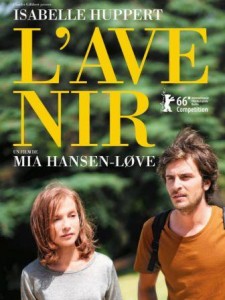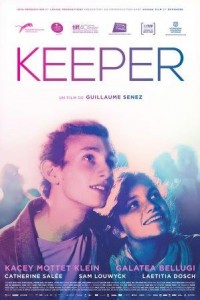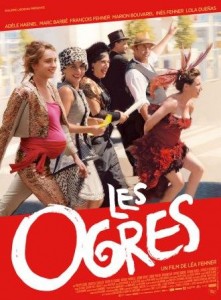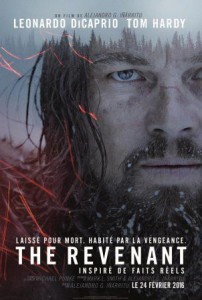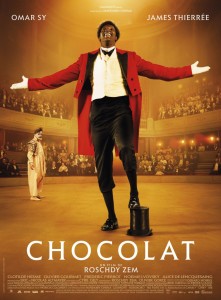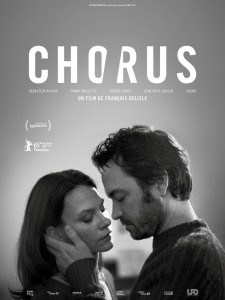20170101 – Cinéma
-
Carol, de Todd Haynes
-
La Fille inconnue, de Jean-Pierre et Luc Dardenne
-
Paterson, de Jim Jarmusch
-
Sunset Song, de Terence Davies
-
Café Society, de Woody Allen
-
Frantz, de François Ozon
-
Les Ogres, de Léa Fehner
-
Moi, Daniel Blake, de Ken Loach
-
L’Avenir, de Mia Hansen-Løve
-
The Assassin, de Hou Hsiao-Hsien
-
Julieta, de Pedro Almodóvar
-
Juste la fin du monde, de Xavier Dolan
-
Le Fils de Joseph, de Eugène Green
-
La Forêt de Quinconces, de Grégoire Leprince-Ringuet
-
Les Délices de Tokyo, de Naomi Kawase
-
Les Innocentes, de Anne Fontaine
-
The Revenant, de Alejandro González Iňarritu
-
Une Vie, de Stéphane Brizé
-
Le Fils de Jean, de Philippe Lioret
-
Brooklyn Village, de Ira Sachs
-
Guibord s’en va-t-en guerre, de Philippe Falardeau
-
Sing Street, de John Carney
-
Peur de rien, de Danielle Arbid
-
Sur quel pied danser, de Paul Calori et Kosta Testut
-
Polina, danser sa vie, de Valérie Müller et Angelin Preljocaj.
Place à 2017 qui s’annonce déjà prometteuse avec les sorties annoncées des nouveaux films de Martin Scorsese, James Gray, Terence Davies, Terence Malick et plein d’autres encore.
L’AMI, FRANÇOIS D’ASSISE ET SES FRÈRES
un film de Renaud Fély et Arnaud Louvet.
Qu’on ne s’attende pas, si l’on a la curiosité d’aller voir ce film, à un biopic sur saint François comme ont osé les faire un Michael Curtiz en 1961 ou un Franco Zeffirelli (cinéaste toujours calamiteux) en 1972. Qu’on ne s’attende pas non plus à un florilège de fioretti, comme le fit, avec génie, Roberto Rossellini en 1950. Renaud Fély et Arnaud Louvet se sont contentés de mettre en scène une période bien précise de l’histoire du saint d’Assise, celle où, le groupe des frères ayant tout quitté pour suivre François s’étant considérablement étoffé, il devient nécessaire de faire approuver l’Ordre par le pape Innocent III, ce qui suppose, au préalable, de lui soumettre une règle.
C’est là que le bât blesse car, de la première règle, écrite par François, qui lui est proposée, le pape non seulement ne veut pas mais il la rejette avec des mots très durs. Ni la pauvreté radicale prônée par le Poverello, ni l’acceptation d’une éventuelle désobéissance (François soutenant, dans sa règle, la primauté de la conscience, plus forte, selon lui, que la voix d’un supérieur, quel qu’il soit), ni même les nombreuses citations des évangiles ne sont tolérées par le successeur de Pierre. François est renvoyé avec l’injonction de revoir sa copie, sans quoi lui et ses frères pourraient être considérés comme hérétiques !
C’est alors qu’intervient Elie de Cortone, frère Elie (Jérémie Rénier), venu rejoindre le groupe des compagnons de François. C’est un personnage qui demeure mystérieux, énigmatique, que ce frère Elie, si j’en crois les pages que Julien Green lui consacre dans sa superbe biographie du saint d’Assise (« Frère François », éditions du Seuil, 1983) : l’homme est animé, à la fois, par un amour sincère et profond de celui qu’il a rejoint, François, et par des désirs de gloire qui sont en totale contradiction avec l’esprit voulu par le saint pour ceux qu’on appellera les franciscains.
Le film se base sur l’opposition entre les deux hommes : l’un (François) voulant à tout prix que l’on reste fidèle à son intuition première, l’autre (Elie) prêt à recourir aux compromis, aux arrangements et aux adoucissements pour que l’Ordre des frères mineurs soit enfin reconnu par l’autorité de l’Eglise. D’un côté l’idéal, de l’autre le pragmatisme. Tout l’intérêt du film repose sur ce heurt. La règle de François ne sera approuvée par le pape que si elle est amendée par Elie. Pour François, cela reste inacceptable. « Elie, tu te damnes », aurait même dit François, si l’on en croit l’ouvrage de Julien Green (p. 288). Dans le film, les paroles de François sont différentes tout en ayant à peu près la même signification : « Ton cœur est devenu froid. Tu n’es plus avec Dieu. » Quant aux autres frères, le film laisse bien percevoir que se diffusent en eux des germes de division. Elie en séduit certains tandis que d’autres ne jurent que par l’idéal prôné par François. Même sur la question de la pauvreté, l’on n’est pas d’accord : faut-il aimer la pauvreté pour elle-même ou faut-il aimer les pauvres tout en les aidant à sortir de leur pauvreté ?
On peut regretter que le film n’approfondisse pas davantage les questions qu’il aborde, mais il a le mérite de les poser d’une façon judicieuse. Il invite à la réflexion, et c’est déjà beaucoup. Son plus gros défaut, à mon avis, il le doit au jeu assez peu convaincant de l’acteur qui interprète le rôle de François (Elio Germano), un acteur qui a une fâcheuse propension à surjouer son personnage. Par contre, Jérémie Rénier, dans le rôle de frère Elie, m’a semblé parfait.
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161222 – Cinéma
PATERSON
un film de Jim Jarmusch.
La ville de Paterson, dans le New Jersey, qui sert de cadre à ce film, n’a pas été choisie au hasard par Jim Jarmusch, son réalisateur. C’est là, en effet, que naquit et passa une grande partie de sa vie l’un des poètes américains les plus célèbres, William Carlos Williams (1883-1963). De 1910 à 1951, tout en y exerçant la profession de médecin, il réussit à consacrer une partie de son énergie à sa passion pour la littérature en général et la poésie en particulier.
Le personnage que Jim Jarmusch fait évoluer dans son film, personnage qui porte le même nom que la ville dans laquelle il réside, Paterson (interprété par Adam Driver), exerce, lui, un métier encore plus prosaïque que celui qui permettait à Williams de gagner sa vie : il est chauffeur de bus. Avec lui, nous parcourons la ville, une ville qui paraît assez sinistre, hormis cependant une chute d’eau qui lui donne un petit cachet touristique. Mais qu’importe ! C’est précisément l’une des facettes les plus intéressantes de ce film que de nous faire percevoir la poésie ailleurs que dans les clichés. Le poète n’a pas nécessairement besoin d’un lac, comme Lamartine, ni d’aucun autre site remarquable, pour donner sa mesure et faire entendre sa voix. Même les réalités les plus triviales, même les objets du quotidien qu’on ne remarque pas, le poète les voit, s’en empare et les transcende. Dans le film, le premier poème de Paterson (qui, on l’a compris, est non seulement chauffeur de bus mais poète) apparaissant à l’écran trouve son origine dans la simple vision d’une boîte d’allumettes. Le poème (comme tous les autres du film) s’écrit sous nos yeux, sur l’écran, pendant que Paterson le rédige dans le carnet qu’il emmène partout avec lui. Même au volant de son bus, avant de se mettre en route, il écrit.
Il écrit certes, mais pour qui ? Qui connaît ses poèmes ? Qui les lit ? Qui les appécie ? Sa femme Laura (Golshifteh Farahani), bien sûr, celle qui partage sa vie, celle qui est l’inspiratrice et à qui sont destinés tous les poèmes. Celle qui croit en lui, en son talent et qui le supplie de photocopier ses œuvres au lieu de ne les conserver qu’en un seul exemplaire dans ses carnets. Celle qui enchante le quotidien non seulement par sa beauté, non seulement par ses talents culinaires de faiseuse de savoureux cupcakes mais aussi par ses compositions, par ses décors de noir et blanc des plus somptueux.
Le film, lui aussi, est somptueux et il se savoure malgré son apparente monotonie, le réalisateur se contentant d’égrener chacun des jours d’une semaine. Chaque journée paraît semblable à l’autre, c’est vrai, et, pour une fois, on a affaire à un récit dénué non seulement de drames mais de tensions. Le couple formé par Paterson et Laura donne le sentiment d’une belle harmonie. En contrepoint, certes, le réalisateur met en scène une histoire de couple qui se sépare, dans le café que Paterson fréquente chaque soir, mettant ainsi à profit, si l’on peut dire, la balade qu’il se doit d’accorder à Marvin, son bouledogue jaloux et facétieux. En vérité, même cette histoire de couple qui se sépare n’apporte pas de véritable tension dans le film. Le seul véritable drame, en fin de compte, vient dee celui qu’on n’attend pas et il prend, lui aussi, des allures de farce !
Jim Jarmusch a réalisé un film d’une grande simplicité, une simplicité telle qu’elle provoquera peut-être de l’ennui chez certains spectateurs. D’autres n’y décèleront que de la vacuité (c’est le mot qu’emploie le critique d’un site spécialisé dans le cinéma). Pour ce qui me concerne, bien au contraire, j’ai été profondément touché par les personnages de ce film et j’ai été conquis par le ton adopté par le réalisateur. Bien loin de m’ennuyer, j’ai trouvé dans cette œuvre l’inestimable goût de la poésie, ce goût qui m’a irrésistiblement séduit lorsque j’étais enfant et qui ne m’a jamais quitté.
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161202 – Cinéma
SULLY
un film de Clint Eastwood.
Il ne faut désespérer de personne, surtout pas d’un cinéaste qui a su donner les preuves de son talent à de nombreuses reprises dans le passé. Il y avait cependant de quoi se poser des questions. Depuis une bonne dizaine d’années, toutes les réalisations de Clint Eastwood m’avaient semblé plus ou moins décevantes, voire carrément détestables, à l’image du dernier film en date, « American sniper » (2014), œuvre nauséeuse dont le héros était un tireur d’élite ayant abattu 255 cibles durant la guerre d’Irak.
Aujourd’hui, au contraire, le héros choisi par le cinéaste est un homme dont la gloire est d’avoir sauvé des vies. Le commandant Sullenberger, appelé familèrement Sully (Tom Hanks), c’est ce pilote d’un Airbus A320 qui, alors que son avion était en péril au-dessus de New-York, a décidé de le faire amerrir sur l’Hudson, sauvant ainsi les 155 vies qui étaient à son bord. Cela a duré exactement 208 secondes : si peu de temps pour prendre une décision et, plutôt que de tenter de rejoindre une piste d’atterrissage, oser se poser sur le fleuve. C’est ce que les journalistes ne tardèrent pas à désigner par « le miracle de l’Hudson ».
Comment faire un film intéressant, captivant, sur ces 208 secondes sans refaire pour la énième fois un film catastrophe sur une histoire d’avion en danger ? C’est là qu’intervient le talent de Clint Eastwood, car « Sully » réserve la surprise d’être bien davantage qu’un simple et banal film catastrophe. Certes le réalisateur nous impressionne aussi sur ce plan-là : les 208 secondes fatidiques sont filmées avec un formidable savoir-faire. Mais ce qui donne au film sa grandeur et sa force, c’est son personnage principal, son héros que les uns acclament mais que les autres interrogent sans relâche.
Car, même si tous les passagers sont sains et saufs, une commission d’enquête cherche à déterminer si Sully n’a pas failli à son devoir. Plutôt que de prendre le risque d’amerrir sur l’Hudson, le pilote n’aurait-il pas dû mener l’avion jusqu’à une des pistes d’atterrissage les plus proches ? En avait-il les moyens ? Ces soupçons rejaillissent sur lui, l’isolent et le tourmentent au point qu’il ressasse inlassablement l’événement. Le titre de héros qu’on lui a si vite attribué ne va pas de soi à ses yeux, il est loin de l’accepter comme une évidence.
Il lui faut donc revivre par la pensée, comme une obsession, chacune des secondes du drame, soupeser les mots échangés avec son copilote et les décisions qu’il a prises. Et rappeler aux enquêteurs la part de l’humain. Face aux simulateurs de vol qui essaient de recréer l’événement afin de vérifier si réellement il n’y avait pas moyen de rejoindre une piste d’atterrissage, c’est ce que rappelle Sully. Aux commandes d’un avion se trouve un homme et non une machine. Un homme à qui, certes, il est nécessaire d’accorder quelques secondes de plus pour prendre une décision, mais un homme qui va jusqu’au bout de l’exploit afin de sauver les vies qui lui sont confiées.
En choisissant de faire le portrait de ce héros malgré lui, de cet homme qui doute, qu’on malmène et qui cherche sa guérison, Clint Eastwood a réussi un film à la fois haletant et bouleversant.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161126 – Cinéma
UNE VIE
un film de Stéphane Brizé.
Les spectateurs d’aujourd’hui, trop habitués peut-être à voir des films qui ne leur épargnent rien, à avoir affaire à des cinéastes qui se croient tenus de tout montrer à l’écran, prenant le risque du voyeurisme, ces spectateurs-là risquent fort d’être déstabilisés s’il leur vient l’idée d’aller voir cette adaptation d’un roman de Guy de Maupassant. Le réalisateur, Stéphane Brizé, y a fait des choix de mise en scène si radicaux qu’ils vont clairement à l’encontre de ce qui se pratique le plus souvent de nos jours. Son film est épuré à l’extrême, laissant de côté à peu près tout ce qui est de l’ordre du sensationnel ou de l’événementiel, ce qui, évidemment, peut surpendre et dérouter plus d’un spectateur. Il suffit d’aller voir, comme je l’ai fait, l’un après l’autre, « La Fille de Brest » d’Emmanuelle Bercot et ce film de Stéphane Brizé pour percevoir deux manières radicalement opposées de mettre en scène un récit. Dans « La Fille de Brest », film au demeurant intéressant, la réalisatrice a cru bon de tout mettre sous nos yeux, y compris le corps d’une défunte en train d’être autopsiée, ce que je déplore. Rien de tel dans « Une Vie », film qui élude, qui laisse hors champ presque tout ce qui est de l’ordre du spectaculaire. Je n’ai pas besoin de préciser que c’est la manière choisie par Stéphane Brizé qui me paraît de loin la meilleure. C’est celle qui respecte le spectateur, c’est celle qui parie sur son intelligence, sa perception et sa sensibilité (au lieu de lui servir un spectacle qu’il n’a plus qu’à consommer passivement).
Dans « Une Vie », c’est par le moyen d’une voix off ou d’un plan très fugace que le réalisateur évoque des moments importants de l’histoire, préférant montrer à l’écran l’avant et l’après plutôt que les événements eux-mêmes. Ceux qui ont vu récemment « La Mort de Louis XIV » d’Albert Serra (qui nous fait assister à l’agonie du roi-soleil jusqu’à la nausée) seront tout étonnés par le moyen dont use Stéphane Brizé pour nous renseigner sur le décès d’un des personnages du film : simplement en filmant son nom sur une pierre tombale, rien d’autre.
J’imagine bien volontiers que ce qui précède risque d’en décourager plus d’un. « Ce film, s’il est si économe en événements, doit être très ennuyeux », se dit-on peut-être. Mais non, il n’en est rien. Ou, plus exactement, ne s’ennuieront que ceux qui ne conçoivent le cinéma que comme un produit à consommer passivement, que ceux qui ne vont voir un film que pour assister à un spectacle qui ne leur demande aucune participation ni de compréhension ni d’imagination.
Ajoutons que, dans « Une Vie », Stéphane Brizé prend cependant grand soin de mettre en scène des moments clés du récit : non pas les événements à proprement parler, mais les choix que doit opérer son héroïne, Jeanne (jouée par Judith Chemla), choix qui déterminent son avenir. Deux de ces moments se déroulent d’ailleurs dans une confrontation avec un prêtre. D’abord avec le vieux curé de son village qui lui demande avec insistance si elle accepte de pardonner à son mari fautif. Ensuite, plus loin dans le cours de l’histoire, avec le nouveau curé, beaucoup plus jeune, avec qui elle débat rudement à propos de la vérité et du mensonge. Faut-il dire la vérité en toutes circonstances, quelles qu’en soient les conséquences, même lorsque la confession de vérité doit engendrer des désastres humains ?
Filmé en format carré (qui convient bien à cette histoire) et au moyen d’une superbe photographie, ce film, qui conte les malheurs d’une femme qui perd tout (y compris celui qu’elle aime le plus au monde, son propre fils) restera dans les mémoires, je le suppose, comme une des œuvres cinématographiques les plus touchantes de cette année.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161124 – Cinéma
LE DISCIPLE
un film de Kirill Serebrennikov.
Un grand adolescent qui reste à la maison au lieu de rejoindre ses camarades de classe à la piscine puis qui, contraint de s’y rendre, fulmine contre l’indécence des filles qui s’y exposent en bikini ! A qui a-t-on affaire ? A un extrémiste musulman ? Pas du tout ! Nous sommes dans la Russie d’aujourd’hui, le garçon a pour prénom Veniamin (Petr Skvortsov) et il ne rate pas une occasion d’affirmer qu’il est chrétien ! Le metteur en scène de théâtre Kirill Serebrennikov, honni par les autorités russes à cause de ses prises de position avant-gardistes et de sa défense des minorités, passe aujourd’hui derrière la caméra pour nous brosser le portrait d’un fanatique religieux de son pays. Et n’imaginons pas que ce jeune homme soit un cas ou une rareté : « le problème, prévient le réalisateur dans une interview, c’est que des Veniamin, il y en a, désormais, des flopées, des hordes… ».
L’adolescent, tel qu’il se présente dans le film, paraît pourtant très isolé, mais c’est sans doute parce qu’il se refuse à faire partie d’une communauté, quelle qu’elle soit, et parce qu’il s’oppose à tout le monde. On n’a affaire ni à un garçon obtus ni à un nigaud, bien au contraire, on le devine malin, rusé, capable d’apprendre par cœur des dizaines et des dizaines de versets de la Bible et de les réciter en fonction des circonstances. Mais cet intégriste est si convaincu d’être dans la vérité et il est si enfermé dans ses convictions religieuses qu’il ne ressent plus que du mépris pour tous ceux qui sont différents de lui.
Tout est suspect à ses yeux et chacun de ceux qu’il côtoie lui semble dévoyé : les filles à cause de leur prétendue impudicité et parce qu’elles apparaissent comme des tentatrices, les homosexuels parce qu’ils s’adonnent à ce qu’il considère comme un vice abominable, les prêtres orthodoxes parce qu’ils ne songent qu’à s’enrichir et transmettent une religion de pardon, les professeurs parce que leurs enseignements ne s’accordent pas avec la Bible. Même sa mère ne trouve pas grâce à ses yeux à cause de son divorce. Pour accréditer la condamnation de tout ce monde, il suffit à Veniamin de puiser dans le catalogue de citations bibliques qu’il a apprises et qu’il se fait un plaisir d’assener (et dont le réalisateur indique chacune des références sur l’écran). L’adolescent fait ce que font tous les intégristes, tous les fondamentalistes religieux, tous les fanatiques : il utilise les textes, il en isole soigneusement les passages qui servent ses intérêts et semblent conforter ses convictions et les martèle à la figure de ses « ennemis ». Les textes bibliques, tels qu’il les énonce, ne sont plus rien d’autre que des instruments sélectionnés et mis au service de sa haine des autres.
Celle contre qui il s’oppose le plus brutalement, c’est sa professeure de biologie car son enseignement darwinien le révulse au plus haut point. Et l’affrontement entre les deux personnages donne lieu à des scènes atterrantes, voire effrayantes, et qui mettent aussi en lumière les peurs et les lâchetés de la directrice de l’établissement scolaire et des autres professeurs.
En fait, ce que montre parfaitement la mise en scène efficace de Kirill Serebrennikov, c’est que la folie de l’adolescent est telle que tout dialogue avec lui semble impossible. La professeure de biologie s’y prend très mal en essayant de le contredire sur son propre terrain, c’est-à-dire en cherchant à son tour à argumenter à coups de citations bibliques. La mère de Veniamin, de son côté, s’efforce d’établir un dialogue avec son fils mais sans jamais vraiment y parvenir. Le garçon s’est enfermé dans sa terrfiante solitude, il n’a personne à qui parler en vérité, si ce n’est, peut-être, le seul camarade de sa classe avec qui il noue une sorte d’amitié, un infirme qu’il cherche à entraîner dans son sillage et à qui il fait des promesses insensées.
En réalité, en focalisant sa caméra sur ce personnage rempli non seulement de la haine des autres mais aussi de lui-même (car, on le comprend à la fin du film, il ne s’accepte pas tel qu’il est), le metteur en scène révèle avec habileté les mensonges et les bassesses qui gangrènent son pays. Il n’y a pas besoin de grand chose pour qu’apparaissent sur les visages des uns et des autres les affligeants rictus qui accompagnent les propos homophobes ou les insinuations hideusement antisémites. Ce film « coup de poing » nous interpelle vivement, qui que nous soyons, quel que soit notre pays, Russie, Etats-Unis, France, à l’heure où se répandent de plus en plus les tentations intégristes, les replis identitaires et les professions de foi réactionnaires. Même quelqu’un qui se réclame du Christ et ne cesse de citer la Bible peut prêcher une religion de violence et de haine, plutôt que d’amour et de pardon. A nous de réagir, à nous de montrer à tous ce qu’est le vrai visage d’un disciple du Christ !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161121 – Cinéma
POLINA, DANSER SA VIE
un film de Valérie Müller et Angelin Preljocaj.
Ayant brillamment servi la danse en tant que danseur et chorégraphe depuis bien des années, voici qu’Angelin Preljocaj ajoute à son arc la corde du cinéaste, tout en restant fidèle à l’univers qu’il connaît. Aidé de Valérie Müller, c’est une bande dessinée de Bastien Vivès consacrée au monde de la danse qu’il adapte aujourd’hui pour le grand écran, et tous deux le font avec un indéniable talent. Le film est passionnant de bout en bout et il l’est d’autant plus que le parcours qu’il raconte se modèle pour une grande part sur celui d’Angelin Preljocaj lui-même.
On le découvre dès le début du film, alors qu’elle n’est encore qu’une enfant, Polina est issue d’un milieu très modeste. Ses parents (lui Géorgien, elle Sibérienne) cultivent pourtant l’ambition de voir leur fille non seulement intégrer la troupe du Bolchoï mais devenir une danseuse étoile. Son apprentissage de la danse, Polina le fait donc dans un cadre prestigieux mais très strict. Le professeur auquel elle a affaire est un homme qui ne craint pas de rudoyer ses jeunes élèves : l’art de la danse ne s’apprend pas en dilettante, il suppose à la fois de la maîtrise et de l’abandon.
Mais Polina, à présent devenue une jeune fille ( Anastasia Shevtsova), le pressent, elle ne réussira jamais à s’épanouir totalement en n’exerçant que de la danse classique (celle qui est enseignée au Bolchoï). Quitte à décevoir ses parents, elle choisit de quitter la célèbre institution de son pays, la Russie, pour s’exiler en France et y apprendre la danse contemporaine. La jeune fille y découvre certes d’autres façons de danser, plus épanouissantes pour elle, mais au prix de beaucoup d’épreuves, de « galères » de toutes sortes.
Sans jamais tomber dans le misérabilisme et en évitant tous les poncifs du film de danse, Angelin Preljocaj et Valérie Müller mettent en scène, avec beaucoup d’habileté la plupart du temps, le parcours chaotique d’une jeune fille passionnée par son art. Ce qu’apprend Polina au fil du temps et de ses expériences, c’est, comme l’indique le titre du film, à « danser sa vie », autrement dit, comme le lui demande une de ses enseignantes (jouée par Juliette Binoche), à éviter d’être « une jolie danseuse » pour être elle-même, Polina, en train de danser et d’exprimer par son corps sa vie, ses émotions, sa personnalité.
Nul doute que, comme je l’ai déjà indiqué, Angelin Preljocaj a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage, lui qui, tout en restant imprégné de danse classique, met en scène des chorégraphies de danse contemporaine. Le film cependant fait surtout la part belle aux répétitions, à l’apprentissage de la danse, plus qu’aux chorégraphies elles-mêmes. Il faut attendre les scènes finales pour voir une longue et magnifique séquence de danse sur le superbe concerto pour violon de Philip Glass. C’est l’apothéose d’un film qui m’a constamment tenu en haleine.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161112 – Cinéma
MAMAN A TORT
un film de Marc Fitoussi.
« Bienvenue dans le monde du travail ! ». Ce sont les mots que prononce Cyrielle (Emilie Dequenne) au moment où elle introduit sa fille Anouk (Jeanne Jestin, épatante), une adolescente de 14 ans, dans l’entreprise dont elle est une salariée. C’est dans l’urgence qu’il a fallu trouver pour la collégienne, scolarisée en classe de 3ème, un lieu où faire un stage d’une semaine en entreprise. Le père ayant failli à cette tâche, la mère s’est résolu à proposer son propre lieu de travail, une agence d’assurances.
C’est une riche idée que d’avoir imaginé un scénario se déroulant dans le monde de l’entreprise en y faisant s’y confronter le regard neuf, presque innocent, d’une adolescente à peine sortie de l’enfance et les regards aguerris, voire blasés, des adultes qui y exercent leur emploi. Anouk découvre un monde dont elle ignore à peu près tout mais, comme elle est de nature curieuse, voire fureteuse, elle ne tarde guère à en sonder les arcanes et à s’étonner de ce qu’elle découvre. Les surprises sont d’autant plus grandes qu’il s’agit, entre autres, de sa propre mère. Comment admettre que cette dernière soit vertement remise en place par un collègue ? Pire encore : comment comprendre que sa mère soit impliquée dans de louches combines visant à enrichir l’entreprise au détriment de ceux qui devraient en être les bénéficiaires ?
Pas question pour Anouk de se contenter de ranger un cagibi comme on lui a ordonné de le faire (sans d’ailleurs lui donner davantage de précisions, car manifestement on ne sait que faire d’une jeune stagiaire). L’adolescente cherche, fouine, interroge, pour le compte d’une femme qu’elle estime être l’une des victimes des agissements de l’entreprise. Emue, bouleversée, ne laissant parler que son cœur, elle n’a de cesse de démêler les suspectes intrigues qu’elle perçoit ou devine.
Ce film de Marc Fitoussi n’a rien d’une comédie, contrairement à ce que pourrait laisser présager son titre. Ou alors c’est une comédie très âpre et très grinçante. Même si l’on y trouve quelques personnages hauts en couleurs, le monde de l’entreprise, tel qu’il est montré ici, se révèle surtout rude, mesquin et dénué de toute compassion. Sur un mode certes plus léger que « Moi, Daniel Blake » de Ken Loach, c’est aussi, d’une certaine façon, un film de combat que « Maman a tort », puisqu’il dénonce sans ambiguïté les magouilles dont se rendent coupables des dirigeants d’entreprises allant jusqu’à faire pression sur les salariés pour en faire les complices de leurs malversations. Mais ce qui donne à ce film un ton et un charme particuliers, c’est la mise en scène des rapports mère-fille. Voir sa mère sur son lieu de travail, c’est, forcément, en découvrir un visage nouveau, surprenant, inattendu… Heureusement Anouk est une adolescente généreuse et sensible. Et l’on se dit à la fin du film : « Pourvu qu’elle garde son grand cœur, même quand elle aura grandi, même quand elle sera, à son tour, une adulte exerçant un travail ! ».
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161027 – Cinéma
MOI, DANIEL BLAKE
un film de Ken Loach.
Je l’avoue, lorsque j’ai eu connaissance de l’attribution de la Palme d’Or du dernier festival de Cannes à ce film, ma première réaction fut celle d’un cinéphile dépité. Je me suis dit : « Pourquoi une deuxième Palme d’Or à Ken Loach (après celle reçue pour « Le vent se lève » en 2006) ? N’aurait-il pas été plus judicieux de récompenser un cinéaste plus jeune et n’ayant pas encore été gratifié d’un prix ? » Cela étant dit, aujourd’hui, maintenant que j’ai vu le film du réalisateur anglais, je comprends combien et pourquoi il a séduit le jury du festival et je me dis que c’est loin d’être un mauvais choix. Car « Moi, Daniel Blake » peut sans nul doute être classé parmi les meilleures réalisations de Ken Loach (avec « Raining Stones » – 1993 – par exemple, ou encore « Ladybird » – 1994 – et d’autres films de cet acabit) et l’attribution de la Palme d’Or peut lui donner, je l’espère, le rayonnement qu’il mérite.
Une fois encore, aidé de son fidèle scénariste Paul Laverty, Ken Loach réussit à la perfection un grand film politique, un film d’indignation et de combat, mais sans jamais l’alourdir d’un poids ouvertement idéologique. Plusieurs commentateurs ou critiques ont cru bon de dénoncer le caractère prétendument manichéen de « Moi, Daniel Blake » mais, à mon avis, tous se sont fourvoyés. Le terme de « manichéen » ne peut nullement s’appliquer à ce film. Si l’on tient absolument à lui accoler un qualificatif, seul celui de kafkaïen peut convenir. Le film montre que ce qu’on appelle l’Etat-providence s’est tellement dégradé qu’il a engendré un système d’inhumanité, un système qui ne tient plus compte des personnes, mais dont le but est de s’auto-réguler en appliquant indifféremment les mêmes directives à tous ceux qui font appel à lui. Ce système n’engendre pas des bons et des méchants, mais il met face à face des employés d’administration chargés d’exécuter des ordres et des demandeurs qui risquent de n’être pas mieux considérés que s’ils étaient des pions. Ken Loach est si peu manichéen qu’il a pris soin de mettre en scène l’un ou l’autre employé d’administration ayant encore conservé son souci d’aider sincèrement les demandeurs, tandis que d’autres, il est vrai, n’ont plus d’autre objectif que d’appliquer les règles imposées. Il ne cherche pas à séparer les bons des méchants, il a l’ambition de dénoncer un système qui humilie les plus faibles au point d’en faire des laissés-pour-compte en même temps que des assistés.
Certains n’ont pas ou n’ont plus leur place dans la société d’aujourd’hui, tel le personnage éponyme du film, Daniel Blake, un charpentier de 59 ans qui, après avoir subi une attaque cardiaque, perd son travail. Le voilà pris entre deux feux, dans une situation kafkaïenne : d’un côté, son médecin lui interdit de reprendre un travail, de l’autre l’administration veut le contraindre à chercher un travail, sous peine, s’il s’y refuse, à le laisser sans ressources. Forcé de respecter d’obscures procédures, obligé de remplir des questionnaires sur internet (lui qui ignore tout du fonctionnement d’un ordinateur), contraint d’assister à l’application de règlements administratifs humiliants, il comprend que tout est conçu, d’une certaine manière, pour le pousser à l’exclusion, lui et tous ceux qui lui ressemblent. Que peut-il surgir, dès lors, des entrailles de Daniel Blake, sinon un désir de révolte ? De la révolte, oui, il y en a dans le film de Ken Loach, mais il y a aussi autre chose : il y a la solidarité des humbles, des petits, des laissés-pour-compte. C’est ce qui donne au film un ton extrêmement touchant, poignant, qui va droit au cœur. Le système administratif a beau faire de Daniel Blake un révolté, il lui reste son cœur qui bat (même si c’est un cœur affecté par la maladie). C’est un homme au cœur sur la main, comme on dit, et qui n’hésite pas une seconde à se mettre au service de Katie, une femme rejeté par le système comme lui mais ayant à charge deux enfants. Daniel Blake fait tout ce qui est en son pouvoir pour les aider, leur donner du baume au cœur, etc. Il ne mesure pas sa générosité. Si les rejetés de la société ont tout perdu, il leur reste néanmoins cela : l’entraide, la solidarité, l’amitié. L’inhumanité du système administratif n’a, fort heureusement, pas détruit l’humanité de ceux qui en sont les victimes. Quelques scènes bouleversantes du film (en particulier celle qui se déroule dans une banque alimentaire) nous montrent l’humain dans ce qu’il a de plus fragile et de plus noble.
Ken Loach, âgé de 80 ans aujourd’hui, avait décidé, je crois, de ne plus réaliser de film après « Jimmy’s Hall » en 2014. Fort heureusement, il n’a pas pu se retenir de se mettre à nouveau derrière la caméra et de nous offrir ce grand film, ce film de révolté, ce film exaltant la générosité des plus petits. Qu’il en soit remercié !
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
SING STREET
un film de John Carney.
Il m’arrive, de temps à autre, comme à tout cinéphile, d’être déçu par un film que pourtant j’avais attendu avec délectation (à cause d’une critique alléchante ou d’un sujet suscitant mon intérêt). A contrario, fort heureusement, il m’arrive aussi, comme à tout cinéphile également, d’être enchanté par un film dont je n’espérais pas grand chose. Ce fut le cas à propos de « Sing Street » : le sujet (une bande d’adolescents irlandais du milieu des années 80 se défoulant en faisant de la musique) ne m’attirait guère. Mais, le film bénéficiant de critiques élogieuses, je me suis résolu à aller le voir et je n’ai eu qu’à m’en féliciter. Tout m’a séduit, tout m’a non seulement convaincu mais enthousiasmé.
Ce film plein d’énergie enchante littéralement mais également passionne parce qu’on devine que le réalisateur y a mis beaucoup de lui-même, beaucoup de sa propre histoire. Même dans ses quelques excès, il garde un ton de vérité, une approche qui semble marquée du sceau du vécu. Le personnage principal du film se prénomme Conor et c’est un lycéen de 15 ans que ses parents, à cause de difficultés financières, retirent d’un établissement privé pour l’inscrire à l’école publique. Le choc est rude. A la fois du fait des autres élèves pour le moins turbulents et du fait du directeur, un prêtre aux méthodes rigides, voire brutales (n’oublions pas que nous sommes à Dublin dans les années 80, c’est-à-dire à mille lieues de la laïcité à la française!).
Le malheureux Conor semble voué aux pires épreuves, d’autant plus que, chez lui, ça ne va pas fort : ses parents ne cessent de se quereller sans cependant pouvoir divorcer (le divorce étant interdit en Irlande à cette époque-là!). Mais l’adolescent n’est pas du genre à baisser les bras : il parvient à se lier à quelques élèves de sa nouvelle école et, surtout, il aperçoit, non loin de l’établissement, une jeune fille un peu plus âgée que lui et d’une ravissante beauté. Elle se prénomme Raphina. Le garçon l’aborde aussitôt et cherche à l’impressionner en lui disant qu’il fait partie d’un groupe de musique et qu’il cherche une partenaire féminine pour un clip vidéo qu’il veut tourner. Rien de tout cela n’est vrai, mais Raphina le prend au mot et Conor, s’il veut ne pas perdre la face, se trouve obligé de rendre effectif ce qui n’était que vantardise.
Qu’à cela ne tienne ! Conor se met aussitôt à la recherche de musiciens en herbe et ne tarde pas à composer ses premières chansons. Avec ses copains, avec Raphina qui entre dans le jeu, le film se pare d’un ton festif tout en préservant quelque chose de mélancolique. Quand on lui demande quel genre de musique il veut faire, Conor répond en affirmant qu‘il est futuriste. Mais la vérité, c’est que toutes ses chansons (ou presque) sont écrites pour Raphina. La jeune fille n’est pas dupe, bien sûr, et demande à Conor de lui composer quelque chose de plus joyeux que ce qu’il a fait jusque là. C’est alors que Conor imagine un style qu’il définit par deux termes antinomiques : gai-triste. La musique est joyeuse, dynamique, mais les paroles restent mélancoliques. D’autant plus que Conor croit aimer Raphina sans espoir de retour : elle a déjà un petit ami, plus âgé qu’elle, et qui lui a promis de l’emmener à Londres…
Cette antinomie (gai-triste) n’imprègne pas seulement les chansons que compose Conor mais le film tout entier. D’un côté, il déborde d’énergie et de vitalité, de l’autre, il entrouvre des fenêtres sur de dures réalités sociales (tous les personnages vivent dans la précarité) et sur des êtres en situation d’échec. L’un des personnages les plus touchants du film est le frère aîné de Conor : il lui sert, en quelque sorte de mentor, voyant son cadet réussir là où lui-même pense avoir échoué. Il ne semble pourtant pas y avoir d’amertume ni d’envie chez ce frère aîné, mais juste la joie d’aider Conor à trouver une issue pour échapper à la fatalité de la médiocrité.
Ce personnage du frère aîné ainsi que quelques autres (tous admirablement interprétés) rendent ce film réellement passionnant et émouvant. Et, bien sûr, il faut compter avec la qualité de la bande son : impossible de ne pas se trémousser sur son siège quand Conor et ses musiciens y vont de leurs chansons !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161015 – Cinéma
LA FILLE INCONNUE
un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Il m’est bien difficile de m’expliquer le peu d’enthousiasme suscité par ce film lors de sa projection au dernier festival de Cannes. C’est la preuve, en tout cas, qu’il est prudent de ne se fier ni aux applaudissements ni aux sifflets exprimés, tantôt les uns tantôt les autres, par le public cannois. Car ce film, tel qu’il est proposé à présent sur nos écrans, les réalisateurs ayant décidé de le raccourcir de 7 minutes après sa présentation à Cannes, égale le niveau d’excellence de toutes les oeuvres précédentes des deux Frères.
Une fois encore, mais sans aucunement s’autoparodier (comme on le leur a reproché bêtement à Cannes), fidèles à leurs obsessions et à leur style, les Dardenne font le choix d’attacher, en quelque sorte, leur caméra à la suite d’un personnage et de sa quête. En l’occurrence, dans « La Fille inconnue », la caméra ne quitte jamais le personnage joué par Adèle Haenel, celui du docteur Jenny Davin. Elle évolue, tout au long du film, dans un environnement qui, lui aussi, nous est familier, puisqu’il apparaît dans tous les longs-métrages des Dardenne : nous sommes à Seraing, aux portes de Liège.
C’est là que le docteur Davin exerce sa profession : elle occupe le cabinet d’un confrère âgé et malade en attendant, prévoit-elle, d’intégrer un centre médical où sa place est déjà préparée. Mais un événement, qui semble d’abord anodin, bouleverse bientôt le bel ordonnancement de sa vie. Un soir, alors qu’elle est dans son cabinet avec un stagiaire (Olivier Bonnaud) à qui elle vient de faire la leçon (« si tu veux être un bon médecin, tu dois contrôler tes émotions », lui a-t-elle dit parce qu’il s’affolait de voir un jeune patient en convulsions), quelqu’un sonne à la porte. Alors que le stagiaire s’apprête à ouvrir, Jenny Davin, dans un sursaut d’orgueil et dans le but de donner une autre leçon à l’apprenti, lui enjoint de n’en rien faire. « On n’ouvre pas la porte, une heure après la fin des consultations », affirme-t-elle.
Ce malheureux sursaut d’orgueil, c’est, d’une certaine façon, la faute originelle que Jenny Davin va s’efforcer de réparer tout au long du film. Car, très vite, elle apprend que la personne à qui elle a fermé la porte de son cabinet a été retrouvée morte au bord de la Meuse : c’est la fille inconnue qui donne à ce long-métrage son titre. Qui est-elle ? Que faisait-elle à la porte du cabinet médical à une heure tardive ? Se sentant coupable, Jenny Davin n’a de cesse de découvrir l’identité de la morte, de lui donner un nom, de connaître un peu de son histoire et de lui offrir une sépulture plus digne que celle du carré des indigents. Obstinée, déterminée, elle mène une sorte d’enquête, sans se décourager de n’aboutir à pas grand chose (dans un premier temps). La fille inconnue semble précisément n’avoir été remarquée par personne. Elle est aussi évanescente que la silhouette filmée par la caméra de surveillance de l’entrée du cabinet médical. Mais elle a un visage et, bientôt, à force d’entêtement, elle aura également un nom. Car Jenny Davin non seulement ne baisse pas les bras, mais elle répare sa faute en pratiquant son contraire : elle qui a péché par orgueil, elle se met au service et à l’écoute d’autrui, quitte à en payer le prix quand sa recherche de vérité se heurte à ceux qui, bien plus coupables qu’elle, trouvent son obstination très embarrassante.
Ce film aux allures de polar est aussi et surtout un grand film moral. Jenny Davin ne se contente pas de soigner les corps, comme son métier le lui ordonne, mais elle se met à l’écoute des uns et des autres, elle perçoit les souffrances cachées, les blessures secrètes, les culpabilités enfouies. Elle exerce sa profession, réellement, comme un sacerdoce. Elle semble n’avoir aucune relation affective avec qui que ce soit (si ce n’est la sorte d’amitié qui la lie au stagiaire du début du film), elle se donne tout entière à ses patients et à la mission de réparation qu’elle se doit de mener à bien. Patiemment mais avec détermination, elle parvient à en savoir davantage sur la fille inconnue, sur ce qui l’a conduit à la mort, sur ceux qui se sont rendus coupables à son sujet. Sa manière d’être, son obstination, sa qualité d’écoute, l’empathie qu’elle dissimule maladroitement derrière la froideur apparente d’un médecin qui n’est chargé que d’établir de bons diagnostics, tout mène en fin de compte aux aveux.
Dans sa critique parue dans Télérama, Samuel Douhaire va jusqu’à parler de figure christique à propos de Jenny Davin. Il n’est pas question, bien sûr, de chercher à « récupérer » les Frères Dardenne qui n’ont jamais fait mention de la foi chrétienne dans aucun de leurs films. On peut cependant affirmer que leurs préoccupations, leurs sujets, leurs personnages et les motivations qui les guident entrent plus d’une fois en concordance avec les convictions chrétiennes. Dans « La Fille inconnue », le docteur Jenny Davin fait des choix qui engagent la vie entière, elle préfère reprendre le cabinet du médecin qu’elle remplace plutôt que d’intégrer le centre médical qui lui ferait gagner bien plus d’argent, elle conçoit clairement sa profession comme un engagement de tout l’être et, par sa manière d’être, elle conduit ceux qui se sont rendus coupables envers la fille inconnue à se confesser. Pour l’une des coupables, cela se conclut même, après qu’elle ait prononcé ses aveux, par une sorte d’absolution prenant l’aspect d’une accolade.
Je n’ai pas besoin d’en écrire plus pour faire comprendre à quel point, à mes yeux, ce film est important. Nul doute qu’il comptera parmi mes grands coups de cœur de l’année. Ses qualités, il les doit aux Dardenne (dont tous les films, sans exception, sont remarquables), mais aussi au travail extraordinaire effectué par la grande et superbe actrice qu’est Adèle Haenel. Comme ses consœurs (Cécile de France dans « Le Gamin au Vélo » et Marion Cotillard dans « Deux jours, une nuit »), elle a su parfaitement adopter le style des Frères Dardenne et se fondre dans leur environnement. Elle est géniale !
9,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161010 – Cinéma
Etrange film mettant en scène, outre les deux personnages principaux, plusieurs comparses dont on ne sait pas toujours très bien ce qu’ils viennent faire dans cette histoire. On a le sentiment tantôt d’avoir affaire à un récit très réaliste tantôt d’être transporté dans un rêve. Le personnage de Léo est assez intrigant et presque séduisant, mais le film se perd dans un récit confus. Le réalisateur semble s’intéresser grandement à la misère sexuelle de ses personnages. Pourquoi pas? Mais, malheureusement, il la met en scène de manière si frontale et si crue que cela en devient gênant. Je déteste cette manière de filmer, j’ai déjà eu l’occasion de le dire et de l’expliquer. De plus, je trouve que la photographie de ce film est sans attrait.
5/10
20161005 – Cinéma
LE CIEL ATTENDRA
un film de Marie-Castille Mention-Schaar.
C’est une fiction qu’a réalisée Marie-Castille Mention-Schaar mais une fiction tellement ancrée dans le réel qu’elle ressemble à un documentaire. Nul doute que la réalisatrice a pris soin de beaucoup s’informer car ce qu’elle nous montre est à la fois bouleversant et criant de vérité. Le film nous confronte à une des réalités de notre actualité, celle des jeunes gens, ou plus précisément en l’occurrence des jeunes filles qui se laissent séduire par l’islamisme radical au point de s’y trouver prises comme dans un étau. En s’appuyant sur les parcours croisés de deux jeunes filles, la réalisatrice met en scène de manière quasi analytique les processus qui conduisent aux extrémismes.
Sonia (Noémie Merlant), 17 ans, s’est déjà engagée si loin sur cette voie, elle a déjà été si bien embrigadée et formatée qu’elle a failli se rendre en Syrie et commettre l’irréparable, croyant ainsi offrir à ses parents une place au « paradis ». Anéantis, ces derniers tentent de sortir leur fille de ce piège. Ce que le film montre, c’est le lent et difficile processus de déradicalisation de la jeune fille. C’est d’autant plus compliqué que, comme elle finit par l’affirmer, elle n’était plus elle-même. L’embrigadement djihadiste est si insidieux qu’il fait penser à une possession. La victime ne s’appartient plus, elle ne pense, ne vit, ne respire que pour accréditer les thèses de l’islamisme radical. Pour ce qui concerne Sonia, il faut beaucoup de temps, de patience, de discussions, de conflits pour trouver une issue à cette emprise.
Quant à Mélanie (Naomi Amarger), 16 ans, qui pourrait imaginer qu’une adolescente comme elle puisse devenir la proie d’un islamiste radical ? Elle semble mener la vie la plus tranquille qui soit, une vie sans histoires, à la maison avec sa mère ou son violoncelle, au collège avec ses copines. Néanmoins le piège se referme sur elle du fait d’une relation qu’elle noue sur internet et qui bouleverse et son existence et celle de ses proches. Celui avec qui elle discute sur internet a tôt fait de se présenter à elle sous l’apparence d’un « prince », la manipulant habilement de telle sorte qu’elle devient rapidement dépendante, au point de ne plus oser faire quoi que ce soit sans son accord. Insidieusement, le « prince » en vient à lui donner des ordres et, bientôt, comme Sonia, elle rêve de tout quitter pour rejoindre la Syrie.
Fort bien conçu, réalisé et monté de manière judicieuse, ce film concilie habilement son ambition pédagogique et préventive et l’émotion forte qu’il transmet. Il vient à point nommé comme une mise en garde qui s’adresse à la fois à des jeunes gens, probablement fragiles et idéalistes, qui pourraient être des proies pour les recruteurs du djihad et aux parents qui, dans bien des cas, ne découvrent la terrible réalité que lorsqu’il est trop tard. Cela étant dit, je le répète, ce film est aussi une œuvre bouleversante, l ‘émotion qu’il suscite étant due en grande partie aux impressionnantes prestations de ses deux jeunes actrices (Noémie Merlant et Naomi Amarger). On ne peut voir leurs parcours sans être remué aux entrailles.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161003 – Cinéma
LE PAPE FRANÇOIS
un film de Beda Docampo Feijóo.
Parmi tous les genres cinématographiques, celui du film biographique (ou biopic) est sans doute l’un des plus difficiles à mener à bien de manière satisfaisante. Les pièges qu’il faut éviter sont nombreux et, si l’on n’y prend garde, on risque fort de ne proposer qu’une œuvre académique, empesée et soporifique. Preuve en est le film qui vient de paraître sur la danseuse Loïe Fuller et qui m’a semblé terne et ennuyeux du début à la fin (« La Danseuse » de Stéphanie Di Giusto 5/10). A contrario, il y a quelques mois, le film sur le scénariste Dalton Trumbo m’avait considérablement séduit. Mais qu’en est-il d’un film sur le pape François, autrement plus connu en 2016 qu’une danseuse de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ou qu’un scénariste de l’âge d’or d’Hollywood ?
Eh bien, autant le dire sans détours, j’ai été séduit ! Certes l’on n’a pas affaire à un film mémorable mais cette réalisation m’a paru plus qu’honorable, pleine de beaux moments, de belles scènes et surtout aidant à comprendre la personnalité du pape actuel. Et c’est bien ce qu’on est en droit de demander à un film de ce genre. Bien sûr, on peut, si l’on y tient, exprimer quelques réserves ou quelques regrets. On peut, par exemple, chipoter sur l’apparence physique de l’acteur qui joue le rôle titre (Dario Grandinetti). Mais qu’importe ! Faut-il à tout prix qu’un acteur ressemble physiquement à son modèle ou ne faut-il pas plutôt qu’il s’imprègne de son esprit ? De ce point de vue il m’a semblé que l’acteur choisi remplissait plutôt bien son rôle.
Outre l’acteur principal et les autres acteurs et actrices (tous excellents), le grand point fort de ce film, c’est de s’être inspiré, pour son scénario, d’un livre écrit par la journaliste Elisabetta Piqué. Ce sont ses rencontres avec Jorge Bergoglio, futur pape François, qui ponctuent le film tout entier et introduisent à quelques moments forts de sa vie. Ce qu’on découvre du parcours du futur pape, on le découvre par le prisme d’un regard, celui de cette journaliste avec qui Jorge Bergoglio noue des liens amicaux.
On échappe ainsi, fort heureusement, au piège d’une biographie qui prétendrait à l’exhaustivité. Seuls quelques instantanés, quelques moments volés pourrait-on dire, quelques confidences faites à une journaliste apparaissent à l’écran. On est heureux de découvrir le jeune Jorge d’abord séduit par le charme d’une jeune fille puis, ayant décidé de répondre à l’appel qui fera de lui un Jésuite, annoncer cette nouvelle à sa famille (au grand dam de sa mère qui se refuse à admettre que son fils puisse choisir la voie de la vie religieuse). On le voit prendre le risque de défendre des Jésuites menacés pendant la dictature. On voit le prêtre, puis l’évêque se soucier des pauvres au point d’aller à leur rencontre même quand cela risque de déplaire à certains. On est heureux de découvrir à l’écran que, bien avant d’être pape, Jorge Bergoglio se souciait davantage de dispenser de la miséricorde plutôt que d’appliquer indifféremment des lois (fussent-elles des lois d’Eglise) !
Quant aux deux conclaves auxquels il participe, celui qui élit Benoït XVI, puis celui qui l’élit lui-même, ils sont remarquablement mis en scène. On le sait, au conclave de 2013, le premier surpris de l’élection fut Jorge Bergoglio lui-même. « Parmi les cardinaux qui l’ont élu, dit une voix off pendant qu’on les voit quitter la chapelle sixtine, il en est certains qui risquent de regretter leur vote ! ». Juste exclamation qui conclut avec malice ce film qui, sans être une grande œuvre, vaut largement la peine d’être vu !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20161001 – Littérature
JUDAS
un roman d’Amos Oz.
Sous des apparences de simplicité, le nouveau roman d’Amos Oz ne manque ni de subtilité ni de complexité et il ne fait aucun doute qu’on peut le compter parmi les oeuvres importantes de cet auteur. L’intrigue peut assez facilement se résumer. Tout se déroule entre fin 1959 et début 1960 à Jérusalem. Un étudiant hirsute et barbu âgé de 25 ans et prénommé Shmuel, ayant perdu à la fois sa fiancée (qui le plaque pour un autre) et l’allocation mensuelle que lui versait son père, décide d’interrompre ses études. Peu de temps plus tard, il tombe sur l’annonce d’un vieil homme cherchant « un homme de compagnie ». Shmuel se présente et est engagé: Son travail consistera simplement à faire la conversation tous les soirs avec l’instigateur de l’annonce qui s’appelle Wald. Avec lui, réside une mystérieuse et belle femme prénommée Atalia dont on découvre, au fil du récit, qu’elle est la veuve du fils de Wald (mort au combat pendant la guerre d’indépendance de 1948) et la fille d’un certain Shealtiel Abravanel (qui fut considéré, en Israël, comme un traître à cause de ses idéaux de paix et de ses liens amicaux avec des Arabes). La complexité du roman d’Amos Oz provient de ce que, en prenant appui sur ses personnages, sur les liens qui existent ou ont existé entre eux, sur leurs évolutions – Shmuel ne tarde pas à tomber amoureux d’Atalia, qui est pourtant bien plus âgée que lui -, l’auteur aborde, non sans érudition et subtilité, divers thèmes dont, en particulier, celui du traître. Une grande partie du roman, se fondant sur les discussions des personnages et leurs recherches, s’interroge sur la figure du traître. Celui-ci apparaît, tout particulièrement, sous les traits de deux personnages: Shealtiel Abravanel, dont j’ai déjà parlé et qui s’est opposé aux choix politiques de Ben Gourion, Shealtiel qui fut rejeté presque unanimement parce qu’il était considéré comme un rêveur ayant trahi sa patrie, et Judas Iscariote, celui qu’on méprise, le traître par excellence sur qui s’est fondé l’antisémitisme de générations de chrétiens. Car, si Shmuel a pris la décision d’abandonner ses études, il n’en continue pas moins de s’interroger au sujet de Jésus et de son disciple Judas. Et il émet des hypothèses: l’Iscariote était-il vraiment le traître qu’on se plaît à détester et qui fut représenté dans l’iconographie comme la caricature du Juif perfide?
Amos Oz n’est certes pas le premier écrivain à s’emparer de la figure du traître, à s’interroger à son sujet en se référant à celui qui semble en être l’archétype. Bien évidemment, le romancier se plaît à malmener les idées toutes faites. Les hypothèses qu’il formule à propos de Judas ne sont d’ailleurs pas totalement nouvelles. Dès le IIe siècle, un écrit apocryphe (« L’Evangile selon Judas ») estimait que, de tous les disciples, l’Iscariote était le seul à avoir vraiment compris qui était Jésus. Je ne sais si Amos Oz a eu connaissance de ce récit, car il ne le cite pas dans son roman. Toujours est-il que, depuis longtemps, l’on s’interroge à propos de Judas et que l’on n’a sans doute pas fini de le faire. Amos Oz, par le biais d’un roman qui est aussi une méditation et une réflexion sur le thème de la traîtrise, y contribue à sa manière et il le fait avec intelligence. Quoi qu’on pense des hypothèses qui sont formulées dans ce livre, on n’en est pas moins interpellé et dérangé dans ses certitudes ou ses idées toutes faites. Personnellement, j’ai fait depuis longtemps ce choix de préconiser davantage les écrits qui nous interrogent, voire qui nous déstabilisent, plutôt que ceux qui se contentent de nous conforter dans ce que nous croyons (ou croyons croire) déjà! De ce point de vue, outre ses indéniables qualités littéraires, le « Judas » d’Amos Oz apparaît comme des grands romans de cette rentrée littéraire.
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160924 – Cinéma
JUSTE LA FIN DU MONDE
un film de Xavier Dolan.
Cela fait douze ans que Louis (Gaspard Ulliel), jeune écrivain de théâtre, n’a pas renoué avec les membres de sa famille autrement qu’en envoyant fidèlement à chacun une carte postale à la date de son anniversaire. Mais à présent, ce qu’il lui faut leur annoncer est d’un autre registre et d’une gravité telle que cela ne peut se dire, lui semble-t-il, que de vive voix, en allant les voir : le jeune homme est gravement malade et il est condamné à mourir prochainement. Le voici donc qui débarque chez les siens. Tous sont présents : la mère (Nathalie Baye), sa sœur Suzanne (Léa Seydoux), son frère Antoine (Vincent Cassel) et sa belle-soeur Catherine (Marion Cotillard) qu’il n’avait encore jamais rencontrée.
Ces retrouvailles, bien sûr, si elles sont inaugurées par des étreintes et des exclamations, n’ont rien cependant ni de paisible ni de serein. Chez ces gens-là, pour reprendre l’expression de Jacques Brel, la tension est quasi permanente, presque palpable, et les relations plutôt conflictuelles. Certes Suzanne et, davantage encore, Catherine, ne manquent ni de bienveillance ni d’attention, mais la mère apparaît fantasque, imprévisible, et le frère sanguin, s’irritant de la moindre parole qui, pour une raison ou une autre, lui paraît futile. Dans ce jeu complexe de relations, dans le réseau contradictoire des gentillesses et des méchancetés mâtiné de maladresses, comment faire entendre une parole de vérité, comment se livrer à des aveux ? Entre les conflits qui n’ont pas besoin de grand chose pour s’exprimer autrement que de manière latente, y a-t-il place et pour une véritable confession et pour une parole de miséricorde ? Peut-être, semble nous dire ce film, le pardon n’est-il qu’un oiseau échappé du temps et qui, malgré sa grâce, ne peut plus rien d’autre que de se cogner dans les murs et dans le plafond ?
Adapté d’une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce et venant à la suite d’un de ses chefs d’oeuvre (« Mommy »), ce nouveau film de Xavier Dolan pourrait être facilement qualifié de mineur, mais ce serait sans doute se méprendre. Le cinéaste s’est manifestement approprié sa source théâtrale au point de lui donner un ton et des couleurs qui sont propres à son univers. On y retrouve aisément son style. Le cinéaste use d’une abondance de gros plans, prenant le risque d’une apparence de monotonie, mais c’est pour mieux scruter chaque trait des visages et chaque regard et, loin d’être assommant, le film en devient fascinant. Xavier Dolan sait d’ailleurs parfaitement rompre l’apparente uniformité de ses scènes en osant quelques-unes de ces belles envolées lyriques dont il a le secret. Mais le plus fort et le plus émouvant de ce film, ce sont les regards. C’est un film qui s’appuie sur les regards. Et, paradoxalement, puisqu’on a affaire, à l’origine, à une pièce de théâtre, ce sont les scènes muettes qui m’ont paru les plus intenses et les plus belles : rien que par leurs regards, les personnages en disent plus que par toutes leurs paroles : ainsi les regards qu’échangent Louis et Catherine au début du film, celui de Louis étreignant sa mère, celui de Louis encore fixant une scène à travers des persiennes, etc. Il convient de dire enfin que le film est servi par la crème des acteurs et actrices d’aujourd’hui. Mais encore faut-il leur offrir une mise en scène inventive et attractive, ce que réussit brillamment, une fois de plus, le jeune prodige québecois Xavier Dolan.
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160921 – Cinéma
BROOKLYN VILLAGE
un film de Ira Sachs.
C’est par un simple appel téléphonique que Jake (Jacob de son vrai prénom), un adolescent de 13 ans, apprend la mort de son grand-père. Déjà, dès le début du film, cette scène en donne le ton : le réalisateur préfère la nuance et la subtilité plutôt que les grands effets. Car si c’est par le truchement d’un appel téléphonique qu’est révélé à Jake ce décès, c’est, pour le réalisateur, une manière d’indiquer, l’air de rien, le peu de proximité qui subsistait entre le défunt et ses descendants. Toujours est-il que les parents de l’adolescent en profitent pour déménager et s’installer dans l’appartement de Brooklyn où résidait l’aïeul et dont ils héritent. D’abord mécontent, Jake ne tarde pas à se satisfaire pleinement de ce changement de cadre de vie qui signifie pour lui la naissance d’une amitié.
Son nouvel ami, un garçon de son âge, se prénomme Toni et il est le fils de Leonor, une couturière qui tient boutique juste au-dessous de l’appartement où il habite désormais. On ne tarde pas à apprendre que c’est le défunt grand-père qui avait accueilli, pour un loyer des plus modestes, l’humble retoucheuse de vêtements. Entre les deux garçons, nonobstant leur différence de classe sociale, naît et grandit une amitié qui semble indéfectible. Jake est beaucoup plus introverti que Toni, mais qu’importe, tous deux partagent le même désir, celui d’être admis dans une prestigieuse école où pourront s’épanouir leurs talents d’artistes.
Cette belle amitié, si, dans un premier temps, elle semble parfaitement convenir et à Brian, le père de Jake, et à Leonor, elle n’en devient pas moins, au fil du temps, à leurs yeux, de plus en plus embarrassante et incongrue. C’est qu’un élément nouveau intervient : Brian, du fait de la précarité de son emploi (il est comédien) et de la pression exercée par sa sœur, en vient à exiger de Leonor le paiement d’un loyer beaucoup plus conséquent que celui qu’elle versait jusque là. Pour la modeste couturière, bien évidemment, une telle demande est impossible à honorer.
Ira Sachs, sans jamais s’appesantir sur l’aspect dramatique de son récit, montre néanmoins parfaitement, par petites touches, comment s’agrandit la cassure qui sépare le monde des adolescents de celui des adultes, leurs parents. Le réalisateur se garde bien, cela dit, d’accabler ses personnages, il ne manie pas la caricature, mais, avec délicatesse, il montre que, même chez Brian, homme qui n’a rien d’un monstre, ce sont les impératifs économiques qui l’emportent sur tout le reste. « Nul ne peut servir deux maîtres », comme il est dit par Jésus dans l’Evangile (Lc 16, 13). L’amitié de deux adolescents, malheureusement, ne pèse pas bien lourd sur le plateau de la balance quand, de l’autre côté, s’impose le poids de l’argent. Ce film poignant et délicat en est l’illustration.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160909 – Cinéma
FRANTZ
un film de François Ozon.
Librement inspiré d’une pièce de Maurice Rostand déjà adaptée au cinéma par Ernst Lubitsch en 1932 sous le titre de « Broken Lullaby », le nouveau film de François Ozon s’en démarque toutefois suffisamment pour en faire une œuvre originale et singulière, un chef d’oeuvre de finesse et d’émotion dont les thèmes entremêlés nous interrogent et nous bouleversent : celui du conflit et du pardon et celui de la vérité et du mensonge, ce thème-ci étant récurrent chez le cinéaste qui l’a abordé dans plusieurs de ses films (« Jeune et jolie » et « Une nouvelle amie » par exemple). Mais, même si j’ai déjà eu bien des fois l’occasion d’en souligner les mérites, jamais encore l’art de François Ozon ne m’avait autant enthousiasmé que dans ce nouveau film dont il faut souligner tous les aspects : scénario, mise en scène, photographie, musique et jeu des acteurs et actrices, en insistant sur celui de Paula Beer (sans aucun doute la révélation du film).
Dix ans après une œuvre remarquable intitulée « Angel », c’est la deuxième fois que François Ozon signe un film en costumes. L’action démarre dans une cité d’Allemagne (Quedlinburg) en 1919. Les plaies de la Grande Guerre sont encore vives et c’est peu dire que les habitants de cette ville ne voient pas d’un bon œil séjourner chez eux un jeune homme venant de France et prénommé Adrien (Pierre Niney). Que peut-il bien venir faire là ? Pour Anna (Paula Beer), qui vient chaque jour entretenir la tombe de Frantz Hoffmeister, son fiancé mort au combat, la surprise est encore plus grande, puisqu’elle découvre que le Français, lui aussi, vient se recueillir au cimetière et pleurer le même disparu. Intriguée, elle ne tarde pas non seulement à faire sa connaissance mais à l’introduire chez les parents du défunt. Hostile dans un premier temps (« Chaque Français est l’assassin de mon fils ! », dit-il), le père de Frantz ne tarde pourtant pas à s’amadouer. Si ce Français a réellement connu et fréquenté leur fils, avant la guerre, au point d’en être l’ami, les Hoffmeister ne demande pas mieux que de se consoler un peu en l’écoutant en faire le récit. « N’ayez pas peur de nous rendre heureux », lui demande même la mère de Frantz.
Peut-il vraiment donner du bonheur à ces gens ? Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’Adrien se trouve pris dans un jeu affectif qu’il n’avait sans doute pas prévu. Et pour ce qui est de raconter, il raconte : son amitié avec Frantz, leur passion commune pour le violon, une visite au Louvre qu’ils firent ensemble, etc, etc. Comment s’arrêter quand on s’est laissé entraîner dans un discours mensonger, comment ne pas en rajouter encore et encore, d’autant plus qu’on a affaire à des personnes meurtries que ces paroles apaisent ?
En fait, et c’est une des grandes idées de scénario de ce film, le spectateur est amené à assister, en quelque sorte, à un transfert de la parole mensongère d’une personne à l’autre. Quand, n’en pouvant plus, Adrien se décide à tout révéler à Anna, c’est elle qui devient comme la dépositaire des propos mensongers et qui se doit, d’une certaine façon, de les entretenir et même de les alimenter. C’est d’ailleurs, curieusement, à la faveur d’une confession que le film bascule, en son milieu, Anna en devenant dès lors le personnage principal bien plutôt qu’Adrien. Le prêtre qui l’entend au confessionnal l’absout des paroles mensongères qu’elle a commencé de proférer (« Dire la vérité, affirme le confesseur, ne ferait qu’apporter davantage de souffrance et davantage de larmes ! ») et l’invite à accorder son pardon à celui qui l’a entraîné sur cette voie.
Munie de la force du sacrement, c’est, après Adrien qui était venu en Allemagne chercher la tombe de son « ami », au tour d’Anna d’entreprendre un voyage en France en quête d’un jeune homme qui n’a même pas laissé de véritable adresse. Ce voyage, qui pourrait être éprouvant pour la jeune fille, car elle découvre, étape par étape, des vérités qui ne sont pas très belles (ou qui ne sont, en tout cas, pas celles qu’elle était en droit d’espérer), ce voyage s’avère, en fin de compte libérateur. Anna, qui se trouve contrainte de mentir aux Hoffmeister, Anna, qui pourtant est le seul personnage du film connaissant la vérité tout entière (dans la mesure où on peut la connaître), Anna éclaire tout le récit d’une présence à la fois souffrante, apaisante et pardonnante.
On n’en finirait pas d’énumérer les nombreuses qualités de ce film et toutes les subtilités de sa réalisation. J’en relèverai simplement trois. D’une part, il est intéressant de noter la finesse de la réalisation du point de vue de la photographie. L’essentiel du film est tourné en noir et blanc, ce qui se justifie pleinement pour une œuvre de cette sorte, mais quelques scènes, par contraste, sont dotées de couleurs. Il s’agit surtout de scènes heureuses (même si le bonheur qu’elles donnent à voir n’est, en fin de compte, que mystification) et les tons en sont pâles, un peu comme ceux d’un vieux livre d’images aux couleurs défraîchies dont on feuilletterait les pages. Aucun de ces passages du noir et blanc à la couleur et inversement ne m’a semblé ni ostentatoire ni artificiel, bien au contraire. Chacun d’eux s’appuie finement sur un tournant du récit. D’autre part, il faut relever combien les thématiques abordées dans ce film apparaissent pertinentes à l’heure actuelle. Bien qu’on ait affaire à un film d’époque, tout y parle aussi, en filigrane, d’aujourd’hui, et nous renvoie à nos propres angoisses, nos propres malaises, nos propres questionnements. Que dire, par exemple, des accents de patriotisme exacerbé qui se manifestent, à plusieurs reprises, au cours du film, tant du côté allemand que du côté français ? Il n’est pas question, bien sûr, de dénigrer le patriotisme en tant que tel, mais comment ne pas être pris de malaise quand celui-ci n’est mis en avant que pour justifier une xénophobie latente et qui n’ose pas ou plus (encore) se montrer à visage découvert ? Pour moi, en tout cas, cela ne fait pas de doute, et ce film, dont l’action se situe en 1919, nous interroge, nous, Européens et Français de 2016, de manière bien plus intelligente et plus pertinente que des films tapageurs (et moralement douteux) comme « Nocturama » et « Divines » (qui, tous eeux, viennent de sortir sur nos écrans mais que je ne recommande nullement!). Enfin, mais il est impossible de tous les énumérer, il convient de souligner combien ce film de François Ozon offre de scènes ou de plans à la fois simples, subtils et forts émotionnellement. Comme tous les grands cinéastes, Ozon n’éprouve jamais le besoin de s’encombrer d’explications : un plan rapide, un reflet sur la vitre d’un train par exemple, nous font comprendre plus de choses que toutes les explications du monde. Et quand, parmi tant d’autres scènes superbes et poignantes de ce film, Anna récite un célèbre poème de Verlaine (« Chanson d’automne »), ce plan si simple et si beau nous étreint irrésistiblement le cœur et les entrailles. Le cher poète Verlaine, dont Anna reçoit un peu plus tard un recueil de poèmes choisis, éclaire de sa douce lumière ce grand et beau film (comme Rimbaud qui offrait une des clés de lecture de « Jeune et jolie », un autre film de François Ozon). Quoi qu’il en soit, pour moi pas de doute : « Frantz » est d’ores et déjà l’une des grandes révélations cinématographiques de cette année 2016.
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160901 – Cinéma
LE FILS DE JEAN
un film de Philippe Lioret.
Etre informé au même moment de l’identité de son père et de son décès, c’est ce qui arrive à Mathieu (Pierre Deladonchamps), un jeune cadre français à qui l’on annonce par téléphone que son père, dont il ignorait tout, est québecois et qu’il vient de périr accidentellement dans un lac. Pour Mathieu, pas d’hésitation, il lui faut se rendre sur place, d’autant plus que le défunt lui a légué un colis. Arrivé à Montréal, il est accueilli par Pierre (Gabriel Arcand) qui se présente comme un médecin ami de son père. Le premier contact, néanmoins, n’a rien de très chaleureux. Pierre recommande surtout à Mathieu de ne rien révéler de son identité ni à la veuve ni aux deux enfants de cette dernière (qui seraient donc ses demi-frères).
Etonné, Mathieu n’en fait pas moins la connaissance de ceux-ci, ainsi que de l’épouse de Pierre et de leur fille, tout en se faisant passer pour un ami français de passage au Canada. Petit à petit, insensiblement, les relations entre toutes ces personnes évoluent. Tandis qu’il participe à la vaine recherche du corps du noyé dans le lac, Pierre découvre que ses supposés demi-frères révèlent pour l’un un tempérament de buveur irascible et pour l’autre, derrière des apparences vertueuses, un caractère guidé par des considérations bassement matérielles. La question de l’héritage entraîne leur querelle.
En fait, grâce à des petits signes, grâce à des paroles et à des gestes, entre autres à cause de l’héritage qui lui a été transmis (qui n’est rien de moins qu’un tableau de grand prix), Mathieu devine que tout n’a pas été dit, loin de là. Il faut du temps et de la confiance pour que la vérité affleure derrière les faux-semblants.
Tout l’art de Philippe Lioret, c’est de nous faire avancer, nous les spectateurs, vers la vérité au même rythme que les personnages. Nous n’avons rien de plus que Mathieu, juste un visage qui inspire la confiance, un regard pur, une perception du cœur, pour percevoir ce que dissimulent les non-dits. Il faut se contenter des seuls signes que sème chichement Pierre (admirablement joué par Gabriel Arcand) pour deviner ce que cachent ses apparences de bourru. Ce film, c’est peut-être par excellence le film qui invite à ne pas se fier à ses premières impressions, à ne pas se contenter de ce que l’autre veut montrer de lui-même. Avec le temps se révèlent d’autres aspects des personnes que ceux qu’on croyaient déjà connaître et les secrets enfouis se devinent.
Pour réussir un film de cette sorte, il convient de faire preuve de beaucoup de subtilité et de faire appel à des acteurs capables de transmettre des émotions sans les exagérer mais en les faisant cependant percevoir. Philippe Lioret, dont la filmographie, bien qu’inégale, comptait déjà deux très bons films (« Je vais bien, ne t’en fais pas » et « Welcome »), réussit ici parfaitement cette performance. Et il est servi par des acteurs d’excellence. Le seul visage de Pierre Deladonchamps dans le rôle de Mathieu en dit plus que tous les discours. Avec de tels acteurs (et actrices, ne les oublions pas), nul besoin de surligner, un simple regard ou un simple geste suffisent pour transmettre les émotions. Et dans « Le Fils de Jean », de ce point de vue, tout est parfait.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160830 – Littérature
LES ENFANTS JÉROMINE
un roman de Ernst Wiechert.
Il y a à peu près 45 ans, au temps joli (?) où j’étais collégien, mon professeur d’allemand avait fait traduire aux élèves de ma classe un extrait des « Enfants Jéromine » de Ernst Wiechert tout en ne tarissant pas d’éloges sur les très grandes qualités de ce roman. Il faut croire que ces propos s’étaient logés dans un coin quelconque de mon cerveau puisque, il y a quelques semaines, en voyant ce livre sur l’étal d’une librairie, je m’en suis souvenu. Et je me suis dit qu’il était grand temps, après toutes ces années, de le lire enfin, ce roman, et de vérifier par moi-même si le dithyrambe de mon ex-professeur était justifié.
Aujourd’hui, l’ayant lu (et c’est un roman de plus de 1000 pages), je peux dire que oui, en effet, il s’agit bel et bien d’un chef d’oeuvre de la littérature. Et j’ajoute qu’il faudrait redonner toute sa place au très grand écrivain que fut Ernst Wiechert.
« Les Enfants Jéromine », achevé d’écrire en 1946, se divise en deux parties, la première très dramatique et très sombre, la deuxième beaucoup plus lumineuse bien qu’il y soit question de la montée du nazisme et de l’instauration de son effroyable régime.
L’ensemble du roman se déroule durant la première moitié du XXe siècle, essentiellement à Sowirog, un petit village allemand sis au coeur d’une forêt proche de la Pologne. C’est là que vit (ou que survit) la famille Jéromine. Le père, charbonnier de son métier, gagne juste de quoi nourrir ses sept enfants. La pauvreté, voire la misère, sont le lot commun de la quasi totalité des habitants du village. Dans la première partie du roman, Wiechert relate essentiellement cela, les dures conditions de vie de la famille Jéromine et des autres familles du bourg, les famines, les maladies, la mort. Cette dernière est omniprésente, et bien davantage encore lorsque survient la grande guerre. Le ton du livre confine au désespoir. Le pasteur du village est si ébranlé par les tragédies qui frappent ses ouailles qu’il en perd la foi.
Mais au cœur de cette désespérance commence à poindre une lumière, ce que développe la deuxième partie du roman. On y suit la destinée et les choix de vie de Jons, le benjamin des enfants Jéromine. L’instituteur du village s’étant pris d’affection pour lui et croyant en ses dons, il réussit à l’envoyer à la ville pour y faire des études. Jons a la chance de rencontrer des guides, parmi lesquels, tout particulièrement, un juif du nom de Lawrenz. Car le garçon réussit si bien dans ses études qu’il entreprend de devenir médecin. Ayant passé brillamment ses examens, se pose pour lui la question de son orientation. Tout le monde le voit déjà chirurgien de renom, mais Jons, guidé par son mentor et gardant le souvenir de son enfance, de son père qui lui lisait la Bible, de la misère sévissant à Sowirog, fait le choix du retour à son village. Plutôt que d’être un grand médecin gagnant somptueusement sa vie, il préfère être le médecin des pauvres, de ceux qui n’ont jamais eu qui que ce soit pour les secourir quand ils étaient malades. C’est ce que raconte la fin du roman, tout éclairée par de belles figures (celles de Jons, de Lawrenz et de plusieurs autres habitants du village). Paradoxalement, par contraste, survient au même moment la montée inexorable du nazisme. La menace est là, grondante, de plus en plus présente, elle tue, mais la plupart des habitants de Sowirog ne pactise pas avec elle.
Ce grand roman est aussi, il faut le préciser pour finir, tout imprégné de Bible, de foi chrétienne, de recherche de Dieu. On peut dire, me semble-t-il, que la première partie du roman, sombre et désespérée, est celle de l’absence ou du silence de Dieu (le pasteur de Sowirog perd la foi, je l’ai dit), tandis que la deuxième partie est celle de la foi retrouvée, ou en tout cas d’un chemin de foi à nouveau possible.
Même lorsqu’on le lit dans une traduction française, on perçoit que le roman est doté d’un style et d’un ton qui lui sont propres et qu’on a affaire à un grand écrivain. Ce n’est pas un roman facile à lire, il faut faire un effort de lecture pour en venir à bout, rien à voir avec les guimauves d’un Paulo Coelho par exemple, mais cet effort est largement récompensé. Mon seul regret, c’est d’avoir attendu si longtemps (45 ans!) pour le découvrir !
9,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160818 – Cinéma
Cette comédie sympathique et tendre, pleine d’humour, restera malheureusement le dernier film de Solveig Anspach, décédée peu après sa réalisation.
20160817 – Cinéma
DERNIER TRAIN POUR BUSAN
un film de Sang-Ho Yeon.
Quand on me questionne sur mes goûts de cinéphile, quand on me demande quels genres de films j’aime, je réponds: « Tous les genres ». Il n’y en a pas un que je rejette totalement, j’aime aussi bien les films d’aventure que les comédies musicales, les westerns que les mélodrames, les comédies que les films noirs, etc, etc. Chaque genre a été magnifié par des chefs d’oeuvre et, dans chaque genre aussi, on trouve pas mal de navets. Le seul genre pour lequel je n’ai vraiment pas beaucoup d’attirance, c’est celui du cinéma d’horreur. Les films de zombies, par exemple, ça ne me dit rien du tout. Mais je suis toujours prêt à réviser mes points de vue et à remettre en cause mes à priori si l’occasion m’en est offerte.
Donc, je suis allé voir ce film coréen, parce qu’il bénéficiait de critiques favorables, mais sans trop savoir qu’il y serait question de zombies. Eh bien, en fait de zombies, de scènes d’horreur, de plans gore, j’ai été servi. Et pourtant, surprise!, ce film, par bien des côtés, a su me séduire. Non pas à cause des scènes les plus horrifiques, mais parce que le réalisateur a su tirer partie d’un excellent scénario mettant en valeur les quelques personnes qui essaient de survivre, d’échapper à la contamination qui ferait d’eux, à leur tour, des zombies.
Plusieurs de ces personnages sont très attachants, en particulier un père et sa fille, ainsi qu’une femme enceinte accompagnée de son mari. Parmi le groupe des survivants, pris au piège dans un train pendant une grande partie du film, on trouve de tout: des égoïstes et des lâches, mais aussi des altruistes et des hommes qui se changent en héros, allant même jusqu’à se sacrifier pour le salut d’autrui. En fin de compte, ce que ce film illustre, c’est qu’il n’y a de salut, non pas forcément pour tous mais au moins pour quelques-uns, que dans la solidarité et dans l’entraide. Pour un film de ce genre, je trouve que ce n’est pas si mal que de nous délivrer ce message. Quant au dernier plan du film, qui nous montre les rescapées de la catastrophe s’avançant dans un tunnel vers des soldats en armes, il est à la fois sublime et bouleversant, inoubliable!
Cela étant dit, je tiens à préciser encore que ce n’est pas un film à mettre sous tous les yeux: âmes sensibles s’abstenir, comme on dit! Ce film offre largement de quoi faire pas mal de cauchemars! Vous voilà tous avertis!
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160729 – Cinéma
GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE
un film de Philippe Falardeau.
En cet été assombri par d’innommables folies meurtrières, il n’est pas interdit, le temps d’un film, de s’en aller sonder les arcanes de la vie politique et de la société canadiennes en compagnie du québecois Philippe Falardeau. Le voyage s’avère d’autant plus agréable que le ton choisi par le réalisateur appartient résolument au registre comique.
Tout commence avec l’arrivée d’un stagiaire haïtien au prénom inattendu, Souverain (Irdens Exantus), venu apprendre le métier d’homme politique aux côtés d’un parlementaire québecois, le nommé Guibord (Patrick Huard), député de Rapides-aux-Outardes, Prescott et Makadewà. Le nouveau venu, tout imprégné de ses lectures savantes (Jean-Jacques Rousseau et Tocqueville, entre autres), ne tarde pas à découvrir les dures réalités de la vie canadienne, la route vers le nord, qu’il a empruntée avec Guibord, étant barrée par des Indiens Algonquins en colère contre ceux qui exploitent la forêt sans tenir compte ni de leur présence ni du respect de l’environnement.
Si le stagiaire haïtien avait pour finalité de se confronter à du concret, le voilà servi ! Il peut à souhait non seulement admirer les procédés du député Guibord mais lui insuffler ses propres conseils. Et il n’est au bout ni de ses surprises ni de ses enthousiasmes puisqu’apparaît bientôt le clou du film : le parlement canadien étant invité à voter pour ou contre l’envoi d’une force armée au Moyen-Orient, il se trouve que c’est la voix du député Guibord qui est déterminante. C’est elle qui fera pencher la balance en faveur du oui ou en faveur du non. Tout le monde, premier ministre et journaliste en tête, est donc suspendu aux lèvres de ce dernier…
Oui ou non à la guerre ? C’est une question qui mérite débat, on ne peut y répondre à la légère. Et des débats il va y en avoir ! Non seulement avec les habitants du comté dont Guibord est le député et à qui il veut donner la parole, mais au sein même de sa famille, sa femme et sa fille n’étant pas franchement du même avis sur cette difficile question. Comment Guibord réussira-t-il à se tirer de ce guêpier ? Lui, l’homme simple, ex-champion de hockey sur glace ayant la phobie des avions et s’étant reconverti en politique, lui qui ne connaissait pas même le nom de Jean-Jacques Rousseau, quels moyens peut-il prendre pour se déterminer ?
Sous-jacente à la farce savoureuse imaginée par Philippe Falardeau se glisse une critique impertinente du monde politique institutionnalisé. Le plus amusant, mais aussi le plus judicieux, du film, c’est la rencontre et la confrontation de deux mondes : le monde policé, guindé, formaté et sournois des hommes politiques élus (députés, premier ministre, etc.) et le monde tonitruant, rebelle et passionné des gens du peuple (les Indiens Algonquins, les camionneurs, les ouvriers de la mine, mais aussi le petit peuple haïtien). Il faut voir ces derniers, les haïtiens, discuter avec ferveur au sujet des débats en cours au Canada. Car Souverain, très régulièrement, se connecte, par le biais de Skype, à sa famille et ses amis vivant en Haïti pour leur faire part des derniers événements et entendre leurs opinions.
Subtilement, malicieusement, en donnant la parole aux haïtiens, le réalisateur suggère qu’il ne serait peut-être inutile de se mettre davantage à l’écoute de ceux à qui on ne prête pas même attention. « De quoi te mêles-tu, toi qui viens du Tiers-Monde ? », demande un des députés magouilleurs canadiens en toisant de son mépris le jeune Souverain. Et si, précisément, l’on se mettait à les écouter, eux, les petits du Tiers-Monde, de Haïti et d’ailleurs ? Il faudrait le susurrer davantage à l’oreille des politiciens du Canada, mais aussi, pourquoi pas, de France…. Tel pourrait être le message, si l’on peut dire, de ce film savoureusement et intelligemment drôle.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160706 – Cinéma
SUR QUEL PIED DANSER
un film de Paul Calori et Kostia Testut.
Les temps sont durs et les emplois précaires, Julie (Pauline Etienne) en sait quelque chose : dès l’ouverture de ce film (après une introduction en mode rétro), on la découvre se faisant virer de son travail dans une usine de baskets au profit d’une collègue sans doute jugée plus méritante. Qu’à cela ne tienne ! La jeune fille se met aussitôt en recherche d’un nouvel emploi et, fort heureusement, ne tarde pas à être prise à l’essai dans une fabrique de chaussures de luxe. Ouf ! Dès lors, Julie n’aspire plus qu’à une chose : qu’au bout de sa période d’essai elle puisse enfin obtenir un CDI et, ainsi, être libérée de tout tracas. Malheureusement, tout n’est pas si simple. Voilà que le journal local fait état d’un plan de modernisation de la fabrique d’escarpins. Pour les ouvrières, aucun doute, cette expression n’est là que pour cacher un plan social, autrement dit du travail délocalisé et des pertes d’emploi. Les voilà aussitôt en pleine effervescence, demandant des explications au patron et se postant devant l’usine avec banderoles et slogans. Julie, quant à elle, est bien embarrassée, elle ne sait sur quel pied danser : peut-elle se mettre du côté des ouvrières en révolte, au risque de perdre tous ses espoirs de CDI ? Elle ne tarde pas, pourtant, à être embarquée, presque malgré elle, dans le car des travailleuses en colère bien décidées à interroger le PDG de la marque en personne. Après avoir été faussement rassurées avec des promesses creuses, les voilà de retour à l’usine et bien dépitées lorsque Samy (Olivier Chantreau), un camionneur (amoureux de Julie), se laisse dévoyer pour vider l’entrepot de son stock. La lutte n’est pas finie, ni les soucis ni les déceptions pour Julie…
A-t-on donc affaire à un film social, implacable et réaliste, dans la veine de « La Loi du Marché » de Stéphane Brizé ? Eh bien non, pas du tout ! Le duo de réalisateurs, dont c’est le premier film, a choisi de mettre en scène cette histoire sur le mode de la comédie musicale ! Et ça fonctionne parfaitement. Ce n’est pas tout à fait quelque chose d’inédit : la veine sociale a déjà été présente dans des comédies musicales (« Une Chambre en Ville » [1982] de Jacques Demy ou encore « Pique-nique en Pyjamas » [1957] de George Abbott et Stanley Donen), mais jamais peut-être avec autant de force et d’intensité. Le mariage des contraires (la gravité du thème social et la grâce des chansons et des danses) non seulement ne choque pas mais s’avère exaltant. Il faut ajouter que les chansons ont été particulièrement bien écrites (elles sont signées de noms divers – Clarika et Olivia Ruiz, parmi d’autres, pour les textes ; Olivier Daviaud et Albin de la Simone pour la musique) et qu’elles s’intègrent parfaitement dans le récit. De même pour ce qui concerne les chorégraphies. Quant à la mise en scène, bien qu’orchestrée par des débutants, elle ne manque ni d’intelligence ni de subtilité. Malgré son sujet, on se régale d’un bout à l’autre du film : il y en a pour les yeux, pour les oreilles et pour l’esprit !
Rien n’est simpliste d’ailleurs dans l’histoire qui est ici mise en scène. Les personnages, et en particulier celui qu’incarne merveilleusement Pauline Etienne, ne manquent ni de finesse ni de complexité. « A quoi rêves-tu ? », demande l’un des personnages à Julie au cours du film. « A décrocher un CDI », répond-elle sans hésiter. Rien d’autre ne semble compter pour elle en effet, mais est-ce la vérité ? Au fond d’elle, dans les recoins secrets du cœur, ne se tapit-il pas autre chose qu’un rêve de travail non précaire ? Un rêve de liberté ou un rêve d’amour, peut-être bien…
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160701 – Cinéma
LA TORTUE ROUGE
un film de Michael Dudok de Wit.
S’il ne s’agissait que de noter la forme, je mettrais sans hésiter un 10/10 à ce film d’animation somptueux. On n’est pas surpris d’apprendre que le studio Ghibli (celui des maîtres japonais Hayao Miyazaki et Isao Takahata) a accueilli et soutenu ce projet de longue haleine, pourtant écrit et réalisé par un néerlandais. Même si les styles diffèrent quelque peu, le soin apporté aux dessins, aux couleurs, aux techniques d’animation et les méthodes employées rappellent indéniablement les chefs-d’oeuvre des Japonais. « La Tortue rouge » est un enchantement pour les yeux, comme l’ont été « Le Voyage de Chihiro » ou « Le Conte de la Princesse Kaguya » par exemple.
Cela étant dit, je me vois contraint d’ajouter que, pour ce qui concerne le fond, ce film de Michael Dudok de Wit me laisse perplexe. Car, aussi satisfaisant soit-il pour le regard, il est question d’un récit, et d’un récit que je me trouve bien en peine d’interpréter d’une manière acceptable. Et cela d’autant plus que le film est totalement dénué de parole, les seuls bruits émis par la gorge des personnages étant des cris. Rien de plus.
Il faut donc se contenter de ce qu’on voit, de ce qui se déroule sous les yeux, c’est-à-dire d’une histoire de naufragé, la scène introductive, étonnante et sublime, montrant un homme aux prises avec l’océan déchaîné et échouant sur une île déserte. L’individu essaie très vite de s’en échapper à l’aide de radeaux, mais chacune de ses tentatives se solde par un échec : chaque embarcation de fortune est systématiquement détruite par une force venue du fond de l’océan. C’est comme si l’île voulait le retenir de force… à moins que ce ne soit l’animal qui donne son titre au film et qui apparaît enfin sous les yeux effarés de l’homme.
La suite s’oriente vers quelque chose de fabuleux, voire de mythique, et de simple en même temps. Des entrailles de l’animal naît une femme et de cette femme ne tardera pas à naître un enfant. L’homme ne songe plus à quitter l’île, il s’y trouve en communion avec la nature et avec le cosmos. Il semble apaisé, heureux, acceptant sa vie et même sa mort. Quant à celle qui est venue le rejoindre, une fois sa mission accomplie, elle retourne à son état d’origine. La boucle est bouclée.
On peut, bien sûr, se contenter d’être émerveillé par cette histoire à la fois simple et fabuleuse et par la splendeur des images. Pour ce qui me concerne, je n’ai pas pu m’empêcher de lui chercher des significations et je me suis trouvé très en peine. Ce qui vient spontanément à l’esprit, c’est-à-dire de comparer ce récit avec « Robinson Crusoë », s’avère rapidement peu pertinent. Il faut chercher d’autres voies, puiser dans d’autres références.
Mais lesquelles ? A-t-on affaire à une fable d’inspiration rousseauiste ? Plus le temps passe pour le naufragé, plus il semble se rapprocher de l’état de nature et ne plus être assujetti aux contraintes morales. S’agit-il d’un récit panthéiste ? Dans ce film, les humains apparaissent en parfaite symbiose non seulement avec les autres êtres vivants, mais avec le cosmos tout entier, sans qu’il soit jamais fait mention, cela dit, d’un quelconque désir d’absolu, d’une quelconque aspiration au divin. Ou encore s’agit-il d’une sorte de variation sur le mythe des origines, voire sur le récit biblique d’Adam et Eve ? Nonobstant une impressionnante scène de tsunami, on peut avoir le sentiment que l’homme et la femme qui lui est donnée vivent dans le jardin d’Eden. Mais un jardin sans rien d’interdit, et donc sans chute possible, sans faute ni péché. Comme s’il n’y avait plus d’autre horizon que l’innocence et la pureté, la mort elle-même apparaissant comme quelque chose de simple et de paisible.
Etrange film, par conséquent. Je ne sais que choisir parmi toutes les lectures et interprétations possibles d’une telle histoire. Autant cette œuvre m’a enchanté par sa beauté plastique, autant elle me laisse dubitatif quant à sa signification.
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20160622 – Cinéma
LA FORÊT DE QUINCONCES
un film de Grégoire Leprince-Ringuet.
On a déjà eu de nombreuses occasions d’apprécier le talent d’acteur de Grégoire Leprince-Ringuet, aussi à l’aise dans un film de Christophe Honoré que dans un autre de Bertrand Tavernier ou encore de Robert Guégiguian. Or le voici qui non seulement se produit comme acteur mais comme scénariste et réalisateur. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce premier essai contient beaucoup de promesses.
C’est un film intrigant, quelque peu déroutant peut-être, mais irrésistiblement séduisant, qu’a écrit et mis en scène Grégoire Leprince-Ringuet. En se basant sur des poèmes qu’il avait écrits il y a longtemps, il a bâti un fil dramatique et des personnages. Les dialogues du film sont donc constitués pour une bonne part de poèmes versifiés de manière très classique (des alexandrins mais aussi des octosyllabes, m’a-t-il semblé) et rimés. Et c’est un des grands plaisirs que procure ce film que de faire entendre ces vers. Ils interviennent de manière très naturelle, sans s’exhiber, mais en imprégnant le long-métrage de leur musicalité. Car, qu’on le veuille ou non, et même si beaucoup de poètes contemporains l’ont laissé choir (ce que je regrette!), il n’y a rien de tel que le vers de forme classique pour faire chanter les mots. L’alexandrin et l’octosyllabe sont naturellement musicaux et ce film en bénéficie extraordinairement. Il donne l’impression d’être chanté en effet.
Une des autres grandes qualités de « La Forêt de Quinconces », c’est son casting et, en particulier, outre le rôle tenu par le réalisateur lui-même, le choix des deux actrices principales, toutes deux superbes et très talentueuses : Amandine Truffy dans le rôle d’Ondine et Pauline Caupenne dans celui de Camille.
Enfin, outre l’excellence de son écriture et du choix des acteurs et actrices, il faut louer la mise en scène et la réalisation du film, plein de bonnes idées, parsemé d’indices qui éclairent et déroutent tout à la fois, comme il se doit quand on a affaire à un conte. Car, même si l’intrigue se noue et se dénoue au cœur des réalités les plus ordinaires de notre temps, c’est bien sous ce registre qu’il faut le percevoir. Et comme dans les meilleurs contes, il est ici question d’ensorcellement et d’objets dotés de pouvoirs.
Il est question aussi d’une forêt, celle qui donne son titre au film, la forêt de quinconces qui est plantée d’arbres si ordonnancés qu’on s’y perd. Autour de soi, quand on s’y trouve, s’ouvre une multitude de chemins. Pour Paul (le personnage joué par Grégoire Leprince-Ringuet lui-même), cela fait écho aux atermoiements du cœur, aux difficultés d’aimer ou d’apprendre à aimer en vérité. Qu’en est-il d’Ondine qui, après qu’il l’ait fait littéralement tomber, décide de le laisser parce qu’elle le trouve trop distant ? Et qu’en est-il de Camille l’ensorceleuse que Paul rencontre un peu plus tard à la faveur de la séquence la plus extraordinairement mise en scène de tout le film ? Après un échange de propos des plus étranges avec un sans-abri qui prend figure d’augure, Paul croise le chemin de Camille dans une voiture de métro, la main du premier s’approchant autant qu’il est possible de la main de la deuxième enserrant une barre. Paul prend ensuite la belle inconnue en filature jusqu’à entrer à sa suite dans une salle de spectacle où tous deux se rejoignent au milieu de danseurs. Et c’est sur les toits que tous deux se retrouvent enfin pour parachever leur alliance. Et pour mettre fin à une séquence dont il faut louer tous les aspects, sans oublier l’extraordinaire bande-son.
Cela étant dit, même dans ses scènes les plus ordinaires, voire triviales (un échange de propos dans un escalier ou sur un trottoir de Paris), le film n’est jamais banal. Il respire tout entier de son empreinte poétique. Et il s’ouvre, de ce fait, sur de multiples interprétations. Ne peut-on pas voir dans les blessures infligées au coude et aux genoux d’Ondine, du fait de sa chute, et à la joue de Camille qui s’orne d’une balafre d’où s’écoule une goutte de sang qui désenvoûte, ne peut-on pas voir dans ces blessures des ouvertures sur le mystère des êtres, sur les cœurs insondables qui y palpitent ?
Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que ce film gagnera à être revu autant de fois qu’on le voudra. Semblable aux meilleurs recueils de poésies qu’on peut lire et relire tout au long de sa vie sans jamais en épuiser la substance, « La Forêt de Quinconces » également, j’en suis persuadé, fait partie de ces films qu’on n’a jamais fini de redécouvrir et qui n’ont jamais fini de surprendre (parce qu’ils ne se donnent jamais tout entier, comme les poésies). Et ces films-là sont les meilleurs de tous !
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160617 – Cinéma
DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
un film de Safy Nebbou.
« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant ». Cette célèbre « pensée » de Pascal pourrait fort bien servir d’exergue à ce film librement adapté d’un récit de Sylvain Tesson, tant il est question ici à la fois de la petitesse et de la grandeur de l’homme. En s’isolant complètement des bruits du monde au point de vivre dans une cabane construite sur les rives du lac Baïkal, que cherche Teddy (Raphaël Personnaz) sinon un supplément de vie et le sentiment d’une liberté retrouvée ? L’homme qui lui vend son abri n’en revient pas : « Tout le monde veut aller en Europe et toi, tu viens ici ? », s’étonne-t-il. Mais Teddy n’en démord pas : il veut vivre là, dans un isolement total.
Commencent alors non seulement ses joies mais ses combats. Passer l’hiver dans la taïga, dans une nature certes grandiose mais hostile, cela ressemble à de la folie. Glisser sur le lac gelé ou en percer l’épaisseur de glace pour s’y baigner, ce sont de vrais plaisirs, on veut bien le croire. Mais se faire surprendre par un ours ou par une tempête de neige, ce sont des dangers qui peuvent coûter cher. Dans cet environnement-là, le moindre faux pas peut être fatal, la moindre erreur de jugement peut entraîner la mort. Petitesse d’un homme qui n’est qu’un point minuscule perdu dans une nature qui n’a que faire de sa présence.
Mais grandeur de l’homme qui n’a pas oublié d’emmener dans ses bagages quelques livres de chevet. Grandeur de l’homme qui, dans l’adversité, se bat pour sa survie. Grandeur de l’homme qui, même dans cette terre isolée du bout du monde, finit par trouver son semblable. On a presque le sentiment de découvrir une nouvelle version des aventures de Robinson Crusoé. En fait d’éloignement, les rives du lac Baïkal valent bien l’île déserte de ce dernier. Quant à se trouver un compagnon inattendu, c’est également ce qui advient à Teddy en la personne d’Aleksei, un homme qui, après l’avoir sauvé d’une mort certaine, se présente à lui comme un braconnier.
Débute alors la partie la plus passionnante du film, celle qui culmine dans une scène qui, à elle seule, irradie de sa force tout le long-métrage, en en révélant toute la singulière beauté. Malgré tout ce qui les oppose, malgré la barrière de la langue, entre Teddy et Aleksei, naît et grandit une amitié indéfectible (qui fait irrésistiblement songer à celle qui unissait un officier russe et un autochtone sibérien dans « Dersou Ouzala » (1976), le film d’Akira Kurosawa).
Dans le film de Safy Nebbou, l’amitié de Teddy et d’Aleksei se révèle pleinement et se scelle dans une scène de survie : enfouis au fond d’un trou pour se protéger d’une tempête de neige, le prétendu braconnier, après avoir prononcé une prière à la manière orthodoxe, se livre à son compagnon en lui faisant sa confession. La vérité, c’est qu’il vit depuis douze ans dans la taïga afin d’échapper à la justice : l’homme est un criminel en cavale et il a la prétention de vivre encore trois ans dans l’isolement, c’est-à-dire jusqu’à ce que son affaire soit prescrite. « Tu as tué un homme, mais tu en as sauvé un autre », lui répond Teddy (qui lui doit la vie et qui, lui aussi, se livre à une véritable confession un peu plus tard).
Dès lors, après cette scène qui a la puissance et la beauté d’un sacrement, Aleksei a beau lui dire qu’il ferait mieux de s’en retourner chez lui, Teddy ne peut se résoudre à abandonner son compagnon et ami. Une amitié comme celle qui le lie à cet homme, à ce reclus en pleine nature, cela ne peut s’achever que par obligation…
On pardonnera volontiers au réalisateur et à son scénariste de n’avoir pas su ou pu éviter les scènes « à faire » dans ce genre de film (celle de l’ours par exemple), tellement il y a de beauté dans l’histoire d’amitié qui unit ces deux hommes que rien ne destinait à se rencontrer.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160610 – Cinéma
|
Bonjour à tous,
|
Sébastien Betbeder réutilise les trouvailles de mise en scène qui avaient fait leurs preuves lors de son film précédent, le sympathique « 2 automnes 3 hivers ». La surprise ne joue plus autant avec ce film-ci, mais ce qu’il perd en originalité, il le gagne en loufoquerie. Il fait bon se laisser mener par le bout du nez, surtout quand c’est Vimala Pons qui mène la danse!
Ces célèbres vers de Baudelaire, mis en exergue au film, disent bien le projet de la réalisatrice, Claire Simon, qui, fidèle à sa méthode, s’est mise en symbiose avec un lieu et avec ses présences humaines, en l’occurrence le Bois de Vincennes et ceux qui le fréquentent, voire même qui y vivent. Et ce sont en effet des paroles, souvent confuses (comme dans le poème), qui sont émises. Claire Simon fait parler et, le plus souvent, elle fait parler celles et ceux qui, habituellement, n’ont personne ou quasiment personne à qui parler. Cela donne au film un ton émouvant, avec parfois des instants amusants. Il y a de tout dans le Bois de Vincennes, de simples promeneurs bien sûr, ou des sportifs, mais aussi des prostituées, des hommes qui cherchent à assouvir leur misère sexuelle, des hommes et des femmes qui s’y sont installés, des Cambodgiens ou des Guinéens qui s’y rassemblent pour des fêtes, un colombophile, des solitaires, etc. La plupart de ces personnes émeuvent, tant on ressent leur solitude précisément. Une Cambodgienne qui n’a encore jamais pu se raconter à un Français, une prostituée qui se confie, un sans-domicile qui s’y est fabriqué un refuge… Des paroles, des rêves, un Bois…
20160606 – Cinéma
LE LENDEMAIN
un film de Magnus Van Horn.
Pour son premier film, le suédois Magnus Van Horn n’a certes pas opté pour la facilité. Le sujet qu’il a choisi de traiter exigeait de sa part la plus grande rigueur, et l’on peut dire qu’il s’y est tenu. D’autres cinéastes, pourtant plus aguerris, ont raconté des histoires semblables à celle dont il est question ici mais sans être capables d’éviter des pièges (cf. le film médiocre de Thomas Vinterberg, « La Chasse »).
Dans « Le Lendemain » cependant, contrairement à ce qui apparaît dans le film de Vinterberg que je viens de citer, on devine d’emblée qu’on a affaire à un vrai coupable. John (Ulrik Munther), le jeune homme blond que son père vient chercher à la sortie de la prison pour mineurs où il a effectué une peine de deux ans, a réellement commis un crime, le film ne laisse place à aucune ambiguïté à ce sujet. Et l’on parvient assez rapidement à percevoir de quel crime il s’agit. La question que pose le réalisateur n’est pas celle de la culpabilité, puisqu’elle est établie, mais celle de la possibilité (ou non) de la réinsertion (et, en filigrane, celle du pardon). En retrouvant son environnement d’autrefois, la ferme familiale, la vie au foyer avec son père et son petit frère, et même son lycée, et donc ses camarades de classe, qu’espère John ? Que tout va pouvoir recommencer comme avant, comme si rien ne s’était passé ?
La réalité est, évidemment, beaucoup plus cruelle que les espoirs caressés par le jeune homme. La proviseure du lycée, tout comme les professeurs, ont beau en appeler au calme et vouloir donner à John une seconde chance, celui-ci a tôt fait d’être considéré, de manière quasiment unanime, comme un paria. Du rejet l’on a vite fait d’en venir à la haine et de la haine à la violence. On devine pourtant que le garçon est habité d’un vrai désir de rachat, mais que faire quand on se heurte à un mur d’intolérance ? A la violence répond malheureusement la violence.
Le réalisateur laisse poutant entrevoir, très habilement, que le déroulement des faits aurait pu être différent. Il n’y a pas de fatalité. A plusieurs reprises, à l’occasion de plusieurs scènes, l’on pressent qu’il suffirait d’un rien, d’une parole, d’un mot, d’un geste de pardon pour changer le cours des événements. John n’attend que cela, on le sait, et si ses manières de faire apparaissent déroutantes, c’est bien parce qu’il est en quête de pardon. Seule une jeune fille semble partager un peu de sa peine et lui faire entrevoir une lueur d’espoir. Mais le malheur veut que ce soit la peur qui ait le dernier mot. Et la peur, on le sait, n’engendre jamais rien de bon.
Tout cela, le jeune cinéaste le filme avec grande maîtrise, en sachant toujours garder la bonne distance, en évitant et la froideur excessive (ou le regard clinique d’un Haneke) et son contraire le pathos. Puisse-t-il persévérer sur cette voie et l’on aura affaire, très certainement, à un cinéaste de grand talent !
J’ajoute qu’en écrivant ces quelques lignes, je ne peux pas ne pas songer à l’un ou l’autre détenu que j’ai accompagné durant le temps où j’étais l’aumônier du Centre Pénitentiaire de Meaux-Chauconin. Bien souvent, au cours des entretiens que j’avais avec les prisonniers, il était question de leur libération et de leur réinsertion futures. Et je me souviens fort bien que nombre d’entre eux étaient habités de sentiments contradictoires : d’un côté, bien sûr, ils ressentaient de la joie et de l’espoir à l’idée de sortir enfin des murs de la prison et de tout faire pour se reconstruire une vie ; mais d’un autre côté, plus d’un d’entre eux ressentaient aussi de la peur ou de l’appréhension. Retrouver son environnement d’autrefois, les gens qu’on a fréquentés, voire même ses proches, quand on est passé par la case prison, cela ne va pas de soi. Ce qu’il faut souhaiter, bien sûr, c’est qu’aucun d’entre eux ne soit en butte au rejet et à la haine comme dans ce film de Magnus Van Horn !
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160523 – Cinéma
LA RÉSURRECTION DU CHRIST
un film de Kevin Reynolds.
Bien que peu friand, je dois le dire, de films américains d’inspiration biblique (ces films étant, le plus souvent, très décevants), je me suis résolu à aller voir celui-ci, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux personnes qui me demandaient mon avis. Eh bien, je peux à présent le donner et, je le dis d’emblée, il ne sera pas très tendre !
Car, bien sûr, comme je le pressentais, on a affaire à un film grossier, sans nuances, contredisant les textes des Evangiles, et rempli d’incohérences. La seule bonne idée de scénario, c’est d’avoir déroulé les événements de la Passion et de la Résurrection sous le regard d’un témoin étranger au groupe des disciples, un tribun romain du nom de Clavius (Joseph Fiennes). Témoin de la mort de Jésus en croix, celui-ci est, plus tard, délégué par Pilate afin de rechercher le corps du supplicié car il s’agit de faire taire les rumeurs annonçant sa résurrection. Secondé par Lucius (Tom Felton), le tribun mène l’enquête, allant jusqu’à rechercher le corps de Jésus parmi les cadavres entassés dans un charnier et se mettant à la poursuite de ses disciples. Le film se mue par conséquent en une sorte de polar à tendance apologétique car, évidemment, le brave Clavius, voyant lui-même de ses yeux Jésus ressuscité, se convertit et accompagne les apôtres jusqu’en Galilée.
Cela étant dit, il ne reste qu’à énumérer les nombreuses incohérences du scénario, les effets de mise en scène déplorables, le peu de crédibilité des acteurs assez souvent mal dirigés, etc. On dirait que le scénariste s’est attaché, par moments, à respecter à la lettre l’un ou l’autre récit des Evangiles, puis, à d’autres moments, à prendre ses aises et à imaginer des scènes qui, si l’on y réfléchit, paraissent bien peu convaincantes. Au début du film, quand Jésus meurt, le ciel s’assombrit, la terre tremble et les murailles de la ville se fissurent, ce qui peut assez bien s’accorder avec l’Evangile selon St Matthieu (27, 51). Mais, plus tard, on est surpris de voir les membres du sanhédrin accompagner, un jour de sabbat, Pilate et Clavius au tombeau de Jésus pour s’assurer que le corps est toujours là.
Le réalisateur, heureusement, s’est gardé de mettre en scène la résurrection proprement dite. Mais il n’a pas pu s’empêcher de la faire raconter par un des gardes qui, bien évidemment, évoque une lumière aveuglante, un énorme bruit et autres effets de cette sorte. Description qui n’a aucun fondement, les Evangiles ne comportant aucun récit de ce genre.
On pourrait multiplier les descriptions de scènes peu crédibles, mais je préfère aller à l’essentiel, à ce qui me paraît le plus incongru dans ce film. On y voit le groupe des disciples (Marie-Madeleine et les apôtres) depuis Pâques jusqu’à l’Ascension. Leur manière d’être manque totalement de cohérence : tantôt ils donnent l’impression d’être sans peur, déjà tout à la joie d’être les témoins du Ressuscité, tantôt ils se cachent des Romains comme des bandits fuyant des adversaires. Il faut dire que les acteurs sont très mal dirigés, le pompon revenant à celui qui joue le rôle de Barthélémy (on le croirait échappé d’un groupe de hippies des années 60 n’ayant que « peace and love à la bouche ! Ridicule!). D’autre part, et c’est en contradiction avec les récits des Evangiles, les apôtres donnent l’impression, dans ce film, de n’avoir aucune difficulté à croire que c’est bien Jésus ressuscité qui est avec eux. Les textes font pourtant mention de leurs doutes, mais, dans le film, les apôtres ne semblent même pas étonnés de voir Jésus vivant au milieu d’eux !
Quant à l’acteur qui joue le rôle de Jésus (Cliff Curtis), son manque total de charisme le rend bien peu crédible. Mais c’est le fait même de le montrer incarnant Jésus mort en croix puis Jésus ressuscité qui provoque la gêne. Les textes des Evangiles insistent sur l’étonnement, voire l’effroi des disciples qui croyaient avoir affaire à un esprit et sur leur difficulté à reconnaître Jésus. Mais de cela, il n’est pas question dans ce film : au contraire, les disciples semblent trouver tout naturel que Jésus soit vivant, ils ne sont nullement troublés et ils sont déjà prêts à témoigner de leur foi. Et les voilà qui vont en Galilée, poursuivi par l’armée romaine, d’autant plus que Clavius a déserté pour les suivre ! Pour finir, le réalisateur n’a pas pu s’empêcher de mettre en scène l’Ascension à grands coups de lumière aveuglante et de mouvement de caméra s’élevant au ciel !
L’intention apologétique est évidente, mais ne convaincra que ceux qui le sont déjà. Ce qu’il faut dire, me semble-t-il, c’est que réaliser un film sur la résurrection est une gageure qui ne peut être tenue. Aucun film, quel qu’il soit, ne saurait être satisfaisant et ce film-ci ne l’est pas du tout. Les textes suffisent.
2/10
Luc Schweitzer, sscc.
ADDENDUM AU FILM « LA RÉSURRECTION DU CHRIST ».
En guise d’addendum à ma critique du film « La Résurrection du Christ » de Kevin Reynolds, je ne trouve rien de mieux que d’emprunter de larges citations d’un livre dont je recommande fortement la lecture (« Petite théologie du cinéma » de Jean Collet et Michel Cazenave, éditions du Cerf).
C’est Jean Collet qui s’exprime :
« …les films les plus authentiquement spirituels sont rarement nés des bonnes intentions de cinéastes croyants. Presque toujours, ce sont des cinéastes extérieurs à toute religion qui ont réalisé des films vraiment spirituels.
Ce paradoxe, loin de troubler les croyants – dont je suis – , devrait au moins rassurer les chrétiens, car il est au cœur même de l’Evangile : « Le Vent souffle où il veut. » Autrement dit, l’Esprit n’appartient pas à ceux qui le revendiquent. Tout l’enseignement de Jésus gravite autour de ce paradoxe. Il a scandalisé les pharisiens – ceux qui se croyaient propriétaires de la vérité et de son mode d’emploi – au point qu’ils en sont arrivés à faire condamner et mettre à mort le Christ. Scandale donc du christianisme où Dieu se révèle aux petits, voire aux pécheurs (saint Paul), à la femme adultère, à ceux qui cherchent, et surtout pas à ceux qui croient avoir trouvé !
(…) Ce paradoxe est au cœur de toute création véritablement artistique et résume peut-être ce que nous pouvons connaître de l’Esprit : il vient toujours d’ailleurs. (…) Cela ne veut pas dire que tout ce qui vient d’ailleurs, tout ce qui est étranger est de l’Esprit (…) car le mal aussi, sous les traits de l’Esprit, vient d’ailleurs.
La création artistique, comme la création charnelle, sexuée, voilà de bonnes métaphores de l’Esprit à l’oeuvre, si l’on peut dire. Godard, sur ce point, l’a souvent formulé avec humour, non sans profondeur : « Il faut être deux pour faire un film », il faut être inspiré, ouvert et fécondé par l’Esprit de l’autre. Ce que tout être humain peut éprouver dans sa propre vie, c’est qu’il s’agit toujours d’une histoire d’amour. Ici, l’expérience la plus humble rejoint la plus authentique théologie chrétienne : l’incarnation de Dieu dans l’histoire humaine.
L’art dans l’âme des choses – comme la religion – , mais par ses propres chemins. Ce sont les chemins qui nous intéressent, les lieux où souffle l’Esprit, où l’amour nous arrache à nous-mêmes. » (pp. 29-31)
Plus loin, toujours dans la bouche de Jean Collet :
« (…) Il faut oser dire que les films religieux sont le plus souvent des films médiocres, sans spiritualité. Je pense à La Passion du Christ de Mel Gibson, ce film est plein de bonnes intentions, mais la vérité sur l’écran est aux antipodes d’un projet trop pieux, car on ne triche pas avec le spirituel. Il faut beaucoup d’humilité pour faire un film authentique, il faut accepter de ne pas tout maîtriser, au lieu de vouloir dire en croyant qu’on possède la Vérité et qu’on peut l’enfermer dans des images. Alors, les images se révoltent, elles trahissent. Dans le film de Gibson, ce n’est pas le mystère de la Rédemption que révèle l’écran, mais seulement la fascination d’un cinéaste sidéré par la violence et aveuglé par le sadomasochisme. » (p. 47)
Si j’ai tenu à citer ces longs extraits des propos tenus par Jean Collet, c’est parce que je partage sans réserves son point de vue et que c’est une façon commode de le partager. Dans la suite de l’ouvrage, Jean Collet explicite son opinion, sa vision du cinéma, sa recherche de spiritualité dans le 7ème art, en se référant à de multiples réalisateurs comme Luis Buňuel, Alfred Hitchcock, John Ford, Carl Dreyer et plein d’autres. Je partage totalement cette conviction qu’il y a davantage, bien davantage, de spiritualité dans des films qui sont dépourvus de références explicitement chrétiennes que dans des films qu’on pourrait dire « estampillés » chrétiens. Les réserves émises par Jean Collet à propos du film La Passion du Christ peuvent facilement être adaptées au film La Résurrection du Christ : un « film plein de bonnes intentions » mais qui est dépourvu de véritable spiritualité. A contrario, l’on peut sans difficulté citer nombre de films sortis sur les écrans depuis le début de l’année et qui, sans qu’ils se réfèrent d’aucune façon à la foi chrétienne, n’en sont pas moins tout emplis de spiritualité (parce que l’Esprit y souffle) : Carol de Todd Haynes, Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase, Sunset Song de Terence Davies, L’Avenir de Mia Hansen-Løve, Julieta de Pedro Almodóvar en sont quelques exemples.
Luc Schweitzer, sscc.
20160520 – Cinéma
JULIETA
un film de Pedro Almodóvar.
Oublions l’insupportable comédie réalisée par Pedro Almodóvar en 2013 (« Les Amants passagers ») et réjouissons-nous de le voir renouer aujourd’hui avec ce qui lui convient le mieux : le portrait de femme raconté en mode mélodramatique (et même, en l’occurrence, tragique). Il y a pourtant matière à étonnement à propos de ce nouveau film, non pas à cause du sujet qu’aborde le cinéaste espagnol, mais à cause de sa source d’inspiration. En choisissant d’adapter trois nouvelles de la canadienne Alice Munro (prix Nobel de Littérature 2013), le moins qu’on puisse dire, c’est que le réalisateur espagnol a cherché loin de chez lui, loin de l’environnement qui lui est familier, de quoi nourrir son scénario. Et pourtant, comme on dit vulgairement, ça marche ! Les histoires imaginées par l’auteure canadienne, soigneusement hispanisées par Almodóvar, non seulement n’ont rien d’incongru mais se teintent subtilement des colorations typiquement méditerranéennes les plus persuasives.
Même si bien d’autres femmes interviennent et prennent place au cours du film, le portrait de femme auquel s’attache le réalisateur, c’est d’abord et avant tout celui de celle qui lui donne son titre : Julieta. C’est elle qui raconte, c’est elle qui écrit, narrant à sa fille Antia, 13 ans après avoir perdu tout contact avec elle, le destin tragique de sa vie. D’abord campé par l’actrice Emma Suárez, le rôle de Julieta est confié à une autre actrice (Adriana Ugarte) lorsque le film bascule dans le flashback.
Les faits s’enchaînent alors à la façon des tragédies grecques, prenant leur départ au fil de superbes scènes filmées dans un train (scènes qui, irrésistiblement, rappellent certaines œuvres fameuses d’Alfred Hitchcock). Est-ce à cause d’un mystérieux passager qui se suicide ou à cause d’un cerf qui semble être à la poursuite du train ? C’est en tout cas à son bord que, par un concours de circonstances ou par le jeu de la destinée, se rencontrent et s’aiment Julieta et Xoan (Daniel Grao). Et c’est de leur union que naît Antia.
Mais reste à raconter par quels coups du sort cette dernière finit par rompre tous les liens avec sa mère. Par quels enchaînements Antia en arrive-t-elle à cette extrémité ? Que s’est-il passé dans la maison de Galice où Xoan exerce son métier de marin-pêcheur ? Et quel rôle joue Marian (Rossy de Palma), la gouvernante et gardienne de la maison de Galice, qui semble, elle aussi, s’être échappée d’un film de Hitchcock (« Rebecca » – 1940) tout en ayant des allures de pythie dégoisant ses mauvais augures ? Sans compter les autres personnages, comme Ava, l’amie sculptrice de Xoan, et Beatriz, l’amie d’enfance d’Antia, qui, chacun, nourrit à sa façon le cours de la tragédie.
Pedro Almodóvar, dont les films sont volontiers marqués du sceau de l’exubérance, n’a peut-être jamais usé d’un style aussi dépouillé que pour conter l’histoire de Julieta. Il le fallait, probablement, pour faire percevoir aux spectateurs tout le poids de culpabilité qui pèse à la fois sur la mère (Julieta) et sur la fille (Antia) et qui les sépare l’une de l’autre pour des années. C’est comme un poison qui envenime le cœur et qui se transmet de l’une à l’autre. Cela étant dit, le film n’a rien d’ascétique. Si le jeu des actrices est empreint de sobriété, l’action, elle, se déroule dans une grande diversité de sites et donne à l’oeuvre une ample palette de tons et de couleurs : scènes d’allure onirique dans le train, scènes citadines tournées à Madrid, scènes maritimes de Galice, scènes andalouses, scènes pyrénéennes… Le film passionne et fascine par tous ses aspects. Et l’on n’est pas près d’oublier le personnage qui donne son titre au film : Julieta qui, semblable à Ulysse ensorcelé par Calypso, a laissé passer tant d’années en enfouissant au fond d’elle la douleur d’avoir perdu sa fille.
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160514 – Cinéma
MA LOUTE
un film de Bruno Dumont.
S’il y a une chose qu’on ne saurait reprocher à Bruno Dumont, c’est d’être incapable de se transformer du point de vue stylistique. Après avoir réalisé quelques films au ton très austère et totalement dénué d’humour, le cinéaste a créé la surprise en mettant en scène une série télévisée au comique absurde et déjanté diffusée sur Arte en 2014 (« P’tit Quinquin »). Fort de cette expérience, voici qu’il présente aujourd’hui « Ma Loute », film en compétition au festival de Cannes et d’allure encore plus extravagante que la série qui l’a précédé.
Cela étant écrit et nonobstant les dithyrambes de quelques critiques (mais pas de tous, fort heureusement), je me dois d’exprimer à présent ma consternation et ma stupéfaction. Car s’il est vrai que Bruno Dumont a totalement changé de style ou de genre cinématographique, il n’en est pas moins vrai, me semble-t-il, que, pour ce qui concerne sa pensée, ou sa vision du monde et de l’humanité, rien n’a changé, si ce n’est en pire. Ce que je veux dire, c’est que le cinéaste n’a cessé, au fil de son œuvre, de faire montre de sa misanthropie et que cette misanthropie n’a jamais été ni aussi flagrante ni aussi repoussante que dans « Ma Loute ».
Personne n’est épargné dans ce film, ni les Van Pethegem, famille bourgeoise de Tourcoing venue se détendre en bord de mer, ni les Brufort, famille de pêcheurs locaux aux mœurs très particulières, ni l’inspecteur Machin et son adjoint Malfoy, fades épigones de Laurel et Hardy enquêtant sur de mystérieuses disparitions. Tout ce monde est croqué par le réalisateur avec un évident mépris : triste humanité de décadents, de dégénérés et d’abrutis. Mais non, c’est faire trop de concession à Bruno Dumont que de parler d’humanité à propos de ses personnages. En vérité, ils n’ont rien d’humain, ce sont soit des pantins qui se roulent par terre comme l’inspecteur Machin ou s’effondrent sur le sol à la façon d’une marionnette désarticulée, soit des baudruches qui s’envolent dans les airs. Et s’ils parlent, c’est en éructant ou en grimaçant comme des singes.
Tel est le spectacle offert par Bruno Dumont : comique si l’on veut, mais d’un comique détestable. Même le semblant d’histoire d’amour qui naît entre Ma Loute, l’aîné des Brufort, et Billie, une des filles des Van Pethegem (dont on se demande si elle est une fille ou un garçon), même cette histoire d’amour, dont on espère un instant qu’elle va illuminer le film, ne mène à rien d’autre qu’à un surplus de violence et d’abrutissement. Les pantins actionnés par Bruno Dumont sont comme tous les pantins, ils sont dépourvus de cœur et font juste semblant d’aimer. Chez Bruno Dumont, la seule façon d’aimer, c’est de s’entredévorer à la manière des anthropophages.
Quant aux acteurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels (puisque, pour la première fois, le réalisateur a engagé des acteurs confirmés), ils surjouent leurs rôles au point qu’ils en deviennent agaçants. Fabrice Luchini, Juliette Binoche et Valeria Bruni Tedeschi n’ont jamais été ni aussi mal dirigés ni aussi irritants que dans ce film. On se demande bien pourquoi ils se sont laissé manipuler, eux aussi, comme des pantins grotesques, par le réalisateur.
Sous ses airs de comédie, c’est un triste film que propose Bruno Dumont, puisque dépourvu d’humanité. Dans une interview, quand on lui demande quels sont ses projets, le cinéaste répond qu’il s’apprête à tourner un film sur Jeanne d’Arc ! Mon Dieu ! Pauvre Jeanne ! Passée à la moulinette de Bruno Dumont, que restera-t-il d’elle ?
2/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160513 – Cinéma
CAFÉ SOCIETY
un film de Woody Allen.
Après tant de films réalisés et portés à l’écran, il serait absurde d’attendre de Woody Allen quelque chose de totalement inédit. Mais tous les créateurs ne font-ils pas de même ? Qu’ils soient romanciers, peintres ou cinéastes, les artistes les plus grands ressassent inlassablement les mêmes thèmes et donnent en spectacle les mêmes personnages ? Il ne viendrait à l’idée de personne, je suppose, de déplorer la manie qu’avait Rembrandt de se peindre lui-même (il fit à peu près 80 autoportraits et pas un n’est anodin!). Woody Allen, lui aussi, en grand cinéaste qu’il est, triture sans fin les mêmes thèmes et malaxe sans se lasser la même pâte humaine. L’impression de déjà-vu qu’on peut ressentir en voyant ce nouveau film est réelle, on a le sentiment que les personnages qui s’y produisent sont issus de films antécédents, mais on n’en est pas moins irrésistiblement séduit car ce qui est vrai également, c’est que le talent de conteur et de metteur en scène du cinéaste new-yorkais non seulement ne faiblit pas mais qu’il s’approche de plus en plus d’une sorte d’idéal !
Si le scénario de « Café Society » n’est pas d’une folle originalité, la mise en scène, elle, est si parfaite et les dialogues, eux, sont si savoureux qu’on n’en finit pas de se délecter. « La vie, affirme l’un des personnages du film, est une comédie écrite par un sadique ». Pour preuve, nous voici emporté avec Bobby (Jesse Eisenberg) jusqu’à l’Hollywood du début des années 30. Ayant quitté la demeure familiale de New-York, il y retrouve non sans peine son oncle Phil (Steve Carell), un producteur richissime qui se vante de fréquenter les plus grandes stars de l’époque. Bobby n’obtient qu’une place de coursier mais qu’importe puisqu’il fait la connaissance de Vonnie (Kristen Stewart), la ravissante secrétaire de l’oncle dont il tombe aussitôt éperdument amoureux. Tout n’est pas si simple cependant, on l’imagine, car la belle fréquente déjà un homme, marié certes et beaucoup plus âgé qu’elle, mais riche et qui pourrait bien quitter ses attaches pour elle. Quel choix fait-on dans ce cas-là ? Celui du jeune homme séduisant, mais pauvre et n’aspirant qu’à retourner à New-York, ou celui de l’homme mûr et marié, mais riche et fréquentant le grand monde d’Hollywood ?
Woody Allen suggère assez habilement le peu de cas qu’il fait de ce monde-là, ce monde de frivolité que Bobby se décide en effet à quitter pour s’en retourner à New-York et y retrouver les siens, laissant derrière lui celle qu’il aime. La famille que Bobby réintègre n’a rien de très reluisant pourtant, c’est le moins qu’on puisse dire (on y compte même un membre de la pègre), ce qui n’empêche pas le garçon de réussir enfin et à se marier et à gagner largement de quoi vivre en dirigeant le night-club qui donne son titre au film. Fidèle à sa manière, sous des apparences de légèreté, c’est un monde déliquescent que dépeint Woody Allen, à quoi s’ajoutent ici les portraits d’une famille (celle de Bobby) qui collectionne les revers, au point que son chef, Marty, le patriarche, en vient à déplorer le « silence de Dieu » (ce à quoi son épouse rétorque que « pas de réponse, c’est encore une réponse ») ! Un monde cruel, marqué par la fuite du temps, et qui, s’il autorise des retrouvailles (celles de Bobby et Vonnie, par exemple), le fait sous les signes des regrets inutiles et de la mélancolie.
Un scénario qui n’est pas d’une folle originalité, écrivais-je plus haut : c’est vrai et faux à la fois. Vrai si l’on ne prend en compte que le récit dans sa globalité. Faux si l’on s’attarde sur les détails, sur la multitude des bonnes idées qui réactivent sans cesse l’intérêt du spectateur. Woody Allen est un maître dans ce domaine : son film étincelle de petits détails qui relancent l’intrigue, de répliques savoureuses et de belles idées de mise en scène. Qualifier « Café Society » de film mineur, comme je l’ai lu dans certains commentaires, n’est pas du tout opportun. Les qualités d’un film ne se mesurent pas à l’aune d’une histoire (ou d’un « pitch », comme on dit aujourd’hui), mais bien davantage à l’aune de la finesse des dialogues, des idées de mise en scène et de la direction d’acteurs (sans compter la photographie, le son et plein d’autres éléments). De ce point de vue, « Café Society », comme bien d’autres œuvres de Woody Allen, est un film majeur, une parfaite réussite !
9/10
Luc Schweitzer, sscc
20160512 – Théatre
20160329 – Cinéma
DALTON TRUMBO
un film de Jay Roach.
On ne compte pas beaucoup de films tournés, jusqu’à présent, sur une des périodes les plus noires de l’histoire des Etats-Unis, celle qui commence en 1947 à l’initiative du sénateur McCarthy et qui se traduit par une chasse effrénée aux communistes. La guerre froide, qui commence alors, conduit à une psychose s’emparant de tout le territoire américain. Il faut dénicher les communistes, considérées comme des traîtres à la patrie, et les traduire en justice, ce dont se charge la commission des activités antiaméricaines.
Hollywood n’est pas épargné. Dix-neuf noms de « traîtres » figurent bientôt sur une liste noire. Dix d’entre eux refusent de répondre aux questions de la commission et de donner des noms. L’un des dix se nomme Dalton Trumbo et c’est l’un des scénaristes les plus talentueux d’Hollywood. Reconnu coupable, ce dernier doit purger une peine de prison et n’est plus autorisé à signer des scénarios. Il le fera quand même sous des noms d’emprunt et, ironie du sort, se verra doté de plusieurs oscars (que, bien sûr, il ne peut recevoir en mains propres puisqu’il est contraint de travailler sous de faux noms).
Ce biopic retrace donc, de manière talentueuse et très crédible, cette sombre histoire. A cette occasion se dévoilent les comportements mesquins, voire hideux, de quelques célébrités comme John Wayne ou le futur président des USA Ronald Reagan. D’autres, au contraire, fort heureusement, font preuve d’audace et de courage en confiant du travail à Trumbo malgré les interdictions et même, pour finir, en s’efforçant de le réhabiliter. Parmi ces courageux, il faut noter les noms de Kirk Douglas et d’Otto Preminger.
S’il figure parmi les nombreuses victimes de la chasse aux sorcières qui a sévi dans ces années de guerre froide, Dalton Trumbo n’est cependant pas présenté dans ce biopic comme un saint. On a affaire à un homme courageux, à un bourreau de travail, mais aussi à un mari et à un père faisant preuve, par moments, d’une extrême dureté envers ses proches et capable d’un égoïsme peu flatteur. Mais on a également affaire à un homme intelligent, droit et généreux. Quand enfin il est réhabilité et qu’il peut à nouveau signer des scénarios sous son vrai nom, quand enfin on le félicite à visage découvert, ses mots, ses phrases de remerciement n’ont rien d’un discours convenu. Il ne prononce pas une parole de haine, il n’a pas un mot de reproche pour qui que ce soit. Au contraire, il estime que, dans cette affaire, il ne sert à rien de séparer les bons des méchants: « il n’y a que des victimes », dit-il. que des personnes qui ont été abîmées, d’une manière ou d’une autre, par le vent de folie qui s’est emparé des esprits.
Ce film de Jay Roach, magnifié par la formidable prestation de Bryan Cranston dans le rôle-titre, en donne toute la mesure. Il est superbement réalisé et véritablement passionnant, rappelant tout un pan de l’histoire américaine dont il n’est peut-être pas inutile de garder mémoire.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160324 – Cinéma
LES MALHEURS DE SOPHIE
un film de Christophe Honoré.
Rangés au rayon de la bibliothèque rose, les romans de la Comtesse de Ségur, s’ils n’ont jamais connu de totale désaffection, sont pourtant aujourd’hui beaucoup moins lus que dans le passé. Sans doute les juge-t-on vraiment trop désuets pour notre temps. Qu’a-t-on à faire en 2016 des robes en taffetas de la Comtesse et de ses petites filles modèles ? Cela semble vraiment très démodé.
Certes, mais l’un des mérites du film qui vient de paraître sur nos écrans, c’est précisément de changer notre perception et de réviser nos préjugés. En adaptant deux des romans les plus célèbres de la Comtesse de Ségur (« Les Malheurs de Sophie » et « Les petites Filles modèles »), Christophe Honoré, le réalisateur, invite à découvrir ou à redécouvrir, sous les apparences, ce qu’ont de moderne ces récits. Ces livres, qui ont été édités pour la première fois l’un en 1859 l’autre en 1866, parlent certes de petites filles de ce temps-là, mais avec des caractéristiques qui ne manquent pas de surprendre si l’on y réfléchit un peu. Etait-ce banal, au milieu du XIXème siècle, de raconter les aventures d’une fillette qui fait les 400 coups ? Etait-ce évident de la décrire colérique, menteuse, voleuse et même apte à traiter les animaux avec sadisme ?
Dans le film, comme dans les romans, la petite Sophie (Caroline Grant) va incorrigiblement de bêtises en bêtises malgré les remontrances de sa mère, Mme de Réan (Golshifteh Farahani). Par contraste, son cousin Paul, le petit garçon du roman, lui, se comporte avec beaucoup plus de sagesse. C’est la petite fille qui multiplie les tours tandis que le petit garçon se comporte comme un enfant sage ! L’une des premières scènes du film donne le ton : s’étant querellé avec Sophie, le petit Paul a brisé un vase précieux et, pour sa punition, est contraint de garder la chambre. Un peu plus tard, alors qu’il lui est proposé d’en finir avec sa punition et de rejoindre les fillettes, Paul juge qu’il mérite de rester enfermé et s’en va dans sa chambre lire l’ « Emile » de Jean-Jacques Rousseau, pendant que Sophie et ses amies, elles, s’amusent comme des folles !
Je n’ai nul besoin d’en dire davantage pour souligner combien ce film met l’accent sur la modernité des récits de la Comtesse de Ségur et sur leur audace. On peut sans peine y distinguer deux parties qui correspondent aux deux romans adaptés par le cinéaste : la première, au ton plutôt léger, narrant les multiples sottises de Sophie, la deuxième, plus grave, racontant les sévices endurés par la fillette après la mort tragique de sa mère et son « adoption » par une belle-mère venue d’Amérique, Mme Fichini (Muriel Robin), femme acariâtre et adepte des châtiments corporels. Fort heureusement pour l’enfant, c’est, en fin de compte, la douce Mme de Fleurville (Anaïs Demoustier), qui sera sa protectrice et sa tutrice.
Aux qualités intrinsèques des romans de la Comtesse de Ségur, dont j’ai tenté de donner un rapide aperçu, il faut ajouter celles qui sont propres à l’oeuvre cinématographique qui nous est proposée. J’en détecte deux qui se complètent admirablement : d’une part le talent des acteurs et actrices, à commencer par le jeu superbe de la petite Caroline Grant qui interprète Sophie, d’autre part les judicieuses idées de mise en scène adoptées par le cinéaste qui nous livre un film le plus souvent pétillant de vitalité. Heureuse idée que d’avoir intégré au film des animaux en dessins animés, heureuse idée que d’avoir mis en mouvement des tableaux pour figurer la tempête qui scelle la fin de la mère de Sophie, heureuse idée que d’avoir introduit dans le film quelques chansons, etc. C’est un film plein de bonnes idées, oui, et qui, de plus, peut ravir tous les publics, les enfants (sauf peut-être les plus petits à cause de scènes quelque peu cruelles) et même les adultes !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160422 – Cinéma
LE FILS DE JOSEPH
un film de Eugène Green.
Le temps de se réhabituer au style unique d’Eugène Green, à une langue qui emprunte autant à l’ancien qu’au moderne, à une diction qui respecte scrupuleusement toutes les liaisons, et nous voilà à nouveau emporté, dès les premières scènes, dans une aventure si riche de contenu, si pleine de pistes qu’on ne peut l’appréhender totalement en se contentant d’une seule séance. Autant dire que l’on a déjà hâte de voir paraître ce film en DVD afin de le voir et le revoir à loisir.
Au cœur du récit ou plutôt de la parabole proposée par le réalisateur (américain d’origine, mais amoureux de la France et de l’Europe bien plus que de sa patrie d’origine), se trouve un jeune homme prénommé Vincent (Victor Ezenfis), jeune homme dont trois scènes soulignent à la fois l’étrangeté de caractère et la profondeur des désirs secrets qui l’habitent : un jeune homme sensible (il ne supporte pas qu’on maltraite un animal nuisible pris au piège), un jeune homme facétieux (s’il vole un objet dans un magasin, c’est pour le remettre à sa place aussitôt après), un jeune homme droit (à un camarade qui lui propose un marché rentable mais douteux, il oppose une fin de non-recevoir). Mais s’il donne une impression d’étrangeté, c’est peut-être aussi et surtout parce que Vincent a le cœur tiraillé de souffrance, celle d’être privé de père.
A sa mère Marie (Natacha Régnier) qui s’inquiète de lui, il répond brutalement qu’il lui manque l’amour. Il ne sait pas aimer et il n’est aimé par personne, ose-t-il affirmer à celle qui précisément l’aime plus que tout. Mais quant à révéler l’identité du père, elle s’y refuse obstinément, ce qui oblige Vincent à mener sa propre quête. C’est sans doute ce mot-là qui résume le mieux le sujet central du film. En se mettant en quête d’un père, que cherche Vincent si ce n’est d’apprendre à aimer ?
Non sans humour, Eugène Green conduit son personnage de jeune homme aventureux et avide de vraie connaissance sur des chemins d’excentricité tout en posant la question de la paternité (et, du même coup, bien sûr, celle de la filiation). Le chemin conduit à Oscar Pormenor (Mathieu Amalric), un grand éditeur parisien entouré de ses fidèles (secrétaire, écrivains, critiques) dont le réalisateur se fait un malin plaisir de souligner tous les ridicules. Si ce microcosme grotesque n’a bien évidemment rien à donner d’autre que sa vanité, il faut cependant en passer par lui pour atteindre un père et le sacrifier (ou, en tout cas, tenter de le sacrifier).
Comme dans « Le sacrifice d’Isaac » de Caravage dont le jeune homme contemple une reproduction affichée dans sa chambre, mais en inversant les rôles, le fils tend le couteau vers le père mais ne va pas au bout de son acte. Et c’est en Joseph (Fabrizio Rongione), son oncle dont il ignorait jusque là l’existence et qui survient à point nommé, que Vincent trouve un père. En visite au musée du Louvre, c’est encore dans la contemplation d’un tableau, en l’occurrence « Saint Joseph charpentier » de Georges de La Tour, que se révèle l’intimité des êtres : à Vincent qui affirme que saint Joseph n’était pas le vrai père de Jésus, l’oncle Joseph répond que si, c’était son vrai père, car la paternité lui a été donnée par le Fils.
Comme dans « La Sapienza », le film précédent du réalisateur, tout est affaire de transmission, mais pas à sens unique. Entre Vincent et Joseph, c’est comme un va-et-vient de connaissances qui circule : tous deux se réalisent et se découvrent autant dans la joie du don que dans celle de la réception. Quant à la teneur du don, elle ne peut être mieux désignée que par le verbe aimer, d’autant plus que le don ne tarde pas à prendre le visage et l’aspect de Marie, la mère. Quant à Pormenor, le père biologique, qui sait s’il n’y a pas pour lui aussi une voie de salut, tout éditeur égoïste qu’il est ?
Magnifiquement écrit et judicieusement divisé en cinq chapitres qui se réfèrent à des scènes bibliques (Le Sacrifice d’Abraham, Le Veau d’Or, Le Sacrifice d’Isaac, Le Charpentier, La Fuite en Egypte), ce film émerveille, amuse et séduit irrésistiblement. Eugène Green ne bâcle rien, il invite à la contemplation et à l’ouverture du cœur. Et quand il donne place à la musique, lors d’une des scènes les plus belles du film, il laisse entendre la pièce musicale choisie dans son intégralité (une pièce de Domenico Mazzocchi interprété par le Poème Harmonique de Vincent Dumestre). Pur moment de grâce au sein d’un film qui entreprend précisément de chercher la grâce œuvrant au plus secret des cœurs.
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160409 – Cinéma
L’AVENIR
un film de Mia Hansen-Løve.
Il est des cinéastes dont on pressent, dès leur premier film, qu’ils ne nous décevront jamais et qu’on demeurera toujours curieux de découvrir les nouveaux jalons de leur art. Ce fut le cas, en ce qui me concerne, lorsque je vis, en 2007, le premier long-métrage d’une réalisatrice au nom suggérant des origines nordiques (danoises en l’occurrence), Mia Hansen-Løve. Son film ne se contentait pas d’être muni d’un beau titre évocateur (« Tout est pardonné »), mais il était d’ores et déjà réalisé avec beaucoup de finesse. Il touchait juste. Depuis lors, d’oeuvre en œuvre, le talent de la cinéaste qui, comme certains de ses illustres prédécesseurs, avait collaboré en tant que critique aux Cahiers du Cinéma, s’est, en effet, confirmé.
Voici à présent que paraît son cinquième film et, autant le dire d’emblée, il me semble que c’est son meilleur à ce jour. Pour chacun de ses films, Mia Hansen-Løve a puisé son inspiration dans sa propre histoire ou dans celle de ses proches et c’est encore le cas pour ce film. Ce sont, en l’occurrence, ses propres parents qui lui ont servi de modèles. Ils étaient tous deux enseignants en philosophie, mais le père plutôt kantien et passionné de philosophie allemande (Schopenhauer, Nietzsche) et la mère plutôt rousseauiste et aimant également Descartes, Platon et Socrate, ce qui donnait lieu, explique la réalisatrice, à des débats passionnés et à « des scènes cocasses à la maison ».
Cette ambiance studieuse, ces discussions et ces disputes philosophiques, on les retrouve tout au long de « L’Avenir », film tout entier habité, possédé même, par les débats d’idées. Nathalie, la professeure de philosophie incarnée admirablement par Isabelle Huppert, comme son mari Heinz (André Marcon) sont des passionnés chez qui les livres tiennent une place privilégiée. Les étagères de leur domicile en sont remplies. Et on disserte, et on expose, et on s’affronte volontiers, en effet, sur le plan des idées philosophiques.
Mais comment faire un film avec de la philosophie ?, se demandera-t-on à juste titre. Ne risque-t-on pas de se morfondre d’ennui ? Non, pas de crainte à avoir, au contraire ! Le film n’a rien d’austère et les débats d’idées dont il se fait l’écho n’ont jamais rien d’aride. Mia Hansen-Løve a pris grand soin de lier étroitement les idées philosophiques à la vie des personnages et, en particulier, à celle de Nathalie. Le film ne se complaît pas dans les ratiocinations de philosophes, il leur donne du poids et de la valeur en les incarnant. Ce n’est pas un film uniquement conceptuel qu’a conçu la réalisatrice, fort heureusement, c’est aussi un film charnel.
L’une des premières scènes du film donne le ton : on y voit Nathalie corrigeant des copies d’élèves qui ont dû disserter sur la question suivante : « peut-on se mettre à la place de l’autre ? ». La question bascule presque aussitôt sur le terrain pratique quand l’on découvre que Nathalie est en charge d’une mère (jouée par Edith Scob) âgée, dépressive et fantasque.
Quand on enseigne la philosophie, quand on se passionne pour les grands penseurs de l’humanité, est-on mieux armé pour affronter les turbulences de l’existence ? Telle est la question sous-jacente à tout le film. Pour Nathalie, il s’agit non seulement de prendre des décisions concernant le bien-être de sa mère (la mettre ou non dans une résidence pour personnes âgées), mais il s’agit aussi de se confronter aux nouvelles orientations de la maison d’éditions avec qui elle collabore et il s’agit surtout de supporter la souffrance infligée par un mari qui lui déclare soudain qu’il fréquente une autre femme et qu’il a décidé de la quitter.
Les apparences, une fois de plus, sont trompeuses : elles laissent supposer que Nathalie supporte stoïquement et sereinement toutes ces vicissitudes. Elle semble n’en être que peu affectée. Tout l’art de la réalisatrice, Mia Hansen-Løve, c’est de suggérer, à l’aide de signes discrets, qu’au fond il n’en est rien. Un lied de Schubert vient à point nommé pour le révéler tout comme la citation d’une des « Pensées » de Blaise Pascal lue pendant des obsèques ou, plus simplement, les larmes versées, la nuit, dans une chambre d’une maison du Vercors où elle est accueillie par un de ses anciens élèves : il ne faut pas se fier à l’impassibilité apparente de Nathalie. Si, en digne philosophe, elle sait se comporter avec retenue, les petits signes égrenés par la réalisatrice suffisent à révéler que son for interne n’est pas pour autant dénué d’émotions, bien au contraire. Et cette émotion, quelques scènes la rendent parfaitement perceptible et la communiquent aux spectateurs.
Si, comme l’écrivait Montaigne, « philosopher, c’est apprendre à mourir », mais pour mieux apprécier le cadeau de la vie, alors le film tout entier de Mia Hansen-Løve est irrigué de philosophie en acte, et c’est passionnant. La mort est signifiée dès l’entrée en matière du film qui montre certains de ses protagonistes en visite à la tombe de Chateaubriand (au Grand Bé près de Saint-Malo), elle l’est aussi par la mort effective de la mère de Nathalie en cours de récit et même, lors d’une des dernières scènes, par la vision d’un personnage lisant un livre ayant pour titre « La Mort » (un ouvrage de Vladimir Jankélévitch). Mais si le film prend en compte la réalité de la mort, c’est manifestement pour mieux souligner, par contraste, le bouillonnement indéfectible de la vie. La philosophie n’a que faire de l’immobilisme, elle est par esssence mouvement, ce qu’indiquent parfaitement de nombreuses scènes du film : on y voyage et on y bouge beaucoup, on y circule en bateau, en train, en voiture, on y marche, on s’y baigne, etc. Et l’on y est constamment interpellé par des désirs de vivre (et de vivre à l’excès) : si Nathalie a déjà bien des années de philosophie derrière elle, son métier d’enseignante et ses relations privilégiées avec un de ses anciens élèves l’obligent à réviser et à reformuler sans cesse sa pensée et à la préserver de la stagnation. Ses élèves en sont bien conscients, ils savent qu’ils ont affaire à quelqu’un sur qui compter et l’une des belles scènes du film nous montre quatre d’entre eux demandant à Nathalie sa participation au site internet qu’ils veulent créer (un site dédié à la philosophie bien sûr). Mais la vie ne se signifie pas uniquement par des jeunes gens pleins de vitalité, elle se signifie aussi, très simplement, par une naissance, celle d’un petit-enfant pour Nathalie. La philosophe est mère, et la voilà grand-mère !
Si c’est une gageure que de faire un film qui se fonde ou, plus exactement, qui est irrigué d’un bout à l’autre par la passion de la philosophie, alors cette gageure a été pleinement tenue par la réalisatrice Mia Hansen-Løve. Cinéphiliquement, son film offre un bonheur de tous les instants. Il est intelligemment construit, habilement mis en scène, et il est servi non seulement par l’immense talent d’Isabelle Huppert mais également par les convictions sans failles des autres acteurs. Le talent de la cinéaste ne s’est jamais autant épanoui que dans cette œuvre tout en finesse qui fait la part belle non seulement aux débats d’idées dont elle est pétrie, mais aux cœurs et aux corps ainsi qu’aux sentiments. On ne peut qu’admirer, par exemple, la science et la subtilité qui président à l’introduction, au cours du film, de quelques plages musicales : outre le lied de Schubert (magnifiquement chanté par le grand Dietrich Fischer-Diskau) que j’ai déjà signalé, une chanson du chanteur américain engagé Woody Guthrie (un précurseur de Bob Dylan). Ces moments musicaux s’intègrent à merveille dans le film, ils sont porteurs de sens, ils révèlent, d’une certaine façon, quelque chose de l’intimité des personnages.
Couronné de l’Ours d’argent de la meilleure réalisatrice à Berlin, il ne reste qu’à souhaiter que ce superbe film puisse à présent trouver son public. C’est mon vœu le plus ardent.
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160404 – Cinéma
Bonjour à tous!
Plusieurs films vus ces dernières semaines, mais qui ne m’ont pas semblé valoir plus que quelques lignes. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas aller les voir. A chacun de se faire son opinion!
Belgica, de Felix Van Groeningen:
Que pouvait-on attendre de Félix Van Groeningen après « Alabama Monroe », film moralement très douteux que j’ai déjà eu suffisamment l’occasion de dézinguer? Voici donc « Belgica », un film qui n’a rien à dire ou quasiment rien. Juste une histoire de frangins qui s’associent pour diriger un bar puis qui se disputent et se séparent. Les quelques tentatives que fait le réalisateur pour donner un peu de sens et de consistance à son film avortent toutes rapidement. Ne reste qu’une débauche de décibels, d’engueulades, de violence, de défonce et de sexe! Et l’impression pour le spectateur que je suis d’avoir vu quelque chose de creux et d’abrutissant. 3/10
Suite armoricaine, de Pascale Breton:
Destins croisés de Françoise, une enseignante en histoire de l’art et de Ion, un étudiant, à la fac de Rennes. Où l’on découvre, petit à petit, que tous deux ont quelque chose ou plutôt quelqu’un en commun. Le film est assez bien fait mais, malheureusement, trop long. Beaucoup de belles scènes mais d’autres qui flirtent avec l’ennui. 7/10
Midnight Special, de Jeff Nichols:
Un peu déçu par ce nouveau film de Jeff Nichols (dont le film précédent, « Mud », m’avait captivé). Ma déception est néanmoins relative, car « Midnight Special » ne manque pas d’atouts. Cette première incursion du réalisateur dans le monde de la SF, si elle n’est pas totalement convaincante, reste cependant suffisamment intéressante. Disons que le scénario est un peu bancal, mais que le film réserve tout de même bien des moments de réelle fascination. Le grand atout du film, c’est le petit garçon doté de pouvoirs extraordinaires. Le maillon faible, c’est tout ce qui se rapporte à la secte qui détenait l’enfant et qui cherche à le récupérer, cet aspect du film n’étant pas assez développé. De plus, le film souffre de son rythme inégal: il fait alterner des scènes haletantes parmi beaucoup d’autres qui semblent poussives. Un film à voir, quand même! 7,5/10
Kaili Blues, de Bi Gan:
Il arrive qu’une seule scène sauve un film de la médiocrité. Ici, ce n’est pas une scène mais toute une séquence très longue filmée avec une incroyable virtuosité. Le début de « Kaili Blues » me semblait pourtant ennuyeux et confus, mais l’arrivée de cette séquence a tout changé et m’a irrésistiblement fasciné. Je n’en dis pas plus. C’est un film étonnant, poétique, désemparant. 7,5/10
La Passion d’Augustine, de Léa Pool:
Au début des années 60, au moment même où a lieu le Concile Vatican II, se déroule au Québec une période à laquelle on donnera l’appellation de Révolution tranquille. A cette époque-là, le gouvernement canadien décide, entre autres choses, de procéder à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ce qui entraîne de lourdes conséquences. L’Eglise qui, jusque là, pesait d’un poids énorme sur la société québécoise se trouve rapidement délestée de ses privilèges.
C’est dans ce contexte que Léa Pool a choisi de situer son récit et, plus précisément, entre les murs d’une école tenue par des religieuses. L’originalité de cette école pour filles, c’est qu’on y forme des talents de musiciennes. La Mère supérieure, Mère Augustine, en fait un point d’honneur. Bientôt, c’est la propre nièce de la supérieure qui est admise au sein de l’institution scolaire, une jeune fille qui révèle aussitôt ses immenses talents de pianiste mais qui pèche volontiers par son impertinence.
Dans le même temps, il s’agit de s’adapter à des temps nouveaux tout en se battant pour sauver une école qui, du fait des événements, est menacée de fermeture.
Ce film offre de belles séquences de grâce et d’émotion. Quand la nièce de la supérieure se met au piano, c’est la grâce qui emporte tout. Quand les religieuses décident d’ôter leurs voiles et d’opter pour des tenues plus adaptées aux temps nouveaux, c’est une séquence d’émotion. Et il y en a d’autres au cours du film. Mais, malheureusement, la réalisation n’est pas toujours de ce niveau. Elle est trop souvent banale, scolaire, pourrait-on dire. Lors d’une scène, la nièce de la supérieure est rappelée à l’ordre par cette dernière parce qu’elle prend des libertés avec une pièce de Bach. Pas question d’improviser, dit Mère Augustine qui trouve inacceptable qu’un air de Bach se transforme tout à coup en air de jazz. Il faut être sage, trop sage. Sage comme l’est, le plus souvent, la mise en scène de ce film. Une réalisation ultra classique, presque académique, mais un film qui est traversé de grands moments de grâce ou d’émotion. 7/10
Quand on a 17 ans, d’André Téchiné:
Le gros point faible de ce film, c’est un scénario qui est comme marqué du sceau du déterminisme. Même si l’on n’en a pas pris connaissance auparavant, dès les premières scènes, à moins d’être une oie blanche, on peut prédire sans peine tout ce qui va suivre. Et, de fait, la suite du film n’offre que de très rares surprises. Tout est écrit d’avance. On sait que les échanges de coups du début évolueront vers d’autres échanges, plus sensuels. On sait que les mots de haine dissimulent des mots d’amour. Rien que de prévisible. Malgré tout, ce qui rend le film intéressant, ce qui le sauve de l’ennui, c’est le choix des décors de montagne et ce sont surtout les talents conjugués des deux jeunes acteurs principaux (Kacey Mottet Klein et Corentin Fila). 7/10
Bien amicalement.
Luc Schweitzer, sscc.
20160402 – Cinéma
SUNSET SONG
un film de Terence Davies.
Cela ressemble à s’y méprendre à un récit de Thomas Hardy (romancier dont les œuvres ont déjà été plusieurs fois adaptées au cinéma), mais non, c’est un roman de l’écossais Lewis Grassic Gibbon que le cinéaste britannique Terence Davies a porté à l’écran. Si l’erreur est permise cependant, c’est bien parce qu’on a affaire, dans ce récit comme dans tous ceux de l’auteur de « Tess d’Urberville », à une jeune femme dont tous les désirs se heurtent tôt ou tard au poids de la famille, aux conventions de la société ou aux faits qui les réduisent à néant. Si bonheur il y a, ce ne peut être que de façon passagère, car il se trouve toujours un obstacle, un personnage, un événement, pour le chasser comme feuille emportée par le vent et le remplacer aussitôt par son contraire.
Pour Chris (Agyness Deyn), c’est la figure imposante du père qui contrecarre d’emblée toute velléité d’émancipation. La jeune fille, qui se passionne pour les études, se verrait bien échapper aux pesanteurs de la ferme familale afin d’entreprendre une carrière d’institutrice. Mais il n’est pas simple de prendre son envol dans l’Ecosse pétrie de traditions séculaires et de mœurs archaïques du début du XXème siècle et c’est encore plus difficile quand règne en maître chez soi un père violent et tyrannique. Certes, même dans ce coin reculé de l’Ecosse, l’on voit poindre timidement des idées nouvelles, venues du socialisme par exemple, mais on ne se défait pas si facilement de l’autorité patriarcale. Comme toujours chez le cinéaste Terence Davies, le père est un homme terrifiant qui fait régner sa loi, restant impertubable et sûr de son bon droit même lorsque ses actes provoquent des drames. Chris n’en est que le témoin affligé et impuissant et elle, dont le cœur déborde de compassion pour ceux qui sont victimes, reste de marbre quand c’est au tour du maître de quitter ce monde.
Car le temps passe, lui aussi, inexorablement, emportant tout avec lui, la figure du père, mais aussi les rêves d’une autre vie (une vie d’institutrice par exemple). Et c’est sur sa terre proche de la petite ville de Blawearie, c’est dans la ferme dont elle a hérité que Chris devra mener sa vie. Quand, allant jusqu’à braver les interdits liés à la période de deuil, elle épouse l’homme qu’elle aime, lorsqu’ont lieu les noces, lorsqu’enfin elle est aimée, on peut imaginer que le bonheur est à portée de vie. Sans tarder, c’est vrai, viennent les souffrances d’un accouchement, mais c’est pour laisser place à la joie d’être mère. La vie de fermière ne manque pas de rudesse, mais on peut la mener avec un cœur apaisé.
C’est sans compter cependant avec les événements qui bouleversent le monde, engendrant en l’année 1914 ce monstre que l’on nommera Grande Guerre. Même au fin fond de l’Ecosse, se pose rapidement pour les hommes en âge de combattre la question de s’enrôler ou non. Refuser de partir à la guerre, c’est être condamné à passer le reste de sa vie en portant le fardeau de la honte. Pas de pitié pour les lâches ! Le pasteur de Blawearie n’est pas en reste pour le rappeler, y compris dans ses sermons. En voyant cette scène, en l’écoutant, je ne pouvais pas ne pas songer au sermon d’un autre pasteur, autrichien celui-là, retranscrit dans « Les Derniers Jours de l’Humanité », la pièce que l’écrivain viennois Karl Kraus écrivit pour tendre comme un miroir à ses contemporains. Pasteur écossais, pasteur autrichien : les sermons des deux prédicateurs sont quasi interchangeables. « Sus à l’ennemi ! Mort au Kaiser qui n’est autre que l’Antéchrist ! », éructe l’écossais. «En temps de guerre, tuer n’est pas un péché, mais un service divin », déclare l’autrichien.
Ce que les pasteurs ne disent pas, ce qu’ils omettent soigneusement de révéler, c’est ce que la guerre fait naître dans le cœur des hommes qui la font. Que peut donc engendrer la guerre monstrueuse sinon des cœurs broyés ? A quoi ressemble l’homme doux et bon, le père aimant, quand il revient en permission à son foyer ? Quel homme retrouve l’épouse ? Son mari, l’homme qu’elle aime, ou une sorte d’étranger qui n’a d’autre souhait que de la violer ? Et que devient-il, cet homme-là, quand il lui faut retourner au front, renouer avec l’horreur de la guerre ? Le pasteur, qui croyait de son devoir d’envoyer les hommes au casse-pipe, a-t-il eu un mot, une pensée pour Chris et pour toutes les autres femmes et épouses dont les vies seraient anéanties, les visages inondés de larmes et les cœurs hoquetant de souffrance ?
Le cinéaste Terence Davies, cinéaste discret, plutôt rare, sensible et attachant, dont chaque film est marqué du sceau de l’excellence, signe là un grand et bouleversant mélodrame. Il a parfaitement su recréer à l’écran la vie rude des fermiers écossais du début du XXème siécle, l’attachement à la terre, la peine des hommes qui la travaille, les signes du temps qui passe, l’enchaînement des saisons, etc. Magnifié par une mise en scène intelligente et délicate sachant signifier les fluctuations des cœurs par de simples mouvements de caméra, le film ne laisse jamais indifférent. Le cinéaste sait parfaitement indiquer aussi bien l’irruption de la nuit dans un cœur que les lueurs de l’espoir qui se révèlent à nouveau. Il sait aussi ce qu’il ce qu’on peut montrer à l’écran et ce qu’il est préférable de laisser hors champ. Il donne habilement la place qu’il faut aux chansons locales ou à la musique ; et c’est fort justement un air de cornemuse qui rend hommage aux morts tombés à la guerre. Mais surtout, surtout, en racontant la rude destinée de Chris, son héroïne, c’est une ode à la femme, à son courage, à sa bravoure, à sa ténacité, à sa beauté, que propose le cinéaste et on l’en remercie.
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
N.B. : La pièce de Karl Kraus, « Les Derniers Jours de l’Humanité », dont il est fait mention dans ma critique, n’est autre qu’une des deux pièces préparées par la troupe Réplic’Pus de Réseau Picpus à laquelle j’ai la joie de participer. Rendez-vous les 7 et 10 juin au théâtre Le Passage vers les Etoiles (Paris 11e) pour les représentations.
20160328 – Cinéma
ROSALIE BLUM
un film de Julien Rappeneau.
Le nom du metteur en scène de « Rosalie Blum » ne nous est pas étranger… Rien d’étonnant, car Julien Rappeneau n’est autre que le fils de Jean-Paul, le talentueux réalisateur de « La Vie de Château », de « Cyrano de Bergerac » et, tout dernièrement, de l’excellent « Belles Familles ». Julien, lui, après s’être fait la main en tant que scénariste, passe à son tour à la réalisation avec ce film dont l’un des points forts est précisément d’être magnifiquement écrit, son scénario mêlant tous les ingrédients qu’il faut pour plaire quand on veut faire une comédie : l’intelligence, l’habileté, la malice, la fantaisie…
C’est une bande dessinée signée Camille Jourdy qui a été adaptée pour en faire ce film savoureux. Tourné en grande partie à Nevers et un peu à La Charité-sur-Loire, l’action y est divisée en trois parties, chacune épousant le point de vue d’un des personnages. Trois personnages principaux donc : d’abord Vincent Machot (Kyan Khojandi), un garçon timide et plutôt solitaire, exerçant le métier de coiffeur et devant supporter le voisinage d’une mère possessive, envahissante et écervelée (jouée par Anémone) ; ensuite la délicieuse Aude (Alice Isaaz), jeune fille sans emploi et vivant en colocation avec un hurluberlu (Philippe Rebbot) ; enfin la tante d’Aude, celle qui donne son titre au film, Rosalie Blum (Noémie Lvovsky), une épicière qui, pour une faute commise autrefois, a été mise au ban de sa propre famille et a perdu la garde de son fils.
Tous ces personnages trompent comme ils peuvent leur solitude et essaient de cacher leurs blessures intimes. Pourtant, et même si le film n’est dénué ni de mélancolie ni de tendresse, c’est bien une comédie qui se met en place au fil d’une intrigue à rebondissements et à surprises dont les éléments s’assemblent, petit à petit, comme les pièces d’un puzzle. Au gré des filatures, car les personnages se suivent et s’épient les uns les autres, se découvrent les petites mystères et les secrets petits et grands de chacun. Le film avance à la manière d’une enquête ludique faisant se succéder des scènes souvent très amusantes. Le petit jeu qui consiste à s’espionner les uns les autres conduit aux situations les plus cocasses, la moindre n’étant pas celle qui voit s’introduire par effraction Aude et ses comparses (outre Philippe Rebbot déjà nommé, Sara Giraudeau et Camille Rutherford) chez l’inénarrable mère de Vincent.
Le charme de ce film paraîtra peut-être un peu rétro à certains… Qu’importe ! Les comédies de qualité n’abondent pas dans le cinéma français contemporain et je ne serai certes pas de ceux qui feront la fine bouche. Avec « Les Bêtises » de Rose et Alice Philippon et « Belles Familles » de Jean-Paul Rappeneau, sortis l’an dernier, voici la crème de la comédie à la française : un film qui émeut et fait rire à la fois (et le fait irrésistiblement)!
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160327 – Cinéma
MÉDECIN DE CAMPAGNE
un film de Thomas Lilti.
Après avoir exploré avec talent le quotidien d’un hôpital dans « Hippocrate » (sorti en 2014), Thomas Lilti aborde à nouveau son sujet de prédilection, celui de la médecine, mais en déplaçant sa caméra du côté du monde rural. « Médecin de campagne, cela ne s’apprend pas », explique Jean-Pierre Werner (François Cluzet) à sa consoeur Nathalie Delezia (Marianne Denicourt), venue dans ce coin de ruralité profonde pour le seconder. Cette dernière a tôt fait de le découvrir, exercer la médecine à la campagne n’a rien d’une sinécure : il faut non seulement avaler les kilomètres pour visiter les malades mais affronter les chiens méchants et les jars en furie, patauger dans la boue, aller au fin fond d’un coin perdu pour trouver des caravanes de gens du voyage et être muni d’une bonne dose de patience avec ceux que précisément on nomme les patients ! Et quand enfin on peut rentrer chez soi, ce n’est certes pas pour se reposer mais pour trouver une salle d’attente bondée d’autres… patients.
Mais ce qui donne beaucoup d’humanité à ce film, ce n’est pas seulement le parti-pris d’exposer le quotidien d’un homme exerçant un métier en voir de raréfaction, mais c’est de le montrer lui-même fragilisé et vacillant du fait de la maladie. Jean-Pierre n’accepte à contre-coeur la présence de Nathalie que parce qu’il est lui-même gravement malade (on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau). Il se passerait volontiers de toute aide, à vrai dire, mais c’est son cancérologue qui lui a en quelque sorte imposé la venue et le soutien de Nathalie.
De ce fait, entre les deux médecins, Jean-Pierre et Nathalie, se noue une relation assez complexe et quelque peu ambiguë. Pour Jean-Pierre, il est difficile de voir quelqu’un d’autre empiéter sur son terrain. Pour Nathalie, il n’est pas aisée d’être plus ou moins sous la surveillance d’un aîné qui ne la ménage pas. Mais, fort heureusement, on n’a pas affaire à des personnages monolithiques et leur relation évolue subtilement au cours du film, allant vers quelque chose de moins rude et de plus mystérieux.
Thomas Lilti (qui, si j’en crois ce que j’ai lu dans un article, prépare à présent une série télévisé – toujours sur le monde de la médecine – qui sera diffusée sur Canal +) a réussi là un film très touchant, constamment juste et (grâce aussi aux talents conjugués de ses deux acteurs principaux) très agréable à regarder.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160327 – Théatre
Bonjour à tous!
Joyeuses fêtes de Pâques!
Christ est ressuscité! Alleluia!
Rappel des dates des représentations des deux pièces jouées cette année par Réplic’Pus, la troupe de théâtre de Réseau Picpus dont je fais partie (je jouerai dans « Les Derniers Jours de l’Humanité »):
Depuis plusieurs mois, la troupe Réplic’pus prépare avec enthousiasme deux belles pièces de théâtre et nous avons hâte de les partager avec vous !
Suivez dès maintenant les aventures de la troupe ici !
Et notez bien dans vos agendas les dates de nos représentations :
– mardi 7 juin et vendredi 10 juin à 20h : Les Derniers Jours de l’Humanité de Karl Kraus au Passage vers les Etoiles (17 Cité Joly, Paris 11e).
1914, Autriche-Hongrie.
Un climat d’insouciance règne au sein de l’empire. Mais, entre les nations, c’est la poudrière. Soudain, l’étincelle : on assassine le trône. Et le peuple, tout entier, s’engage – à corps et âmes perdus – dans une guerre meurtrière. Au nom de quoi ? Nul ne semble vraiment le savoir…
Peuple, presse, armée… Par une série de portraits au vitriol, le satiriste autrichien Karl Kraus (1874-1936) dépeint cette guerre qui – si on n’y prend garde – s’insinue dans nos consciences, se nourrit de nos arrangements. Dans ces mots qu’on utilise, dans cette réalité qu’on travestit, dans les intérêts que l’on sert, dans ce manquement à nos responsabilités, dans notre vision de l’Homme qu’on manipule…C’est du vécu.Venez nombreux, ça va « valser » (si,si) !
– mardi 14 juin à 20h, mercredi 15 juin à 20h et dimanche 19 juin à 17h : L’Importance d’être Constant d’Oscar Wilde à l’Espace Bernanos (4 rue du Havre, Paris 9e).
Vous aimez Feydeau ? Vous aimez la jelly ? Vous aimerez Oscar Wilde !
Constant, dandy londonien, revient de la campagne et arrive en ville, bien décidé à demander en mariage Gwendoline. Mais l’étui à cigarette retrouvé par son ami Algernon va le contraindre à avouer sa double-vie et à révéler sa véritable identité…
Les situations de plus en plus complexes, servies par des personnages tantôt drôles, tantôt émouvants, souvent carricaturaux et ridicules, s’enchainent tout le long de cette farce joyeuse dans laquelle l’auteur propose néanmoins une réflexion sur l’identité, le rapport difficile à soi et à autrui et bien sûr… l’importance d’être constant.
Pour en savoir plus sur la troupe et les pièces, rendez-vous sur le site !
Pour info, il vous sera possible d’y acheter vos billets… d’ici quelques semaines !
Nous espérons vivement vous voir dans le public en juin !
Bien amicalement.
Luc Schweitzer, sscc.
20160323 – Cinéma
KEEPER
un film de Guillaume Senez.
Mélanie (Galatéa Bellugi) et Maxime (Kacey Mottet Klein) sont deux adolescents de 15 ans qui s’aiment d’amour tendre ou, plus exactement, qui apprennent à s’aimer : une des premières scènes du film l’indique habilement, aimer c’est aussi respecter l’autre, ne pas l’obliger à faire ce pour quoi il (ou elle en l’occurrence) n’éprouve que dégoût. A 15 ans, on a tout le temps qu’il faut pour découvrir ce que c’est que de s’aimer vraiment. En tout cas, on devrait avoir tout le temps nécessaire, mais pour les deux tourtereaux de ce film, les choses se compliquent de façon inattendue le jour où Mélanie découvre qu’elle est enceinte !
Deux adolescents de 15 ans confrontés à la naissance d’un enfant : on imagine aisément que cela ne va pas de soi. Ce n’est pas un âge pour être parents et pourtant il faut bien se prononcer et prendre des décisions. Les discussions sont d’autant plus vives que, on s’en doute, à cet âge-là, on est bien obligé un jour ou l’autre de tout révéler aux parents et d’entendre leur avis. Ceux de Maxime (bien que séparés) se rejoignent dans une position d’ouverture et d’accueil. C’est surtout le cas de la mère du garçon, le père étant habité aussi par d’autres préoccupations. Quant à la mère de Mélanie, elle se souvient trop d’avoir elle-même souffert d’avoir eu sa fille alors qu’elle était très jeune pour accepter que cette dernière subisse le même sort. Discussions, petits arrangements, peurs, hésitations, décisions : le film avance en prenant en compte tous les enjeux, toutes les difficultés, faisant naître et grandir chez le spectateur une empathie pour les deux personnages d’adolescents, joués par deux acteurs qui, en dépit de leur âge, font preuve d’un grand talent. Quand Mélanie, soutenue par Maxime, décide de tenir tête à sa mère qui voudrait la faire avorter et lui affirme qu’elle veut garder l’enfant, on en reste pantois d’admiration tant le jeu de l’actrice est fort et convaincant.
Pour Maxime, les décisions à prendre s’avèrent d’autant plus complexes que le cœur du garçon est divisé : s’il est habité d’un côté par son amour pour Mélanie, il l’est aussi d’un autre côté par sa passion pour le football. Belle idée que d’en avoir fait un gardien de but qui, guidé par son père, rêve de grimper les échelons de l’excellence. Le « keeper », le gardien, se trouve empêtré dans ses dilemmes. Que lui faut-il garder ? Garder un but, garder Mélanie, garder l’enfant… Peut-on tout garder sans rien perdre ? Ou faut-il faire des choix et, de ce fait, accepter des renoncements ? Et quels choix opérer quand on a affaire à une fille imprévisible comme Mélanie ?
En optant pour un sujet aussi délicat, aussi périlleux pour son premier film, le belge Guillaume Senez a pris tous les risques. Mais il a su parfaitement maîtriser sa mise en scène, choisir ses acteurs et les diriger et réussir un film qui échappe totalement à tous les écueils, et en particulier à celui du moralisme. Ce n’est certes pas de leçons de morale dont ont besoin les deux adolescents qui sont au cœur de ce long-métrage, mais d’écoute, d’accompagnement, de soutien et, peut-être, de miséricorde. Jamais le réalisateur n’invite à juger ses personnages, il veut simplement nous les faire aimer tels qu’ils sont, forts et fragiles en même temps.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160322-Cinéma
NO LAND’S SONG
un film de Ayat Najafi.
Dans le passionnant « À peine j’ouvre les yeux », film de Leyla Bouzid sorti sur les écrans il y a quelques mois, nous découvrions à quel point il était risqué pour la jeune Farah d’oser chanter dans la Tunisie de Ben Ali. Aujourd’hui, c’est un documentaire venu d’Iran qui retrace les combats menés par des chanteuses de ce pays désireuses de se produire en public. Or en Iran, depuis la révolution de 1979 et les diktats de l’Imam Khomeyni contre la musique, il est interdit aux femmes de chanter en solo pour un public mixte (composé d’auditeurs des deux sexes). La jeune compositrice Sara Najafi (sœur du réalisateur) entreprend donc une véritable lutte afin de faire entendre la voix des femmes en Iran. Avec des chanteuses et des musiciens, elle ose s’engager dans de laborieux pourparlers afin d’obtenir l’autorisation d’organiser un concert à Téhéran. Pour ce faire, il faut multiplier les rendez-vous au ministère de la culture iranien et supporter les refus sans baisser les bras. Il peut même être utile de rencontrer un mollah afin de lui demander des explications, ce qui donne lieu à des scènes à la fois consternantes et savoureuses tant le supposé théologien s’empêtre dans ses raisonnements confinant à l’absurde.
Heureusement, pour mener à bien son combat, Sara Najafi peut non seulement compter sur le soutien de chanteuses et musiciens de son pays, mais aussi de France et de Tunisie. C’est un véritable partenariat qu’on voit se mettre en place au fil de ce documentaire en même temps que se noue un dialogue interculturel des plus intéressants. En France, ce sont les chanteuses Jeanne Cherhal et Elise Caron accompagnées de leurs musiciens qui s’engagent aux côtés des Iraniennes. De Tunisie vient aussi s’adjoindre au groupe Emel Mathlouthi, une chanteuse à la voix d’or. Tout ce monde se rencontre, discute, débat, chante et espère se produire un jour sur une scène de Téhéran.
On imagine la joie et l’émotion qui étreignent le cœur de ces femmes quand enfin, après avoir surmonté tous les obstacles et les tentations de désespoir, un concert a lieu, le 19 septembre 2013, à l’Opéra de Téhéran. Toutes sont présentes, les Iraniennes, les Françaises et la Tunisienne. Et les voix féminines tant honnies par les censeurs obscurantistes s’élèvent enfin. Quand la tunisienne Emel Mathlouthi fait entendre son chant, lorsque s’impose sa voix si belle, c’est à la manière d’un hymne à la liberté. Liberté conquise le temps d’un concert, mais liberté encore à gagner pour les femmes d’Iran et de tant d’autres pays ! Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que ce superbe documentaire (chaleureusement applaudi par les spectateurs de la séance à laquelle j’ai assisté) insuffle de l’espoir.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160319-Cinéma
LES OGRES
un film de Léa Fehner.
Bienvenue à la troupe du Théâtre Davaï, troupe itinérante qui propose, de lieu en lieu, un spectacle adapté de deux courtes pièces d’Anton Tchekhov, « L’Ours » et « La Noce ». Bienvenue aux comédiennes et comédiens, à chacun des membres de ce théâtre, à ces personnages hauts en couleur qui, dès la première scène de ce film-fleuve, emportent irrésistiblement le spectateur dans la ronde effrénée de leur passion ! Chez ces gens-là, on ne parle pas, on crie, on chante, parfois on murmure ou on se confie, le plus souvent on gueule et on s’engueule ! Tout est comme emporté par un torrent d’énergie dont on se demande où il prend sa source.
« Davaï », qui veut dire en russe « Vas-y ! », convient parfaitement à la frénésie des personnages ainsi qu’à la formidable mise en scène de Léa Fehner. Pas de temps mort, on avance, on avance, même quand les personnages trébuchent et chancellent. Il faut dire que la réalisatrice connaît son sujet : ce sont ses propres parents, François et Marion, qu’elle met en scène. Pourtant, et même si, de fait, ces derniers dirigent une structure théâtrale itinérante depuis plus de vingt ans, on n’a pas affaire à un simple documentaire, mais à un film mixant subtilement et intelligemment le réel et la fiction. Cela participe d’ailleurs à la fascination qu’exerce ce film que de ne pas toujours savoir ce qui relève de l’un ou de l’autre.
Ce qui interpelle et dérange le plus peut-être, c’est de découvrir à quel point il est difficile, voire impossible, de conserver un minimum d’intimité quand on est membre d’une troupe de cette sorte. Si les comédiens se donnent en spectacle sur la scène, ils le font aussi les uns pour les autres : leur vie entière est spectacle. Tout se donne à voir, rien ne peut rester longtemps dissimulé. Quand François fait appel à une ancienne amante pour remplacer une comédienne blessée et que Marion crie sa souffrance et sa peine, tous les autres membres de la troupe en sont les témoins. De même quand Mr Déloyal (Marc Barbé) éructe son mal de vivre, lui dont la nouvelle et jeune compagne, Mona (Adèle Haenel), est enceinte. Ou encore quand la fille de François et Marion (Inès Fehner) fait part à son père de sa souffrance et de son amertume, tant elle est meurtrie d’être méprisée par ce dernier.
Cette mise à nu de chacun, cette mise en commun de toute vie et de tout sentiment, c’est à la fois ce qui fait la force et la faiblesse de la troupe et c’est aussi ce qui provoque en elle de rudes débats. Que faire quand un des membres commet une faute grave ? Que décider quand il est question de présenter des excuses à cause de la faute d’un seul ? Est-ce le groupe entier qui les présentera ou bien le seul fautif ? François a beau diriger le théâtre d’une main ferme, les discussions n’en sont pas moins vives et tournent vite à l’engueulade. Tantôt mise à mal, tantôt renforcée dans l’épreuve, la cohésion de la troupe donne lieu aussi à des instants de grâce teintée d’humour : ainsi à l’hôpital où Mona accouche d’un bébé aussitôt doté d’une troupe de papas !
Ce n’est sans doute pas un hasard si la réalisatrice a choisi de faire jouer des pièces de Tchekhov au théâtre Davaï. Les comédiennes et les comédiens qui le composent sont des personnages tchekhoviens en effet, non seulement sur la scène mais dans la vie.Joyeux, dévorant la vie comme des ogres, toujours prompts à la dispute et à la réconciliation, il cachent bien mal leur indomptable mélancolie. Sous les rires, les chants et les éructations affleurent des multitudes d’angoisses et, parfois même, des désirs de mourir.
Mais davaï, « allons-y », il faut continuer la route, monter et démonter et monter à nouveau le chapiteau. Et chanter malgré tout, chanter encore lors d’une sublime scène finale qui emporte et fait chavirer le cœur du spectateur. Une troupe d’ogres, la troupe du théâtre Davaï ? Oui, mais d’ogres qui n’en sont pas moins très très humains : des ogres agaçants et attachants et pleins de fêlures comme des humains !
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
P.S. : Une mise en garde me semble et nécessaire : je tiens à avertir que des scènes et des propos de ce film peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs !
20160309 – Cinéma
THE ASSASSIN
un film de Hou Hsiao-Hsien.
Cela fait huit ans que les cinéphiles attendaient un film du taïwanais Hou Hsiao-Hsien, mais probablement ne l’attendait-on pas sur le terrain qu’il a choisi en fin de compte d’explorer : celui du wu xia pan, film de chevalerie, de sabre, d’art martial à la manière chinoise. Un genre dont le réalisateur s’empare à sa façon, offrant aux regards des spectateurs du grand spectacle certes, mais sans jamais céder à la facilité ni aux conventions qui pullulent le plus souvent dans les films d’art martial. Autant le dire d’emblée, ceux qui iront à une séance de « The Assassin » en souhaitant voir se succéder des scènes de combat seront déçus. Des combats, il y en a, bien entendu, mais de manière parcimonieuse et presque fugitive. Que reste-t-il donc à voir ?, se demandera-t-on. La réponse est simple et directe : des scènes et des plans d’une stupéfiante beauté !
Il ne faut pas se laisser décourager par certains avis parus sur le net qui prétendent que l’intrigue de « The Assassin » est si obscure, si confuse, qu’on n’y comprend rien. Ce n’est pas du tout exact. En vérité, si le film peut prêter parfois à confusion, sa trame n’a rien de très complexe et peut se résumer en quelques lignes qui suffisent amplement à décrypter, si besoin est, chacun de ses plans et chacune de ses scènes. L’action se déroule dans la Chine du IXème siècle, dans la province de Weibo, l’une de celles qui, apprend-on, se sont rebellées contre le pouvoir impérial au point de le défier. Nie Yinniang (jouée par la sublime Shu Qi), une jeune femme dont l’éducation a été confiée à une nonne taoïste qui l’a initiée aux arts martiaux, revient dans sa province en ayant pour mission secrète d’éliminer les tyrans, à commencer par son propre cousin Tian Ji’an, le gouverneur de Weibo. Or cet homme, ce Tian Ji’an, n’est nul autre que celui avec qui Nie Yinniang a passé son enfance, avec qui elle espérait se marier, et qui, même si le mariage n’a pas pu se concrétiser, demeure son amour secret. Voilà tout le dilemme qui se joue sur l’écran : la justicière Nie Yinniang ira-t-elle jusqu’à sacrifier l’homme qu’elle aime ou désobéira-t-elle à ses commanditaires ?
Il n’est pas besoin d’en savoir davantage pour apprécier ce film dont toute la splendeur réside, bien plus que dans son scénario, dans la minutie et le soin apportés à la réalisation de chacun de ses plans. Chacun d’eux est composé à la manière d’un tableau doué de mouvement. Dès les scènes d’ouverture, filmées en noir et blanc, on ne peut qu’être subjugué par tant de beauté, comme si se façonnaient sous nos yeux de somptueux dessins faits à l’encre de Chine. Viennent ensuite les couleurs, le plus souvent dans des tons chauds de rouge et d’ocre, mais parfois aussi dans des teintes plus vaporeuses lorsque les scènes sont tournées en extérieur. A cela s’ajoutent les sons : bruits hallucinatoires des tambours ou musique de danse à l’occasion d’une scène des plus somptueuses dans le palais du gouverneur. Tant de splendeur laisse pantois, au point qu’on se demande si l’on ne rêve pas : la Chine du IXème siècle, une Chine certes peut-être fantasmée, semble nous être donnée à contempler.
Cela étant dit, si les décors ravissent les regards et si les sons émeuvent, c’est aussi et surtout d’une part parce qu’ils sont habités et d’autre part parce qu’ils émanent de personnages qu’on se délecte de découvrir et d’observer. Certains d’entre eux, il est vrai, n’ont droit qu’à un passage éclair (et c’est peut-être ce qui donne au film une apparence de complexité narrative), mais d’autres nous deviennent vite familiers, à commencer par le gouverneur et par son entourage et, bien sûr, par la justicière Nie Yinniang. Les apparitions de cette dernière sont toutes remarquables : silhouette vêtue de noir, elle se devine ou se montre à peine, à la façon d’un félin qui s’apprête à bondir, elle surgit lors de brèves confrontations, elle disparaît comme un oiseau aux ailes sombres. Est-elle une tueuse, comme l’indique le titre du film ? Oui sans doute, mais une tueuse qui, si elle maîtrise à la perfection la technique de son art martial, n’en recèle pas moins sa fragilité. Fragilité qui se révèle peu à peu et qu’on peut désigner par cette expression : un cœur qui bat. Car même dans un cœur aguerri peut naître et grandir ce curieux sentiment qui a nom miséricorde et qui s’invite, si l’on peut dire, comme trouble-fête (ou plutôt, en l’occurrence, comme trouble-crime) !
Même si l’on n’est nullement amateur de films d’arts martiaux, il ne faut pas hésiter à aller voir ce film-ci tant il est différent, hors norme, tant il est sublime de beauté !
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160307-Cinéma
PEACE TO US IN OUR DREAMS, de Sharunas Bartas:
EL CLAN, de Pablo Trapero:
AVE CESAR, de Joel et Ethan Coen:
L’HISTOIRE DU GEANT TIMIDE, de Dagur Kari:
JE NE SUIS PAS UN SALAUD, de Emmanuel Finkiel:
SAINT AMOUR, de Benoît Delépine et Gustave Kervern:
BROOKLYN, de John Crowley (vu en avant-première):
Luc Schweitzer, sscc.
20160226 – Cinéma
THE REVENANT
un film de Alejandro González Iňárritu.
Adapté d’un roman de Michael Punke lui-même inspiré d’une histoire vraie, et ayant déjà été traité au cinéma par Richard Sarafian en 1971 (« Le Convoi sauvage »), ce film, à présent qu’il est sorti sur les écrans, suscite autant de réactions de rejet que de réactions élogieuses. Pour les uns, ce n’est qu’une coquille vide ou une sorte de long pensum qu’on a hâte de voir s’achever. Pour les autres, c’est, au contraire, une œuvre fascinante qui, malgré sa durée, paraît bien courte tant on en savoure tous les instants. Pour ce qui me concerne, si je me suis rendu à une projection de ce film en me préparant mentalement à faire partie du premier de ces groupes, je me suis vite rendu compte, dès les premières scènes, que ce serait le deuxième groupe qui me compterait parmi ses membres les plus résolus et les plus enthousiastes.
« The Revenant » est en effet un film superbe et passionnant, un grand film d’aventures et une œuvre qui ouvre ou qui peut ouvrir (chez celui qui est réceptif) de multiples champs de réflexion. Je n’ai pas besoin de souligner la performance d’acteur de Leonardo Di Caprio : elle a été suffisamment relayée par les médias. Mais ce qu’il convient d’ajouter, c’est que ce film ne repose pas seulement sur les qualités d’un acteur, aussi doué soit-il, il est mis en scène et réalisé de très belle manière et, parfois même, de manière grandiose. Cela saute littéralement aux yeux dès l’ouverture, dès les premières scènes qui nous mettent en présence d’un groupe de trappeurs qui, en 1823, isolés dans une nature sauvage du Dakota, est attaqué par des Indiens Arikaras. Séquence classique de tant de westerns, dira-t-on, mais elle est filmée ici avec une telle invention, avec des angles de caméra si innovants qu’on a presque l’impression de la voir pour la première fois. Cette inventivité de la mise en scène et ces subtilités dans les prises de vue et les mouvements de caméra sont présentes tout au long du film. Certains plans, c’est vrai (et il n’a pas manqué de critiques pour le reprocher à Iñárritu, comme s’il était une sorte de plagiaire), sont directement inspirés de films d’un géant du cinéma, le russe Andréi Tarkovski : rien n’interdit cependant de les considérer non pas comme de pâles imitations, mais comme de beaux et révérencieux hommages à l’un des plus grands cinéastes du monde !
Cela étant dit, il me paraît également important et nécessaire de contredire ceux qui ont cru bon d’éreinter « The Revenant » en en soulignant la prétendue inanité. Ce film est-il vraiment la « coquille vide » que dénoncent quelques critiques ? Ses qualités ne sont-elles que formelles ? N’a-t-il rien d’autre à offrir que de belles images, que des paysages impressionnants ? Nullement. Et il n’est pas juste, me semble-t-il, de le limiter au seul thème de la vengeance, thème ô combien éculé quand il s’agit de western !
S’il est exact d’affirmer qu’un désir forcené de vengeance anime la plus grande partie du film, il est faux cependant de le circonscrire à ce seul thème. Le héros du film, le trappeur Hugh Glass, brutalement attaqué et lacéré par une ourse grizzli, d’abord recueilli et soigné par ses compagnons, doit ensuite être laissé à la seule garde de trois d’entre eux (dont son fils métis prénommé Hawk), les autres, toujours pourchassé par les Indiens, essayant de rejoindre un fort. Mais la tension ne tarde pas à monter entre les trois qui se sont proposés pour assurer la surveillance de Glass. L’un d’eux, nommé Fitzgerald, menteur, fourbe et détestant les Indiens, en vient à tuer Hawk sous les yeux de son père, en l’absence du troisième garde, le jeune Bridger (dont on a pu déjà constater, lors d’une scène précédente, que c’est un homme compatissant). Fitzgerald, à force de ruse et de mensonge, réussit néanmoins à l’entraîner à sa suite et à abandonner Glass à une mort quasi certaine.
Commence alors pour Glass une lutte inouïe pour vaincre tous les dangers, surmonter les épreuves, survivre, retrouver Fitzgerald et se venger. Je me garderais bien sûr de raconter toutes les péripéties du film, mais ce qu’il me paraît important de noter, c’est que, si Glass parvient à s’en sortir et à vivre, c’est, en partie, parce que sa route croise celle de Hikuc, un Indien Pawnee qui fait preuve de miséricorde envers lui et le sauve de la mort. Je le souligne pour indiquer que, s’il est vrai que le thème central du film est celui de la vengeance, il n’y en a pas moins place dans le scénario pour son opposé, le thème de la miséricorde. Il convient également de remarquer que le traitement réservé aux Indiens dans ce film n’a rien de caricatural : ceux-ci ne sont pas uniquement présentés comme des tueurs sanguinaires.
Il ne faut pas se fier aux apparences ni se contenter de la simple trame du film. Sous ses airs simplistes se dissimulent mille richesses. Le thème lui-même de la vengeance n’est pas traité d’une manière trop rudimentaire. Fitzgerald (peut-être est-ce par dérision) énonce au cours du film que « la vengeance appartient à Dieu seul. » Pour les lecteurs de la Bible, impossible de ne pas songer aussitôt à Isaïe 35,4 pour qui « la vengeance qui vient, la revanche de Dieu », c’est d’apporter le salut aux hommes.
Pour finir, j’ajouterais qu’il est possible et tout à fait licite de recevoir « The Revenant » à la manière d’une parabole, d’une de ces paraboles (dont Jésus lui-même fait parfois usage, notons-le) qui racontent le négatif afin de faire percevoir le positif. En voyant comment, dans ce film, Glass parvient à surmonter toutes les épreuves, à traverser tous les dangers, à survivre à tous les malheurs dans le seul but de se venger, l’on se dit qu’il faudrait adopter le même acharnement pour atteindre d’autres buts : non pas la vengeance mais le pardon, non pas la haine mais l’amitié.
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160220 – Cinéma
CE SENTIMENT DE L’ÉTÉ
un film de Mikhaël Hers.
Il faut faire preuve de beaucoup de réserve et de beaucoup de délicatesse pour bâtir et réaliser un film ayant pour principal sujet ce qu’on appelle communément le travail de deuil. Or ce sont précisément ces qualités-là qui irriguent tout le film de Mikhaël Hers. Toutes les scènes larmoyantes sont soigneusement omises par le réalisateur qui préfère très judicieusement suggérer la peine et la souffrance plutôt que de les donner en spectacle. Cette retenue est d’autant plus pertinente que le sujet même du film (le travail de deuil, donc) est empreint d’une dimension universelle. Qui n’a pas perdu un être cher et qui n’a pas éprouvé la douleur de l’absence ? Nul besoin, par conséquent, d’être démonstratif : un geste, un signe, un objet suffisent à évoquer la personne disparue et l’on imagine sans difficulté le degré de souffrance qui ne demande qu’à surgir dans le cœur de ceux qui restent. On le sait, on sait par expérience ce que c’est que d’éprouver cette douleur-là.
C’est au fil de trois étés que Mikhaël Hers a choisi de dérouler son récit : une saison que d’instinct on aimerait associer à la joie de vivre et à l’insouciance. Mais ce lieu commun est ici refusé : c’est en été que survient la brutalité d’un décès et c’est en été que l’absence de l’être aimé se fait davantage ressentir.
Trois étés et trois villes : Berlin, Paris (avec un passage par Annecy) et New-York. A Berlin, un matin d’été, une jeune femme se lève, s’éloigne du lit où dort son compagnon, s’habille et se rend à son travail de sérigraphiste. Une journée comme une autre… Sauf que, quittant son lieu de travail et marchant dans un parc, la jeune femme tout à coup s’écroule. Peu de temps après, à l’hôpital, elle décède. On ne saura pas grand chose d’elle, mais on découvre son compagnon d’origine américaine, Lawrence (Anders Danielsen Lie) et, bientôt, la famille de Sasha (la jeune femme décédée) et tout particulièrement Zoé (Judith Chemla), sa petite sœur.
Mikhaël Hers ne montre rien des obsèques. Il multiplie les ellipses pour mieux attarder sa caméra sur les deux personnages qu’il a choisi de suivre au cours de trois étés : Lawrence et Zoé qui, tous deux touchés au plus intime de leur être par la perte de Sasha, nouent une relation faite à la fois de proximité et de distance. Leur complicité comme leur éloignement s’expriment le plus souvent en mode mineur, par de petites touches et de petits signes : nul besoin de grands discours ni de grandes effusions pour laisser entrevoir ce qui habite les cœurs. « Les grandes douleurs sont muettes », on le sait. Et c’est encore plus vrai quand on a affaire à des êtres pétris de pudeur et de discrétion comme le sont Lawrence et Zoé.
Après l’été de Berlin, leurs chemins se croisent à nouveau : un été à Paris, l’autre à New-York. Avec toujours, invisible mais ô combien réelle, la présence/absence de Sasha. Est-ce qu’avec le temps on oublie ? La douleur s’apaise-t-elle vraiment ? Pas sûr. Mais on apprend à vivre quand même, tout en portant ce poids secret qui ne peut être partagé (même tacitement) qu’avec un cœur qui en est également blessé.
C’est ce secret des cœurs que fait entrevoir Mikhaël Hers en optant pour la simplicité et un parti-pris de minimalisme. Certains critiques jugeront peut-être que, du coup, le film en devient presque insignifiant. Pour ce qui me concerne, si je déplore certes quelques longueurs, je n’en ai pas moins été touché par les personnages tels qu’ils sont mis en scène et je n’en ai pas moins apprécié la manière du réalisateur. Ce film tout en sensation, tout en finesse, tout en délicatesse, a de quoi faire vibrer nos cordes les plus intimes.
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160215 – Cinéma
PEUR DE RIEN
un film de Danielle Arbid.
« Jusqu’ici, tout est laid ». Voilà tout ce que Lina (Manal Issa, révélation de ce film) peut écrire en réponse à la professeure d’histoire de l’art qui vient de demander à ses élèves de faire la liste de ce qu’ils trouvent laid. Nous sommes au début des années 90 à Paris sur les bancs d’une fac. Lina est arrivée en France peu auparavant, venant de son Beyrouth natal où elle a laissé une famille avec qui elle s’entend mal. La laideur, elle sait ce que c’est, elle qui a perçu dans son pays les bruits de guerre et qui, accueillie dans un premier temps par une tante, a dû s’enfuir parce que son oncle essayait d’abuser d’elle.
Danielle Arbid a sans doute puisé dans sa propre histoire pour raconter celle de Lina, son héroïne. La caméra ne la quitte quasiment jamais, épousant les luttes, les découvertes, les enthousiasmes et les déceptions de la jeune fille et révélant le trésor de sa beauté. Car si Lina affirme à sa professeure n’avoir vu que laideur, la caméra, elle, et surtout le regard de la réalisatrice ne cessent de faire écho à la beauté.
Non pas que Danielle Arbid nous décrive la jeune fille comme étant sans reproches, mais parce qu’elle nous la montre comme une battante. Chaque épreuve, chaque déception sont l’occasion d’aller plus loin et de faire de nouvelles rencontres. Lina multiplie les expériences pour pouvoir s’en sortir, avec à la clé des tentations auxquelles elle résiste ou non.
Elle rencontre des étudiantes, loge chez elles, s’inscrit en fac d’économie puis, réalisant qu’elle n’est pas à sa place, préfère suivre un cours d’histoire de l’art (où elle rencontre la professeure que j’ai déjà mentionnée – jouée par Dominique Blanc – qui lui sera d’un grand secours). Elle découvre donc l’art moderne, mais aussi, à un autre cours, les noms de Marivaux et de Blaise Pascal. Elle exerce des petits boulots pour gagner de quoi vivre, quitte les étudiantes avec qui elle s’est fâchée pour rejoindre un foyer de jeunes filles. Elle rencontre des militants royalistes et, plus tard, d’autres étudiants rédigeant un journal d’une tout autre tendance, plutôt anarchiste.
A vrai dire, les orientations politiques ne sont nullement la préoccupation de Lina. Ce qu’elle veut, c’est de ne pas être seule et d’obtenir des papiers pour pouvoir vivre en France. Ses histoires sentimentales, même si elles se soldent par un échec, ne la découragent pas. Elle se relève et elle se bat et fera tout pour obtenir le sésame lui permettant de rester à Paris, sésame difficile à obtenir alors que les lois de Charles Pasqua restreignent considérablement les autorisations de s’installer en France.
Quand il est question d’immigration au cinéma, en règle générale, les réalisateurs insistent beaucoup sur la pénibilité, les épreuves et les déceptions. Il y a de tout cela dans « Peur de rien », mais l’impression qui demeure a beaucoup plus à voir avec l’espoir et avec l’audace qu’avec la peine. Jamais la réalisatrice n’invite le spectateur à s’apitoyer sur le sort de Lina. Au contraire, ce personnage de jeune fille avide de liberté suscite sympathie et enthousiasme, d’autant plus que la jeune actrice qui l’incarne le fait à merveille. Un bien beau film donc, qui captive d’un bout à l’autre.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160208 – Cinéma
LES INNOCENTES
un film de Anne Fontaine.
Des témoignages facilement disponibles l’attestent : en 1945, non seulement l’Armée Rouge soviétique progresse irrésistiblement jusqu’à Berlin mais elle occupe les territoires conquis et considère comme une évidence et un droit d’y faire régner la terreur, notamment en pratiquant le viol systématique des femmes. Les soldats ne demandent pas mieux que d’exercer ce droit, sachant que leurs supérieurs hiérarchiques non seulement ne les sanctionneront pas mais les approuveront. L’un des témoignages les plus saisissants à ce sujet fut écrit par une femme anonyme de Berlin : elle y raconte le quotidien cauchemardesque des berlinoises contraintes de se terrer afin d’échapper, autant que faire se peut, à l’emprise fatale des soldats soviétiques (« Une Femme à Berlin », Folio n° 4653).
Mais ce que dévoile aujourd’hui « Les Innocentes », le film d’Anne Fontaine, nous laisse stupéfaits. En Pologne, en décembre 1945, Mathilde Beaulieu (Lou de Laâge, remarquable), une jeune interne de la Croix-Rouge française est mise en alerte par une religieuse échappée clandestinement d’un couvent de Bénédictines. Introduite dans la clôture, l’infirmière y est mise en présence de l’invraisemblable : plusieurs parmi les religieuses sont enceintes, le couvent ayant été investi, occupé, il y a quelque temps, par la soldatesque de l’Armée Rouge.
Sans hésiter, tout à son sens du devoir et n’écoutant que son cœur, la jeune Mathilde se met au service des religieuses durement éprouvées, au point que se noue, petit à petit, entre l’infirmière issue d’une famille aux convictions communistes bien ancrées et l’une ou l’autre des cloîtrées une relation d’amitié ou de complicité qui autorise des confidences et n’est pas dénuée de dimension spirituelle. Quand Mathilde s’enquiert auprès d’une des religieuses de ce qui persiste de sa foi et de sa vocation après l’épreuve qu’elles ont subie, la réponse vient tout naturellement : « Au début d’une vocation, c’est comme si l’on était pris par la main et conduit doucement. Mais vient le jour où le Père lâche la main de son enfant et il faut continuer d’avancer malgré la nuit, les doutes, la croix. »
Pour les religieuses bénédictines de ce couvent polonais, la croix est des plus éprouvantes. On imagine les nombreuses questions et les nombreux dilemmes qui se posent à elles. Elles s’efforcent de poursuivre leur vie conventuelle de toujours, mais, qu’elles le veuillent ou non, elles se trouvent confrontées à des faits qui risquent d’ébranler, de faire vaciller, les vœux mêmes auxquels elles se sont engagées. Deux des vœux sont particulièrement concernés. Celui de chasteté, bien évidemment, non seulement à cause des viols qu’elles ont subis mais aussi parce que, pour celles qui sont enceintes, chaque examen, même exercée par les mains d’une infirmière, est ressentie comme une nouvelle atteinte à leur intégrité, voire comme une agression. Celui d’obéissance aussi, car plus d’un doute et plus d’une question surgissent dans l’esprit de certaines religieuses au sujet des décisions prises par la mère abbesse.
Cette dernière, en effet, semble habitée par une obsession : le secret. Pour elle, les faits qui se sont déroulés au sein du couvent doivent, à tout prix, demeurer secrets, sans quoi, elle en est certaine, un scandale éclatera, des sœurs seront victimes de l’opprobre et la communauté sera dissoute. La conséquence de cette obsession va de soi : comment garder secrets les grossesses et les accouchements de religieuses dont l’état exige des soins et, surtout, que faire des enfants une fois qu’ils sont nés ? Que fait la mère abbesse ? Comment s’y prend-elle ? Comment se résoudront ces épineuses questions ?
C’est avec grande délicatesse et une constante justesse de ton qu’Anne Fontaine aborde ces questions inédites et ces dilemmes dans son film. On le ressent d’un bout à l’autre de celui-ci, la réalisatrice s’est elle-même fortement imprégnée de la vie conventuelle qu’elle met en scène. On le devine aussi à cause de la pertinence de certaines répliques, elle a été judicieusement conseillée (en l’occurrence par dom Jean-Pierre Longeat, l’ancien abbé de Ligugé).
Servis par des actrices remarquables, le film convainc sans peine chaque fois qu’il se déroule entre les murs du couvent (c’est un peu moins le cas pour les scènes se déroulant au sein de la Croix-Rouge). On y ressent fortement la détresse des religieuses, leurs doutes, leurs peurs, mais aussi leur foi (même si elle a de quoi vaciller), leur espérance, leurs désirs (qui diffèrent de l’une à l’autre) et, étonamment, quelque chose qui surgit, par moments, et qui ressemble à la joie. La scène finale, surprenante, donne presque envie de rire !
Ce film nous rappelle aussi que, de tout temps, et aujourd’hui encore, le viol est considéré par certains militaires comme une arme de guerre parmi d’autres. Cette pratique inqualifiable doit cesser : il faut non seulement la dénoncer mais agir pour qu’elle soit réellement sanctionnée pour ce qu’elle est : un acte criminel.
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160206 – Théatre
Bonjour à tous!
Juste un mot pour attirer votre attention sur des articles parus dans le journal « La Croix » à propos de la pièce de théâtre « Les Derniers Jours de l’Humanité » de l’auteur autrichien Karl Kraus donnée actuellement en représentation par des membres de la Comédie Française au théâtre du Vieux-Colombier à Paris.
http://www.la-croix.com/Debats/Chroniques/Sur-le-sentier-de-la-haine-par-Bruno-Frappat-2016-02-05-1200737893
20160205 – Cinéma
CHOCOLAT
un film de Roschdy Zem.
Il est des rencontres qui changent une destinée, qui transforment une vie qui semble banale et obscure en une existence hors du commun, vouée à la gloire puis à la déchéance. Celle de Chocolat (Omar Sy, extraordinaire), le clown qui s’exhibe dans un cirque miteux où il a pour mission de faire peur aux enfants, bascule lorsque Footit (James Thierrée) lui propose de former un duo avec lui. Mais c’est une deuxième rencontre qui les propulse, tous deux, sous les feux des projecteurs et sur le devant de la scène, celle d’un producteur d’une grande salle parisienne (Olivier Gourmet). Adieu le petit cirque sans ambition : les deux compères ont tôt fait d’acquérir le rang de célébrités. On se presse, on se bouscule pour les applaudir.
Nous sommes au tournant du XIXème et du XXème siècle et si les prestations des clowns Footit et Chocolat remportent un franc succès, c’est en grande partie à cause de leur caractère inédit. Non seulement Chocolat apparaît comme le premier clown noir de l’histoire mais chaque spectacle se conclut invariablement par la rouée de coups que lui donne son partenaire. C’est cela qui amuse le plus les spectateurs : un clown noir qui reçoit des claques et des coups de pied au derrière ! C’est l’auguste que le clown blanc domine, voire humilie, sauf qu’en l’occurrence l’auguste est noir et que, de ce fait, les rires des spectateurs ne sont pas dénués de pensées ou d’arrière-pensées racistes. Une promenade à l’exposition coloniale du bois de Vincennes (1907) ou un projet d’affiche qui caricature outrageusement l’acteur noir ne feront que confirmer ce qui est flagrant : le racisme est monnaie courante en France en ces années-là.
Chocolat, Rafael Padilla de son vrai nom, se rêverait bien, lui en comédien shakespearien plutôt qu’en clown qui reçoit des baffes. Et pourquoi pas dans le rôle d’Othello, rôle dédié à un noir mais qu’on a coutume de proposer à des acteurs blancs dont le visage est peinturluré ? Reste à savoir si le public est prêt à accepter cette transformation : le clown Chocolat se changeant en comédien de Shakespeare… Non seulement le pari est risqué mais il pourrait se solder par l’irrémédiable déclin de celui que les foules adulaient, à condition qu’il se laisse battre par son comparse.
Est-il besoin de faire de longs discours pour expliquer combien l’histoire du clown Chocolat reste d’actualité ? Certes le contexte a bien changé en un peu plus d’un siècle, mais le racisme n’a malheureusement pas pris son congé. Il suffit de tendre l’oreille, il suffit de naviguer quelque peu sur le web pour en trouver ici et là les relents nauséabonds. Les propos orduriers et les termes méprisants ont tôt fait de surgir quand l’occasion s’y prête.
Le film de Roschdy Zem n’a donc pas seulement le mérite de faire mémoire d’un personnage ayant réellement existé mais il nous interpelle et nous interroge. Son caractère pédagogique est avéré, mais il convient aussi d’en encenser la réalisation même si elle n’est pas parfaite. On peut certes déplorer quelques maladresses, mais elles n’altèrent que bien peu la qualité du film. Il faut souligner la justesse des décors, admirer de nombreuses bonnes idées de mise en scène et, surtout, accorder une salve d’applaudissements à Omar Sy : son interprétation du clown Chocolat est époustouflante. Puisse-t-elle nous inciter à changer nos regards, à en chasser tout ce qui s’apparente, de près ou de loin, au mépris de l’autre, quelles que soient ses différences !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160201 – Cinéma
LES DÉLICES DE TOKYO
un film de Naomi Kawase.
Heureusement que, de temps à autre, quelques collégiennes sortant d’un établissement voisin viennent égayer son échoppe, sans quoi les journées y seraient bien mornes. Sentaro, le gérant du commerce, porte l’ennui sur son visage. Il y fabrique et il y vend, comme il peut, des dorayakis, spécialité japonaise qui se compose de deux petites crêpes fourrées à la crème de haricots rouges confits. Mais tout change ou s’apprête à changer, le jour où passe par là une vieille dame un peu lunaire et tout absorbée par les émerveillements que suscitent chez elle les beautés simples du monde. Elle s’appelle Tokue et, voyant sur une affiche que Sentaro est à la recherche d’une aide, elle propose ses services : la crème de haricots rouges, elle la fait mieux que personne !
D’abord rétif, Sentaro, après avoir goûté un échantillon du savoir-faire de Tokue, se laisse convaincre et l’engage. Grand bien lui prend : les dorayakis sans saveur laissent place à de merveilleux petits délices qui ont tôt fait d’attirer des ribambelles de clients. C’est vrai, Tokue n’a pas son pareil pour fabriquer sa pâte de haricots rouges et tout le monde est sous le charme !
Tout le monde, sauf la patronne du commerce, qui vient de temps à autre y faire sa visite. Car « Les Délices de Tokyo » n’est pas seulement un gentil film culinaire, mais bien plus que cela. Une anomalie, pourrait-on dire, n’a pas échappé à la patronne : c’est l’aspect qu’ont les mains et les doigts de Tokue. Celle-ci d’ailleurs n’en avait pas fait mystère : dès son engagement, elle avait signifié à Sentaro qu’elle pouvait avoir quelques difficultés à se servir de ses doigts, suite à une maladie contractée dans sa jeunesse. Et, de fait, elle en porte les stigmates : ses mains sont tachées et ses doigts déformés.
Ces signes-là, nous les connaissons, ce sont ceux de la lèpre. Tokue en est guérie depuis longtemps, mais les marques restent et elles suffisent à effrayer. Au Japon, comme partout dans le monde, là où sévit cette maladie, on excluait les malades de la société. Certes, on ne les reléguait pas sur une île comme aux Hawaï du temps de saint Damien, mais on les confinait dans une léproserie d’où il leur était interdit de sortir. Une loi datant de 1907 préconisait leur internement forcé, loi qui n’a été abolie qu’en 1996 ! Et aujourd’hui encore, affirme la réalisatrice dans une interview, et même si l’Etat offre des indemnités aux malades ou aux anciens malades, les discriminations subsistent.
La lèpre fait encore peur, nous rappelle ce film, ou, en tout cas, elle fait peur à certains. D’autres, heureusement, n’en restent pas aux apparences. Dans « Les Délices de Tokyo », ce sont les blessés de la vie, ceux qui vivent ou ont vécu des épreuves, qui regardent non pas seulement avec les yeux mais avec le cœur. Sentaro, le gérant du commerce de dorayakis, cache lui aussi son douloureux secret. De même que Wakana, une des collégiennes qui s’y donnent volontiers rendez-vous, et dont la situation familale n’est pas des plus aisées. Ce sont eux qui non seulement acceptent Tokue, mais pratiquent une sorte de communion de cœur et d’esprit avec elle. Ce sont eux qui lui seront fidèles jusqu’au bout, sans crainte de quoi que ce soit.
Car des trésors de sensibilité, d’émotion et de poésie se dévoilent dans ce film aux airs de petite œuvre qui risque de passer inaperçue. Ce serait bien dommage. La vérité, c’est qu’on a affaire à une superbe réalisation et à de très bons acteurs. Et les spectateurs qui l’auront vue ne l’oublieront pas de si tôt !
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160130 – Réflexions sur le sexe et la violence au cinéma
SEXE ET VIOLENCE AU CINEMA
Quelques réflexions.
Je m’étonne toujours de certains catholiques pratiquants qui, sachant que je suis un passionné de cinéma, me disent qu’eux n’y vont jamais, qu’ils n’aiment guère les films parce qu’on y trouve trop de sexe et de violence. Chaque fois que j’entends ça, je suis tenté de répondre: « Mais, dans ce cas, ne lisez pas non plus la Bible, surtout pas! Vous seriez choqué de ce qu’on y trouve! »
Car la Bible elle-même raconte tout au long de ses pages et de ses récits des scènes de sexe et de violence! Et comment en serait-il autrement? La Bible est faite de l’histoire des hommes et Dieu sait si, en elle, en l’histoire des hommes, le sexe et la violence tiennent une grande place! Pour ne prendre qu’un exemple, la première lecture d’hier (2ème livre de Samuel) racontait comment David, voyant Bethsabée en train de se baigner, est pris de désir pour elle. Il l’envoie chercher, couche avec elle et, quelque temps après, Bethsabée découvre qu’elle est enceinte. Or elle est l’épouse d’Ourias le Hittite. Que fait David? Il organise un complot afin de faire périr celui-ci au cours d’une bataille! Et voilà! Dans le même récit, on a droit à ce qui déplaît tant à nos chers catholiques qui les dénoncent au cinéma, le sexe et la violence. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres: la Bible n’est pas avare de récits de cette sorte!
La vraie question n’est donc pas celle d’un éventuel surplus de sexe et de violence au cinéma. Le cinéma n’est qu’un reflet de ce qui fait nos vies et nous vivons dans un monde pétri, en grande partie, de sexe et de violence. La vraie question, c’est celle du regard: que fait-on du sexe et de la violence au cinéma? Quels regards portons-nous sur ces réalités? Comment les réalisateurs s’y prennent-ils pour mettre en scène le sexe et la violence? Comment s’y prend un John Ford? Un Quentin Tarentino? Et tant d’autres réalisateurs? Voilà la question qu’il faut se poser! Non pas: est-ce qu’il y a trop de sexe et de violence? Mais: comment le sexe et la violence sont-ils mis en scène, montrés ou seulement suggérés? Tel est le clivage. Personnellement, j’admire la manière de John Ford et je déteste celle de Tarentino, pour reprendre les noms des deux cinéastes cités précédemment. Ce que je désavoue par dessus tout, c’est le regard complaisant de certains réalisateurs qui nous transforme, nous les spectateurs, en voyeurs! J’ai horreur de ça! Mais beaucoup de cinéastes portent un autre regard sur le sexe et la violence: ils ne font pas de nous des voyeurs mais ils nous invitent, par leur regard subtil, à penser le sexe et la violence et pas seulement à s’en repaître visuellement. La Bible fait de même: elle ne se contente pas de raconter le sexe et la violence, elle les pense, elle en indique le sens ou le non-sens, elle invite à une certaine forme de regard. Tout est là, que ce soit dans la Bible, au cinéma, dans les romans, les opéras, le théâtre, la peinture, la BD, la chanson, etc. Ce qu’il faut exiger, c’est que les créateurs, quels qu’ils soient, ne nous transforment pas en simples dévoreurs de sexe et de violence, mais aussi et surtout en penseurs de ces réalités. Il ne doit jamais s’agir uniquement de s’en repaître, voilà tout!
Le 30 janvier 2016
Luc Schweitzer, sscc.
20160122 – Cinéma
CHORUS
un film de François Delisle.
Tout commence par une séquence difficile à mettre en scène, mais que, fort heureusement, le réalisateur a réussi en la tournant de manière simple et dépouillée. Aucun artifice de mise en scène, mais la réalité la plus nue : un homme, un prisonnier, face à un enquêteur à qui il avoue le crime sordide dont il s’est rendu coupable dix ans plus tôt.
Cela fait précisément dix ans qu’Irène (Fanny Mallette) reste sans nouvelles de son fils Hugo, disparu à l’âge de huit ans. Christophe (Sébastien Ricard), le père de l’enfant, a préféré se séparer d’elle et fuir lâchement. Il habite désormais au Mexique. Irène reste seule au Québec, non loin de sa mère qu’elle supporte difficilement. Elle essaie de tromper sa douleur en participant à un groupe de chant, mais c’est en vain. Elle le dit en voix off, « on croit que la souffrance s’estompe avec le temps, mais c’est faux. C’est même le contraire. Hugo est là, toujours là, et même s’il faut donner le change et ne pas pleurer devant les autres, la souffrance non seulement ne cesse pas mais elle grandit. »
Les aveux du prisonnier, coupable de crime pédophile, ayant permis aux enquêteurs de retrouver ce qu’il reste du corps de l’enfant, signent aussi les retrouvailles des parents. Revenu du Mexique, Christophe accompagne Irène dans ses démarches, y compris les plus pénibles : auprès des pompes funèbres, mais aussi à la morgue où leur sont dévoilés les restes de l’enfant et même devant un écran , les deux parents ayant exigé de voir et d’entendre les aveux enregistrés de l’assassin.
Ce sujet, celui de la mort d’un enfant et de ce qu’on appelle le travail de deuil des parents, est probablement l’un des sujets les plus risqués quand on fait du cinéma. Si Nanni Moretti, dans « La Chambre du Fils » (2001) avait réussi à le traiter d’une manière bouleversante mais en évitant tout pathos, d’autres, comme Felix Van Groeningen dans le désastreux « Alabama Monroe » (2012), s’y sont cassé les reins, faisant peser sur les spectateurs une sorte de chantage aux sentiments des plus repoussantes.
« Chorus » n’évite pas totalement les maladresses et les lourdeurs, ce n’est pas un film de la qualité de celui de Nanni Moretti. Cependant, si l’on tient compte du fait que, dans le film de François Delisle, il est non seulement question du décès d’un enfant mais de son odieux assassinat, on peut dire que le réalisateur ne s’en tire pas trop mal. La scène des parents regardant sur écran la confession du tueur de leur fils ainsi qu’une autre scène confrontant les parents aux horreurs perpétrés en Syrie et diffusés à la télé (comme s’il fallait graduer les atrocités) m’ont semblé maladroites. Mais beaucoup d’autres scènes sont filmées avec intelligence et justesse, comme celle des parents qui, à la fin du film, font la rencontre d’un des camarades d’école d’Hugo. Impossible de ne pas être bouleversé par le regard d’une mère qui, en voyant ce jeune homme de dix-huit ans, voit l’image de ce que serait son fils s’il vivait encore.
On peut mettre également au crédit de ce film la photographie en noir et blanc tout à fait superbe, les magnifiques scènes de chant choral et, surtout, le jeu très nuancé et très juste de Fanny Mallette qui interprète le rôle ô combien délicat d’Irène.
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20160113 – Cinéma
CAROL
un film de Todd Haynes.
L’année 2016 commence, sur le plan cinématographique, de façon assez curieuse, avec la sortie presque simultanée de deux films importants, attendus par les cinéphiles, mais stylistiquement aux antipodes l’un de l’autre. D’un côté, le féru de cinéma a dû supporter non seulement les dialogues interminables, pénibles, soûlants, voire carrément vulgaires des « Huit Salopards » de Quentin Tarentino, mais encore des scènes de violence absurdes et répugnantes baignant dans des flots d’hémoglobine. De l’autre, avec « Carol » de Todd Haynes, tout n’est que dialogues superbement écrits et réalisation d’une finesse et d’une subtilité qui laissent pantois. On aura compris, bien évidemment, combien le film de l’un m’a semblé détestable (je lui accorde un 2,5/10) et combien celui de l’autre apparaît, à mes yeux, comme une grande réussite, proche de la perfection.
Le genre mélodramatique sied à merveille à Todd Haynes ; il l’a prouvé, en 2002, avec la réalisation de « Loin du Paradis », grand film dans lequel le personnage joué par Julianne Moore découvrait, dans l’Amérique des années 50, l’homosexualité de son mari et tombait amoureuse de son jardinier noir. En 2011, sortait sur les petits écrans de la télévision une mini-série intitulée « Mildred Pierce », elle aussi superbement mise en scène et se déroulant dans le contexte de l’Amérique de la Grande Dépression. Aujourd’hui, avec « Carol », adaptation d’un roman de Patricia Highsmith, Todd Haynes déploie à nouveau son savoir-faire en situant son récit au début des années 50, fin 52 et début 53 exactement. Et, comme dans « Loin du Paradis », il s’intéresse à une histoire de transgression ou de ce qui paraissait tel dans l’Amérique puritaine de ces années-là.
Tout commence par la rencontre de deux femmes dans un magasin où l’on se presse pour la course aux cadeaux de Noël. Des regards échangés, quelques mots, puis une paire de gants oubliée et rien ne sera plus comme avant ni pour Carol (Cate Blanchett), femme bourgeoise qui fait ses achats, ni surtout pour Thérèse (Rooney Mara), vendeuse gracile et très séduisante malgré le ridicule bonnet rouge qu’on l’oblige à porter. Entre les deux femmes se déploie petit à petit l’éventail d’un rapprochement, d’une amitié, d’un amour et d’une passion qui atteindra son acmé à l’occasion d’une échappée en voiture.
Cependant, ni pour l’une ni pour l’autre des deux femmes, vivre une telle passion n’est quelque chose de simple. Thérèse est liée à un petit ami qui souhaite fort l’épouser, mais qui ne tarde pas à se poser des questions. Mais c’est Carol qui affronte le plus difficile : elle est mariée, en instance de divorce, et mère d’une très jeune enfant dont son mari menace de lui retirer la garde. La tension est grande, palpable et ô combien dure à supporter.
Sans jamais être démonstratif, par sa mise en scène soignée, Todd Haynes réussit parfaitement à faire percevoir au spectateur ce que la passion vécue par les deux femmes comporte à la fois de douceur et de complicité, mais aussi de douleur et de désespoir. Impossible de poursuivre cette aventure de manière apaisée et heureuse. Tout est dit, tout est suggéré plutôt par le jeu habile des deux actrices, toutes deux formidables. Ce qui se lit sur les visages des deux femmes, et particulièrement dans leurs regards, est primordial. Car tout est affaire de regard dans ce film : regards échangés qui dévoilent et dissimulent en même temps, regard de Thérèse qui prend une photographie de Carol (elle qui ne photographiait jusque là que des objets), regards de passagère apercevant la silhouette de l’être aimé derrière la vitre d’une voiture…
Méfions-nous de ceux qui, même parmi les critiques, ont cru bon de déplorer le manque d’émotion de « Carol ». L’émotion est là, bien présente d’un bout à l’autre du film, mais elle n’est jamais surlignée comme on le fait quand on veut que coulent les larmes des spectateurs. Todd Haynes s’est bien gardé de réaliser un film de ce genre, mais il a su intelligemment multiplier des signes qui, pour le spectateur attentif, sont autant de raisons d’être ému. L’émotion, ici, est discrète et légère, à la manière de la « chanson bien douce » de Verlaine « qui ne pleure que pour [nous] plaire ».
Avec ce film, nul doute que Todd Haynes compte désormais comme un des meilleurs réalisateurs de mélodrames, digne successeur des maîtres du genre que furent, au cours des années 50 et 60, des cinéastes de génie ayant pour noms Douglas Sirk et Vincente Minnelli.
9,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
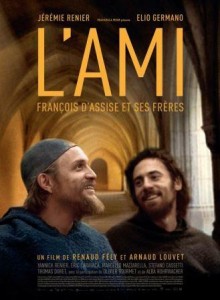



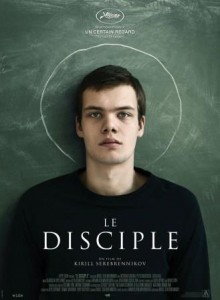
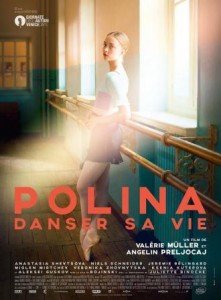






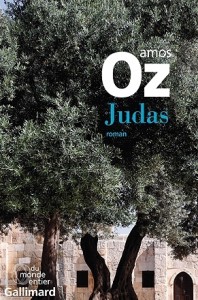

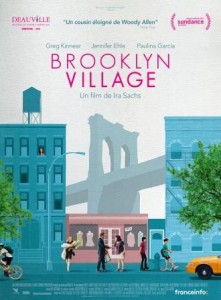
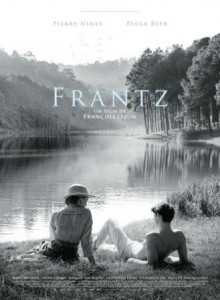

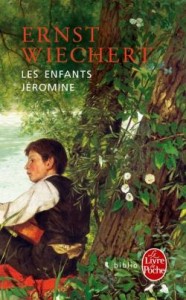
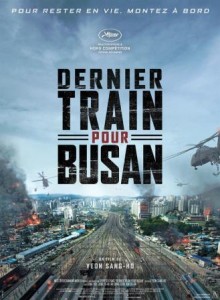


![La tortue rouge [287603]](http://paroissesaintjean.org/wp-content/uploads/2016/02/La-tortue-rouge-287603-224x300.jpg)