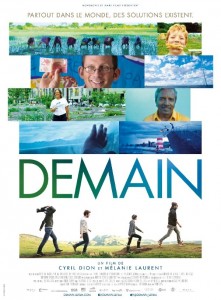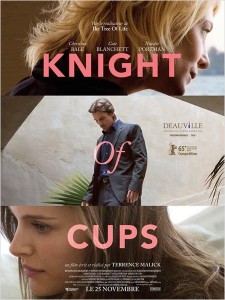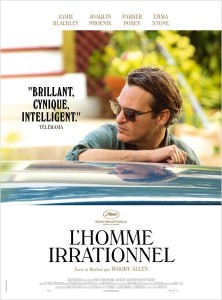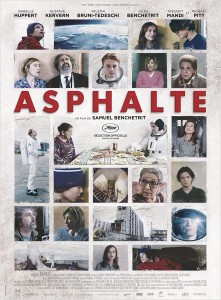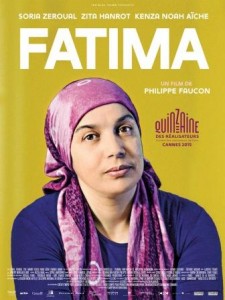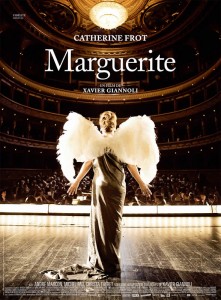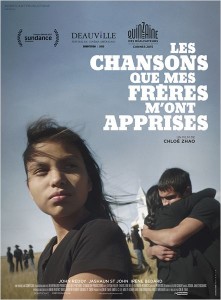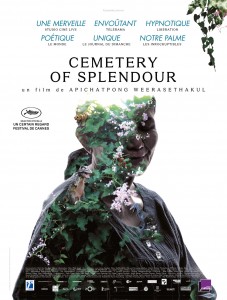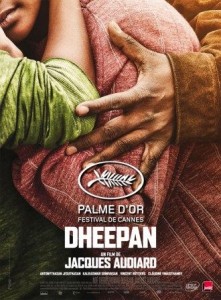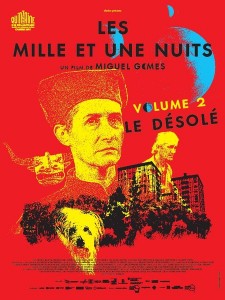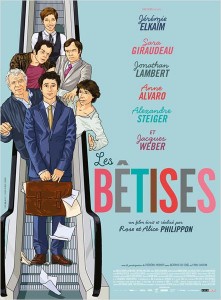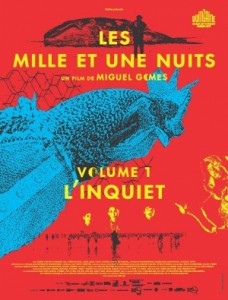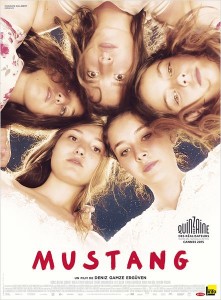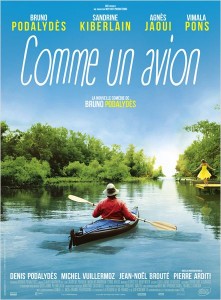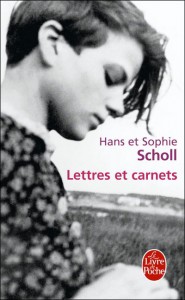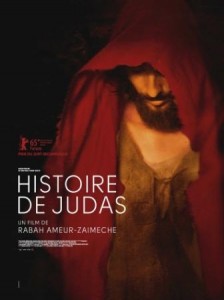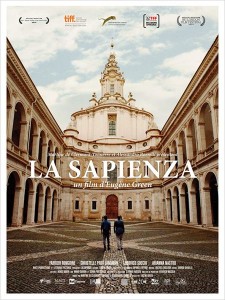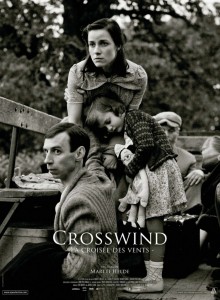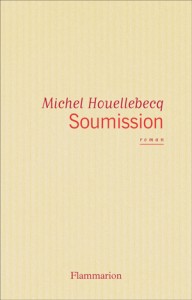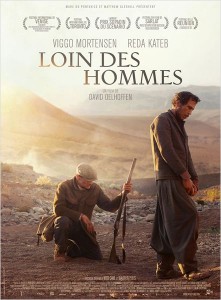20151227 – Bilan ciné 2015
Bonjour à tous!
L’année 2015 étant sur le point de s’achever, je n’ai nul besoin d’attendre davantage pour vous envoyer la liste de mes 25 films préférés.
-
TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE, Arnaud Desplechin
-
CEMETERY OF SPLENDOUR, Apichatpong Weerasethakul
-
L’HOMME IRRATIONNEL, Woody Allen
-
LA SAPIENZA, Eugène Green
-
KNIGHT OF CUPS, Terrence Malick
-
COMME UN AVION, Bruno Podalydès
-
L’OMBRE DES FEMMES, Philippe Garrel
-
LE BOUTON DE NACRE, Patricio Guzmán
-
LES MERVEILLES, Alice Rohrwacher
-
MUSTANG, Deniz Gamze Ergüven
-
FATIMA, Philippe Faucon
-
CROSSWIND, Martti Helde
-
MIA MADRE, Nanni Moretti
-
LES NUITS BLANCHES DU FACTEUR, Andrei Konchalovsky
-
LES CHANSONS QUE MES FRÈRES M’ONT APPRISES, Chloé Zhao
-
MARGUERITE, Xavier Giannoli
-
LES MILLE ET UNE NUITS, Miguel Gomes
-
A PEINE J’OUVRE LES YEUX, Leyla Bouzid
-
LA LOI DU MARCHÉ, Stéphane Brizé
-
LE DOS ROUGE, Antoine Barraud
-
LA TÊTE HAUTE, Emmanuelle Bercot
-
LA MAISON AU TOIT ROUGE, Yoji Yamada
-
MACBETH, Justin Kurzel
-
TAJ MAHAL, Nicolas Saada
-
GENTE DE BIEN, Franco Lolli.
20151223-Cinéma
À PEINE J’OUVRE LES YEUX
un film de Leyla Bouzid.
A force de n’entendre parler, dans les médias, que de jeunes musulmans dérivant vers le radicalisme islamique, on risque de se méprendre et d’ignorer que, pour beaucoup de jeunes gens de culture islamique, le chemin emprunté est à l’opposé de celui qui fait volontiers la une de l’actualité. Ce que recherchent et revendiquent nombre de ces jeunes, ce n’est pas l’embrigadement, mais au contraire l’émancipation. Il n’est d’ailleurs pas anodin de souligner que cette aspiration à la liberté se manifeste, dans ce film de Leyla Bouzid, par le désir de faire de la musique et de chanter. Même s’il n’est pas question d’islamisme radical ici, mais de l’état autoritaire et corrompu de Ben Ali peu avant la révolution tunisienne, impossible de ne pas remarquer que, dans tous les cas, on ne prise guère ceux qui osent chanter. Comme le rappelle Emmanuel Dupuy dans l’éditorial qu’il signe dans le dernier numéro de la revue Diapason, à la fin des années 70 déjà, l’ayatollah Khomeiny éructait contre la musique, « ce poison [qui] détruit notre jeunesse ». Les autocrates, quels qu’ils soient, n’aiment pas que l’on chante.
Eh bien, c’est ce « poison » qui enivre Farah, jeune fille de 18 ans, le personnage qui est au cœur du film de Leyla Bouzid. Alors qu’elle vient de réussir brillamment ses examens et que sa mère rêve pour elle d’une carrièrre dans la médecine, celle-ci ne songe qu’à rejoindre ses amis musiciens de rock et à se produire avec eux sur des scènes ou dans des bars. Dans la Tunisie corsetée et contrôlée de Ben Ali, ce groupe de musiciens renvoie l’image d’un espace de liberté qui ne convient pas à tout le monde. C’est d’autant plus vrai que les chansons écrites, composées, jouées et chantées par le groupe peuvent avoir des accents revendicatifs. La révolution tunisienne éclatera bientôt, et les chansons dont Farah se fait l’interprète inspirée en sont la prémonition.
Tout n’est pas si simple cependant, c’est évident, et le film se fait l’écho des durs combats qu’il faut mener. La mère de Farah s’inquiète beaucoup des chemins empruntées par sa fille et, pour cette dernière, s’épanouir dans ce qu’elle considère comme sa véritable passion se fait au prix de luttes incessantes. Au sein du groupe de musiciens aussi, les avis divergent et l’on assiste à de houleux débats : faut-il ou non chanter une chanson engagée quand on sait qu’on est surveillé par la police ? Et, pour compliquer encore les choses, à tout cela se mêlent des affaires de cœur !
Oser le chant, oser la liberté de chanter, dans la Tunisie de Ben Ali, cela ne va pas sans risques. Le danger rôde, c’est vrai, et pourrait s’abattre tout à coup sur qui a trop brandi l’audace d’être libre. Ce film de Leyla Bouzid, qui a, à juste titre, remporté plusieurs prix dans des festivals, nous fait ressentir à la fois l’espérance et l’angoisse de jeunes gens avides d’émancipation. Les scènes euphorisantes et magnifiquement filmées de concerts laissent place à des scènes rudes et qui font mal au cœur. Avec ce premier film, en tout cas, Leyla Bouzid, elle-même fille d’un réalisateur tunisien, entre d’ores et déjà dans la liste des cinéastes qui comptent et dont on attend avec curiosité la prochaine œuvre.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20151207-Cinéma
DEMAIN
un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Quand il est question d’écologie et du devenir de notre planète, c’est, le plus souvent, de catastrophes dont on nous parle. La Terre est en grand péril et l’on nous promet (à nous ou à ceux qui viendront après nous) des cataclysmes tels qu’ils pourraient signifier l’extinction de l’humanité.
Ces menaces, Cyril Dion et Mélanie Laurent, les co-réalisateurs de ce film, ne les ignorent pas. Mais s’ils en font état, eux aussi, s’ils les exposent en ouverture de ce documentaire, c’est pour se mettre aussitôt à la recherche de solutions. Plutôt que de se lamenter ou de faire les fatalistes, tous deux ont sillonné la planète pour rencontrer celles et ceux qui agissent, qui entreprennent déjà, là où ils sont, de transformer ce monde, de le rendre plus habitable et plus équitable.
Car il en est qui ne baissent pas les bras et qui inventent de nouveaux modes de vie. Place à l’imagination, place au respect de la nature et au respect d’autrui. Cyril Dion et Mélanie Laurent prennent grand soin de promouvoir, dans ce film, une « écologie intégrale » (expression qui fait l’objet de tout un chapitre dans l’encyclique « Laudato si »). Si « tout est lié », comme le dit et le répète le pape François, il serait insensé de ne parler que d’agriculture ou d’élevage sans prendre en compte les réalités humaines.
Or ce qui frappe dans ce film, c’est précisément qu’il faut agir à tous les niveaux: se nourrir autrement, c’est nécessaire, comme il est nécessaire d’opter pour des sources d’énergie propres, mais aussi de transformer les échanges économiques, nos manières de vivre la démocratie et nos méthodes d’éducation. Chacun de ces domaines est abordé par l’exemple dans le film. En France, en Angleterre, au Danemark, en Islande, en Finlande, aux Etats-Unis, en Inde, à la Réunion, des hommes et des femmes, des communautés entières adoptent de nouveaux modes de vie. Des villes, des états, en ont déjà fini avec les énergies fossiles et avec le nucléaire ou sont sur le point d’y parvenir. D’autres produisent localement de quoi se nourrir, inventent des monnaies, cherchent à éduquer autrement et dans un plus grand respect de chacun, etc. Le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent pétille de bonnes idées. S’il prend en compte les dangers qui nous menacent, c’est pour nous inviter à agir, et à agir sans tarder! « Je suis optimiste, dit Mélanie Laurent dans une interview, car je sais qu’il y a des solutions. » « Demain » en est la parfaite illustration.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20151204- Cinéma
TAJ MAHAL
un film de Nicolas Saada.
Parce que son sujet entre très en résonance avec les terribles événements survenus à Paris le 13 novembre dernier, beaucoup hésiteront probablement à aller voir ce film. Certes, le voir pourrait être ressenti comme une trop pénible épreuve pour certains, mais il faut prendre en compte les multiples qualités des choix de mise en scène voulus par le réalisateur Nicolas Saada avant de se décider à assister ou non à une séance de ce film.
Ce sont des événements réels survenus à Bombay en 2008 qui ont servi de base au scénario du film. Cette année-là, des attaques islamistes visant entre autres le Taj Mahal, un hôtel grand standing, ont ensanglanté la vaste cité indienne. Comment échapper au piège du sensationnalisme quand on traite d’un tel sujet ? Y a-t-il moyen de mettre en scène le terrorisme tout en évitant de le donner en spectacle ? Peut-on donner à voir l’horreur des actes terroristes ou peut-on les faire ressentir sans jamais céder à quoi que ce soit d’ambigu ou de malsain ?
C’est une gageure peut-être que de ne pas tomber dans ces pièges, mais si c’en est une, elle a été brillamment relevée par Nicolas Saada. Son film méritera à l’avenir d’être cité, à mon avis, comme un exemple d’intelligence de mise en scène.
Comment s’y est-il pris ? Par quels moyens a-t-il si parfaitement réussi un film au sujet ô combien délicat, ô combien difficile à traiter ? Pour commencer, il a réalisé un film qui prend le temps. Avant qu’il ne soit question de terrorisme, de nombreuses scènes nous familiarisent avec d’une part les personnages principaux et d’autre part l’environnement qui est le leur. Nous découvrons par le regard d’un couple (Louis-Do de Lencquesaing et Gina McKee) et surtout par celui de leur fille Louise (formidable Stacy Martin) la ville de Bombay et son grouillement de population. Venus à Bombay dans l’intention d’y résider deux ans, ils s’installent dans un premier temps dans une suite de l’hôtel Taj Mahal. Hôtel que nous découvrons aussi avec les yeux de Louise, impressionnés par de grands espaces suscitant déjà une sorte d’angoisse.
Vient ensuite évidemment, puisque c’est le sujet du film, l’attaque des terroristes qui s’introduisent dans l’hôtel pour y faire un massacre. Elle se déroule lors d’une absence des parents de Louise, sortis en ville. Seule à occuper la suite, cette dernière se retrouve comme prise en otage. C’est à cette occasion que se vérifient les choix de mise en scène radicaux et très judicieux décidés par le réalisateur. Evitant tout sensationnalisme, celui-ci ne filme le terrible événement que du point de vue de Louise. Autrement dit, on ne vit le cauchemar qui frappe l’hôtel que par le regard et les oreilles de Louise. Hormis les scènes montrant ses parents affolés avec qui elle reste en lien par téléphone, nous ne voyons et n’entendons rien d’autre que ce que voit et entend la jeune fille : la suite plongée dans la pénombre après qu’elle ait éteint toute lumière, les lueurs filtrant sous les portes, les bruits de fusillades, les cris, etc. Pas un seul plan ne montre les terroristes accomplissant leur besogne de mort. Comme l’affirme le cinéaste lui-même dans une interview, il a voulu réaliser « un film intimiste » sur une attaque terroriste et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est réussi.
Ce n’est qu’à la fin du film qu’on aperçoit, sur un écran de télévision, les images prises par les caméras de surveillance de l’hôtel montrant les terroristes à l’oeuvre. Comme pour mieux nous signifier que ce que Nicolas Saada a voulu réaliser, c’est précisément l’inverse de ce dont se repaissent volontiers les télévisions avides de sensationnel. Et il y a fort à parier que plus d’un réalisateur n’aurait pas su davantage éviter ce piège-là.
Sans jamais donner le terrorisme en spectacle, mais en se contentant de nous en montrer les effets sur une jeune fille prise dans ses rets, « Taj Mahal » nous bouleverse, nous étreint, nous fait ressentir l’angoisse, nous tient en haleine. Oui, c’est une grande leçon de mise en scène qui nous est proposée dans ce film.
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
MIA MADRE
un film de Nanni Moretti.
Il est assez troublant de se dire que ce que Nanni Moretti choisit aujourd’hui de montrer à l’écran, c’est ce que lui-même a vécu à l’époque où il tournait « Habemus Papam », la maladie et la mort de sa mère. Mais il est vrai que le réalisateur italien en est coutumier : nombre de ses films se sont fondés sur son vécu. Faut-il appeler ça de l’autofiction, comme on le fait volontiers ? Peut-être mais en se hâtant de préciser que, chez Nanni Moretti, autofiction n’équivaut jamais à nombrilisme. Contrairement à d’autres réalisateurs qui s’empêtrent dans leur ego et dont les films ne parviennent jamais à échapper ni à la médiocrité ni à la vanité de l’autosuffisance dont on n’a rien à faire (un exemple des plus irritants nous a été donné cette année avec « Mon Roi » de Maïwenn), Nanni Moretti, lui, tout en puisant son inspiration dans sa propre histoire, prend toujours soin de nous la présenter de manière à ce qu’elle nous touche, à ce qu’elle rejoigne l’expérience commune, universelle. Ce n’est pas parce que ses films sont écrits à la première personne du singulier que nous sommes étrangers à l’oeuvre, en dehors, comme si nous n’étions que les simples spectateurs d’un récit qui jamais ne serait en mesure de nous interpeller.
Qui n’a jamais vécu ou ne vivra jamais l’expérience de la maladie et de la perte d’un proche ? Dans « Mia Madre », l’on saisit rapidement que l’alter ego du réalisateur, ce n’est pas le personnage de fils sage et ordonné qu’il interprète lui-même à l’écran, mais celui de Margherita (Margherita Buy), sa sœur dans le film, une cinéaste en plein tournage d’un film dont on sait aussitôt qu’il traite d’un sujet social, des luttes des ouvriers dans une usine. Un tournage qui va de complication et complication lorsqu’apparaît Barry (John Turturro), l’acteur vedette du film dans le film, incapable de jouer correctement, d’apprendre ses textes, de prononcer l’italien comme il faut.
Cette contrepartie comique est la bienvenue dans un film qui s’oriente également vers l’accompagnement d’une mère malade et hospitalisée et dont on sait rapidement qu’elle ne s’en sortira pas. Pour Margherita, prise entre ses devoirs de cinéaste, de fille d’une mère (Ada) en fin de vie et de mère d’une adolescente (Livia) ayant grand besoin d’être encouragée et aidée pour ses études (en particulier de latin ! – d’autant plus que la grand-mère mourante est elle-même une professeure de latin à la retraite), la vie se complique grandement.
L’une des recommandations que Margherita fait volontiers à ses acteurs, c’est de « jouer à côté de leur rôle », autrement dit de ne pas se contenter d’incarner un personnage mais de garder une place pour eux-mêmes, pour leur propre personne. Il ne faut pas s’oublier soi-même quand on joue un personnage. Cette recommandation, que Margherita a bien de la peine à expliquer à ses acteurs, ne s’applique-t-elle pas d’abord à elle-même sans qu’elle s’en doute ? N’est-ce pas elle qui est toujours comme « à côté », jamais tout à fait là où il faut et, de ce fait, toujours peu ou prou dépassée par les évènements. Si elle a bien du mal à maîtriser le film qu’elle réalise, elle a autant de mal à affirmer sa présence aux côtés de son frère si ordonné quand il s’agit d’être présente au chevet d’une mère malade (le film annonce dès le début la couleur en voyant se substituer les pâtes apportées par le fils à sa mère au lieu des plats achetés par Margherita) et elle est bien en difficulté aussi quand il s’agit d’accorder du temps et de l’attention à sa fille de treize ans. C’est Ada, la grand-mère, qui révèle à Margherita que Livia vient de souffrir d’une rupture avec un garçon. La mère n’en avait rien deviné. C’est Ada également qui affirme qu’avec la vieillesse, contrairement à ce qu’on pourrait supposer, elle se sent plus lucide et plus intelligente que par le passé !
Ce sont ces trois femmes (grand-mère, mère et petite-fille) qui sont au cœur du film de Nanni Moretti. Toutes trois nous touchent, nous bouleversent. Nanni Moretti s’autorise toutes les audaces pour nous faire percevoir ce qui habite le cœur de ces femmes, assurance, peine, joie ou désarroi. L’onirisme même est le bienvenu pour l’une ou l’autre scène. Ou ce plan symptomatique qui voit s’éveiller Margherita pour constater que son appartement est inondé et qu’il faut se battre désespérément pour en réparer les dégâts. C’est peut-être cela précisément qu’a voulu montrer Moretti : une vie submergée, les luttes incessantes qu’il faut mener pour ne pas se noyer. Le réalisateur italien l’a fait avec tout son talent et toute sa sensibilité : il nous touche droit au cœur !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20151125 – Cinéma
KNIGHT OF CUPS
un film de Terrence Malick.
« Je suis un étranger sur la terre ; ne me cache pas tes volontés »
Cette citation trouvée dans le psautier (118 ; 19) pourrait fort bien être mise en exergue de ce film de Terrence Malick. A nouveau, après les sublimes «The Tree of Life » et « A la Merveille », le réalisateur américain à la légendaire discrétion nous offre un de ces films-poèmes dont il s’est fait une spécialité. A nouveau également, nous avons droit à un film frisant avec l’excellence, même si, à nouveau, il paraîtra abscons à certains spectateurs et insupportable de prétention à d’autres.
Pour ce qui me concerne, pas la moindre réserve : ce nouveau film de ce qu’on peut désigner comme une trilogie m’a fasciné autant que les deux films précédents. Qu’un cinéaste nous propose autre chose qu’une œuvre classiquement narrative n’est certes pas pour me déplaire. Et qu’un film, ou plutôt que trois films se présentent à nous comme des poèmes à la fois visuels et sonores me ravit. D’autant plus que ces films sont constamment la manifestation du talent et de l’intelligence.
Il me semble d’ailleurs que l’hermétisme tout relatif de la trilogie malickienne s’éclaire à l’occasion de ce film qui, dès son ouverture, donne des clés qui ouvrent à une meilleure perception ou compréhension des trois œuvres. Le psaume que j’ai cité correspond à la première des clés : celle du pèlerin. Le mot revient fréquemment dans « Knight of Cups », ouvrant un champ de signification qui s’accorde parfaitement avec nombre de textes bibliques : nous sommes des pèlerins sur la terre.
La deuxième clé, le deuxième mot qui se fait souvent entendre au cours du film, c’est le mot « perle ». Le réalisateur le dévoile dès l’ouverture du film en contant une parabole, celle d’un prince envoyé par le roi, son père, sur une terre inconnue pour y trouver une perle de grand prix. Arrivé au pays de sa quête, le prince entre en songe et ne se souvient ni d’où il vient ni ce pourquoi il est là. C’est en somme l’inverse de ce qui est raconté dans l’évangile de St Matthieu : au lieu de trouver la perle et de l’acheter, le prince oublie jusqu’à l’objet même de sa recherche.
Le personnage joué par Christian Bale dans « Knight of Cups » se dévoile néanmoins, assez souvent, comme un être pensif qui semble percevoir qu’il n’est pas là par hasard et que sa vie n’est pas qu’un simple jeu de loterie. On perçoit nettement que c’est un homme en quête, mais en quête de ce qu’il ne sait peut-être pas clairement nommer. Pris dans un univers de faux-semblants, errant de Los Angeles à Las Vegas, incapable de se lier vraiment aux femmes qu’il fréquente, il ne parvient qu’à vivre des « expériences d’amour » mais pas à aimer en vérité. Même si c’est St Augustin qui est cité au cours du film et non l’auteur des « Pensées », le film s’imprègne, me semble-t-il, par moments, d’un ton pascalien. Beaucoup de ceux et celles qu’on voit évoluer dans « Knight of Cups » ne songent qu’à se divertir afin de mieux oublier qui ils sont, ce qu’ils font sur la Terre et ce à quoi ils sont destinés.
Le personnage joué par Christian Bale, lui, comme d’autres personnages évoluant dans les deux films précédents du cinéaste, se débat dans sa nuit mystique. Le qualificatif peut sembler incongru, mais il l’est d’autant moins que les films de Terrence Malick s’inscrivent délibérément dans le cadre d’une quête au sens religieux du mot. On oublie d’ailleurs trop facilement que le mot « mystique » ne s’accorde pas uniquement à « extase » mais aussi à « nuit ». Les mystiques sont peut-être d’abord et avant tout des poètes de la nuit. Et l’on peut sans trop d’audace affirmer que Malick, dans ses trois derniers films, se fait poète de cette nuit-là. Ses personnages en errance, blessés intérieurement, évoluant au gré de leur mémoire, ne perçoivent rien de plus que des bribes de ce qu’au fond d’eux-mêmes ils cherchent tous : l’amour, la compassion, la joie.
La perle recherchée est pourtant là, visible, apparaissant aux yeux des protagonistes qui semblent comme empêchés de la voir. Dans « A la Merveille », elle se dévoilait quand le personnage du prêtre joué par Javier Bardem visitait des prisonniers ou se dévouait pour les pauvres de sa paroisse. Ici, dans « Knight of Cups », elle apparaît de même, mais fugacement, quand le réalisateur nous montre une infirmière soignant des malades aux membres hideusement atteints. Oui, la perle est là, toute proche, mais le monde est tel et les êtres qui s’y trouvent sont si perdus qu’ils ont du mal à la désigner (s’ils ne passent pas leur vie entière sans même se douter qu’elle existe).
Il y a tout cela, et bien plus que cela, dans ce nouveau poème filmé de Terrence Malick. Un ravissement pour l’esprit, un enchantement pour les yeux et pour les oreilles, tant le réalisateur soigne chacun de ses plans et chaque élément de sa bande-son. Dans « Knight of Cups », les images sont peut-être moins immédiatement séduisantes que dans les deux films précédents, car la caméra évolue essentiellement en milieu urbain, mais elles sont extrêmement soignées, comme l’est le montage du film. Le cinéaste-poète Terrence Malick a fait merveille une fois encore.
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
20151120 – Littérature
COMPAGNIE K
un livre de William March.
Cet ouvrage de William March (1893-1954), de son vrai nom William Campbell, compte sans nul doute parmi les documents les plus forts et les plus saisissants écrits sur la Grande Guerre. L’auteur lui-même combattit en France dans les rangs de l’US Marine Corps et revint chez lui, aux USA, couverts de multiples décorations et distinctions pour ses faits d’arme. Plus tard, hanté par ses souvenirs de guerre, il écrivit, au long de nombreuses années, ce livre, « Compagnie K », qui n’est rien de moins qu’un chef d’oeuvre.
Une des grandes originalités de l’ouvrage tient à sa construction. Au lieu de raconter ses propres souvenirs, William March, au fil de chapitres très courts, donne la parole, tour à tour, à chacun des membres d’une compagnie. 115 hommes prennent ainsi la parole, relatant chacun un épisode, une scène, un événement dont il fut l’acteur ou le témoin. L’ensemble fait penser à une mosaïque dont chaque élément reflète et révèle un des aspects de la guerre, un des comportements possibles de l’homme en guerre.
Ce sont des soldats américains qui parlent parce que ce sont ceux que l’auteur connaît mais, comme il l’affirme lui-même dès le début du livre, les hommes ici évoqués « pourraient tout aussi bien être français, allemands, anglais, ou russes. » Les comportements ne diffèrent pas d’une nation à l’autre. Partout l’on trouvera des hommes courageux capables de faits glorieux, mais partout aussi l’on trouvera la peur, la lâcheté, la révolte, le désespoir, les rêves, les gestes de compassion, voire les moments de drôlerie.
Il y a de tout cela dans « Compagnie K », chaque chapitre mettant en scène l’un de ces aspects. Parfois même deux chapitres successifs se répondent l’un l’autre. Impossible de tout énumérer. Bien sûr, des soldats évoquent des femmes rencontrées, désirées, parfois abandonnées. L’un raconte comment il convainquit « une femme bien » de passer une nuit avec lui, l’autre la fascination qu’il éprouve pour le visage de Lillian Gish (une actrice du cinéma muet de l’époque), un autre encore comment il fut déserteur malgré lui à cause d’une fille. Un autre, que la faim tenaille, rêve plus prosaïquement d’un bon repas. Mais il se trouve aussi des soldats poètes : l’un qui, blessé et hospitalisé, pleure en récitant du Verlaine (« Il pleure dans mon cœur…), l’autre qui se sent bien isolé parmi ses camarades qui n’ont que faire de sa poésie (mais ignorant que l’un d’eux n’y est pas insensible) !
Beaucoup de chapitres soulignent l’absurdité de la guerre. Quand les soldats américains sont confrontés directement aux soldats ennemis, il se déroule des scènes que les protagonistes n’oublieront jamais. Ils en seront hantés jusqu’à la fin de leurs jours. Ainsi de ce soldat américain qui tue un soldat allemand, croyant que celui-ci tient une grenade dans ses mains, et qui découvre ensuite qu’en fait de grenade l’ennemi serrait dans ses mains la photo de sa fille. Ou de cet autre qui, pris de pitié en entendant les lamentations d’un prisonnier allemand gazé, lui donne son masque à gaz, tout en se demandant pourquoi il a fait ça. Mais le plus terrible, c’est quand l’ordre est donné de fusiller des prisonniers : l’un a le cran de refuser, un autre accepte mais, traumatisé, se dit que c’est un mensonge que d’affirmer que Dieu est amour.
Plus d’un intervenant parle d’ailleurs de la foi chrétienne mais c’est le plus souvent avec des mots de révolte. S’il est un soldat qui affirme avoir vu le Christ pleurer et avoir pleuré avec lui, il en est d’autres qui rejettent les paroles, voire la présence même de l’aumônier. L’un d’eux, entendant l’aumônier demander à Dieu la mort des ennemis impies, se dit avec justesse que, des deux côtés, du côté américain comme du côté allemand, on prie le même Dieu.
Même si quelques-uns rapportent des scènes humoristiques (une séance d’épouillage qui tourne en spectacle pour les civils qui en sont les témoins éberlués ; ou encore un soldat blessé qui, étant visité par la reine d’Angleterre en personne, la confond avec une voisine de sa mère!), dans la plupart des cas c’est la souffrance, l’incompréhension et la révolte qui dominent. Cela va, chez certains, jusqu’à un refus des honneurs qui pourraient leur être rendus : ainsi de ce soldat qui, pris mortellement dans des barbelés, trouve la force de jeter loin de lui toute marque d’identification afin de n’être plus qu’un anonyme. Plusieurs évoquent le retour au pays, mais c’est avec bien des désillusions : l’un d’eux retrouve sa fiancée qui ne veut plus de lui à cause de sa gueule cassée, un autre se désole au sujet de son frère qui n’a passé que trois jours au combat et à qui l’on rend plus d’honneurs qu’à lui qui y a passé des mois.
Peut-être est-ce le soldat Andrew Lurton qui trouve le mieux les mots pour dire sa désillusion : « J’aimerais, dit-il, que les types qui parlent de la noblesse et de la camaraderie de la guerre puissent assister à quelques conseils de guerre. Ils changeraient vite d’avis, parce que la guerre est aussi infecte que la soupe de l’hospice et aussi mesquine que les ragots d’une vieille fille. »
Chaque chapitre de ce grand livre est comme un petit chef d’oeuvre à lui tout seul. Pas besoin de s’épancher longuement, tout est dit avec netteté et sécheresse et l’on sent bien que ce que rapporte William March est vrai, foncièrement vrai, même si l’auteur n’a pas été le témoin de tout ce qu’il raconte. La guerre est ainsi, se dit-on, elle n’est pas belle à voir, et les hommes qui s’y livrent nous chamboulent le cœur !
William March, « Compagnie K », éditions Gallmeister, 259 pages.
Luc Schweitzer, sscc.
20151119 – Cinéma
MACBETH
un film de Justin Kurzel.
Quel dramaturge se prête davantage aux adaptations cinématographiques que Shakespeare ? Et quelle pièce convient davantage que « Macbeth » ? Avec ses batailles, ses prophéties, ses sorcières, ses meurtres, ses paysages de landes et ses brumes, elle n’a pas manqué de séduire des réalisateurs aussi prestigieux qu’Orson Welles, Akira Kurosawa et Roman Polanski. De tels noms n’ont cependant pas intimidé, semble-t-il, le cinéaste australien Justin Kurzel dont l’adaptation comptera sans nul doute comme l’une des meilleures.
Tout commence dans la brutalité et la sauvagerie : les visages se teintent de peintures de guerre avant que ne se déchaîne une sanglante bataille qui donne la victoire à Macbeth (Michael Fassbender), chef des armées du roi d’Ecosse Duncan, contre les ennemis de ce dernier. Tout semble alors se dérouler sous le signe de la fatalité, de ce qui est écrit et annoncé par les sorcières de la lande, d’une série d’événements dont on ne peut changer le cours : c’est Macbeth qui sera roi à la place de Duncan, mais c’est à la descendance de son ami Banquo que la couronne sera ensuite transmise. Mise au courant de ces prophéties, Lady Macbeth (Marion Cotillard) incite son époux à s’emparer du trône. Commence alors un cycle de folie meurtrière visant à la conquête et à la conservation du pouvoir et que résume on ne peut mieux la plus fameuse des répliques de la pièce : « La vie est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien ».
Mettre en scène une telle histoire cependant et la confier à des acteurs (dont il faut souligner la performance), c’est nécessairement lui donner une teinte particulière. Les choix voulus par le réalisateur Justin Kurzel n’ont rien, à mon avis, que de très légitime. Ils font du personnage de Macbeth un homme ambivalent, physiquement fort mais mentalement faible. « Le sang appelle le sang », dit-il comme pour se justifier de commettre crime après crime. Mais la vérité, c’est que, comme un enfant, il se laisse impressionner par des prophéties de sorcières et, comme une marionnette, il se laisse manipuler par son épouse.
Car c’est elle qui conduit la danse macabre. Danse sanglante à laquelle elle s’accroche jusqu’à la démence et la mort, tant elle est avide de pouvoir. On aurait tort de voir dans le rôle dévolu à cette dernière quoi que ce soit de misogyne. Dès sa venue en scène, Shakespeare lui-même a pris grand soin de lui faire renier sa propre féminité : elle clame son désir d’être « désexuée » et de ne plus voir sourdre de ses seins autre chose que du fiel ! Elle n’est plus dès lors, à proprement parler, une figure féminine mais inexorablement l’être qui tire Macbeth du côté de la nuit sans fin, ce que le réalisateur Justin Kurzel a su parfaitement mettre en image dans le film.
En fin de compte, l’appétit de pouvoir dont il est question dans cette pièce s’accompagne sinon d’un retour au paganisme, en tout cas d’un refus du Dieu chrétien. Les sorcières-démones sont-elles autre chose que des pythies conduisant au chaos ? Cet aspect n’a pas échappé à Justin Kurzel qui, sans être démonstratif, insère dans son film des indices : les signes chrétiens sont présents dans bien des scènes, mais jamais ils ne sont invoqués par les personnages. Si une croix se détache parfois derrière Lady Macbeth, c’est pour indiquer précisément que celle-ci s’en détourne. Quant aux évêques apparaissant lors de quelques scènes, comme des spectres, ils sont si blafards qu’ils semblent venus d’outre-tombe. Seules règnent la violence et la mort, au point que l’écran finit par se teinter de rouge sang.
Jusqu’à l’ultime scène où, sur le champ de bataille, sa femme étant morte et lui-même mortellement blessé, Macbeth se mette à genoux comme s’il retrouvait enfin le Dieu qu’il avait perdu !
On pourra certes regretter quelques effets de mise en scène : on se passerait volontiers de la surabondance des ralentis lors des séquences de batailles. Cela étant dit, les qualités du film l’emportent de loin sur ses défauts : si l’on fait exception des scènes de batailles, celui-ci ne manque pas de sobriété. Les décors eux-mêmes, faits de landes austères et de paysages brumeux, ont été choisis avec soin pour s’accorder aux personnages. Quant à ceux-ci, on ne dira jamais assez avec quel talent ils sont interprétés : Michael Fassbender comme Marion Cotillard méritent tous les applaudissements !
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20151104-Cinéma
LE FILS DE SAUL
un film de László Nemes.
C’est une de mes convictions qu’il n’y a pas de sujet interdit au cinéma et ce film me donne l’occasion de le réaffirmer. Cela étant dit, il est des sujets qu’il faut manier avec la plus grande précaution tant ils exigent, de la part de celui qui les choisit et les met en scène (qui plus est dans une œuvre de fiction), des choix radicaux quant à ce qu’il convient de mettre ou non sous les yeux des spectateurs. Peut-être certains sujets ne devraient-ils être abordés que dans le cadre d’un documentaire… Un exemple remarquable vient de nous en être donné avec la sortie sur les écrans du « Bouton de Nacre » de Patricio Guzmán. Le hongrois László Nemes, lui, s’est aventuré sur un terrain bien plus risqué encore que celui d’évoquer des massacres d’Indiens et de partisans d’Allende au sud du Chili. Il a opté pour le sujet le plus délicat qui soit, celui qui, chaque fois qu’un réalisateur avait osé l’aborder jusqu’à présent, avait suscité de houleuses controverses, celui de la représentation de l’holocauste dans un film de fiction.
Or, non seulement la controverse n’a pas eu lieu, mais le film a été récompensé à Cannes par le Grand Prix et a reçu l’approbation de Claude Lanzmann qui a félicité le réalisateur quant à sa façon de procéder. Et c’est vrai que «Le Fils de Saul » se démarque beaucoup de ce qu’on a vu jusqu’à présent. Rien de semblable à la mise en scène déplorable de Gillo Pontecorvo dans « Kapo » (1960). Pas davantage de représentation comme dans le feuilleton télévisé « Holocauste » ou dans « La Liste de Schindler » de Steven Spielberg (1993). Ici, tout est concentré sur un homme, un membre du Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau, autrement dit un de ceux qui étaient sélectionnés par les nazis pour exécuter les basses besognes du camp en échange de quelques mois de survie supplémentaire. La caméra ne quitte, pour ainsi dire, jamais cet homme, laissant hors champ ou, souvent, dans le flou toutes les scènes d’horreur dont il est témoin. Fréquemment au cours du film, c’est la bande-son plus que l’image qui nous laisse percevoir qu’il se déroule des faits terrifiants.
Ces choix de mise en scène très radicaux sont pertinents, bien entendu, ils permettent d’éviter judicieusement le piège de la représentation. On ne peut reprocher au cinéaste d’avoir « filmé l’infilmable ». Mais ces choix comprennent aussi leur revers. Se concentrer sur un seul homme, comme le fait le cinéaste hongrois, c’est prendre le risque de faire de nous, qui sommes devant l’écran de cinéma, rien d’autre que des spectateurs admiratifs. Ce que nous voyons, c’est certes une histoire émouvante, celle d’un homme qui croit reconnaître son fils dans le cadavre d’un enfant et qui, de ce fait, cherche par tous les moyens à l’enterrer et à trouver un rabbin qui saura prononcer le kaddish, mais c’est aussi, qu’on le veuille ou non, une performance d’acteur. L’histoire est émouvante, comme je l’ai dit, (c’est bien le moins quand on a affaire à un tel sujet), mais elle risque d’être, en quelque sorte, parasitée tout du long et par le jeu de l’acteur principal et par les questions qu’on en vient inévitablement à se poser quant à la vraisemblance d’un tel récit. A chaque instant, on peut se demander si ce qu’on voit (car, malgré tout, on voit quelque chose) et si ce qu’on entend restent plausibles. Pour ne prendre qu’un exemple, lorsque Saul est surpris à l’infirmerie (où il n’a rien à faire) par des officiers nazis, la seule réaction, la seule sanction improvisée par un de ces derniers consiste à le railler et le ridiculiser puis à le renvoyer à son travail… Est-ce plausible ? Je pose la question…
Pour conclure, il me faut affirmer ma perplexité et mes hésitations. D’un côté, on ne peut que reconnaître que le réalisateur de ce film a réussi un véritable tour de force, évoquant avec intelligence le drame de l’holocauste sans jamais chercher à le représenter en tant que tel. De l’autre, on est en droit de demeurer insatisfait et d’oser admettre que jamais la fiction, quelle qu’elle soit et quel qu’en soit le réalisateur, ne pourra rendre compte, si peu que ce soit, de l’horreur de l’holocauste. Ce film peut, sans aucun doute, être considéré comme un jalon, mais son propos, de par sa nature même, reste cependant limité.
6,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20151105
Bonjour à tous!
20151030 – Cinéma
LE BOUTON DE NACRE
un film de Patricio Guzmán.
Tout commence par une superbe évocation, par une ode plutôt, à ce qu’il y a de plus précieux sur notre Terre : l’eau. L’élément sans lequel il n’y a pas de vie, l’eau qui ruisselle, l’eau qui régénère, l’eau des rivières et l’eau des océans, l’eau qui imprègne tout le vivant. L’eau si indissociable du Chili, le pays natal du réalisateur Patricio Guzmán qui veut ici en montrer la beauté. Même au nord, au cœur du désert le plus aride du monde, où sont installés des télescopes qui, braqués sur les lointaines galaxies, y recherchent des signes de vie et, de ce fait, la présence de l’eau. Quant au reste du pays, ce sont des milliers de kilomètres de côtes bordées par l’océan le plus vaste de notre Terre, jusqu’au sud, jusqu’à la Patagonie, jusqu’à une multitude d’îles, jusqu’au pays des pluies, jusqu’au pays des glaces.
C’est précisément sur ces terres du sud du Chili que le réalisateur a choisi de s’attarder, mettant en avant, pour ce faire, le deuxième point d’appui de son documentaire : le bouton de nacre ! Le récit prend alors un sérieux virage : il ne s’agit plus seulement de chanter la noblesse de l’eau ni de s’extasier sur la majesté des océans, il s’agit de parler des hommes, de ceux qui, depuis des temps ancestraux, vivaient sur ces terres de Patagonie et de ceux qui s’y invitèrent de gré ou de force, y perpétrant des abominations.
Dans un premier temps, donc, Patricio Guzmán évoque les coutumes et les mœurs des Indiens qui peuplaient ces îles, y vivant en parfaite harmonie avec un océan dont ils tiraient l’essentiel de leur subsistance. Jusqu’à ce qu’arrivent les colons et que tout ne dégénère. C’est là qu’intervient le premier bouton de nacre, remis par un navigateur à un Indien aussitôt baptisé Jemmy Button, en échange de sa venue jusqu’à la lointaine Angleterre. Ayant été éduqué selon les bonnes mœurs de ce pays, l’Indien finit cependant par être ramené chez lui. Mais est-il possible de se réadapter à une terre quittée depuis longtemps et aux coutumes des gens de son peuple ? Quoi qu’il en soit, son retour s’apparente à un signal de déclin et de mort. Les chercheurs d’or et autres colons venus dans ces contrées ne s’encombrent guère de sentiments. Victimes de maladie pour les uns, de mort violente pour les autres, les Indiens de ces terres disparaissent au point qu’il n’en reste aujourd’hui que quelques individus. « Vous considérez-vous comme chilienne », demande le réalisateur à l’une des survivantes. « Non, répond-t-elle, je ne suis pas chilienne, mais kawésqar » (le nom de son peuple).
Le deuxième bouton de nacre servant de référence au cours du film, c’est celui qui est remonté du fond de l’océan, incrusté sur un segment de rail de chemin de fer. Que fait-il là ? Il témoigne d’une autre tragédie, celle qui s’est déroulée durant la dictature de Pinochet, dans ces mêmes contrées du sud du Chili. C’est là, en effet, sur l’île Dawson, une des nombreuses îles de l’archipel, que furent détenus dans un camp les sympathisants d’Allende. Certains furent exterminés de la façon la plus barbare, jetés dans l’océan lestés à un rail, de manière à ne jamais refaire surface.
Habilement, Patricio Guzmán sonde, dans ce documentaire, ces épisodes tragiques et douloureux de l’histoire de son pays. Les tueurs d’Indiens comme les bourreaux des sympathisants d’Allende sont restés impunis. Sans doute est-il difficile, pour les Chiliens, de se confronter à ce passé-là. C’est pourtant nécessaire, affirme à sa façon le réalisateur, en faisant ressurgir du fond de l’océan la mémoire des nombreuses victimes. Les visages des Indiens décimés, l’écho des voix de ceux qui furent sacrifiés pour l’instauration d’une sombre dictature : cela ne peut sombrer dans l’oubli. Au Chili, explique Patricio Guzmán dans une interview, « les plus jeunes ressentent un fort désir de savoir tout ce qui est arrivé ». Ce film, remarquablement réalisé, vient à point nommé pour les y aider.
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20151014 – Cinéma
L’HOMME IRRATIONNEL
un film de Woody Allen.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’arrivée d’Abe Lucas (Joaquin Phoenix) en tant que professeur au département de philosophie d’une université des Etats-Unis ne passe pas inaperçue. Elle est précédée de rumeurs plutôt négatives : le nouveau professeur est réputé non seulement pour ses méthodes peu conventionnelles mais pour son manque de scrupule dès qu’il trouve une occasion de vivre une aventure avec l’une ou l’autre de ses étudiantes. Pour ce qui concerne le premier reproche, cela s’avère vite exact au point qu’on a le sentiment que l’enseignant tient en piètre estime la matière même qu’il enseigne. Quant à mettre des étudiantes dans son lit, pas si simple… La vérité, c’est qu’on a affaire à un homme dépressif, peu enclin à goûter quelque plaisir que ce soit. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui manquent, deux femmes étant irrésistiblement attirées par ce qui lui reste de charme : avec Rita Richards (Parker Posey), l’une de ses collègues, cela tourne vite au fiasco, la libido d’Abe Lucas étant à peu près au point mort ; avec Jill Polard (Emma Stone, superbe), une de ses étudiantes, éprise au point de délaisser son fade fiancé pour préférer sa compagnie, il préfère se contenter d’une fervente amitié (quitte à alimenter les ragots, prompts à se répandre dans ce microcosme qu’est un campus).
Le hasard tenant souvent un rôle déterminant dans les films de Woody Allen, c’est à l’occasion de l’un d’eux que tout bascule. Alors que Jill et Abe sont attablés dans un café, ils surprennent une conversation mettant gravement en cause les méthodes et la probité d’un juge. Naît aussitôt dans l’esprit torturé du professeur une idée affolante qui, si elle se réalise, pourrait bien redonner du sel à sa morne existence. Commence alors la deuxième partie du film, celle qui conduit à la réalisation du projet criminel d’Abe et à ce qui ressemble à son retour à la vie. Car, dès son forfait accompli, l’homme retrouve instantanément tout ce qu’il se désolait d’avoir perdu, et son appétit de vivre et sa libido. A ses côtés se trouve une sorte de victime désignée: c’est Jill qui, d’abord consentante, devient, lorsqu’elle découvre à qui elle a affaire, comme la voix de la conscience égarée du professeur. Jusqu’à un dénouement qui doit (une fois encore) beaucoup à quelque chose de hasardeux.
Peut-être l’a-t-on déjà compris, la source d’inspiration avérée, affirmée, de ce nouvel opus de Woody Allen se trouve dans « Crime et Châtiment », l’un des chefs d’oeuvre de Dostoïevski. Dans le film comme dans le roman, il est question de commettre le crime parfait qui débarrassera le monde d’un être abject qui, de ce fait, ne mériterait pas de vivre. Ne se porterait-on pas sans mieux si disparaissaient de la surface de la terre l’usurière du roman et le juge inique du film ?
Cela étant dit, Woody Allen se garde bien de n’être qu’un copieur ou un pâle imitateur de Dostoïevski. Il s’approprie le récit du romancier russe pour en faire quelque chose de différent et de typiquement allenien. On peut même affirmer, me semble-t-il, qu’il en prend le contre-pied. Raskolnikov, le personnage de Dostoïevski, une fois son double crime perpétré, se rongeait de remords et de culpabilité. Rien de tel chez Abe Lucas qui, engoncé dans son orgueil, reste persuadé jusqu’au bout de son bon droit. Chez Dostoïevski, le chemin de la repentance et du salut était inspiré au criminel par Sonia, la lumineuse prostituée imaginée par l’auteur. Chez Woody Allen, Jill l’étudiante, qui se découvre plus conventionnelle qu’elle ne voulait le croire, a beau faire et beau dire, elle ne fait pas bouger d’un iota la conscience égarée de son professeur. Quant au châtiment, s’il était voie de rédemption dans le roman russe, il n’est plus ici que le fruit du hasard. A la déportation en Sibérie se substitue la chute dans un gouffre.
Qu’on se rassure, il n’est nullement nécessaire d’être un fin spécialiste de Dostoïevski ni même d’avoir lu le roman susnommé pour apprécier « L’Homme irrationnel ». Il suffit de se laisser conduire par une intrigue assez limpide et par la mise en scène élégante de Woody Allen. Il faut aussi accepter de se laisser interroger par la vision de l’humanité somme toute très pessimiste de ce dernier. Les criminels ne trouvent pas tous un chemin de salut et il en est d’impénitents comme celui que le cinéaste a choisi de faire évoluer. Nous aimerions sans doute que tous acceptent de saisir la main salvatrice d’une Sonia, comme chez Dostoïevski. Mais il en est aussi qui, tout enfermés dans leur suffisance, n’entendent rien d’autre qu’eux-mêmes et rejettent tout rachat. Sous ses apparences de fluidité, voire presque de légéreté, Woody Allen sait, mieux que quiconque, nous confronter à nous-mêmes, à ce que nous sommes, à notre pauvre humanité qui s’égare si facilement. Une fois encore, il nous fait le cadeau d’un film capable d’alimenter nos réflexions et nos méditations pour de longues heures.
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
20151010 – Cinéma
ASPHALTE
un film de Samuel Benchetrit.
Ne nous fions pas aux apparences: derrière la loufoquerie et la nonchalance qui habillent ce film, derrière l’étrangeté de ce qu’on voit à l’écran, se devine aisément le regard tendre d’un réalisateur qui parvient sans peine à nous faire aimer chacun de ses personnages.
Tout ou presque se déroule dans un immeuble des plus délabrés où, d’emblée, il est question de remplacer un ascenseur toujours en panne. C’est là, dans ce lieu déshérité, que nous faisons connaissance avec les personnages: le réalisateur nous conte trois histoires d’hommes et de femmes esseulés qui, tous, trouvent une sorte de salut dans la rencontre de quelqu’un d’autre. Rencontres de gens seuls, d’êtres en mal de vivre pour qui germe enfin quelque chose qui ressemble à l’espoir et qui fait du bien à l’âme.
Un célibataire (Gustave Kervern) qui, au départ, a refusé de payer sa part pour l’achat d’un ascenseur qu’il ne prend jamais (il habite au 1er), mais qui se retrouve plus tard en fauteuil roulant, rencontre une infirmière de nuit (Valeria Bruni-Tedeschi) dont le mal-être l’émeut et auprès de qui il se fait passer pour un photographe.
Une actrice dépressive (Isabelle Huppert) qui échoue dans un appartement minable et se lie d’amitié avec son jeune voisin de palier (Jules Benchetrit) tout ébahi de se trouver en présence de quelqu’un de connu.
Et une dame d’origine kabyle (Tassadit Mandi) qui voit littéralement tomber du ciel un visiteur en la personne d’un astronaute américain (Michael Pitt) échoué là avec sa navette, et qui, entre deux visites à son fils emprisonné, se fait un plaisir de converser avec son hôte (malgré la barrière de la langue) et de lui faire goûter son couscous.
Pour chacun et chacune, même si la vie garde un goût amer, quelque chose change. La rencontre de l’autre brise enfin le terrible isolement et laisse place à de la solidarité, voire à de l’amour. C’est ce que le réalisateur fait apparaître au fil des trois histoires. Peu importe qu’elles soient invraisemblables, elles n’en sont pas moins extrêmement touchantes. C’est même par une sorte de miracle de l’amour que se trouveront réunis (malgré de gros obstacles) les personnages du célibataire et de l’infirmière de nuit lors d’une des scènes finales du film. Un « miracle » qui n’est pas sans rappeler la sublime et ultime scène d’un chef d’oeuvre du cinéma muet (« Lucky Star » de Frank Borzage – 1929). Samuel Benchetrit est certes loin d’avoir le génie de ce dernier, mais son film est tout de même éminemment sympathique et très recommandable.
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20151009 – Cinéma
FATIMA
un film de Philippe Faucon.
Dans le coeur de Fatima, sinon dans sa vie, la place est largement occupée par ses deux filles, qu’elle élève quasiment seule (la cadette voyant, de temps à autre, son père). Difficile de les voir grandir et s’émanciper, d’autant plus difficile que Fatima est écartelée entre sa fierté, ses espoirs, ses incompréhensions, ses craintes et surtout sa peur du « qu’en dira-t-on ». Il ne manque pas de commérages dans son entourage et Fatima exhorte ses filles à tout mettre en oeuvre pour échapper aux rumeurs malveillantes.
L’aînée, Nesrine, a de quoi faire la fierté de sa mère, puisque, ses résultats scolaires ayant été excellents, elle s’apprête à commencer des études de médecine. Avec la cadette, Souad, 15 ans, c’est autrement plus compliqué: c’est une adolescente en révolte qui, plutôt que d’aller en classe et de travailler, préfère passer son temps à traîner dans les rues.
Pour Souad comme pour Nesrine, une des maladies qui rongent l’âme s’appelle la honte. Elles ont honte d’une mère qui porte constamment un foulard, maîtrise mal le français et subvient à leurs besoins en faisant des ménages. Souad, l’adolescente en crise, le dit sans détours à sa mère, lui reprochant d’être une « cave » qui se laisse exploiter sans rechigner. Du côté de Nesrine, la honte n’est jamais exprimée directement, mais elle n’en est pas moins réelle: à sa colocataire qui l’invite à sortir, elle répond qu’elle préfère rester seule, de peur de devoir parler de sa mère à un inconnu trop curieux qui lui poserait des questions.
Si la communication entre Fatima et ses filles s’avère difficile, on n’est pas surpris de constater combien c’est encore plus problématique quand il s’agit d’autres personnes. Fatima est loin d’être dénuée d’intelligence ni de perception: elle a bien compris que l’argent qui traîne comme par hasard dans une des demeures où elle fait des ménages y a été laissé à dessein pour tester son honnêteté. Mais, le jour où elle participe, au collège où est scolarisée Souad, à une réunion de parents et qu’elle est invitée à s’expliquer à propos de sa fille, elle demeure muette. Elle est incapable de s’exprimer correctement en français, comme les autres parents. Ce n’est pas qu’elle n’a rien à dire. Au contraire, mais ce qu’elle a à dire, elle le confie, quand elle dispose d’un peu de temps, à un cahier, dans lequel elle écrit en arabe. C’est, en quelque sorte, son cahier de confessions: elle y met tout son coeur, toutes ses pensées, toutes ses craintes et tous ses espoirs.
Venant après « Dheepan » et son accablante collection des clichés les plus éculés et les plus rances sur les cités sensibles, ce film en apparaît comme l’antithèse. Après l’esbroufe d’Audiard, bienvenu à la sobriété et à la justesse de ton de Philippe Faucon. Porté par de superbes actrices, « Fatima » va toujours droit à l’essentiel, semble toujours criant de vérité et touche le coeur du spectateur sans jamais tomber dans le sentimentalisme. Les personnages sont incarnés, ils n’ont rien du symbole. Fatima n’est pas parfaite, son raisonnement s’encombre, par moments, de préjugés, mais elle reste et restera comme une des plus belles et plus touchantes figures de mères au cinéma.
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20150918 – cinéma
MARGUERITE
un film de Xavier Giannoli.
De prime abord, cela semble totalement invraisemblable et cependant le scénario de ce film est inspiré d’une histoire réelle, celle de la soprano américaine Florence Foster Jenkins (1868-1944), une Castafiore américaine qui massacrait allégrement les grands airs d’opéra en se prenant pour une diva.
Cela étant dit, Xavier Giannoli, le réalisateur, s’est bien gardé de faire un simple biopic et il a sans doute eu raison. Son héroïne à lui se nomme Marguerite Dumont et elle est française. Elle aussi, bien sûr, se targue de chanter divinement sans se rendre compte que ceux qui l’écoutent endurent un vrai supplice. Car personne ne lui dit la vérité, personne, pas même son mari, ne se risque à lui faire entendre raison et à la décourager de se produire devant un public.
Autour d’elle, c’est un théâtre de menteurs, de flagorneurs et de profiteurs qui s’est mis en place. Car Marguerite est riche comme Crésus et nombreux sont ceux qui, sans honte aucune, sont prêts à multiplier les flatteries pour en tirer des bénéfices. La vérité est d’autant mieux dissimulée qu’une sorte d’ange mi-bienfaisant mi-malfaisant veille sur Marguerite, son majordome qui la contemple comme une déesse, la prend en photos habillée en héroïne d’opéra et s’ingénie à détruire ou à stopper tout ce qui pourrait nuire à sa réputation. Il est prêt à tout, ce majordome, même à pratiquer le chantage, pourvu que sa maîtresse perdure dans ses rêves et ses illusions.
D’autres personnages plus ou moins bien intentionnés gravitent autour de la prétendue diva, des journalistes, des membres d’une confrérie, un désopilant maître de chant accompagné de ses étranges acolytes, etc. Tout un monde, toute une comédie humaine qui se prend au jeu du mensonge, tire profit du phénomène ou s’en amuse. Jusqu’au drame, à l’inévitable tragédie qui ne peut que survenir tôt ou tard.
Xavier Giannoli a réalisé ce film avec une époustouflante maîtrise et un grand sens de la mise en scène. Jamais il n’en fait trop. Tout est intelligemment suggéré plutôt que souligné et l’on ne sent pas passer les deux heures que dure le film. Il y a bien des scènes très amusantes (comme celle de la première audition de Marguerite par le maître de chant), mais le rire fait vite place à la consternation et à l’effroi. Car on le sent, et Xavier Giannoli le suggère habilement par un plan sur une stèle et une croix qui revient tout au long du film comme un leitmotiv, la mort est là, n’attendant que son heure pour se manifester. Quant à Marguerite, on le devine, c’est parce qu’elle aime et parce qu’elle souffre qu’elle se laisse si facilement aveugler et berner par tant de personnages hypocrites jusqu’à sombrer dans une sorte de folie. En incarnant cette héroïne tragi-comique à l’écran, Catherine Frot a sans nul doute trouvé le meilleur rôle de sa carrière: elle est extraordinaire!
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20150914 – cinéma
LES CHANSONS QUE MES FRÈRES M’ONT APPRISES
un film de Chloé Zhao.
Pour les Indiens Sioux de la réserve de Pine Ridge (Dakota du Sud), les perspectives d’avenir s’avèrent pour le moins limitées. Ils ont beau résider sur un vaste territoire, lorsqu’un professeur demande à ses élèves ce qu’ils veulent faire quand ils seront plus grands, la réponse ne varie pas beaucoup. Tous affirment qu’ils seront « monteurs de taureaux », autrement dit qu’ils s’exhiberont à l’occasion de rodéos. Seul Johnny donne une autre réponse: « Je serai boxeur », dit-il.
Ce Johnnny, un des Indiens lakotas de la réserve, est un adolescent qui rêve d’autre chose que de l’horizon qu’il connaît. Pour l’heure, malgré les interdictions liées à l’alcool qui est l’un des fléaux frappant la communauté indienne, il se risque à en faire le trafic. Que faire d’autre? Comment gagner de quoi partir à Los Angeles avec sa petite amie?
Mais les rêves d’une autre vie, d’un autre environnement, ont beau être forts, ce n’est pas si simple de s’en aller. Ce n’est certes pas son père qui le retient puisqu’il vient de mourir accidentellement. Ce n’est peut-être pas davantage sa mère malgré ses larmes, ni son grand frère emprisonné. Mais sa petite soeur Jashaun, sa petite soeur adorée, comment la laisser, comment l’abandonner à son triste sort? Tout le film est habité par cette tension, par cet écartèlement: partir dans l’espoir de vivre une vie meilleure ou rester parce qu’il n’est pas envisageable de délaisser une petite soeur aimée.
Afin de réaliser ce premier film, la réalisatrice, américaine d’origine chinoise, Chloé Zhao, s’est immergée dans la vie, dans les coutumes, des Indiens de cette réserve. Cela transparaît sur chacun des plans du film. Il s’agit bien d’une fiction, mais d’une fiction qui sait préserver et respecter ceux qui sont mis en scène. Cela donne un film à la fois superbe et déchirant, comme ces Indiens qui, même s’ils survivent dans un contexte sinistre, n’ont pas tout perdu de leur dignité, tel le tatoueur tatoué qui apparaît à plusieurs reprises au cours du récit. Pour d’autres, c’est vrai, l’alcool et le désespoir ne semblent plus laisser place à quelque salut que ce soit. Il y a bien la foi chrétienne, elle est sûrement précieuse, mais dans la mesure où elle ne sert ni d’alibi ni de refuge. Quand la mère de Johnny et Jashaun se décide à visiter son fils aîné qui est en prison, elle lui parle de sa foi, elle lui parle de la présence apaisante de Dieu, mais la réponse du fils est cinglante: « pourvu que ce ne soit pas encore un de ceux pour qui tu délaisses tes enfants! »
Restent le beau visage et le superbe regard plein d’espoir de la petite Jashaun! « Tout n’est pas perdu, semble-t-elle nous dire, tout n’est pas perdu pour les Indiens de la réserve de Pine Ridge!
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20150904 – cinéma
CEMETERY OF SPLENDOUR
un film d’Apichatpong Weerasethakul.
Ceux sur qui le cinéma contemplatif du réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul agit comme un somnifère vont être gâtés à la vue de ce nouvel opus! Leur somnolence risque d’être d’autant plus irrésistible que le film tout entier repose sur une affaire de sommeil! Pour d’autres (dont je suis), « Cemetery of Splendour » sera perçu comme une oeuvre irrésistiblement fascinante, davantage encore que tous les films précédents du cinéaste.
Affaire de sommeil donc, puisqu’une mystérieuse maladie frappe des soldats, et uniquement des soldats, les plongeant précisément dans un étrange sommeil au point qu’ils doivent être mis en quarantaine dans une école transformée en hôpital de fortune. Est-ce une manière, pour le réalisateur, de répondre à l’autoritarisme des militaires omniprésents dans son pays depuis qu’un coup d’état y a eu lieu en mai 2014? Probablement, mais le film ne s’appesantit pas sur des questions d’ordre politique. Fidèle à son esthétique, Weerasethakul préfère construire un film mêlant habilement le charnel et le spirituel et invitant le spectateur à la contemplation.
Deux femmes en sont les pivots: Jenjira, une handicapée ayant une jambe plus courte que l’autre et prenant soin tout particulièrement d’un soldat prénommé Itt, et Keng, une medium qui prétend percevoir et interpréter les pensées et les rêves des endormis. Weerasethakul filme les corps avec attention, y compris dans des postures ou des réactions qui pourraient paraître triviales mais qui, chez lui, ne sont que simplicité et évidence. Dans le même temps, il donne sens à son film en suggérant tout aussi simplement et avec autant d’évidence ce qui est de l’ordre de l’esprit ou plutôt peut-être des esprits. Et si la mystérieuse maladie du sommeil qui frappe les soldats avait pour cause un antique cimetière où sont enfouis des rois qui, parce qu’ils se battent toujours, ont besoin de se nourrir de l’énergie des vivants?
Beaucoup de scènes et de plans de ce film laissent pantois d’admiration. Les jeux de lumière sont remarquables, d’autant plus que les malades sont soignés, entre autres choses, par une thérapie à base de néons de lumière. Les verts, les rouges et les bleus se succèdent, créant une sorte de douce hypnose. Mais le film culmine lorsque Keng emmène Jenjira à la découverte du palais des rois enfouis dans le cimetière. En fait de palais, il ne reste rien mais Keng semble percevoir des murs invisibles. Plus tard, alors qu’elles se sont assises, Jenjira dévoile à sa compagne sa jambe malade, difforme, hideuse, couturée de cicatrices à la suite d’opérations. Keng réagit en couvrant le pied et la jambe de Jenjira d’un baume, puis en les embrassant et même les léchant. Scène sublime, simple et touchante, qui peut être perçue comme une sorte de variante du baiser au lépreux. Sommet d’émotion pure et de tendresse qui fait verser des larmes à la malade.
Est-ce cela qui se reflète dans les yeux grand ouverts de Jenjira lorsque le film s’achève, nous la montrant ainsi, observant un terrain retournée par des pelleteuses où des gamins jouent au ballon? Ou peut-être songe-t-elle à Itt, le soldat qu’elle a réussi à réveiller? Ou encore aux rois enfouis dans le cimetière? Qui peut savoir? Ces yeux largement ouverts et fascinés furent aussi les miens tout au long de ce film sublime.
9/10
Luc Schweitzer, sscc.
20150828 – cinéma
DHEEPAN
un film de Jacques Audiard.
Quoi! Voilà donc le film à qui ont été attribués les lauriers de la Palme d’Or au dernier festival de Cannes! Invraisemblable et atterrant! Qu’est-ce que les membres du jury avaient dans la tête pour accorder tant d’honneur à ce film non seulement médiocre d’un point de vue purement cinématographique mais encore et surtout extrêmement douteux d’un point de vue idéologique? J’ai du mal à comprendre… Certes les trois personnages de réfugiés tamouls, contraints de se faire passer pour une famille (père, mère et fille) afin de fuir le Sri Lanka, ont largement de quoi susciter l’intérêt. La petite fille tamoule et sa fausse mère sont d’ailleurs les seuls personnages intéressants et touchants de ce film. Quant au reste, tout dérape très vite vers les pires clichés véhiculés quand il est question des quartiers dits sensibles.
Car c’est dans un de ces quartiers défavorisés que les trois tamouls trouvent refuge, l’homme en tant que gardien d’immeubles et la femme en tant qu’auxiliaire de vie. Dès lors, le spectateur est comme pris en otage: ce que le réalisateur a choisi de montrer de ce quartier, ce ne sont qu’immeubles dégradés, tagués, sales et inquiétants et entièrement contrôlés par les trafiquants de drogue. On ne voit qu’eux, ils sont partout, ils font régner leur loi, règlent les déplacements des habitants, font la surveillance du haut des toits et, pour un oui ou pour un non, sortent leurs armes et font le coup de feu! Pas une seule fois on n’aperçoit un véhicule de police. Il n’y en a que pour les caïds de la drogue, le quartier leur appartient! Et, bien sûr, la fin du film se complaît dans un tourbillon invraisemblable de violence.
Disons les choses clairement: si Jacques Audiard avait voulu faire la promotion de la propagande du FN, il ne s’y serait pas pris autrement! J’imagine que les dirigeants du parti en question pourraient prendre ce film en exemple afin d’illustrer leurs propos tendancieux! Pour ce qui me concerne, j’exècre cela et je ne supporte pas qu’un film, délibérément ou non, cherche à faire de moi un otage! Que les quartiers dits sensibles soient le théâtre de dégradations, d’exactions et de violences de toutes sortes, il n’est pas question de le nier, mais qu’un film choisisse de ne montrer que cela, c’est extrêmement dommageable! Quand je pense à Miguel Gomes choisissant de mettre l’accent sur une communauté d’oiseleurs vivant dans un quartier défavorisé de Lisbonne (dans le volume 3 des « Mille et Une Nuits »), voilà qui change des clichés habituels et voilà ce que j’apprécie! Le cinéma a-t-il pour but de surligner nos idées toutes faites, que ce soit sur les quartiers sensibles ou sur quoi que ce soit? Non! Il a plutôt pour vocation de nous surprendre ou de nous étonner! Le film de Miguel Gomes nous surprend, celui de Jacques Audiard jamais ou quasiment jamais! Il nous donne plutôt la nausée!
2/10
Luc Schweitzer, sscc
20150826 – Cinéma
LES MILLE ET UNE NUITS, VOL. 3 : L’ENCHANTÉ. Un film de Miguel Gomes.
C’est donc avec « L’Enchanté » que s’achève l’impressionnante trilogie orchestrée par Miguel Gomes, trilogie qui a conquis non seulement les écrans mais les coeurs des spectateurs durant tout cet été. Peut-être conviendrait-il de séparer le sous-titre en deux, comme le faisait Jacques Demy: « en chanté »! Car ce troisième volet est tout entier habité, comme possédé, par la magie du chant et de la danse: chants populaires, hymne national du Portugal et même un brin de heavy metal!
Il y a deux parties bien distinctes dans ce film, la première toute de virtuosité et la deuxième plus contemplative et plus proche du documentaire. Tout d’abord, c’est Schéhérazade en personne qui apparaît comme le personnage pivot de l’oeuvre, Schéhérazade qui, dans un Bagdad réinventé, tout en admettant ne rien connaître du monde extérieur, se charge de raconter et de raconter encore, passant d’une histoire à l’autre afin d’enchanter autant qu’il est possible un monde attristé et dangereux. Tout est possible à Miguel Gomes, qui ne se prive d’aucune magie du cinéma, pour donner à percevoir la beauté, la grâce, l’innocence de l’enfance. Et les histoires s’enchaînent, depuis celle d’un homme réputé pour sa fécondité jusqu’à celle d’un voleur en passant par celle du génie du vent.
Nous étions ravis par ces histoires fabuleuses… Mais voici que le réalisateur nous ramène non seulement à son cher Portugal mais à des barres d’immeubles sans attrait de la banlieue de Lisbonne. Dans ces quartiers autrefois constitués de véritables bidonvilles et aujourd’hui de ces logements sociaux sans âme vivent bien sûr des gens de peu. Après l’enchantement de la première partie du film, va-t-il donc falloir à présent déchanter? Point du tout! C’est par des chants d’oiseaux que le réalisateur nous ensorcelle! Pas de clichés sur la banlieue, mais une surprise: dans ces barres d’immeubles vivent des « pinsonneurs », autrement dit des oiseleurs qui, après avoir attrapé des pinsons, les élèvent en cages, leur apprennent à chanter (on dit alors que les oiseaux sont « retournés ») et les font participer à des concours de chants. C’est tout un art que d’élever et de prendre soin de ces pinsons. Minutieusement, longuement, Miguel Gomes nous invite à découvrir et à suivre pas à pas ces passionnés (si passionnés que l’un d’eux a même fait amputer d’une patte un oiseau blessé afin de lui sauver la vie)!
C’est sur ces scènes étonnantes que l’on quitte à regret ces « Mille et Une Nuits ». Du fait de la crise, la plupart des portugais se sont appauvris, nous rappelle Miguel Gomes au début de chacun des trois films. C’est vrai bien sûr, mais c’est vrai aussi que tout n’est pas perdu. Miguel Gomes nous a donné du peuple portugais l’image d’un peuple qui résiste et on l’en remercie!
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20150807 – Cinéma
SUR LA LIGNE
un film d’Andrea Sedláčková.
C’est avec bien du talent que la cinéaste Andrea Sedláčková, jusqu’ici monteuse, réalise son premier film, nous livrant une approche saisissante de la Tchécoslovaquie des années 80 et, tout particulièrement du milieu sportif.
Pour le système communiste encore en place dans ces années-là, rien ne compte que de faire triompher ses athlètes. Il faut montrer au monde que le communisme produit des champions et peu importe le prix à payer. Anna, repérée pour ses qualités sportives, est l’une de celles qui doivent en subir les conséquences. Prise en charge par un « médecin » sportif, elle est sommée de se plier à la règle, c’est-à-dire d’accepter des injections quotidiennes d’un produit censé augmenter et fortifier la masse musculaire, et de se taire.
Anna, contrainte et forcée, accepte, au moins dans un premier temps, ce diktat, d’autant plus que non seulement son entraîneur mais sa propre mère se font les complices de ce système. En fait, et c’est l’un des grands points forts de ce film que de le souligner, tout le monde, ou presque, se trouve pris, d’une manière ou d’une autre, dans un piège. La mère d’Anna, pourtant « coupable » d’aider un écrivain rebelle au régime en place, coopère d’assez bonne grâce lorsqu’il s’agit d’injecter un produit dopant à sa fille, mais tout en rêvant pour cette dernière d’un triomphe aux Jeux Olympiques et d’une émigration à l’ouest (où elle rejoindrait son père déjà parti).
Que faire? Quelles décisions prendre? Anna rêve d’être championne, elle aussi, mais pas en y laissant sa santé. A travers le prisme du sport, c’est tout un monde heureusement révolu qui renaît sous nos yeux, un monde pesant, terrifiant, un monde glacé et pervers où chacun est sollicité pour se faire l’espion d’autrui et où tout concourt à la destruction des individualités. Malgré une mise en scène un rien trop sage, Andrea Sedláčková a parfaitement réussi à recréer ce monde-là, pas si ancien, en s’appuyant sur des acteurs et actrices tous et toutes excellents!
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20150731 – Cinéma
LES MILLE ET UNE NUITS, VOLUME 2 : LE DÉSOLÉ
Un film de Miguel Gomes.
En a-t-elle, des histoires à raconter, la Shéhérazade convoquée par Miguel Gomes? Des histoires longues ou brèves, des histoires d’un pays attristé, le Portugal, d’un pays dont les habitants se sont majoritairement appauvris du fait de la crise. Le réalisateur l’a sillonné, ce pays, son pays, pendant près d’un an, recueillant une multitude de récits et d’images dont il a tiré la matière de trois films dont voici le deuxième volet, le plus sombre, le plus désolé, comme l’indique son titre.
Y a-t-il moyen de les enchanter un peu, ces histoires-là, ou, du moins, d’y glisser un peu de fantaisie? Oui, semble répondre Miguel Gomes, qui n’a pas choisi la voie du documentaire mais de la fiction. Plus exactement, il reconstruit chaque histoire recueillie et bien réelle en la mettant en scène et en l’habillant de ses couleurs et de sa fantaisie propres. Il s’appuie sur le documentaire pour le réinventer en en une apparence de fiction.
Mais revenons à Shéhérazade et à ses récits. Il y en a trois dans ce deuxième volet. L’histoire de Simão, surnommée « Sans-Tripes », un homme en cavale que les uns jugent mauvais et que les autres déculpabilisent: preuve, s’il en est besoin, qu’on ne connaît jamais suffisamment le coeur d’autrui. La deuxième histoire le dit aussi, mais de manière encore plus complexe, en mettant en scène une juge aux prises avec une affaire de vol de bétail. Qui est réellement coupable, comment déterminer de façon sûre le bien et le mal? La juge déboussolée et impuissante nous ressemble, nous qui, acteurs d’un monde qui va mal, aimerions trancher et désigner des coupables et qui ne le pouvons pas (si nous ne voulons pas céder aux simplifications).
Quant à la troisième histoire, elle est démultipliée en une série de brefs portraits;ceux des habitants d’une tour. C’est un chien appelé Dixie, un chien abandonné et recueilli, un chien qui passe de maître en maître, se prend d’affection pour chacun d’eux tout en s’empressant d’oublier le précédent, qui fait le lien entre ces divers portraits. Ce sympathique animal est-il le signe que tout n’est pas perdu et qu’il y a moyen, même et surtout en temps de crise et de précarité, de faire preuve de fraternité, si l’on peut dire? Peut-être bien. En tout cas, si ce deuxième volume des « Mille et Une Nuits » est teinté de couleurs assez sombres, il ne l’est pas entièrement et ce grâce, entre autres, à ce brave toutou! Mais sans doute le troisième volume nous le dira-t-il encore davantage puisqu’il a pour titre « L’Enchanté »…
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150723 – Cinéma
LES BÊTISES
un film de Rose et Alice Philippon.
N’est-ce pas sur un fond de gravité que se fabriquent les meilleures comédies? Quoi qu’il en soit, pour leur premier film, Rose et Alice Philippon ont judicieusement fait ce choix-là et ont bâti leur histoire sur un sujet de société, celui d’un enfant né sous x et adopté à la naissance et qui, trente cinq ans plus tard, se met en quête de sa mère biologique.
François (Jérémie Elkaïm), bien qu’apparaissant dès le début du film comme un garçon très maladroit, sait aussi, quand il le faut, faire preuve d’habileté et c’est grâce à un habile stratagème et un joli gag qu’il parvient à découvrir le nom et l’adresse de celle qu’il s’est mis en tête de retrouver. C’est à Andlau, commune du Bas-Rhin proche de Sélestat, qu’elle a établi ses pénates et coule ses jours heureux auprès d’un mari et de deux enfants.
Arrivé dans ce charmant bourg d’Alsace, c’est à nouveau en faisant preuve d’ingéniosité et de manigance que François parvient à franchir les murs de la propriété où réside sa mère: il usurpe l’identité d’un serveur et le voilà dans la place, mais obligé, au moins dans un premier temps, de se faire passer pour celui qu’il n’est pas. Ses demi-frères et sa mère ont organisé une fête en l’honneur de l’anniversaire du maître de maison et ont engagé serveur et serveuse pour l’occasion. Aux côtés de Sonia (magnifique Sara Giraudeau), sa collègue serveuse qui ne peut dire deux phrases sans pousser un hoquet, François, tout en collectionnant les maladresses se rapproche pas à pas de celle qu’il cherchait.
Malgré quelques baisses de rythme, ce film, qui fait s’entrecroiser les scènes désopilantes et les scènes émouvantes, sans oublier les scènes festives et lorgne clairement du côté d’un grand classique de Blake Edwards (« La Party », 1968), se savoure avec délectation. Il faut voir le tour que prend la fête lorsque débarquent des noceurs inattendus et drôlement costumés! Il faut se laisser émouvoir lorsque mère, mari et enfants se disent leur quatre vérités! Il faut pousser des rires lorsque s’enchaînent les situations cocasses et les scènes de pure comédie. Et il faut apprécier la « guérison » de Sonia: car la serveuse parvient à se défaire de son hoquet, oui, oui! Courez donc voir ce film réjouissant si vous voulez savoir comment!
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc.
20150722 – Cinéma
LES NUITS BLANCHES DU FACTEUR
un film d’Andréi Konchalovski.
Voulez-vous voir un film dépaysant autant que somptueux? Ce long-métrage d’Andréi Konchalovski, à mi chemin entre fiction et documentaire, devrait parfaitement convenir.
Pas d’acteurs dans cette œuvre, mais les habitants d’un coin perdu du nord de la Russie, au bord du lac Kenozero, filmés au naturel. A commencer par Liocha, le facteur, obligé de traverser le lac immense pour porter aux habitants des villages non seulement leur courrier mais leur maigre pension et les objets du quotidien qu’ils ont réclamés. Entre le facteur et les villageois se sont nouées des relations de grande complicité. Liocha n’est pas un fonctionnaire mais, bien davantage, un confident, voire un ami. Lui qui a réussi à en finir avec la vodka depuis deux ans (et qui se promet d’en terminer un jour avec le tabac) n’émet aucun jugement chaque fois qu’il a affaire à un des habitants, ivrogne invétéré, mais il l’accompagne, il l’aide, il le soutient. Il y a chez Liocha quelque chose de l’ordre de la compassion.
Bien sûr, le facteur n’est pas un saint, il laisse apparaître quelques failles, mais c’est un homme simple qui sait se mettre au service d’autrui. C’est peut-être avec un jeune garçon, son neveu, que la complicité est la plus grande. Il l’emmène volontiers avec lui, partout où il va, pour lui dévoiler des endroits secrets, mystérieux et terrifiants hantés par la sorcière Kikimora ou pour une escapade en ville avec à la clé la dégustation d’une glace.
Pourquoi donc cet homme simple et plutôt droit souffre-t-il néanmoins d’insomnies et est-il visité par un étrange chat gris que lui seul a le privilège de voir? Le film ne donne pas de réponse, mais lorgne habilement du côté du fantastique, lors de quelques scènes suggérant que peut-être la vie de Liocha n’a pas été toujours aussi limpide que les eaux du lac qu’il sillonne sur son bateau.
Quant à ce coin de Russie, il n’est peut-être pas aussi perdu qu’il semblait. En tout cas, l’on découvre au cours du film qu’il avoisine une base militaire, ce qui donne lieu, au cours d’une des scènes finales, au spectacle le plus ahurissant qui soit: deux mondes se côtoient, l’un qui n’est fait que de pauvreté et de rusticité, l’autre où l’on dépense une fortune pour mener à bien un projet militaire.
Quoi qu’il en soit, Andréi Konchalovski a réalisé un film superbe, multipliant les prises de vue les plus belles et nous offrant quantité de plans somptueux sur le lac, la nature, mais aussi les villages et les villageois. Une œuvre fascinante et émouvante qui nous fait admirer et sentir la Russie éternelle!
8/10
Luc Schweitzer, sscc.
20150624 – Cinéma
LES MILLE ET UNE NUITS, VOLUME 1 – L’INQUIET.
Un film de Miguel Gomes.
Alors que paraît sur les écrans ce film de Miguel Gomes, premier volet d’une trilogie, il se trouve que je lis un recueil d’articles de l’écrivain turc Orhan Pamuk (« D’autres couleurs »). L’une des questions qui hante ce dernier au point qu’elle revient assez souvent sous sa plume, c’est celle du bien-fondé de la littérature de fiction dans un monde marqué par la misère et les détresses. Est-il acceptable d’écrire ou de lire des romans plutôt que de se préoccuper des pauvretés et des injustices? C’est la même question qui surgit au début du film de Miguel Gomes, sauf qu’il ne s’agit plus de littérature mais de cinéma.
A cette question, le cinéaste portugais (dont j’avais tellement admiré « Tabou », film en noir et blanc, mi-parlant, mi-muet) répond à sa manière, c’est-à-dire en s’inspirant d’un des ouvrages de fiction les plus célèbres, « Les Mille et Une Nuits », mais pour mieux appréhender et rejoindre les réalités de notre temps et, particulièrement, la crise économique qui a touché, parmi tant d’autres pays, le Portugal au cours de ces dernières années. Cela donne un film foisonnant, inclassable et déroutant qui ne pourra sans doute pas séduire tous les spectateurs mais qui fascinera les autres (dont je suis) au point qu’ils auront hâte d’en voir les deux autres volets.
Ce film-ci (« L’inquiet ») s’ouvre sur deux événements concomitants, la fermeture d’un chantier naval et la prolifération des guêpes asiatiques tueuses d’abeilles. Quel rapport entre le désespoir des ouvriers mis au chômage et celui des apiculteurs perdant l’une après l’autre leurs ruches? Rien, si ce n’est que ces événements surviennent au même moment et dans un même secteur géographique et qu’ils sont signes, parmi d’autres, d’un monde qui va mal.
Ce monde-là, Miguel Gomes choisit de l’appréhender à sa manière, en convoquant sa Shéhérazade d’aujourd’hui. A elle de raconter ses histoires nuit après nuit afin de rester en vie. Des histoires de notre temps qui évoquent à leur manière, sans bien-pensance, aussi bien l’impuissance des décideurs financiers de l’Europe que la détresse des laissés-pour-compte (que le réalisateur appelle les « magnifiques » et qu’il filme frontalement et sans chichis), mais aussi le procès d’un coq coupable de réveiller les gens à des heures indues!
Avec Miguel Gomes, il faut accepter un autre regard que celui auquel nous ont habitués trop vite des films récents (et, certes, excellents) comme « La loi du marché » ou « La tête haute ». Dans « Les Mille et Une Nuits, volume 1 », notre monde à la dérive est bien là, mais il est regardé sous un autre angle, sous celui d’un conteur qui aimerait être capable de le réenchanter un peu et qui ne demande qu’à nous emporter au vent de ses audaces.
A sa manière, on peut aller jusqu’à dire que ce film s’accorde avec les préoccupations qu’expose le pape François dans sa récente encyclique « Loué sois-tu ». Ni le regard ni le propos ne sont tout à fait les mêmes bien sûr, mais, tout de même, rien n’interdit de se réjouir des deux parutions simultanées, celle de l’encyclique et celle de ce film!
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150621 – Cinéma
MUSTANG
un film de Deniz Gamze Ergüven.
Libres et indociles comme les mustangs, les chevaux sauvages de l’Ouest américain, ainsi apparaissent les cinq sœurs dont ce film de la réalisatrice franco-turque Deniz Gamze Ergüven nous invite à suivre les destinées. Cinq soeurs que l’on découvre se livrant sans honte aucune à des jeux aquatiques, juchées sur des épaules de garçons. Mais cinq sœurs que la société rigide du fin fond de la Turquie dans laquelle elles grandissent se fait un devoir de mettre dans le rang.
Cinq sœurs, cinq orphelines, que leur oncle, qui a pris en charge leur éducation, choqué par les ragots qui circulent sur leur compte, décide de dresser. Aidé par sa mère, à qui il a fait de vifs reproches, l’accusant d’avoir donné trop de liberté aux filles, obsédé par la préservation de leur virginité, il s’ingénie à les couper du monde et à ne leur donner d’autre instruction que celle qui convient, selon lui, à de futures épouses.
La grand-mère, pliant sous la volonté tyrannique de l’oncle tout en essayant de protéger les enfants des fureurs de ce dernier, les oblige à revêtir les robes informes que portent les femmes du village et leur apprend à être de parfaites cuisinières. Quant à la maison, jusque là ouverte aux quatre vents, l’oncle la transforme petit à petit en une forteresse-prison. Bientôt surviennent les prétendants et leurs familles, car, bien sûr, il convient de marier ces filles sans tarder et sans guère se préoccuper de leur consentement.
Qu’advient-il donc de ces cinq filles? Se laissent-elles si facilement dompter, elles qui, semblables aux mustangs, nous ont été montrées fières et insoumises? Acceptent-elles sans broncher la loi imposée par l’oncle, elles qui se plaisent, dès qu’elles le peuvent, à se dépouiller des tristes habits qu’on les oblige à revêtir? Chacune a sa destinée propre, la réalisatrice ayant pris grand soin de préserver les individualités. Si l’une courbe l’échine et obtempère, il se peut qu’une autre soit détruite et qu’une dernière brandisse l’étendard de la rébellion…
La plus indocile, la plus fougueuse, la plus inventive, la plus audacieuse, la plus rebelle du groupe se révèle être la benjamine, Lela. A 12 ans, choquée, traumatisée par le sort réservé à ses sœurs, elle est bien décidée à ne pas se laisser faire. Pleine d’imagination, elle cherche par tous les moyens à échapper à l’implacable loi érigée par l’oncle. Elle incarne, plus que les autres, non seulement l’insoumission, mais l’affirmation de sa superbe féminité face à l’arrogance patriarcale des hommes et à leur effarante hypocrisie. Se soumettre à la sorte de cauchemardesque rituel qu’est le mariage forcé et aux rites archaïques qui l’accompagnent, très peu pour elle ! Même à 1000 kilomètres d’Istanbul, il y a peut-être moyen de s’en affranchir !
Hymne à la liberté, hommage à la féminité, ce film de résistance, magnifiquement réalisé, envoûte d’un bout à l’autre. Impossible d’oublier ces cinq sœurs et, en particulier, la petite dernière, l’indomptable Lela !
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150611-Cinéma
COMME UN AVION
un film de Bruno Podalydès.
Beaucoup parmi les meilleurs films proposés sur les écrans sont comme des miroirs reflétant la dureté des temps de crise que nous traversons. Le cinéma ne saurait se réduire à l’usine à rêves, expression par laquelle on désignait quelque peu sommairement l’Hollywood d’autrefois. Il se doit de prendre aussi, en quelque sorte, le pouls du monde et de nous confronter, nous spectateurs, aux parcours compliqués d’un jeune délinquant (dans «La Tête haute ») ou d’un chômeur de longue durée (dans «La Loi du Marché »), par exemple. Cela étant dit, il n’y a pas de raison de bouder son plaisir quand paraît sur les écrans un film qui nous fait complétement oublier, le temps qu’il dure, tous les tracas et tous les soucis du monde, surtout quand ce film est aussi finement réalisé et interprété que ce «Comme un Avion » de Bruno Podalydès. C’est un chef d’oeuvre de poésie et de drôlerie qui nous est offert en l’occurrence et qu’on aurait bien tort de mépriser ! Voulez-vous chasser votre morosité et vous débarrasser de vos idées noires (si vous en avez), allez donc voir ce film-là et vous en sortirez ragaillardis et savourant sans compter le plaisir de vivre !
Est-ce parce que le réalisateur s’est, pour une fois, attribué à lui-même le rôle principal de son film, jamais en tout cas Bruno Podalydès (qui nous a cependant déjà régalés d’oeuvres alléchantes) ne s’est approché d’aussi près de la perfection de son art. Le voilà interprétant un infographiste qui cherche à illustrer une fugue de Bach. Mais c’est une autre fugue qu’il est amené non pas à illustrer mais à vivre et non pas sur un ruisseau mais sur une rivière ! Lui qui se passionne pour l’épopée de l’aéropostale au point qu’il collectionne tout ce qui s’y rapporte, c’est à la faveur d’une recherche sur les palindromes qu’il lui vient l’idée d’effectuer sa fugue en kayak ! Laissant sa femme (Sandrine Kiberlain) compréhensive et presque complice, son travail et toutes ses relations, il s’accorde, muni de son matériel de camping et de son indispensable manuel des castors juniors (!) une gentille escapade dans son avion sans ailes (et au son de la fameuse chanson de Charlélie Couture).
Ce périple émerveillé (aux accents parfois quasi franciscains, tant il y a de reconnaissance et pour la nature et pour les êtres et même pour les objets!), émaillé de petits incidents, conduit notre Ulysse vers sa tentatrice, en l’occurrence une patronne de guinguette (Agnès Jaoui) très accueillante. Ce lieu magique, habité également par une serveuse (Vimala Pons) que la pluie fait pleurer et par de doux dingues très excentriques, notre voyageur a bien du mal à le quitter et, lorsqu’il s’y résout, c’est pour y revenir irrésistiblement. Comment se défaire d’un endroit aussi enchanteur, comment abandonner la Circé qui y réside et qui s’ingénie à le guider jusqu’à elle au moyen d’un délicieux jeu de pistes ?
Pleine d’humour subtil et de superbes échappées poétiques, mâtinée d’un soupçon de mélancolie, la balade enchanteresse se savoure au son des chansons non seulement de Charlélie Couture, mais de Bashung et Georges Moustaki («Donne du rhum à ton homme » et «Le temps de vivre »). C’est peut-être cette dernière chanson qui dit le mieux la revigorante parenthèse que s’offre le héros (si l’on peut dire) de ce film. Le temps de vivre, de rendre grâce, de jouer, de chanter, d’aimer… Le temps de faire un bien fou aux spectateurs aussi, car il y a bien longtemps que, pour ce qui me concerne en tout cas, un film ne m’avait pas autant fait rire et ne m’avait autant rendu heureux !
9/10
Luc Schweitzer, sscc
20150611 – littérature
Bonjour à tous! Aujourd’hui, c’est un compte-rendu de lecture que je vous envoie. Et une invitation à découvrir deux jeunes gens pour qui je ressens une admiration sans borne: Hans et Sophie Scholl qui osèrent défier l’ordre nazi au péril de leur vie. Bien amicalement.
Luc Schweitzer, sscc
LETTRES ET CARNETS
de Hans et Sophie Scholl.
Le 22 février 1943, âgés respectivement de 24 et 21 ans, après une parodie de procès qui fit suite à leur arrestation, pris en flagrant délit de distribution de tracts anti-nazis, Hans et Sophie Scholl furent condamnés à être guillotinés. Malgré le recours en grâce déposé par leur père, le verdict fut aussitôt exécuté. C’était le sixième tract qu’ils avaient rédigé et tenté de diffuser, eux et les autres membres d’un groupe de résistance au nazisme qui avait pris, au moins dans un premier temps, le nom de « Rose Blanche ». On l’ignore, mais en Allemagne, durant toute la période nazie, et tout particulièrement pendant la guerre, il y eut des groupes plus ou moins bien constitués de résistance. La « Rose Blanche » n’était pas un cas unique. Malgré les terribles dangers qui les menaçaient, des Allemands eurent le courage, au péril de leur vie, de dénoncer d’une manière ou d’une autre les folies mortifères initiées et aggravées au fil du temps par Hitler et ses adeptes. Parmi ceux-ci, on peut distinguer, sans dresser d’eux un portrait hagiographique, les deux enfants Scholl, Hans et Sophie. Ni l’un ni l’autre n’étaient des saints, contrairement à ce que leur soeur Inge voulut transmettre d’eux, et, d’une certaine façon, l’on peut dire : tant mieux! C’étaient des jeunes gens presque ordinaires, mais jetés dans les troubles d’une époque si perturbante qu’elle ne laissait pas de place à l’indifférence. Hans et Sophie Scholl en ont pris conscience petit à petit, chacun à son rythme et à sa manière, et ils ont eu l’audace (ou la naïveté, diront certains) d’oser appeler leurs compatriotes à se rebeller contre l’ordre nouveau voulu par Hitler. La lecture de leurs lettres et de leurs journaux intimes, sans mettre en lumière tous leurs débats intérieurs, laisse cependant percevoir comment leurs pensées, à tous deux, ont évolué. Bien des choses sont dites ou simplement suggérées, mais l’on sent bien que tous deux sont habités du désir profond de renaître, de participer à la renaissance d’une autre Allemagne, transformée intellectuellement et spirituellement. Car tous deux, mais Sophie davantage que Hans, témoignent aussi d’un profond cheminement spirituel, traversé d’épreuves et de crises, mais tout entier marqué par le désir de Dieu.Comme l’écrit Sophie dans son Journal à la date du 6 novembre 1941, « si Dieu ne veut pas m’aider, j’aurai la foi quand même ». C’est en 2005, à l’occasion de la sortie sur les écrans d’un film de Mark Rothemund (« Sophie Scholl – les derniers jours ») que j’ai découvert avec émotion ces jeunes gens. J’en ai été si impressionné que je me suis juré de ne pas rater une occasion de parler d’eux et de les faire davantage connaître. Ils le méritent amplement, j’en suis convaincu. «
«Hans et Sophie Scholl, Lettres et Carnets, Le Livre de Poche, 478 pages »
Luc Schweitzer, sscc
20150529 – Cinéma
L’OMBRE DES FEMMES
un film de Philippe Garrel.
Qui fait de l’ombre à l’autre? Qui se tient dans l’ombre et qui dans la lumière? Pour son énième variation sur le sentiment amoureux, sur les difficultés de vivre en couple, sur la fidélité et l’infidélité, Philippe Garrel, plus épuré et plus concis que jamais, touche juste. En à peine 1h10, il en dit autant sur ses personnages que beaucoup d’autres à qui il faut deux ou trois heures de cinéma pour ne rien dire ou presque! Ici l’on sait tout de suite qu’on a affaire à des gens qui vivent chichement, sans grands moyens, au point qu’ils sont menacés d’être expulsés de chez eux. Et l’on sait aussi, rapidement, que c’est l’homme, Pierre (Stanislas Merhar), qui est dans la lumière, bien davantage que sa femme Manon (Clotilde Courau), qui se contente de l’assister. Certes il n’y a rien de très prestigieux dans ce que fait Pierre (Il tourne des films documentaires), mais tout de même, c’est lui dont le travail est reconnu et c’est elle qui reste dans l’ombre. Et quand ils s’invitent chez un couple de personnes âgées en vue de leur prochain documentaire, c’est l’homme qui est interviewé, c’est lui qui raconte ses prétendus exploits de résistant lors de l’occupation, tandis que sa femme se contente de proposer ses délicieux gâteaux à l’anis! Est-ce à dire que les femmes sont condamnées à n’être que l’ombre de leur conjoint? Tout n’est pas si simple, bien entendu, et, quand il s’agit d’aimer, le coeur rempli d’ombres, le coeur défaillant et néanmoins pétri d’orgueil, c’est celui de Pierre. Car il ne s’embarrasse guère de scrupules quand l’occasion lui est donnée de faire d’Elisabeth (Lena Paugam), une stagiaire, sa maîtresse. Pour lui, pas question de quitter Manon, mais pas question non plus de ne pas multiplier les rencontres secrètes avec Elisabeth. Et si Manon, sentant qu’il la délaisse, ne se privait pas d’avoir un amant, elle aussi, qu’adviendrait-il? Qu’en sera-t-il de l’orgueil masculin? Et quelles répercussions dans le coeur de Pierre lorsque la souffrance de Manon s’exposera au grand jour? Avec cette trame somme toute très classique, il était tentant de ne faire qu’un film redondant. Mais l’habileté de Philippe Garrel, et ce qui donne à son film un ton original, c’est d’avoir conçu son histoire à la manière d’un récit d’espionnage. Tout le monde espionne tout le monde, à commencer par le propriétaire de l’appartement de Manon qui cherche de bonnes raisons de brandir ses menaces d’expulsion, jusqu’aux protagonistes principaux du film qui, volontairement ou non, sont témoins des vies secrètes d’autrui. Et si, le plus souvent, c’est Pierre qui n’a pas le beau rôle, il se peut aussi qu’il y ait des désirs obscurs et de sombres tentations dans un coeur féminin. Quand l’occasion est offerte de faire du tort à sa rivale, il n’est pas si facile de résister! C’est un film féministe qu’a réalisé Philippe Garrel, il me semble qu’on peut l’affirmer, mais ce n’est un film ni naïf ni simpliste. Simple dans son expression et dans sa réalisation très épurée, mais nullement simpliste!
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc
20150523 – Cinéma
LA LOI DU MARCHÉ
un film de Stéphane Brizé.
Impressionnant Vincent Lindon sur qui repose la quasi totalité de ce film implacable et qui trouve là un de ses plus grands rôles. Dans « La loi du marché », il y a deux temps. L’un durant lequel Thierry (le personnage joué par Vincent Lindon), chômeur de longue durée, s’efforce de trouver un emploi. L’autre où, ayant été embauché comme vigile dans un grand magasin, il se trouve confronté à des méthodes qui mettent sa conscience à rude épreuve. Stéphane Brizé, le réalisateur, ne s’embarrasse pas de fioritures: son film va droit à l’essentiel, il est brut, aussi brut que ce qu’il montre et dénonce. Il se concentre beaucoup, dans la première partie, sur la recherche d’emploi de Thierry, mais sans ignorer les à-côtés, la vie de famille, les quelques moments de détente qu’il parvient à s’accorder en compagnie de sa femme (une leçon de danse, par exemple). Mais ce n’est que pour faire mieux ressortir les humiliations subies par Thierry, tout au combat qu’il mène pour retrouver un emploi, garder son appartement, payer ses factures, avoir la tête haute (pour reprendre le titre du récent film d’Emmanuelle Bercot). Comment rester digne quand un potentiel employeur, sur Skype, critique vertement la rédaction de son C.V. ou, pire encore, quand il est rabaissé plus bas que terre par d’autres chômeurs lors d’une séance de discussion de groupe? Comment contrôler ses nerfs quand, essayant de vendre son mobile-home, il est forcé de marchander à n’en plus finir pour quelques centaines d’euros? Sans transition, Stéphane Brizé aborde la deuxième partie de son film, celle où Thierry a enfin trouvé un emploi de vigile en grand magasin. On se prend dès lors à respirer et à espérer, d’autant plus que tout commence avec le sourire: on fête le départ à la retraite d’une employée et le gérant y va de son gentil discours de remerciement! Mais il vaut vite déchanter: la loi du marché ne s’encombre pas de sentiments! C’est un sale boulot que celui de vigile car il faut non seulement surveiller les clients, repérer les voleurs et les arrêter, mais il faut aussi avoir l’oeil sur les employés eux-mêmes! Compression du personnel oblige, la moindre faute sera sanctionnée de la manière la plus sévère et le gentil gérant aura vite fait de se métamorphoser en despote sans pitié! Pris dans cet engrenage, que peut faire Thierry? Subir, accepter le pire, se taire, voire collaborer?…Et quand une employée licenciée pour un motif futile en vient à la pire des résolutions? Oui, c’est un film plein d’âpreté et de rudesse que nous propose là Stéphane Brizé. Mais n’est-ce pas aussi, malheureusement, le reflet trop fidèle de notre monde, d’un monde qui ne sait plus ce que miséricorde et générosité veulent dire?
8/10
Luc Schweitzer, sscc
TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE
un film d’Arnaud Desplechin.
«Que sais-tu de la longue attente Et ne vivre qu’à te nommer Dieu toujours même et différente Et de toi moi seul à blâmer Que sais-tu du malheur d’aimer »
«Le malheur d’aimer » : c’est ce poème de Louis Aragon, qu’avait si bien mis en musique et chanté Jean Ferrat, qui me trottait dans la tête tandis que je m’en revenais de la salle où venait d’être projeté ce film beau et émouvant d’Arnaud Desplechin. Un film en trois volets, comme l’indique le titre, mais de longueurs très inégales. C’est le troisième des souvenirs ici évoqués qui occupe la majeure partie du film et c’est tant mieux car le plus beau, le plus touchant, le plus passionnant de cette œuvre se trouve là.
En 1996, dans «Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) », Arnaud Desplechin racontait, de manière assez tortueuse, la vie et les amours d’un certain Paul Dedalus, incarné à l’écran par Mathieu Amalric. On y découvrait, en particulier, la crise qui mettait à mal le couple qu’il formait avec Esther (Emmanuelle Devos), son amour de jeunesse. C’est ce même Paul Dedalus que nous retrouvons ici, mais rajeuni, puisqu’après avoir passé huit années en Russie, un problème d’identité le conduit à se remémorer son enfance et son adolescence. Son enfance dans un premier volet qui évoque la mort tragique d’une mère mal-aimée. Sa prime adolescence dans un deuxième volet où l’on découvre précisément comment, à la faveur d’un voyage en Biélorussie, l’identité de Paul Dedalus a été usurpée par quelqu’un d’autre. Et enfin et surtout sa jeunesse, dans un troisième volet qui, couvrant à lui seul les trois quarts du film, raconte l’histoire d’amour naissante entre Paul et Esther.
C’est ce troisième volet qui emporte ce film vers des sommets, rappelant, il est vrai, certaines grandes œuvres de François Truffaut, mais sans nullement les imiter d’une manière scolaire. Incarnés par de jeunes acteurs très convaincants, Paul (Quentin Dolmaire) et Esther (Lou Roy-Lecollinet) apprennent la douceur, mais aussi la douleur, d’aimer. Le bonheur et le malheur, pour reprendre le mot d’Aragon. Paul voudrait conduire son amour pour Esther jusqu’à des sommets, jusqu’à une sorte d’absolu (on notera, d’ailleurs, que son frère Yvan, lui, se donne tout aussi passionnèment à Dieu dans la prière), mais c’est trop difficile et il n’y arrive pas. Ils ont beau s’aimer d’une manière exceptionnelle, ils sont également rattrapés par des contingences et par des obligations qui séparent. Paul est contraint de quitter Roubaix (où vit Esther) afin de poursuivre ses études d’anthropologie à Paris auprès d’une professeure d’origine béninoise. Ils échangent des lettres, se parlent au téléphone, mais cela suffit-il à préserver la force de leur amour ?
C’est avec infiniment de subtilité et de justesse de ton, c’est en dirigeant formidablement ses jeunes acteurs et en usant de pleins de belles idées de mise en scène qu’Arnaud Desplechin fait sentir en même temps la joie d’aimer et la sorte de détresse qui en découle. Ce que voudrait Paul n’a pas de place sur terre et, même si son idéal d’amour pouvait réellement être atteint, ni Esther ni lui-même ne sont assez vertueux pour y prétendre. Tout en faisant parfois semblant de l’ignorer, ils le savent bien d’ailleurs et c’est ce qui les plonge à la fois dans la stupeur et dans une forme de solitude. L’amour est doux et l’amour est souffrance. Et, d’une certaine façon, cela fait peur.
Lors d’une des premières scènes du film, lorsque Paul est un enfant, le curé auquel il a affaire le surprend en train de prier. Il s’en réjouit, mais sa joie risquerait de se changer en peine s’il savait que l’enfant, dans sa prière, a demandé à Dieu la grâce, si l’on peut dire, de ne plus croire en lui ! Paul n’était-il pas, en vérité, à la fois attiré et effrayé par l’absolu de l’amour de Dieu comme il le sera quand il rêvera d’atteindre des sommets d’amour avec Esther ? Sans jamais en faire trop, sans s’appesantir, Arnaud Desplechin, avec la complicité de ses acteurs, parvient à dévoiler, autant que faire se peut, la complexité du cœur qui aime, ses espérances, ses atermoiements, ses doutes et ses peines.
Ce film enivrant, triste et magnifique en même temps, assez simple dans son déroulement, se doit d’être salué, me semble-t-il, comme le sommet, à ce jour, de la carrière de Desplechin. Une merveille d’intelligence de la mise en scène et de finesse dans l’approche et la perception des personnages.
9/10
Luc Schweitzer, sscc
20150513 – Cinéma
LA TÊTE HAUTE
un film d’Emmanuelle Bercot.
Enfin du changement en ce qui concerne le film d’ouverture du festival de Cannes! Depuis des années, incompréhensiblement, on offrait en pâture aux festivaliers un film à grand spectacle et d’un intérêt quasi nul! Mais, cette année, avec « La tête haute », pas de doute, on a affaire à du cinéma de qualité. C’est, le plus souvent, la tête basse cependant et, parfois même, encombrée d’une casquette ou d’une capuche, qu’apparaît Malony (Rod Paradot, révélation de ce film). Quand il comparaît pour la première fois devant la juge des enfants (Catherine Deneuve, grandiose dans sa retenue), il a six ans! C’est le début d’un long parcours de délinquance et d’une succession de rendez-vous dans le bureau de la juge. Adolescent, il vole des voitures et, dès qu’il est contrarié, se livre à des violences compulsives que sa mère (Sara Forestier) est bien incapable de contrôler. Sa vie de délinquance semble toute tracée et comme inscrite dans ses gênes ou résultant, en tout cas, d’une absence de père (décédé) et de l’évidente fragilité psychologique de la mère. Comment ne pas baisser les bras? Qui peut espérer en un avenir meilleur pour ce garçon? Rien ne lui sera épargné, de fait, ni le placement en institution spécialisée, ni le centre éducatif fermé, ni même la prison ! Impossible pour la juge de le soustraire à toutes ces sanctions. Mais, si sanctions il y a, ce n’est jamais de manière gratuite : chaque fois que tombe un verdict se met en place aussi, autant que faire se peut, un dispositif d’aide et une recherche de solutions adaptées pour que l’adolescent puisse enfin, s’il est possible, échapper à la fatalité de la délinquance. Le meilleur de ce film nous fait voir ou entrevoir les relations compliquées qui se font et se défont entre Malony et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, tentent de le tirer de son enfermement dans la violence. Trois personnes ne baissent pas les bras, trois personnes entreprennent tout ce qu’elles peuvent pour « sauver » Malony. D’abord la juge qui, lors d’une superbe scène, lui tend littéralement la main, la juge à qui le garçon, reconnaissant, fera le cadeau d’un caillou ! Ensuite son éducateur (Benoît Magimel) dont on apprend, au fil du récit, qu’il n’est pas sans failles ni blessures, mais qui, cependant, trouve la force et de se relever et de ne jamais abandonner l’adolescent. Enfin la fille d’une de ses éducatrices avec qui Malony apprend non seulement à faire l’amour mais à se laisser aimer. Lui qui ne respire que violence découvre, stupéfait, la douceur d’aimer et d’être aimé ! Nonobstant toutes les nombreuses qualités de ce film, il faut aussi lui reconnaître deux points faibles. D’abord le jeu outrancier et caricatural de Sara Forestier : elle surjoue son rôle de mère incapable d’élever ses enfants et le rend peu convaincant. Ensuite la fin délibérément optimiste du film : on ne peut évidemment que souhaiter une issue heureuse à un garçon délinquant mais, à l’écran, cela paraît artificiel et peu crédible ! Reste néanmoins, malgré ces petits défauts, un film remarquable, pas loin d’atteindre le niveau des meilleurs films « sociaux », ceux d’un Ken Loach par exemple.
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150501 – Cinéma
Bonsoir à tous!
LE LABYRINTHE DU SILENCE
un film de Giulio Ricciarelli.
Hasard du calendrier: c’est au moment même où est jugé à Lunebourg, dans le nord de l’Allemagne, Oskar Gröning, l’ex-comptable du camp d’Auschwitz, (probablement le dernier procès d’un nazi), que sort sur nos écrans ce film. Premier long-métrage du réalisateur germano-italien Giulio Ricciarelli, « Le Labyrinthe du silence » retrace minutieusement l’enquête menée à la fin des années 50 par quelques acharnés afin de confondre des criminels de ce même camp d’Auschwitz et de les traduire en justice. C’est grâce à leur ténacité qu’ont pu être jugé 19 anciens SS lors du procès qui s’est tenu à Francfort entre 1963 et 1965.
Mais, avant d’en arriver au procès, il a fallu bien du courage et de la volonté à la poignée d’hommes qui s’était juré de briser la chape de silence qui s’était abattue sur l’Allemagne de ces années-là. A la fin des années 50, personne ne voulait plus s’encombrer du passé nazi. Konrad Adenauer lui-même estimait qu’il convenait de tourner la page. Et les jeunes générations ne connaissaient pas même le nom d’Auschwitz.
Si tout a changé et si le procès de Francfort a pu avoir lieu, c’est parce qu’un procureur du nom de Johann Radmann, qui s’ennuyait à ne traiter que de banales infractions de la route, s’est, par un concours de circonstances, pris de passion pour cette cause. Soutenu par sa hiérarchie et par quelques collègues, il s’est battu contre tous les obstacles, toutes les inerties et toutes les menaces, afin de mener à bien un devoir de justice qui s’est révélé, au fil de l’enquête, être aussi et surtout un devoir de mémoire.
Car il ne suffisait pas de retrouver les noms des criminels du camp d’Auschwitz, mais il fallait aussi retrouver des témoins, des rescapés, et les convaincre de s’exprimer. Ce n’était pas chose facile, il s’en fallait de beaucoup. Le film s’attarde assez longuement sur l’un d’eux, un homme ayant perdu sa femme et ses deux filles, des jumelles, emportées dans l’horreur par le sinistre tortionnaire Josef Mengele. « Dieu était absent à Auschwitz », dit-il à Johann Radmann, avant de le supplier de se rendre sur place et de dire en son nom le Kaddish qu’il n’avait pas pu prononcer jusque là pour ses filles, lui-même étant malade et ne pouvant plus entreprendre le voyage.
C’est un film passionnant, captivant et émouvant qu’a réalisé Giulio Ricciarelli. Un film dossier qui échappe à peu près complètement à la pesanteur qui encombre parfois ce genre-là. Ici, on ne s’ennuie pas une seconde et on se dit que les quelques acharnés qui ont osé réveiller une Allemagne amnésique en la confrontant à son passé récent méritaient bien cet hommage.
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150427 – Cinéma
 LE DOS ROUGE un film de Antoine Barraud.
LE DOS ROUGE un film de Antoine Barraud.
Les premières scènes de ce film laissent présager le pire: on se demande, inquiet, si l’on va assister, pendant les deux heures et quelques qu’il dure, à des discussions interminables et très « intellos » sur l’Art (avec un grand A)! Mais tout s’arrange très vite et, pour peu qu’on s’abandonne au récit et qu’on se laisse griser par les personnages, on ne peut qu’être séduit.
Difficile d’en donner une idée précise. Disons que le personnage joué par Bertrand Bonello part à la recherche de la figure du monstre dans la peinture. Il lui faut trouver une oeuvre qui sera le pivot du film qu’il projette de tourner. Pour ce faire, il trouve en une jeune femme (Célia Bhy) le guide dont il a besoin. Le plus souvent accompagné ou, à défaut, inspiré par elle, il va de musée en musée et d’oeuvre en oeuvre. Des peintures, mais aussi des sculptures, retiennent son attention: oeuvres de Francis Bacon, Le Caravage, Gustave Moreau, Balthus, statue d’hermaphrodite, etc. On passe du charme du musée Gustave Moreau à l’excentricité du Centre Beaubourg. On se passionne, on s’interroge, on scrute… Qu’est-ce que la monstruosité?
Mais en rester là risquerait de laisser croire que ce film n’est en somme guère plus qu’un habile documentaire sur la peinture. Le réalisateur, Antoine Barraud, a construit un film savant peut-être, très bien écrit sans aucun doute, mais surtout regorgeant de surprises et d’inventivité. Si ce film séduit, c’est parce qu’il multiplie les échappées poétiques, les petites touches inattendues, les étrangetés… Impossible d’énumérer toutes les bonnes idées qui l’égrènent: cela va d’un même personnage qui est joué par deux actrices différentes à un fantôme surgissant de la nuit pour murmurer des paroles à l’oreille d’un homme endormi, en passant par une jeune femme qui se met parler en chantant, sans oublier, bien sûr, le dos rouge qui donne son titre au film. Que signifie donc cette tache rouge apparue dans le dos de Bertrand Bonello et qui s’agrandit au fil du temps? N’est-elle pas le signe que la monstruosité n’est pas seulement une pensée d’artiste, mais une des réalités présentes dans le coeur de l’homme?
Habité par une multitude de correspondances, à la manière baudelairienne, qui font s’adjoindre et se parler le charnel et le spirituel, voilà un film inépuisable, si imprégné de poésie qu’on pourra le voir et le revoir de nombreuses fois en étant sûr d’y trouver toujours du nouveau!
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150413 – Cinéma
LOST RIVER
un film de Ryan Gosling.
« Quel cauchemar! Mais quel cauchemar ». C’est ce que ne cessait de répéter une spectatrice d’un certain âge me précédant au sortir de la salle où venait d’être projeté ce film. Je le reconnais moi-même volontiers: oui, il est préférable de s’abstenir d’aller le voir si l’on est, comme on dit, une âme sensible.
Pour les autres, s’il est vrai que cette première réalisation de Ryan Gosling (qu’on a connu, jusqu’ici, comme acteur) peut être perçue, en effet, comme un long cauchemar, elle peut aussi exercer un réel pouvoir de fascination. Bien sûr, il ne manquera pas de cinéphiles pour reprocher au réalisateur d’être trop resté sous l’influence de ses pairs et, en particulier, de ceux pour qui il a lui-même fait l’acteur. Cependant, mon sentiment, c’est que, si influence il y a, elle ne supprime nullement l’originalité d’un regard qui demeure singulier.
Ryan Gosling a su habilement tirer parti et des décors et des acteurs qu’il a choisis pour son premier film. Les décors, ce sont ceux d’une ville quasiment abandonnée, des maisons en ruine ou prêtes à s’effondrer ou en cours de démolition. Et non loin de là, une rivière transformée en lac depuis qu’on y a construit un barrage. Et, sous les eaux du lac, un parc d’attraction et des demeures englouties. Tous ces décors sont formidablement filmés et habités par les personnages. Billy, une mère célibataire de deux enfants, qui persiste à vouloir habiter dans ce lieu et qui, pour ce faire, devra consentir à accepter une offre de travail dont elle préférerait se passer, d’autant plus qu’elle émane d’un personnage plutôt louche prénommé Dave. Elle devra pourtant s’exhiber dans une ahurissante maison dédiée au plaisir des mâles! Bones, le fils aîné de Billy, l’ami de coeur d’une fille surnommée Rat, Bones qui essaie de se rendre utile en hantant les ruines de la cité désertée pour y récupérer des matériaux qu’il essaie de vendre. Mais Bones qui se heurte à un petit despote qui a juré d’être le seul maître des ruines, un despote qui parade dans une décapotable sur laquelle il a fixé un fauteuil. Et d’autres personnages encore, dont certains, malheureusement, trop peu exploités (le chauffeur de taxi joué par Reda Kateb, par exemple).
Certains critiques ne manqueront pas de souligner les défauts de ce film. Il y en a, je l’ai dit. Mais il y a aussi et surtout un grand talent qui se révèle: Ryan Gosling a construit son long-métrage en associant avec plein d’inventivité l’univers du film noir à celui du fantastique, voire même à celui du gothique (car il est aussi question d’une malédiction et du moyen de s’en défaire). Il a composé, c’est vrai, un univers de cauchemar… Mais que ce cauchemar est fascinant à voir!
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150410 – Cinéma
HISTOIRE DE JUDAS
un film de Rabah Ameur-Zaïmeche.
Les Evangiles n’étant nullement des récits historiques au sens où nous l’entendons aujourd’hui, il n’y a pas à s’étonner ni à se scandaliser lorsque quelqu’un s’en empare ou s’empare de leurs personnages pour en proposer une interprétation singulière. Après s’être réapproprié, dans son film précédent, le personnage de Mandrin, Rabah Ameur-Zaïmeche redéfinit ou redécrit le personnage de Judas. Cette démarche me paraît on ne peut plus admissible, mais dans la mesure où le regard renouvelé du réalisateur s’imprègne d’intelligence et de subtilité. Il ne suffit pas de vouloir se défaire de la figure du traître à laquelle on associe le nom de Judas, mais encore faut-il la réinventer en quelque chose ou en quelqu’un de crédible ! Or, dans ce film, tout est trompeur, souvent absurde, parfois très ambigu. La tromperie commence dès le titre : « Histoire de Judas ». C’est faux ! Le film ne raconte nullement l’histoire de Judas, il se contente de faire se succéder quelques-unes des scènes des Evangiles en les transformant, en en transformant le sens et en faisant apparaître le personnage de Judas pour tâcher de nous expliquer qu’au lieu d’être un traître c’était un des plus fidèles amis de Jésus. Cela commence dès la scène d’ouverture où l’on voit Judas gravir une colline, aller à la rencontre de Jésus qui vient de passer 40 jours au désert et en redescendre en le portant sur son dos comme un saint Christophe !
Passe encore pour cette scène qui ne manque ni d’imagination ni de beauté, mais la suite du film, hormis les scènes de la femme adultère et du lavement des pieds qui sont assez réussies, n’est qu’un tissu d’invraisemblances et d’absurdité. Qu’on en juge ! Quand Jésus chasse les marchands du temple, non seulement Judas lui donne un coup de main mais il se fait le défenseur des animaux en cages comme s’il était un militant de la cause des animaux. Barrabas, curieusement transformé en Carrabas (!), n’est plus le dangereux brigand des Evangiles, mais un doux illuminé qui ne menace la sécurité de personne. Les soldats romains ressemblent davantage à des soldats d’opérette en villégiature qu’à de redoutables et féroces conquérants. Ce ne sont plus, comme dans les Evangiles, les docteurs de la loi qui réclament la mort de Jésus, mais Pilate en personne ! C’est lui qui se sent menacé par Jésus et qui intrigue pour le perdre, ce qui me paraît totalement invraisemblable au regard de l’Histoire ! De plus, quand Jésus est arrêté, avant de le faire comparaître, Pilate va à la rencontre de Jésus pour se justifier devant lui : imagine-t-on un gouverneur romain agissant ainsi, s’abaissant de cette manière ? Enfin, quand il le fait comparaître, voilà qu’ils se mettent à discuter comme de vieux amis, Jésus lui parlant de ses maux de tête et lui recommandant de faire des promenades !!! On a de la peine à y croire, tellement ces dialogues sont à la fois cocasses et inattendus !
J’arrête là pour ce qui concerne les nombreuses absurdités de ce film et j’en viens à ce qui trouble, à ce qui dérange, à ce qui est terriblement ambigu. Au moment de la Cène, Jésus dit à Judas, exactement comme cela est raconté dans l’Evangile de saint Jean : « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Mais il n’est plus question de trahison, au contraire. Jésus envoie Judas, son ami Judas, pour qu’il exécute en son nom une mission secrète. Et cette mission, c’est de poursuivre un scribe qui a pris note des faits, des gestes, des paroles de Jésus, afin de détruire tous ses écrits. Pas de traces écrites, c’est dangereux ! Mais pourquoi les écrits sont-ils jugés dangereux ? En quoi représentent-ils une menace ? Qui sont ceux qui veulent éliminer les écrits ? Qui sont les hommes que les livres dérangent et qui, dès qu’ils ont assez de pouvoir, organisent des autodafés et censurent les écrivains, sinon les dictateurs ? Rabah Ameur-Zaïmeche n’a sûrement pas voulu faire de Jésus un potentiel dictateur (d’autant plus que l’acteur qui l’interprète manque beaucoup de charisme!), mais l’ambiguïté demeure et, à mon avis, elle entache ce film.
Nul doute que le réalisateur était habité par les meilleures intentions du monde lorsqu’il a conçu et imaginé ce film. Mais (peut-être à son corps défendant) le résultat m’a semblé calamiteux : je l’ai suffisamment prouvé par tous les exemples que j’ai donnés ! Et je me demande bien ce qui est passé par la tête du jury du prix oecuménique pour avoir accordé ses lauriers à ce film au festival de Berlin… C’est consternant !
3/10
Luc Schweitzer, sscc
20150406 – Cinéma
LA MAISON AU TOIT ROUGE
un film de Yôji Yamada.
Quand, après la mort de la vieille tante Taki, l’on retrouve parmi ses affaires des cahiers dans lesquels elle avait rédigé son autobiographie, il en est qui ne sont pas surpris. Son petit-neveu et, dans une moindre mesure, sa petite-nièce avaient été mis dans la confidence depuis longtemps. C’est d’ailleurs à la demande du premier que Taki avait entrepris de faire le récit de sa vie.
Une vie banale, pourrait-on dire, mais à une époque qui ne l’était nullement. Nous voilà donc transportés dans les années 1930 et dans un Japon belliciste qui, très vite, va basculer dans la guerre, d’abord avec sa voisine la Chine puis avec les Etats-Unis. Pour Taki cependant, la priorité reste de trouver un emploi de domestique. En ces années-là, explique-t-elle, les filles de la campagne n’avaient guère d’autre solution: les plus jolies pouvaient certes être recrutées comme geishas mais, pour les autres, il n’y avait d’issue que dans la domesticité en attendant un éventuel mariage. Taki a de la chance: après un passage éclair chez un écrivain, elle entre au service d’une famille bourgeoise de Tokyo composée de trois membres: M. Hirai, sa femme Tokiko et leur fils âgé de 6 ans. Taki prend place dans la maison au toit rouge, celle qui donne son titre au film, elle s’attache très vite à l’enfant et se plaît bien avec ses maîtres. Avec Tokiko s’établit même au fil du temps une relation affectueuse et complice. Malgré les bruits de guerre, tout semble paisible et tranquille. Mais la survenue d’Ikatura,un jeune collègue de travail de M. Hirai va perturber ce bel ordonnancement. Le jeune homme devient vite un familier de la maison, si familier et si présent que Tokiko en vient à s’éprendre de lui. Taki, si proche de sa maîtresse, ne peut pas ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Elle observe, elle est le témoin malgré elle de cette passion interdite. Mais il faudra compter avec la guerre et avec un Japon qui envoie, l’un après l’autre, ses ressortissants au combat. Dans un temps où, comme l’explique Taki, l’individu est dépouillé de son libre-arbitre, même un jeune homme aussi peu apte à se battre qu’Ikatura risque d’être enrôlé. Quant à Taki, ne sera-t-elle pas dans l’obligation d’être davantage qu’un simple témoin et de devoir prendre de difficiles décisions? Réalisé par Yôji Yamada, un cinéaste peu connu chez nous mais très apprécié dans son pays, ce superbe mélodrame prend l’apparence d’un hommage au cinéma de jadis. Quel bel hommage cependant! Certes on retrouve ici beaucoup de codes du mélodrame à la japonaise, mais tout est si bien filmé et mis en scène que c’est comme si on les redécouvrait. Et puis, sous ses apparences de film sage, cette oeuvre laisse paraître aussi, avec subtilité, son esprit critique: elle se perçoit comme une dénonciation de l’aveuglement des politiques menant leur pays au désastre mais aussi du sort réservé aux femmes dans le Japon d’autrefois. Une oeuvre apparemment plus humble et moins subversive que « Le Journal d’une femme de chambre » de Benoît Jacquot qui sort au même moment sur nos écrans, mais une oeuvre bien mieux réalisée et bien plus captivante!
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150330 – Cinéma
LA SAPIENZA
un film de Eugène Green.
Quelques plans d’architecture baroque italienne accompagnés du « Magnificat » de Monteverdi et nous voilà d’ores et déjà invités, dès l’ouverture de ce film, à nous mettre en quête de beauté et de lumière. Le temps, cependant, de faire un crochet par la France et d’y découvrir un architecte prénommé Alexandre à qui on fait les honneurs d’un prix. « On m’a demandé, à plusieurs reprises, de construire des églises, explique-t-il dans son discours de remerciement, mais je m’y suis toujours refusé! Car je suis matérialiste et je préfère construire des usines, qui sont les cathédrales d’aujourd’hui! » Déçu, peu de temps après, parce qu’un de ses projets est remis en cause, il décide de partir en Italie, sur les traces de Borromini, un architecte du XVIIe siècle, rival du Bernin, et concepteur de nombreuses églises!
Accompagné de sa femme Aliénor, une psychanalyste, ils ne tardent pas à faire la rencontre, sur la rive du lac Majeur, de deux jeunes gens: Lavinia, une jeune fille maladive, et son frère Goffredo, lui-même passionné d’architecture. Le couple s’attache aussitôt à ces jeunes gens. Goffredo montre à Aliénor un de ses projets: contrairement à Alexandre qui n’a jamais conçu les plans d’une église, le jeune homme a imaginé une cité rayonnant autour d’un temple. « Mais de quelle religion sera ce temple? », demande Aliénor. « De toutes!, répond Goffredo. Toutes les religions s’y retrouveront pour prier ensemble! » Belle utopie de la jeunesse! Précisément, la suite du film se métamorphose subtilement en voyage initiatique ou, plus exactement, en deux voyages initiatiques qui se rejoignent. Alexandre emmène Goffredo à la découverte des trésors architecturaux de Rome, ceux de Borromini, concepteur d’un « baroque mystique », et ceux du Bernin, concepteur d’un « baroque rationnel », tandis qu’Aliénor reste, sur les rives du lac Majeur, aux côtés de la délicate et maladive Lavinia. Mais, pour l’un comme pour l’autre, il s’agit bien de voyager, de se mettre en mouvement. Car l’un comme l’autre, au contact des deux jeunes gens, sont, petit à petit, changés intérieurement. Ils vont vers la « sapience », accueillant l’un et l’autre, l’amour et la lumière: Alexandre en faisant découvrir à Goffredo les sublimes églises conçues par Borromini, un architecte qui voulait que la lumière se diffuse du sommet jusque dans tout l’édifice; Aliénor en se mettant à l’écoute et au service de Lavinia, une jeune fille qui, quoique souffrante, rayonne de lumière et de beauté. Car l’une des grandes originalités de ce film, c’est que ce ne sont pas les personnes d’âge mûr qui initient les jeunes, mais plutôt le contraire! Ce sont les plus âgés qui, au contact des plus jeunes, retrouvent le trésor perdu de la « sapience ». Eugène Green, qui nous a déjà donné de nombreux films et dont on reconnaît tout de suite le style, très particulier, inimitable (et qui, peut-être, malheureusement, ennuiera certains spectateurs), signe là, probablement son meilleur film à ce jour. Un film sublime, confondant d’intelligence et de beauté, et qu’il me tarde déjà de revoir!
9/10
Luc Schweitzer, sscc
20150321 – Cinéma
GENTE DE BIEN
un film de Franco Lolli.
La mère d’Eric, un enfant de 10 ans, étant dans la nécessité de le lui confier pour une durée indéterminée, Gabriel se retrouve du jour au lendemain ayant la charge de ce fils qu’il connaît à peine, dont il ne s’est jamais occupé jusque là. Le père et le fils se découvrent mutuellement, mais, pour ce dernier, les désillusions ne tardent pas à paraître. Gabriel vit si chichement de son métier de charpentier qu’il se contente d’habiter dans un gourbi. Peut-être Eric pourrait-il néanmoins s’habituer à cette vie plus que modeste si son père n’avait pas l’idée de l’emmener avec lui sur son lieu de travail. Le choc est d’autant plus grand que Gabriel travaille dans une riche demeure dont la maîtresse de maison se prénomme Maria Isabel. Entre Eric et le fils de cette dernière se noue une complicité qui ne tarde pas à se muer en hostilité. Quand on lui demande des explications, tout ce qu’Eric trouve à dire, c’est que l’autre garçon « se la pète »!
La vérité, c’est qu’Eric crève de jalousie et qu’il voudrait, lui aussi, pouvoir « se la péter »! Dans son coeur, naît et grandit quelque chose qui ressemble à de la honte, la honte de son père, la honte de sa condition sociale. Gabriel a beau lui promettre qu’ils déménageront bientôt pour habiter tous deux dans un plus bel appartement, cela ne change rien. Eric ne rêve que d’être un enfant de riche au lieu d’avoir ce père qui lui semble sans envergure! Aussi, quand Maria Isabel propose à Gabriel et à son fils de les emmener passer les fêtes de Noël dans une riche et confortable demeure de sa famille, Eric se réjouit. Mais les bons sentiments et les bonnes intentions ne sauraient suffire. Même si la famille de Maria Isabel se rassemble volontiers pour réciter le rosaire, est-ce si simple d’accueillir chez soi un enfant de pauvre? Les débuts sont toujours prometteurs, mais les soupçons et les méfiances ont tôt fait de réapparaître… Eric pourra-t-il longtemps « se la péter » chez les gens aisés? Et père et fils finiront-ils enfin par se retrouver ou, plus simplement, par se trouver l’un l’autre?
C’est un film magnifiquement réalisé et interprété que nous propose le colombien Franco Lolli. Car l’histoire qu’il nous conte ici se déroule en Colombie, du côté de Bogota. C’est un des mérites de « Gente de bien » que de nous faire voir un autre visage de ce pays que celui qui vient spontanément à l’esprit. Pas de drogue ni de violence ici! Ou plutôt, s’il y a violence, ce n’est pas celle à laquelle on pourrait s’attendre. C’est une autre forme de violence, une violence feutrée, une violence qui a le goût du mépris, de l’envie et de la honte. Pour Eric comme pour son père Gabriel, il faut passer par bien des désarrois et des humiliations pour entrevoir le coeur de l’autre. Et si le chemin de l’un à l’autre s’ouvrait non pas à cause d’un être humain mais d’un animal? Un chien, par exemple…?
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150315 – Cinéma
CROSSWIND
un film de Martti Helde.
Au moment même où Hitler et ses sbires fomentaient leurs horreurs, un autre monstre sévissait et rivalisait en atrocités, un monstre du nom de Joseph Staline. Sur son ordre, dès le mois de juin 1941, plus de 40 000 habitants des pays baltes furent arrachés à leur terre et envoyés en Sibérie dans des wagons à bestiaux. Beaucoup moururent en chemin. Les autres se figèrent dans les terres glacées de Sibérie, victimes du froid, de la faim et des exactions de leurs bourreaux. Très peu en réchappèrent.
Le réalisateur de ce film, l’estonien Martti Helde, met en scène cette page de l’histoire, page méconnue mais dont les répercussions se font encore sentir dans notre actualité. Songeons à ce qui a lieu en Ukraine et qui pourrait aussi se propager aux pays baltes…Pour la réalisation de son film, le cinéaste s’est inspiré des lettres écrites par Erna, une des nombreuses jeunes femmes et mères de famille envoyées de force en Sibérie. Séparée de son mari Heldur, dont elle reste sans nouvelles, elle écrit durant 15 ans des lettres qu’elle ne peut envoyer au destinataire puisqu’elle ignore où il se trouve.
Ces lettres bouleversantes racontent la vie, ou plutôt l’absence de vie, que mènent les déportés dans un coin perdu de l’immense Sibérie. Le travail, la faim, les répressions, les menaces, et le temps qui semble ne plus s’écouler. Tout est comme figé, arrêté, suspendu dans la non-vie.
Pour mettre en scène ce que décrivent ces lettres, Martti Helde a fait le pari de l’audace formelle. Puisque le temps semble s’être figé, il a choisi de ne filmer que des tableaux vivants, des êtres immobiles, des scènes arrêtées. Pari téméraire puisque le cinéma est par définition l’art du mouvement, mais pari gagné. En fait, le mouvement est présent, mais c’est celui de la caméra. C’est elle qui se déplace, qui tourne, scrute, dévisage, revient sur un espace déjà montré mais qui, entretemps, s’est transformé. Le résultat est étonnant, inédit, fascinant. La crainte qu’on pourrait avoir, c’est qu’à force de figer les corps on fige aussi l’émotion. Mais non, l’émotion est intacte. La voix off qui fait entendre les lettres d’Erna nous touche au plus profond et tous ces êtres dont on perçoit la souffrance nous bouleversent.
Enfin un grand film, un film audacieux et nécessaire, en cette année 2015 jusqu’ici assez terne sur le plan cinématographique!
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc
20150223 – Cinéma
RÉALITÉ
un film de Quentin Dupieux.
J’hésitais à aller voir ce film, mais le moins que je puisse dire c’est que j’ai bien fait de m’y résoudre! C’est un bonheur de cinéphile que ce film-là, quelque chose qui ressemble à du David Lynch revu et corrigé par Buster Keaton ou Jacques Tati. Un film labyrinthique à souhait et, assez souvent, très amusant.
Impossible de raconter ce qui s’y passe sans trop en dire. On y trouve pêle-mêle une petite fille qui porte le prénom de Réalité, un cameraman (Alain Chabat) qui cherche à réaliser un film d’horreur, un producteur qui veut bien financer le film à condition qu’on y entende le meilleur gémissement de l’histoire du cinéma, un animateur de télévision qui souffre d’eczéma sans en avoir aucun signe, un directeur d’école qui se travestit en femme, une cassette vidéo retrouvée dans les entrailles d’un porc, etc.
Tout le film est construit d’une manière ludique et savante à la fois. On ne sait jamais où l’on est: dans un rêve qui vire au cauchemar ou dans la réalité? N’est-ce pas justement la petite fille qui porte ce curieux prénom de Réalité qui est la clé de tout le film? Une petite fille qui, engagée pour jouer un rôle dans un film, doit vraiment s’endormir pour satisfaire aux exigences du réalisateur. Nous sommes, tout du long, dans ce que les anglais désignent si bien du terme de « nonsense ». Un monde absurde, cauchemardesque et réjouissant à la fois, magnifiquement bien mis en scène et réalisé par Quentin Dupieux. Le cinéma français, contrairement au cinéma anglais précisément, ne nous a guère donné de bons films dans ce genre-là. Eh bien, voici une exception, et de taille! Foin de notre légendaire cartésianisme, place à la folie, au rêve et à l’inattendu!
8/10
Luc Schweitzer, sscc
20150213 – Cinéma
LES MERVEILLES
un film d’Alice Rohrwacher.
Voici enfin sur nos écrans ce film âpre et magnifique qui a décroché à juste titre le Grand Prix au dernier festival de Cannes. La réalisatrice nous fait voir une famille qui doit ressembler peu ou prou à la sienne, une famille installée en Ombrie, vivant un peu en marge et s’activant à la récolte de miel. Une famille d’apiculteurs donc, dont le père est un allemand colérique qui tâche de mener à la baguette ses quatre filles, au grand dam de la mère. Il est vrai que le travail est rude et que les soucis et les tracas ne manquent pas. Une famille plus ou moins excentrique cependant et quelque peu hors norme où l’on use tour à tour de trois langues: l’italien bien sûr, mais aussi l’allemand et même le français!
Bien qu’il soit nécessaire de beaucoup travailler et bien qu’il faille le concours de tous pour mener à bien tous les travaux, la famille s’accorde aussi, de temps à autre, des petits moments de détente. La mer est proche et l’on en profite en s’y baignant allégrement. Et c’est au cours d’une escapade que ce petit monde découvre, médusé, le tournage dans la région d’un concours télévisé ayant pour titre « Le pays des merveilles ». Fascinée, la plus grande des filles, Gelsomina, ne rêve plus dès lors que de faire participer sa famille à ce concours. Ce qui déclenche, au moins dans un premier temps, la colère du père.
Gelsomina parviendra-t-elle à ses fins, malgré le refus obstiné du père? Et le pays des merveilles tant vanté se trouve-t-il vraiment derrière les caméras de télévision? Par petites touches très subtiles, la réalisatrice fait percevoir d’autres merveilles, plus discrètes, plus humbles, mais sans aucun doute plus réelles: une fillette qui boit avec ses mains un rayon de lumière, un garçon d’origine allemande accueilli par la famille dans le cadre d’un programme de réinsertion et qui siffle comme personne, et Gelsomina elle-même qui se montre capable d’apprivoiser en quelque sorte les abeilles… Et Wolfgang, le père intransigeant de cette famille, ne cache-t-il pas sous ses apparences un coeur capable de merveilles, capable quoi qu’il en soit de faire le cadeau le plus farfelu à ses enfants?
Ce film, qui ressemble lors de certaines scènes à un véritable documentaire sur l’apiculture, nous fait aussi aimer ses personnages. Gelsomina en premier lieu, mais aussi chacun des autres membres de la tribu! Et quand s’achève le film, c’est avec regret qu’on les quitte: on aurait bien aimé rester un peu plus longtemps avec eux!
8,5/10
Luc Schweitzer, sscc
20150213 – Littérature
L’HOMME DE KIEV
un roman de Bernard Malamud.
Comptant parmi les écrivains juifs new-yorkais, Bernard Malamud (1914-1986) reste sans doute bien moins connu que ses condisciples Philip Roth ou Saul Bellow. Il mérite pourtant grandement d’être découvert ou redécouvert et apprécié à sa juste valeur si j’en juge par ce roman.
Dans sa préface, Jonathan Safran Foer en parle comme d’un chef d’oeuvre et, l’ayant à présent lu, je ne peux que que souscrire à cette élogieuse désignation. Comme la plupart des chefs d’oeuvre d’ailleurs, ce roman se compose d’une structure des plus simples et des plus directes. Nous ne sommes pas à New-York mais, comme l’indique le titre, à Kiev en 1911, dans les dernières années du règne de Nicolas II. L’histoire est facile à résumer, comme je viens de le dire: il y est question de Yakov Bok, un juif exerçant le métier de réparateur et qui, ayant quitté son shetl et s’étant séparé de sa femme, cherche à s’établir à Kiev. En essayant de se faire passer pour un russe, il réussit à trouver un travail. Mais le pire des malheurs ne tarde pas à tomber sur lui. Un enfant ayant été retrouvé assassiné et saigné à blanc dans les environs, on cherche à tout prix à retrouver le coupable. Or le coupable tout désigné, le bouc émissaire dont on a besoin, dans la Russie tsariste et fortement antisémite de l’époque, ce ne peut être qu’un Juif.
Reconnu comme tel, malgré ses tentatives de dissimulation, le sort tombe sur Yakov Bok. Ce dernier a beau clamer son innocence, il est le coupable tout désigné. Il ne porte cependant aucun des signes d’appartenance à sa communauté, il se désigne lui-même comme libre-penseur et se réfère davantage à la pensée de Spinoza qu’au Pentateuque, rien n’y fait. Il est celui dont on a besoin pour prouver la perversité des Juifs et détourner l’attention du peuple de ses misères réelles.
Sacrifié, immolé, Yakov Bok est non seulement emprisonné mais il subit, pendant les mois et les années de son incarcération, les pires brimades et les plus avilissantes humiliations. Rien ne lui est épargné. Le roman de Bernard Malamud raconte tout en détails et fait surgir chez le lecteur des sentiments d’horreur et de révolte. Bien que libre-penseur, le détenu trouve le moyen de lire, pendant un temps, un Nouveau Testament qu’un gardien lui a remis en cachette. Découvrant alors le message des Evangiles et l’exemple du Christ, Yakov Bok se demande à juste titre comment des hommes, les Russes orthodoxes, se réclamant de ce même Christ peuvent se changer si facilement en bourreaux d’un innocent.
Car personne n’ignore que le détenu n’est en rien coupable de ce dont on l’accuse. Mais rares sont ceux qui osent prendre sa défense dans une Russie malade de son antisétimisme.
A plusieurs reprises, on tente de faire avouer ses soi-disant méfaits à Yakov Bok, on s’évertue à lui faire signer une déclaration de culpabilité en lui promettant la liberté. Mais, malgré les souffrances terribles qu’il endure, en homme droit et digne qu’il veut rester, le prisonnier refuse. Il s’acharne à tenir tête à l’Etat russe tout entier, comme l’exprime ce passage qui résume parfaitement les enjeux du roman: « Quelle chose étrange et extraordinaire pour un homme comme lui (…) d’avoir pour ennemi juré l’Etat russe tout entier à travers le tsar et ses officiels, et cela pour la seule raison qu’étant né juif il est son ennemi désigné, bien qu’en vérité il ne soit dans son coeur l’ennemi de personne, sinon de lui-même. » (page 351). Un grand roman, oui, un chef d’oeuvre sans nul doute, un livre qui doit ou devrait conduire chaque lecteur à la révolte contre les injustices et au dégoût à jamais de l’antisémitisme.
Luc Schweitzer, sscc.
20150206 – Cinéma
FÉLIX ET MEIRA
un film de Maxime Giroux.
Leurs mondes sont aux antipodes l’un de l’autre et rien ne devrait autoriser leur rencontre. Félix est un québecois qui revient à Montréal pour accompagner les derniers instants de son père à l’agonie. Mais, très vite, il apparaît comme un être plutôt frivole et ne songeant qu’à profiter de l’existence sans s’encombrer de soucis. Après le décès de son père, rien ne lui importe davantage que de dépenser son compter sa part d’héritage. « J’aime vivre dans le luxe », avoue-t-il à sa soeur.
Le monde de Meira, c’est tout l’opposé. C’est une jeune femme juive hassidique, mariée et mère d’une fille. Son mari est un juif pieux, rigoriste, portant tous les signes de l’orthodoxie juive la plus intransigeante. A la maison, pas question de transiger avec les préceptes du judaïsme.
Mais il ne faut pas se fier aux apparences: chez Meira comme chez Félix, il existe des fêlures que le réalisateur de ce film se plaît à révéler. Meira en vérité s’ennuie au point qu’en cachette de son mari elle écoute de la musique interdite; elle renâcle quand il s’agit d’observer les préceptes de sa communauté, elle prend la pilule pour ne pas avoir une ribambelle d’enfants comme les autres femmes de son groupe, etc. Félix, lui, malgré ses airs de ne se soucier de rien, révèle très vite ses questions profondes. Et c’est d’ailleurs à cause de ses inquiétudes mal dissimulées que commence de se nouer un lien entre lui et Meira. Quand il l’aborde la première fois, il le fait parce qu’elle porte les signes d’une femme croyante et que, peut-être, elle sera en mesure de répondre aux questions qui le taraudent depuis la mort de son père.
Et l’improbable se réalise sous nos yeux de spectateurs ébahis: entre Félix et Meira, au fil de rencontres clandestines, naît et grandit un amour interdit. Félix le frivole, lui qui ne voulait que profiter égoïstement des plaisirs de la vie, se trouve contraint de prendre des responsabilités dont il ne voulait pas. Et Meira, qui ne connaissait que les devoirs corsetés d’une épouse et d’une mère sans joie, découvre une autre façon d’aimer. Une superbe scène nous la fait voir, un soir, assistant, interloquée, aux ébats de deux amants qui ont oublié de fermer leurs rideaux, tandis que se fait entendre une chanson de Léonard Cohen.
C’est un film délicat, beau, émouvant, qu’a réalisé le québecois Maxime Giroux. Il était facile et tentant, avec un tel sujet, de s’autoriser des excès et des caricatures. Ce n’est jamais le cas. Toutes les scènes sonnent juste et tous les personnages sont observés avec douceur et respect. Même le mari juif de Meira, bien qu’il soit le prisonnier de ses préceptes rigides, attire la sympathie: il fait preuve, lors d’une des dernières scènes du film, d’une grandeur d’âme peu commune. « En filmant, explique le cinéaste, (…) je voulais que la caméra aille chercher l’humanité des personnages ». Cette quête a été pleinement réalisée.
7,5/10
Luc Schweitzer, sscc
20150125 – Littérature
SOUMISSION
un roman de Michel Houellebecq.
Le titre même de ce roman aurait dû me mettre la puce à l’oreille! « Soumission »: voilà bien un mot qui, parmi tous les mots de la langue française, devrait susciter en chacun la plus grande méfiance. Cela dit, n’ayant encore jamais lu un seul livre ni peut-être même une seule ligne de Michel Houellebecq jusqu’alors, j’ai entrepris de lire cet ouvrage en m’efforçant de ne tenir aucun compte de tout ce que j’avais pu entendre au sujet de l’auteur et, donc, sans le moindre à priori.
J’ai lu et, je dois le dire, j’ai commencé par être séduit. Le narrateur de ce roman étant un professeur de lettres et, qui plus est, un spécialiste de Huysmans, avait tout pour me plaire. L’évocation non seulement de l’auteur d' »A rebours », mais de son « ennemi » Léon Bloy et de bien d’autres écrivains de la fin du XIXe siècle, cela me convenait parfaitement. Ayant moi-même beaucoup fréquenté ces écrivains-là, les ayant lu et relu, je me réjouissais de les voir cités et estimés (positivement ou négativement, peu importe) dans un livre.
Mais, assez rapidement, j’ai été pris de doutes et de gêne: l’évocation de Huysmans et de sa conversion au christianisme n’était-elle pas uniquement illustrative, une façon comme une autre de démontrer qu’aujourd’hui, le christianisme n’étant plus de mise, il convient de se convertir à ceux qui sont ou qui veulent être les maîtres de notre temps, autrement dit les Musulmans! C’est le Huysmans moderne, c’est le Durtal d’aujourd’hui qui se soumet non plus au catholicisme mais à l’Islam! Trois rounds ponctuent le roman: l’affrontement dans les urnes et la montée en puissance du candidat de la Fédération Musulmane face au Front National, la fuite du narrateur dans le Quercy, son retour à Paris et son abdication, sa soumission à l’ordre nouveau.
Est-ce un roman islamophobe? Non pas, à proprement parler. Mais, en mettant en scène un candidat soi-disant modéré dont le premier cheval de bataille est de réformer le système scolaire et d’inciter les femmes à se retirer de la vie publique, ce livre répand une peur diffuse dont on se passerait volontiers, surtout dans le contexte actuel de notre pays et, plus encore, après les récents et dramatiques événements de Charlie Hebdo et du magasin Hyper Casher.
Mais il s’agit surtout et avant tout un roman médiocre, écrit d’une écriture très banale, pétri de misogynie, de dégoût et de haine pour l’époque où nous sommes. « Suicide et décadence de l’Europe », « l’Eglise incapable de s’opposer à la décadence des moeurs » et que sais-je encore?… Le pauvre Houellebecq ne sait-il rien d’autre que d’aligner tous ces poncifs? Faire de l’Islam la nouvelle et plus grande force religieuse d’aujourd’hui face à un christianisme qui, ayant connu son âge d’or et son apogée au cours du Moyen Âge, ne cesserait depuis lors de décliner, c’est faire l’aveu de son ignorance et de son étroitesse d’esprit ! C’est méconnaître que le christianisme s’est répandu sur tous les continents et que, s’il semble en effet être en déclin en Europe, il est au contraire très florissant ailleurs dans le monde. Houellebecq ne pense qu’Europe et ne voit ou ne sait voir que la prétendue décadence de ce continent. C’est dans l’air du temps, semble-t-il, chez un certain nombre de supposés penseurs et intellectuels d’aujourd’hui, que de faire ce constat-là. Et qu’a donc à nous proposer Houellebecq ? La soumission ! « … le sommet du bonheur humain réside dans la soumission la plus absolue », affirme Rediger, l’un des personnages du roman. Mon Dieu ! Où sont passés les écrivains de la révolte ?
Ce qui est sûr et qui est en somme consolant, c’est que ce roman vieillira très vite et paraîtra très vite désuet. Qui aura encore l’idée de lire ces élucubrations dans cinquante ans ? Elles ne seront plus que les vaticinations absurdes d’un écrivain aigri en mal d’imagination et qui se croyait malin en pensant la victoire électorale d’un parti appelé « Fédération Musulmane ». Quant aux nombreux noms de people (comme on dit) qui sont cités dans ce roman, qui les connaîtra encore ? Qui connaîtra encore David Pujadas, Stéphane Bern, François Bayrou ou Jean-François Copé, pour ne citer que quelques-uns des noms qu’on trouve dans ce livre ? Un roman déjà daté, je vous dis, déjà vieillot, alors même qu’il vient seulement d’être édité !
Luc Schweitzer, sscc
20150116 –Cinéma
LOIN DES HOMMES
un film de David Oelhoffen.
Du fait de sa thématique, de ses paysages et de nombre de ses scènes, ce film ressemble à s’y méprendre à un western (et un western, je le dis d’emblée, du meilleur acabit). Sauf que l’on n’est pas du tout dans l’ouest américain mais dans un coin perdu de l’Atlas algérien au moment des premiers soubresauts de la guerre d’indépendance en 1954.
Inspiré d’une nouvelle d’Albert Camus, cette histoire à la fois simple et complexe démarre dans l’école où Daru (Viggo Mortensen), un instituteur français (mais, comme on l’apprend plus tard, dont les parents sont en fait andalous) délivre son enseignement exclusivement à des petits arabes. Loin de tout, il pourrait espérer poursuivre sa mission dans le calme si ce n’est qu’un français de passage lui confie le soin de conduire un assassin prénommé Mohamed (Reda Kateb) jusqu’à la ville de Tinguit où il sera jugé. Pour Daru, cela équivaut à une mise à mort. Il refuse, mais, son école étant assaillie par des hommes en armes, il se résout à entreprendre le voyage.
Au cours de ce périple semé d’embûches, les deux hommes se découvrent l’un l’autre. Mohamed, qui aurait eu l’occasion de s’enfuir, préfère marcher vers la mort, préfère être tué par les français, car c’est ainsi seulement, pense-t-il, qu’il pourra mettre fin au cycle de représailles et de vengeances qui risque de décimer sa propre famille, du fait de l’assassinat qu’il a lui-même perpétré. Mais pour Daru, c’est difficile de conduire un homme à la mort, d’autant plus quand il s’agit d’un homme avec qui l’on chemine, avec qui l’on peine dans le désert, avec qui on affronte de multiples dangers. Y a-t-il une issue, un moyen d’échapper à qui semble la fatalité, la mort de Mohamed?
Ce film ambitieux a été réalisé avec grand talent par David Oelhoffen. Les deux acteurs principaux comptent, il est vrai, parmi les meilleurs d’aujourd’hui. Mais il faut aussi souligner la qualité d’écriture du scénario, sachant rendre compréhensibles et passionnants tous les rebondissements d’un récit qui ne manque pas de complexité. Magnifié par une superbe photographie et mis en scène avec intelligence, ce film, sans nul doute, captive, voire fascine, d’un bout à l’autre.
8/10
Luc Schweitzer, sscc
BÉBÉ TIGRE
un film de Cyprien Vial.
Venant du Pendjab, Many est entré en France à l’âge de 15 ans seulement, aidé, pour ce faire, par des passeurs qui, bien sûr, se sont fait grassement payer. Comme il s’agit d’un mineur, il n’est pas question de le renvoyer dans son pays. L’Etat français prend en charge le garçon, lui attribue une famille d’accueil ainsi qu’un éducateur chargé de son suivi intellectuel et moral.
Deux ans plus tard, à 17 ans, Many semble être un adolescent équilibré, studieux, désireux de réussir en se formant et en décrochant un bon emploi, ce qui pourrait aboutir à sa nationalisation. Mais ces apparences cachent des difficultés, des secrets que le garçon s’ingénie à dissimuler autant que faire se peut tant à sa famille d’accueil qu’à son éducateur. La vérité, c’est que les parents de Many se sont lourdement endettés pour le faire venir en France et qu’ils attendent désormais et sans retard, de sa part, un retour sonnant et trébuchant. Son père, avec qui il a l’occasion de parler au téléphone, le lui répète:« Le fils de nos voisins, qui est à Londres, leur envoie régulièrement de grosses sommes d’argent! Et toi? »
Many est sous pression:il se doit de secourir ses parents et donc de mentir à son éducateur qui lui a, bien sûr, interdit de recourir à tout travail au noir. Il lui faut de l’argent, de plus en plus d’argent, ce dont profite éhontément un caïd local pour qui l’exploitation de jeunes gens comme Many est une aubaine. Many, lui, voudrait garder sa fierté, non seulement au regard de sa famille restée en Inde, mais aussi de ceux qu’ils fréquentent en France et qui comptent à ses yeux:sa famille d’accueil et la jeune fille dont il s’est épris, tout particulièrement. Mais comment faire quand on est contraint de mentir, de dissimuler une grande part de sa vie et de ses activités? L’adolescent supportera-t-il cette pression sans réagir, sans montrer ses griffes (comme le suggère le titre du film)?
Très documenté, ce premier long-métrage de Cyprien Vial, bien que n’ayant manifestement bénéficié que d’un petit budget, est une réussite à tout point de vue:le sujet sans aucun doute, mais également la mise en scène à la fois précise et nerveuse, ainsi que le choix et la direction d’acteurs. Un film remarquable et prometteur.
Très documenté,ce premier long-métrage de Cyprien Vial,bien que n’ayant manifestement bénéficié que d’un petit budget,est une réussite à tout point de vue:le sujet sans aucun doute,mais également la mise en scène à la fois précise et nerveuse,ainsi que le choix et la direction d’acteurs. Un film remarquable et prometteur.
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20150105 –Cinéma
MON AMIE VICTORIA
un film de Jean-Paul Civeyrac.
Elles sont amies depuis l’enfance, à la fois semblables et différentes. Semblables par l’origine et le milieu social, différentes du fait de leurs caractères et de leurs intérêts. L’une est une élève douée qui révèle très tôt ses dons pour l’écriture, l’autre est une rêveuse qui s’ennuie sur les bancs de l’école. Bien plus tard, la première décide de raconter la seconde, son amie Victoria (Guslagie Malanda), une parmi d’autres, une qui sait ce que c’est que de vivre et d’aimer mais qu’on remarque à peine…
Enfant, par un hasard de circonstance, du fait de la maladie de sa tante qui en a la garde, la petite Victoria a découvert un autre monde que le sien, celui des Stavenay. Hébergée pour une nuit dans le grand et chic appartement de cette famille bourgeoise d’artistes, elle en reste marquée à jamais. L’appartement dans lequel elle vit avec sa tante ne tiendrait-il pas tout entier dans une seule des pièces de celui des Stavenay?!
Au fil des années, Victoria, que les Stavenay ont à peine remarquée, aura cependant de nouveau affaire à eux. Mais de quelle manière? Séduite par le fis cadet de la famille, le temps de tomber enceinte et d’accoucher d’une fille sans même que le père soit au courant. Victoria ne semble jamais être maîtresse d’elle-même et de son sort. Ou, quand elle l’est, cela ne dure pas longtemps. Comme avec celui seul qu’elle aimera vraiment, un musicien souvent absent et dont elle aura un fils. Quant aux Staveney, elle croisera à nouveau leur route mais pour se voir, subtilement et insidieusement, privée de tout.
Adapté d’un récit de la grande romancière Doris Lessing, on retrouve dans ce film toute l’intelligence et tout l’art minutieux et précis de cette dernière. Tout en se gardant bien de brandir des idéaux, le réalisateur, Jean-Paul Civeyrac, sait habilement faire apparaître le racisme le plus ordinaire, celui qui se remarque d’autant moins qu’il se cache derrière les meilleures intentions du monde. Les Staveney sont des bourgeois de gauche qui seraient pétrifiés d’horreur si on les accusait d’être racistes. Ils donnent l’impression d’être ouverts, accueillants, bienveillants, compatissants, généreux…Autant de qualités pour mieux dissimuler leurs réflexes hautains et, au fond, méprisants. Derrière leurs belles paroles et leurs grandes déclarations, y a-t-il une once de réelle tendresse pour Victoria?
Sorti le 31 décembre sur les écrans, il serait dommage que ce film excellemment réalisé, à la fois tragique et extrêmement touchant, passe inaperçu! Courez le voir!
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc.