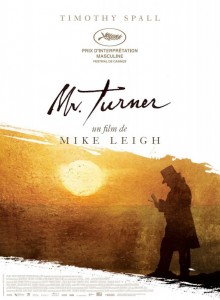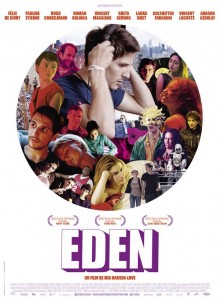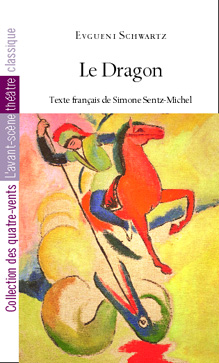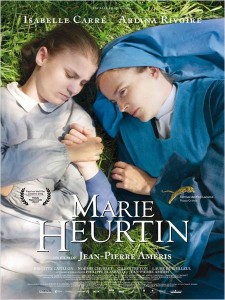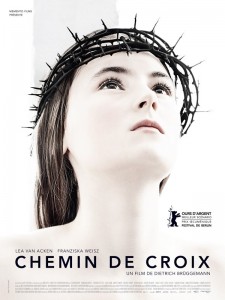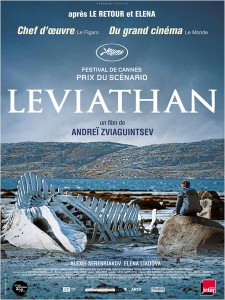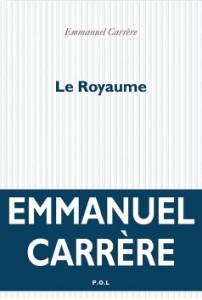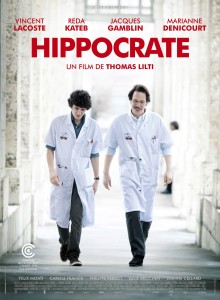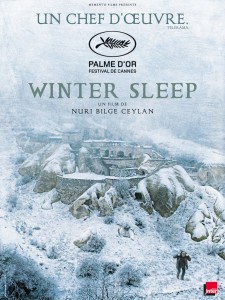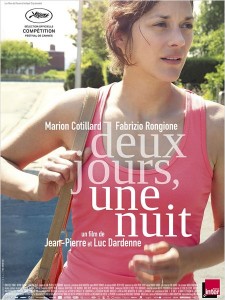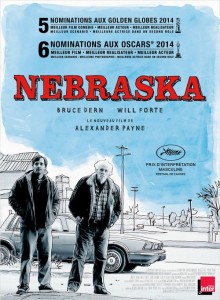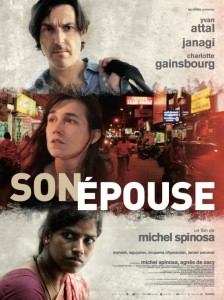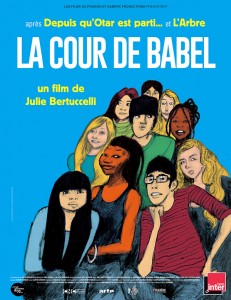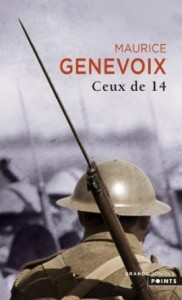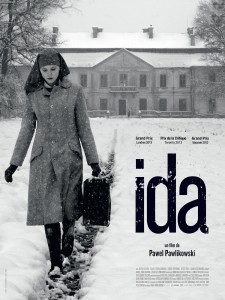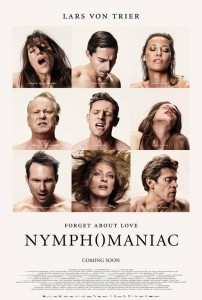20141223 –Cinéma
PALMARES 2014
- IDA,de Pawel Pawlikowski
- DEUX JOURS,UNE NUIT,de Luc et Jean-Pierre Dardenne
- LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA,de Isao Takahata
- WINTER SLEEP,de Nuri Bilge Ceylan
- MOMMY,de Xavier Dolan
- LE VENT SE LÈVE,de Hayao Miyzaki
- MARIE HEURTIN,de Jean-Pierre Améris
- MAGIC IN THE MOONLIGHT,de Woody Allen
- LA COUR DE BABEL,de Julie Bertucelli
- Mr TURNER,de Mike Leigh
- LÉVIATHAN,de Andrei Zviaguintsev
- BIRD PEOPLE,de Pascale Ferran
- SON ÉPOUSE,de Michel Spinosa
- UNE NOUVELLE AMIE,de François Ozon
- PHILOMENA,de Stephen Frears
- NEBRASKA,de Alexander Payne
- JIMMY’S HALL,de Ken Loach
- LES COMBATTANTS,de Thomas Cailley
- PARTY GIRL,de Marie Amachoukeli,Claire Burger et Samuel Theis
- CHANTE TON BAC D’ABORD,de David André
- MY SWEET PEPPER LAND,de Hiner Saleem
- EDEN,de Mia Hansen-Løve
- HIPPOCRATE,de Thomas Lilti
- LES GRANDES ONDES,de Lionel Baier
- ARRÊTE OU JE CONTINUE,de Sophie Fillières
20141219 –Cinéma
TERRE BATTUE
un film de Stéphane Demoustier.
Qui est battu? La terre certes, mais aussi et surtout les hommes et, pour certains d’entre eux, c’est insupportable. Pour Jérôme Sauvage (Olivier Gourmet, formidable une fois de plus), qui vient d’être licencié de son emploi de manager d’une vingtaine de magasins, l’échec est impensable. Aussitôt viré de son travail, il échafaude des projets et s’imagine déjà en patron d’un magasin de chaussures pour femmes. Il aime ça, les grandes surfaces le font vibrer, il ne peut s’en passer. Et pour arriver à ses fins, on le devine prêt à tout, même à des petites combines pas très honnêtes…
En vérité, Jérôme se comporte d’une manière très ambigüe:on le sent déterminé, incapable qu’il est de penser l’échec ou d’accepter d’être battu, et hésitant comme un enfant, au point de se conduire parfois comme le dernier des potaches. L’échec le cerne cependant, sans qu’il s’en rende compte:tout part à vau l’eau, non seulement dans sa vie professionnelle mais aussi dans sa vie de famille. Sent-il seulement que sa femme (Valéria Bruni Tedeschi) s’éloigne de plus en plus de lui? Dans un monde et dans une société où il faut être gagnant à tout prix, Jérôme ne peut concevoir autre chose que de remporter les batailles. Il va mal, il ne dort qu’au moyen d’un puissant somnifère, mais il croit toujours à la victoire.
Mais c’est avec son fils Hugo (Charles Mérienne) que les relations sont les plus étranges et les plus ambigües. Hugo se passionne pour le tennis au point qu’il est repéré et choisi pour s’entraîner comme un futur champion. Doté d’un coeur exceptionnel, il peut aller loin, lui dit-on, et il ne demande qu’à le croire. Son entraîneur a beau lui dire que, dans ce sport-là, il y a 99% de d’efforts et de souffrances pour 1% de plaisir (quand on gagne!), Hugo se lance dans l’aventure, tout en cherchant auprès de son père le soutien dont il a besoin. Mais au tennis comme dans le management de grands magasins ou dans la vie de couple, il y a de possibles échecs, la réussite n’est pas garantie. Comment donc se comportera le garçon? Saura-t-il, mieux que son père, accepter d’en passer par là?
Ce n’est pas la première fois, bien sûr, qu’un film scrute des relations père-fils qui oscillent, qui, sans en avoir l’air, insidieusement, parce qu’elles ne sont pas totalement limpides, conduisent à de funestes dérapages. Ce film de Stéphane Demoustier ne donne pas trop, cependant, une impression de déjà-vu. Le réalisateur a su adopter un ton et un regard qui ne manquent pas d’originalité. Et, bien sûr, on ne vantera jamais assez les qualités des acteurs, en particulier d’Olivier Gourmet!
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20141210 –Littérature sur le Cinéma
JOHN FORD – LA VIOLENCE ET LA LOI
un livre de Jean Collet
(éditions Michalon)
Alors que commence, ces jours-ci, à la Cinémathèque de Paris Bercy, une rétrospective de ses films, je ne résiste pas au plaisir d’écrire quelques lignes à propos d’un cinéaste qui compte parmi ceux pour qui j’ai le plus d’admiration, dont je vois et revois les films avec un bonheur qui ne faiblit pas. Je veux parler de John Ford (1894-1973), le grand réalisateur classique d’Hollywood ayant à son actif 143 films, depuis l ‘époque du muet (1917…) jusqu’à « Frontière chinoise », sa dernière œuvre, en 1966.
Il y aurait bien des choses à dire au sujet de ce géant du cinéma et je ne peux que recommander les nombreux (et, en général, excellents) ouvrages qui lui sont consacrés ainsi que la découverte ou la redécouverte de ses films dont une partie est disponible en DVD. Mais je veux m’arrêter un peu sur un sujet récurrent non seulement chez Ford mais chez de nombreux autres cinéastes, celui de la violence et de son rapport avec la loi. C’est précisément le sujet qu’aborde Jean Collet dans un ouvrage, petit par la taille mais grand par son contenu.
En se basant sur huit grands films de Ford, du « Mouchard » en 1935 jusqu’à « Frontière chinoise » en 1966, l’auteur montre comment le grand cinéaste a su habilement mettre en scène la violence sans jamais tomber dans la tentation du spectacle. Au regard de nombre de films tournés de nos jours, ceux de Ford paraissent d’ailleurs presque exempts de violence, presque trop tranquilles. Ceux qui vont au cinéma pour se repaître d’images de violence seraient sûrement très déçus en les voyant.
Et pourtant ! Que d’enseignements pourrions-nous recevoir d’un grand maître comme Ford ! Et comme cela pourrait changer notre regard ! Car le réalisateur de « La Chevauchée fantastique » nous respecte, nous, les spectateurs, et, en nous respectant, il fait de nous davantage que de simples spectateurs. Il nous rend participant, il nous oblige à voir autrement, à voir la violence par les yeux d’un témoin ou par sa parole plus que de manière directe, à en chercher les causes et les effets plus qu’à la montrer, à la déceler là où on ne l’imagine pas et à en capter le mensonge là où elle se donne à voir. Les films de Ford prennent leur temps et, souvent, quand on croit qu’ils sont finis ils ont encore quelque chose à nous dire. Beaucoup d’entre eux peuvent être classés dans la catégorie des œuvres qu’on peut voir et revoir sans jamais en épuiser la richesse.
Ford ne se fait pas d’illusions sur notre humanité :il la montre capable des pires bassesses, il sait jusqu’où on peut aller dans l’abjection, quand on est habité par la lâcheté, la peur, l’hypocrisie ou, au contraire, la soif de pouvoir et la tentation de la toute-puissance. Quand on croit pouvoir être maître de tout et s’affranchir des lois. Mais Ford, marqué par son catholicisme (même s’il s’agit d’un catholicisme qui, fort heureusement, s’est débarrassé de toute bien-pensance!), sait aussi de quoi est capable l’homme dépouillé de sa suffisance, allant jusqu’au sacrifice de soi pour le salut d’autrui ou sachant trouver le geste et la parole qui mettent la violence en arrêt. Dans « Vers sa destinée » (1939), le jeune et frêle Mr. Lincoln (Henry Fonda) impose le silence aux lyncheurs par la seule autorité de sa parole, créant ainsi un espace sacré où la violence doit laisser place à la loi. Dans « Le Soleil brille pour tout le monde » (1953), le juge Priest (Charles Winninger) obtient le même résultat en traçant simplement une ligne sur le sol, séparant ainsi l’espace où rugit la meute des lyncheurs de celui où doit se faire entendre la loi. Cela ne fait-il pas penser au Christ écrivant sur le sol tandis qu’on lui amène la femme adultère, celle que la loi prescrit de lapider. A la loi de la violence, Jésus oppose une autre loi.
Que d’enseignements encore l’on peut recevoir en revenant à Ford ! Il y aurait mille choses à dire et sur quantité de thèmes variés (celui des appels et des réponses données aux appels, thème médité cette année par le Réseau Picpus, par exemple). Il faudrait aussi, je le pense, que certains parmi les cinéastes d’aujourd’hui osent se mettre à l’école des grands classiques et, en particulier, de Ford. Peut-être éviteraient-ils ainsi le piège dans lequel ils tombent si allégrement, celui de faire de la violence (mais on pourrait dire la même chose du sexe, par exemple) un spectacle destiné à satisfaire à la fois les yeux et les appétits les plus primaires de spectateurs vautrés dans leurs fauteuils dans ce seul but. Des films récents comme « Prisoners », « Alabama Monroe » ou « Nymphomaniac » m’ont paru particulièrement détestables et abjects de ce point de vue. Comme écrit Jean Collet à la page 117 de son livre :« Que faites-vous du spectateur ? C’est la question qu’on voudrait poser à chaque réalisateur, après chaque film. Quel rôle donnez-vous au spectateur dans le film ? Voyeur(…). Témoin (…) »
Et, plus loin, Jean Collet écrit ces lignes si instructives :« …à une seconde près, une seconde de trop, à un décadrage près, la violence au cinéma peut être pornographie ou prière, abjection ou méditation. Tous les débats sur le sujet se révèlent donc dérisoires et vains, s’ils ne sont pas inscrits d’abord dans le rectangle de l’écran, la forme que le cinéaste a donné à son film, parmi tant d’autres formes possibles. Au cinéma, la violence n’existe et ne peut se comprendre qu’en termes de forme.
(…) Ford appartient à une génération de cinéastes qui ne se contentaient pas de remplir les salles par n’importe quel moyen ; encore moins de les vider avec de nobles intentions. Comme tout artiste honnête, il sait qu’on ne peut justifier ce qu’on met sur l’écran ni par l’efficacité ni par les intentions, mais par la qualité d’un regard qui engage le regard du spectateur. Ce n’est pas la caméra qui regarde, c’est l’être humain, parce qu’il réfléchit ce qu’il voit. L’oeil voit, mais c’est l’âme qui regarde. Et c’est l’âme qu’il faut combler, non l’oeil. » (pp. 119-120).
Bienvenus, les cinéastes qui comblent l’âme et non l’oeil. Car, s’il y a aujourd’hui des réalisateurs qui ne savent pas résister à la tentation de repaître l’oeil du spectateur et d’en faire un triste voyeur, il en est d’autres qui satisfont l’âme, même s’ils ne le diraient pas ainsi, à l’exemple des frères Dardenne chez qui l’on sent bien la volonté de peser chaque plan et de réfléchir chaque scène afin d’aiguiser l’intelligence du spectateur plus que de satisfaire ses instincts. Je ne sais si les Dardenne connaissent Ford et se sont inspirés de son intelligence de la mise en scène, mais il est certain que, comme leur illustre prédécesseur, ils ont à cœur de respecter le spectateur et non de le prendre en otage. Dans quelques années peut-être, leurs films seront des classiques qu’on se plaira de prendre en exemples comme on le fait aujourd’hui de ceux de Ford !
Luc Schweitzer,sscc
20141205 –Cinéma
Mr. TURNER
un film de Mike Leigh.
« Un pareil homme, et je l’entends dans sa totalité:sa vie, ses mœurs, sa bassesse, et son aspect, avoir écrit les vers qu’il a écrits, avoir eu en lui un tel don de poésie. (…) Un tel homme, répugnant, même au physique – je me le rappelle fort bien, –avoir été ce poète ! Quel prodige. »Ces lignes, écrites par Paul Léautaud dans son « Journal littéraire »à propos de Verlaine, pourraient servir à décrire le peintre William Turner (1775-1851) tel que le montre Mike Leigh dans ce film. Il suffirait de remplacer les termes ressortissant au domaine de la poésie par d’autres empruntés à celui de la peinture.
Les artistes, y compris les plus grands, n’ont parfois rien d’aimable:ni leur physique, ni leur caractère ni leurs moeurs n’autorisent à les décrire de manière sympathique. Dans le film de Mike Leigh, William Turner (formidablement interprété par Timothy Spall, prix d’interprétation masculine à Cannes) semble n’être qu’un grognon et laid personnage qui, de plus, n’éprouve que mépris pour ses semblables. Rien d’attirant donc, chez un tel être, si ce n’est qu’il s’agit d’un très grand artiste, d’un peintre qui sut marquer de son génie l’art pictural anglais du XIXe siècle, bien davantage que ses contemporains, tel Constable pour qui il n’éprouvait d’ailleurs que du mépris.
Un tel portrait (celui de l’artiste, laid extérieurement, mais recelant au profond de lui des trésors de beauté) pourrait évidemment manquer singulièrement de subtilité et apparaître à la fois grossier et caricatural. Mais Mike Leigh a su échapper à ces travers:avec finesse, par petites touches, il montre que les apparences sont trompeuses et que le peintre bourru est habité par un coeur d’homme, que, sous ses airs hautains, est dissimulé une âme sensible, si sensible que, quand l’occasion s’y prête, les grognements font place aux larmes et aux sanglots d’un enfant.
Sans trop s’attarder sur les scènes spectaculaires (Turner se faisant attacher au mât d’un navire pour mieux être au coeur d’une tempête), le réalisateur nous montre un artiste voyageant, toujours à la recherche de paysages, de couleurs, de lumière, d’impressions, de beauté. Un artiste de plus en plus incompris certes (mais par des critiques, tel John Ruskin, tellement imbus d’eux-mêmes qu’ils en sont ridicules) tout en étant conscient que son oeuvre restera (c’est pourquoi il vaut mieux qu’elle demeure visible par tous plutôt que d’être vendue à un particulier).
Sous ses airs de film classique, voire académique, c’est une oeuvre tout en finesse et en subtilités que nous livre Mike Leigh. Servi par un prodigieux acteur, par des décors superbes, par des paysages, par une lumière et par une photographie qui fascinent tant ils sont en corrélation avec les toiles du peintre, ce film passionnant laisse une profonde impression d’humanité. Et l’on finit presque par éprouver de la tendresse pour ce grognon de William Turner!
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20141121 –Cinéma
EDEN
un film de Mia HANSEN-LØVE.
C’est en voyant ce film que j’ai découvert la musique house, la musique garage et la French Touch des années 90. Je ne connais rien à cette musique, ce n’est pas du tout mon univers et donc, logiquement, ce film aurait dû me rebuter ou me plonger dans des abîmes d’ennui. Eh bien, pas du tout! La réalisatrice, Mia Hansen-Løve, dont j’avais déjà beaucoup aimé les trois premiers films, a su rendre attachants les personnages dont elle conte ici l’itinéraire au point que je me suis surpris moi-même à apprécier également un peu (juste un peu) la musique festive, rythmée, joyeuse mais aussi un brin mélancolique dont il est question.
C’est l’histoire de son propre frère Sven (d’ailleurs co-scénariste du film), rebaptisé Paul, que la cinéaste a choisi de raconter. Elle le fait, une fois de plus, avec un grand sens de la mise en scène et sur la base d’un scénario d’une profonde subtilité. Tout en égrenant les années qui passent, comme elle le fait volontiers dans ses films, Mia Hansen-Løve parvient à faire percevoir, par petites touches qui passeront peut-être inaperçues aux yeux des spectateurs distraits, les fêlures de ses personnages et, en particulier, de Paul. Derrière les apparences et lorsque s’achèvent les rythmes de fête, on a affaire à des êtres fragiles, cherchant refuge dans des paradis artificiels et s’effondrant en pleurs lorsque trop de détresse les font vaciller.
Même dans la première partie du film, la plus festive, celle qui raconte l’ascension de Paul, ses succès de DJ, on sent fort bien que tout ou presque repose sur des illusions. Dans la deuxième partie du film, celle des illusions perdues, c’est encore beaucoup plus flagrant, bien entendu. Dans ce monde-là, il suffit de peu de choses pour que tout s’écroule, pour que, des sommets on tombe dans les abîmes, et de l’euphorie dans la détresse. Tout est éphémère, rien ne subsiste suffisamment longtemps pour combler et pour apaiser. Les femmes qu’aiment Paul, et surtout Louise (Pauline Etienne, formidable), auraient pu mettre son coeur en paix, mais elles étaient elles-mêmes trop fragiles, trop défaillantes…
Malgré les apparences et même si celui-ci est rythmé du début à la fin par la musique garage et les soirées festives, c’est un film d’une profonde mélancolie qu’a réalisé Mia Hansen-Løve. Elle l’a fait, une fois de plus, avec un grand sens de la mise en scène et en choisissant d’excellents acteurs. Sans doute ce film ennuiera-t-il certains spectateurs qui auront le sentiment qu’il ne s’y passe rien ou presque et que tout est plat. Mon impression a été toute différente, toute d’empathie et de sympathie et pour le récit et pour les personnages. Du grand art!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20141120 –Théatre
LE DRAGON
une pièce d’Evguéni Schwartz.
Sauf si des questions de droits viennent contrecarrer le projet, voici la pièce que la troupe de théâtre « Réplic’Pus »que j’accompagne et dont je fais partie interprétera et représentera les 9 et 10 juin 2015.
Il s’agit du « Dragon », une pièce écrite par un auteur russe, Evguéni Schwartz, entre 1940 et 1944. Le but évident du dramaturge était de dénoncer les totalitarismes qui sévissaient à l’époque, le nazisme mais aussi l’oppression stalinienne. Bien sûr, il était inconcevable de le faire de manière frontale. C’est donc sous couvert d’une fable que l’auteur s’y est employé.
La pièce se déroule à une époque indéterminée mais fabuleuse, dans une ville soumise à la tyrannie exercée par un dragon depuis des temps immémoriaux. Des générations d’habitants de la ville ont vécu sous cette terreur et, au fil du temps, s’y sont quasiment résignés. Le dragon « protège »la ville tout en réclamant chaque année son tribut:une jeune fille. Bientôt, c’est la jeune Elsa, la fille de l’archiviste Charlemagne, qui sera emportée…
Arrive un inconnu, un étranger, portant le nom fameux de Lancelot. Il s’informe des événements et jure de combattre et de vaincre le terrifiant dragon. Hésitations, craintes, volte face, les habitants oscillent d’un sentiment à l’autre, mais il en est aussi qui ne voient pas d’un bon oeil l’arrivée de l’intrépide Lancelot, en particulier le bourgmestre et son fils Henri, tous deux rongés d’ambitions peu avouables.
Lancelot parvient cependant à terrasser le dragon, mais non sans être grièvement blessé et sans disparaître à la suite du combat. On pourrait imaginer que la ville est enfin libre et joyeuse, mais c’est sans compter sur les esprits retors et le peu de scrupules du bourgmestre et de son fils. D’une oppression, on est aussitôt passé à une autre! Et le bourgmestre a décidé d’épouser la belle Elsa, pourtant promise initialement à son fils Henri! N’y a-t-il donc pas d’issue, pas d’espoir, pas de recours? Faut-il se résigner, passer d’une dictature à l’autre sans se révolter? Qui redonnera une âme aux habitants de cette ville?…
La pièce d’Evguéni Schwartz, si elle a été écrite pour dénoncer les totalitarismes des années 40, reste bien évidemment d’actualité. Toute forme d’oppression, quelle qu’elle soit, peut conduire ceux qui en sont les victimes à la résignation et à la passivité. La pièce de Schwartz invite au réveil des consciences, à se mettre à l’écoute de celui qui refuse la fatalité et qui ose l’affrontement. Ce peut être quelqu’un qui vient d’ailleurs (comme Lancelot dans la pièce) et qui, par sa présence, sa parole et son audace, contribue à faire passer, même si c’est difficile, de la soumission à l’insurrection, de la triste résignation à la joie d’un désir de liberté. Ces thèmes nous concernent tous, d’une manière ou d’une autre. Pas besoin de vivre sous un régime totalitaire pour se sentir concerné. N’y a-t-il pas, en chacun, de ces asservissements auxquels, avec le temps, l’on s’habitue sans plus guère s’en étonner? Et n’est-ce pas un bonheur quand un « Lancelot »(ou quelqu’un d’autre) fait résonner en nos cœurs l’appel à tuer le dragon, à répondre à l’appel de la liberté et à aller au large? Il peut nous arriver, à tous, d’avoir besoin d’entendre la voix qui dit « non »…
Je découvre cette pièce et ne prétend nullement en avoir épuisé les richesses et les thèmes. Elle peut être lue de multiples manières, mais chacun y trouvera sûrement de quoi alimenter sa réflexion tout autant que ses rêves. Et, bien sûr, rendez-vous les 9 et 10 juin, si tout va bien, pour les représentations. D’ici là, c’est un bonheur pour moi (et, je n’en doute pas, pour tous les autres membres de la troupe Réplic’Pus) que de répéter et de nous préparer!
Luc Schweitzer,sscc
20141119 –Cinéma
QUI VIVE
un film de Marianne Tardieu.
Il ne faut pas lui dire qu’il est vigile! Chérif (Reda Kateb) préfère les termes d’agent de sécurité! De plus, s’il exerce cet emploi dans un centre commercial de banlieue, ce n’est, affirme-t-il, que de manière temporaire car il est bien décidé à passer un concours d’infirmier et à le réussir, ce qui lui permettrait aussi (et il en rêve) de s’éloigner à tout jamais de son quartier et de ses fréquentations. En attendant, cependant, il lui faut s’en accommoder et supporter, autant que faire se peut, non seulement un métier qu’il n’exerce qu’à contre coeur mais la bande de petits jeunes désoeuvrés qui passe son temps aux abords du centre commercial et qui ne trouve rien de mieux, de temps à autre, que de l’importuner et le pousser à bout.
Seules consolations dans l’univers gris et terne de Chérif:ses parents (sa mère en particulier) et Jenny (Adèle Exarchopoulos), une animatrice de centre pour enfants qu’il a rencontrée dans un bus et dont il s’est épris. Tout pourrait, en somme, évoluer vers le mieux, vers un nouvel emploi, un nouvel environnement, une vie nouvelle en compagnie de Jenny s’il n’y avait de ces grains de sable, de ces petits riens, qui se glissent là où il ne faut pas et qui se plaisent, en quelque sorte, à tout compromettre. Chérif n’échappera pas à son milieu et à ses fréquentations sans qu’un piège ne se referme sur lui, sans qu’il se trouve pris dans une affaire sordide, sans qu’il commette l’irréparable…Saura-t-il néanmoins sauver ses rêves de vie meilleure?
Pour son premier film, Marianne Tardieu, si elle n’échappe pas totalement aux clichés sur la banlieue, a su cependant maîtriser son sujet, le rendre captivant et très crédible. Elle a su aussi choisir en Reda Kateb un des meilleurs acteurs d’aujourd’hui. On peut regretter que le rôle tenu par Adèle Exarchopoulos n’ait pas été davantage exploité. Mais tel qu’il est, ce film, s’il n’est pas parfait, n’en demeure pas moins très intéressant et très prometteur. La réalisatrice y révèle déjà un véritable talent de mise en scène.
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20141114 –Cinéma
MARIE HEURTIN
un film de Jean-Pierre Améris.
Lorsque, en ce jour de la fin du XIXe siècle, à l’institut pour jeunes filles sourdes de Larnay, près de Poitiers, les religieuses qui en ont la charge se trouvent face à un père désireux de leur confier sa fille non seulement atteinte de surdité mais de cécité, les voilà contraintes de déclarer forfait. Il faut dire que Marie Heurtin (Ariana Rivoire) se conduit en véritable sauvageonne:on ne peut l’approcher sans qu’elle se débatte et qu’elle hurle et, dès qu’elle le peut, elle s’échappe et trouve refuge dans les branches d’un arbre. Que faire de cette enfant? La mère supérieure ne voit d’autre solution que de la renvoyer chez elle. Mais c’est sans compter sur une des religieuses, soeur Marguerite (Isabelle Carré, lumineuse), qui, touchée par la détresse de l’enfant, veut mener le combat qui la conduira des ténèbres à la lumière.
« J’ai rencontré une âme. Une âme emprisonnée », dit-elle. Pour révéler cette âme, pour la faire sortir de sa prison, c’est bien un combat qu’il va falloir mener. Âpre et violent. Il faut à soeur Marguerite des trésors de patience, de ténacité, de persévérance, pour ne pas baisser les bras et gagner la bataille. Il faut se battre corps à corps avec l’enfant et, après bien des luttes et bien des apparences d’échecs, voir enfin surgir le langage. Apprendre à s’exprimer, à parler un langage approprié, c’est la seule voie pour échapper à la nuit et à l’enfermement. Qu’on la prenne ou non pour une folle, soeur Marguerite s’obstine et saura trouver le chemin pour parler au coeur de Marie.
Paradoxalement, dans ce film où il s’agit de révéler une âme, ce sont les corps qui sont sublimés. C’est par le corps, c’est à force d’empoignades, c’est par le toucher et par l’odorat que la jeune fille sourde et aveugle finit enfin par s’ouvrir au monde qui l’entoure et par communiquer avec lui. Soeur Marguerite, bien qu’elle-même malade, se bat, lave le corps de Marie, parvient avec grand peine à brosser ses cheveux, parvient surtout à lui apprendre les signes du langage…Les empoignades laissent place à des instants de tendresse bouleversants et sublimes. Une fois franchi l’obstacle qui conduit au langage, les progrès de l’enfant sont rapides et saisissants. Elle qu’on croyait idiote au point qu’on la traitait d’animal sauvage révèle ses trésors d’intelligence et de tendresse. Elle apprend le monde, elle apprend le sens du service, elle apprend la vie et elle apprend la mort…Elle apprend l’espérance.
Aussi beau, aussi émouvant et bouleversant que « Miracle en Alabama »(1962), le film qu’avait mis en scène Arthur Penn pour raconter l’histoire d’Helen Keller, une fillette elle aussi sourde et aveugle, ce film lumineux qui raconte l’obstination gagnante, la beauté des corps, la violence et la tendresse, la vie, la mort, le détachement et l’espérance restera sûrement longtemps dans nos coeurs et dans nos esprits comme un repère de lumière dans la nuit.
9/10
Luc Schweitzer,sscc
20141106 –Cinéma
UNE NOUVELLE AMIE
un film de François Ozon.
Certes, il convient d’éviter, autant que faire se peut, les spoilers quand on rédige une critique de film. Mais, en l’occurrence, je ne dévoilerai pas grand chose en révélant d’emblée qu’il est question ici d’un homme qui s’habille en femme! Tout le monde le sait ou l’aura deviné!
Tout commence avec une histoire d’amitié, celle qui lie « à la vie, à la mort », depuis l’enfance, Claire et Laura. Et c’est la mort qui, précisément, s’invite pour y mettre un terme. Laura meurt des suites d’une maladie et Claire (Anaïs Demoustier), à ses obsèques, jure qu’elle prendra soin du bébé de la défunte ainsi que…du papa! Le père, devenu veuf, c’est David (Romain Duris) et c’est lui qui, très vite, sera surpris ayant revêtu les habits de la défunte et donnant le biberon à son enfant! On l’imagine, la première réaction de Claire, c’est d’être choquée et effarée. Mais ce réflexe scandalisé laisse rapidement place à autre chose, à une relation ambiguë faite de fascination, d’étonnement, d’amusement et de méfiance. D’autant plus que Claire vit avec un compagnon à qui elle est incapable d’avouer la vérité. Elle s’installe dans le mensonge en entretenant avec David (à qui elle donne le prénom de Virginia) une relation trouble qu’elle ne saurait sans doute elle-même définir. Quant à David, s’il déclare ne pas être homosexuel, il s’identifie tellement à son double féminin Virginia que c’est quand il revêt ses habits d’homme qu’il paraît le plus perdu ou le plus déphasé.
François Ozon, le réalisateur, décidément porte bien son nom! Il ose, il aborde avec audace des sujets qui paraîtront peut-être scabreux à certains, mais il le fait toujours avec intelligence, sans jamais chercher ni à choquer pour le seul plaisir de choquer ni à militer pour quelque cause que ce soit. Il oriente volontiers sa caméra vers les marges, il scrute des personnages hors normes, mais c’est toujours en préservant la part du mystère. Dans « Jeune et jolie », il se gardait bien d’expliquer pourquoi son héroïne de 17 ans se prostituait. Dans « Une nouvelle amie », David, surpris en habits de femme, bafouille bien quelques mots d’explication à Claire qui l’a surpris, mais c’est uniquement en forme d’excuses embarrassées. On ne sait pas vraiment pourquoi il se complaît tellement dans son double féminin et c’est tant mieux. On le devine à la fois heureux de se travestir et comme intrigué par sa propre identité aux contours flous. Un plan très rapide et bouleversant le montre même en plein désarroi. Mais ce qui intéresse aussi et surtout François Ozon, c’est le regard d’autrui, le regard de Claire et des autres personnages qui interviennent au cours du film quand ils découvrent que David se travestit en femme. Cela donne d’ailleurs à certaines scènes un ton humoristique qui est le bienvenu. Mais cela nous confronte, nous aussi, les spectateurs, à notre propre regard. Serons-nous effarouchés, intrigués, perplexes, voyeurs, indulgents, compatissants, sympathisants, ou que sais-je encore? Ce qui est sûr, c’est que François Ozon a réussi, une fois de plus, un grand film et une belle invitation au respect d’autrui.
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20141030 –Cinéma
CHEMIN DE CROIX
un film de Dietrich Brüggemann.
Quatorze scènes, quatorze stations de chemin de croix, quatorze plans fixes (hormis deux mouvements de caméra) pour nous décrire le calvaire de Maria, une jeune adolescente élevée selon les principes rigides adoptés par sa famille de catholiques intégristes. Quatorze leçons de catéchisme, pourrait-on ajouter, mais non, c’est une seule leçon de catéchisme inculquée par un prêtre en soutane à un petit groupe d’adolescents dès la première scène (ou la première station). Une seule leçon de catéchisme qui s’étire fastidieusement tout au long des treize autres stations et des 1 heure 50 que dure ce film. Une leçon qui consiste à apprendre aux malheureux enfants mis entre les griffes de ce prêtre que la vie du chrétien n’est qu’un combat du bien contre le mal, qu’il faut donc être un bon soldat du Christ, que, pour ce faire, il faut en finir avec les frivolités et les plaisirs et savoir déjouer les ruses du diable et que rien n’est mieux, pour parvenir à cette fin, que de sacrifier sa vie pour le Christ!
La pauvre Maria prend tout ça à la lettre, ose donc tous les sacrifices et s’imagine déjà en sainte. Sa mère veille comme une harpie pour lui rappeler ses devoirs de chrétienne. Et voilà Maria qui, l’esprit et le coeur empoisonnés par toutes ces leçons, projette de donner sa vie pour le salut de son petit frère malade…
Insupportable, tel est mon sentiment! 1 heure 50 de ce catéchisme soi-disant traditionaliste mais surtout irrémédiablement pervers et totalement opposé à l’esprit de l’Evangile, c’est usant au point qu’on aimerait raccourcir le chemin de croix de moitié! Quant au « sacrifice »de Maria et au « miracle »qui l’accompagne, c’est, comme le remarque très justement Pierre Murat dans Télérama, aussi stupide que ce qu’imaginait Lars Von Trier quand il réalisait « Breaking the waves ». Depuis, le cinéaste danois n’a fait que confirmer, de film en film, sa suffisance et sa sottise. Espérons qu »il n’en sera pas de même pour le réalisateur allemand de ce « Chemin de Croix ». Et espérons aussi qu’il saura mieux choisir ses acteurs ou mieux les diriger, car, dans ce film, ils ne m’ont pas toujours semblé très convaincants.
2/10
Luc Schweitzer,sscc
20141024 –Cinéma
MAGIC IN THE MOONLIGHT
un film de Woody Allen.
S’il y en a un qu’on ne peut pas tromper, c’est bien Stanley Crawford (Colin Firth). Les supercheries de soi-disant magiciens, il les connaît toutes, lui qui se produit sur scène en maître illusionniste sous le déguisement d’un chinois nommé pour l’occasion Wei Ling Soo. Et, puisqu’il est lui-même expert en ruses et ficelles et tours de passe-passe de toutes sortes, il se targue de débusquer et de confondre n’importe quel charlatan.
Or, précisément, un de ses amis l’invite à mettre à jour les affabulations d’une jeune Américaine qui se produit en tant que médium sur la French Riviera. Sophie Baker (Emma Stone, délicieuse) prétend, entre autres dons extraordinaires, communiquer avec les défunts, tout en étant courtisée, entre deux séances de divination, par Brice, un fade joueur de ukulélé à la voix de canard.
A priori, rien de tout cela ne saurait troubler Stanley:il a confondu des charlatans bien plus coriaces. Mais, évidemment, rien ne se passe comme prévu et notre incrédule qui se plaît à citer Nietzsche, notre sceptique pour qui seul compte ce qui est rationnel, se trouve fort déstabilisé face au talent et aux dons de la jeune et charmante Sophie. Ses certitudes et son arrogance sont si ébranlées qu’il en viendra même à esquisser une prière….
Illusion, mensonge, nous dit, en fin de compte, le pessimiste joyeux qu’est Woody Allen, mais il le dit avec tant de finesse et tant de classe qu’on en sourit. Et on en sourit d’autant plus qu’il reste, malgré tout, quelque chose de magique et d’irrationnel en ce monde:quand on a dévoilé tous les faux-semblants, ou quand on estime les avoir dévoilés, il reste encore ce curieux sentiment qui naît et grandit dans les coeurs, qu’on nomme du doux nom d’amour, et qui, facétieusement, provoque l’attirance mutuelle de deux êtres que tout devrait opposer. Mais l’amour se moque de la logique et fait fi de la rationalité.
Sous ses apparences de bluette romantique, ce film de Woody Allen aborde de grands thèmes et de vastes sujets, mais il le fait avec tant d’élégance que c’est à peine si on s’en rend compte. C’est tout l’art d’un grand metteur en scène. Quand on aborde des sujets profonds, on peut le faire en donneur de leçons indigeste façon Lars Von Trier ou en professeur distribuant des pensums aux mauvais élèves que nous sommes tous, à la manière d’un Michael Haneke…On peut aussi le faire avec légèreté, l’air de rien, et cela donne les meilleurs films de Woody Allen, dont ce « Magic in the moonlight »fait partie, j’en suis convaincu!
9/10
Luc Schweitzer,sscc
20141021 –Cinéma

CHANTE TON BAC D’ABORD
un film de David André.
Diffusé à la télévision sur France 2, ce documentaire pas comme les autres sort également sur grand écran et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il le mérite amplement. Pendant un an, tandis qu’ils préparent leur Bac, le réalisateur, David André, a suivi au plus près cinq adolescents de Boulogne-sur-Mer, les a scrutés, leur a donné la parole et…les a fait chanter! C’est la plus grande originalité de ce film, que de mettre en chansons les doutes, les questions et les espoirs de ces jeunes. Des jeunes d’aujourd’hui, qu’on dit si facilement désenchantés, mais qui osent chanter, enchanter, ce qui donne à ce film un ton réjouissant et plein d’espoir, sans tomber pour autant dans un simplisme béat qui ferait fi des craintes et des difficultés. C’est d’autant plus vrai que le film donne la parole aux parents autant qu’aux enfants, et si, parmi ceux-ci, certains semblent insouciants, ce n’est jamais le cas chez les parents. « On a des rêves pleins la tête plutôt que des plans de carrière », affirme Gaëlle au début du documentaire. Et elle en a, des rêves, elle qui est passionnée de théâtre et qui, au fil du temps, se verrait bien en marionnettiste. Nicolas, quant à lui, même s’il affirme mener « une vie simple », s’affirme comme le poète de la bande. Rachel, sa copine, sous ses airs hautains, cache un coeur tendre et passionné. Alex, malgré ses difficultés scolaires, et sous ses allures de rocker, étonne par sa bonne humeur constante. Et Caroline, même si elle se décrit elle-même comme « nulle »et même si elle affirme que chez elle on ne s’occupe pas d’elle, n’en rêve pas moins d’embrasser le métier d’archéologue. Ce sont les parents qui mettent le plus de doute et d’inquiétude dans leurs propos. Le père de Gaêlle s’interroge beaucoup, lui qui travaille comme électricien sur le port de Boulogne et entend sa fille rêver d’un tout autre monde que le sien, celui du théâtre. Tous les parents sont conscients qu’il « ne faut pas rester par ici », autrement dit que, pour trouver leur chemin et pour décrocher un emploi, leurs enfants devront quitter Boulogne. Mais tous aussi, malgré leurs craintes et leurs petits moyens, s’affirment prêts à aider leurs enfants à réaliser leurs projets.
C’est un documentaire passionnant, tendu entre craintes et espoirs, entre la dure réalité du monde et les rêves d’adolescents de 17 ans. Comme le rappelle Gaëlle, citant Rimbaud, « on n’est pas sérieux quand on a 17 ans ». Il faut l’être un peu cependant, pour réussir son Bac, visiter l’école qu’on souhaite intégrer à la rentrée prochaine et se dire que tout est passé si vite. On voudrait bien que ça se prolonge un peu, comme dit la chanson finale, mais on ne peut pas! Et nous, spectateurs, nous les quittons avec l’espoir qu’ils oseront chanter encore, et chanter tout au long de leur vie!
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20141017 –Littérature –Citation
Voici une citation superbe, savoureuse, impertinente, mais tellement juste, que je ne résiste pas au plaisir de partager. Je l’ai lue aujourd’hui dans « La Captive aux Yeux clairs », le formidable roman dont je suis en train de lire les dernières pages. Ce roman raconte l’histoire de quelques trappeurs partant à la découverte du Haut-Missouri durant les années 1830-1840. L’un d’eux, Jim, blessé par un Indien et croyant qu’il va mourir, parle ainsi à son compagnon, Boone:
« Tu crois qu’il y a un enfer, Boone ? Ça me faisait presque croire en Dieu, Boone, quand j’entendais Clemens jouer et chanter. Si je ferme les yeux, je l’entends, j’entends les jolies mélodies au banjo et sa voix qui les accompagne, avec les montagnes qui semblent se rapprocher tout autour pour l’écouter. Hi-yi Hi-yi. C’est moins bien quand c’est moi qui chante, mais même une chanson indienne, ça devenait quelque chose dans la bouche de Clemens, comme si elle faisait descendre Dieu du ciel. Moi, au lieu de parler à Dieu, je choisissais l’alcool et les femmes, mais Il semblait être là quand même. Et Il devait se sentir bien lui aussi, de nous voir nous amuser. Il peut pas critiquer ça, ce serait contre nature. Des fois, quand j’étais couché avec une femme, quand la nuit était épaisse et qu’un loup chantait dans les collines, je me disais que Dieu était tout près. Je me disais que c’était un ami, Boone, et pas un salopard coincé qui inscrivait mon nom sur la liste de l’enfer. Des fois, quand je regarde les plaines, si vastes et imposantes que ça donnait le tournis, je me disais que Dieu était là aussi. Qui a fait tout ça, qui a donné des yeux aux hommes pour voir et un cœur pour ressentir, si c’est pas Dieu ?«
B. Guthrie, « La Captive aux Yeux clairs », pp. 375-376.
Bien fraternellement.
Luc Schweitzer,sscc
20141011 –Cinéma
MOMMY
un film de Xavier Dolan.
Dans une interview à Télérama, le jeune prodige du cinéma québecois Xavier Dolan affirmait être hypocondriaque, avoir « tout le temps peur de mourir ou de ne plus pouvoir [s’]exprimer ». Est-ce la raison pour laquelle il enchaîne les films à une cadence effrénée et qu’à 25 ans seulement il présentait au dernier festival de Cannes son cinquième opus filmique, « Mommy », à présent sur nos écrans? Quoi qu’il en soit, ce qui est sûr, c’est que la profusion de ses réalisations ne nuit en rien à leur qualité. « Mommy »est un film impressionnant de maîtrise et de virtuosité, qui méritait amplement le prix du jury qui lui fut accordé à Cannes.
C’est aussi un film qui passionne par le sujet qu’il aborde, celui de la filiation, des rapports compliqués entre mère et fils. Dans un Canada légèrement anticipé, où l’on a promulgué une loi autorisant les parents à placer en institution leur enfant turbulent, Diane (Anne Dorval) doit récupérer son fils adolescent Steve (Antoine-Olivier Pilon), un garçon perturbé, hyperactif, capable de soudains accès de violence et usant sans complexe du dialecte local (le joual), un mélange de français et d’argot des plus truculents!
Etrange « famille », d’autant plus étrange qu’intervient, assez rapidement, une énigmatique voisine, Kyla (Suzanne Clément), qui, délaissant quelque peu son mari et son enfant, s’attache à nos deux éclopés au point de s’incruster, comme on dit, dans leur vie. Son calme et sa présence apaisante la font non seulement accepter mais désirer. Ainsi se forme le curieux trio que Xavier Dolan fait évoluer dans des scènes contrastées, faisant alterner de grandes crises avec de grands bonheurs, des larmes et des joies, des angoisses et du bonheur (ou un semblant de bonheur).
L’amour est là, bien présent, mais, comme on s’y attend quand on a affaire à des écorchés vifs, il s’exprime souvent de façon maladroite et non sans ambiguïté. Tout au long du film, on s’interroge, par exemple, au sujet de l’amour réel de Kyla pour Diana et son fils:comment peut-elle aimer à ce point ces deux-là alors que, dans le même temps, elle semble délaisser presque totalement sa propre famille?
Xavier Dolan, en réalisateur malin et talentueux, donne des pistes mais se garde d’infliger des explications. Il enchaîne scènes fortes et scènes plus paisibles, le plus souvent avec bonheur, mais avec, de temps à autre, une scène un peu trop étirée, nous laissant nous débrouiller avec ses personnages truculents et énigmatiques. Il use d’un cadre étroit qui enserre les personnages, mais qui soudain s’élargit pour faire place aux scènes les plus heureuses du film. Il ose des scènes lyriques d’une grande beauté à la fois visuelle et sonore. Il impose des scènes violentes et des dialogues très verts…Son talent de metteur en scène est indéniable et il séduit, même quand il est quelque peu excessif!
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20140927 –Cinéma
LEVIATHAN
un film de Andrei Zviaguintsev.
De superbes plans de côtes battues par les flots de la mer de Barents ouvrent et ferment ce film tout en faisant entendre une sublime musique composée par Philip Glass :la mer, splendeur de la création mais aussi, selon la Bible, lieu où séjourne le monstre marin Léviathan. Source d’inspiration pour le philosophe Thomas Hobbes ou pour Julien Green qui en fit le titre d’un de ses romans les plus sombres, voici donc à nouveau Léviathan affairé à répandre le mal dans un coin perdu du nord de la Russie.
Ce serait une erreur que de voir dans ce film un portrait de la Russie, comme si cet immense pays pouvait être réduit, le temps d’une fiction, à un microcosme. Zviaguintsev dénonce certains des maux qui affectent son pays, l’alcoolisme et la corruption, comme ils affectent bien d’autres pays sur la terre. Le contexte est russe, la réalité décrite ici est universelle.
Décidé à spolier Kolia de tous ses biens, de sa maison, de son garage, de sa terre, le maire d’une bourgade, petit potentat local, est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Il ne fera fi d’aucun autre pouvoir, ni de celui de la justice, ni de celui de l’Eglise, mais saura habilement les mettre de son côté. Au tribunal, à deux reprises, lors de scènes kafkaïennes, la juge récite le rendu de son jugement à la vitesse d’une mitraillette crachant ses balles. Quant au représentant de l’Eglise, il dit et répète que le pouvoir vient de Dieu, ce qui sous-entend qu’il n’y a rien de mieux à faire que de plier devant la volonté de qui le détient.
Que peut faire Kolia, sur qui peut-il compter? Sur son ami avocat venu de Moscou le seconder ? Pas si sûr…Sur son épouse et sur son fils ? Comme le pauvre Job du récit biblique, ne perdra-t-il pas tout ce qu’il possède et tout ce sur quoi il pouvait s’appuyer ? Et quand il pose la question :« Pourquoi ? Pourquoi, mon Dieu ? », rien ni personne ne lui répond, si ce n’est le bruit de la mer où rode peut-être encore Léviathan. Quant au pope qu’il rencontre un peu plus tard et à qui il demande où est le Dieu de miséricorde, c’est en citant le livre de Job et en racontant l’histoire de ce dernier qu’il répond. N’y a-t-il donc rien d’autre à faire que de se résigner ?
Dans une interview, Zviaguintsev explique que, selon lui, le livre de Job ne se termine peut-être pas aussi bien qu’on l’imagine…Et il ajoute que ce qu’il cherche à dénoncer, ce n’est pas la religion en tant que telle, mais plutôt le pharisaïsme. Dans ce cas, si sa critique est sévère, elle l’est à juste titre !
C’est un film implacable et terrible que ce « Léviathan », mais sûrement pas un film de trop :ce qu’il dénonce, la collusion des pouvoirs en vue d’écraser le faible, il le dénonce avec efficacité et pour de justes raisons !
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20140920 –Littérature
LE ROYAUME
un livre de Emmanuel Carrère.
Que les membres du jury Goncourt aient pris la décision de ne pas le retenir dans leur sélection n’y change rien :c’est à juste titre que ce livre d’Emmanuel Carrère a été presque unanimement encensé par la critique. Pour ce qui me concerne, c’est avec des sentiments mêlés de curiosité et d’appréhension que j’en ai entrepris la lecture, appâté précisément par le nombre de commentateurs qui le désignaient comme le grand livre de cette rentrée littéraire de septembre 2014. Curiosité parce qu’il est question de ce qui me tient à cœur :le Christ, l’Evangile, la foi chrétienne, les premiers témoins de la foi. Appréhension parce que je me doutais qu’il ne s’agissait en rien d’un ouvrage apologétique, mais d’un récit critique qui, peut-être, ébranlerait peu ou prou le socle de mes propres convictions.
Le livre à présent lu, ma curiosité évidemment n’a plus lieu d’être. Quant à mes craintes, elles ont laissé place au seul plaisir d’avoir été en quelque sorte, le temps de ma lecture, le compagnon de route d’un écrivain qui écrit comme un honnête homme. Et que ce dernier se présente comme un incroyant ne m’a pas déstabilisé, mais m’a contraint à un bel effort de réflexion dont je n’ai qu’à me féliciter. Rien de tel, pour un croyant, que de se confronter à la pensée de celui qui affirme ne pas croire !
Car c’est un livre passionnant que « Le Royaume », le livre composite d’un homme qui se souvient d’avoir été croyant, il y a de cela une vingtaine d’années, et qui, tout en exprimant son effarement, ne cesse de s’interroger lui-même et, du même coup, de nous interroger, nous, les croyants d’aujourd’hui. Comme disait un de ses amis, « c’est une chose étrange, quand on y pense, que des gens normaux, intelligents, puissent croire à un truc aussi insensé que la religion chrétienne… » (p. 13). Cela paraît tellement déraisonable en effet que, lorsque Emmanuel Carrère explore sa conversion de 1990 et ses propres années de croyant, il le fait constamment sur le ton de la surprise et de la consternation. La lettre qu’il écrivit à sa marraine au moment de sa conversion lui semble aujourd’hui « sonner faux » (pp. 54-55). De même les méditations qu’il écrivait sur l’Evangile de Jean et qui, lorsqu’il les relit, le plongent dans la stupéfaction ! (pp. 60 et ss. ).
Devenu donc, comme il le dit, « un sceptique, un agnostique », s’il affirme aussitôt « s’en porter bien », il n’en éprouve pas moins le besoin, voire la nécessité, de rouvrir le dossier et d’enquêter sur les origines et la singularité du christianisme. Nous sommes prévenus, ce qu’il entreprend, c’est à la manière d’un de ceux qu’il considère comme un maître et dont les ouvrages restent toujours à portée de sa main, Ernest Renan. Comme ce dernier, il se lance dans l’aventure de relire, d’explorer et d’interpréter en non-croyant non pas tant la vie de Jésus, mais les premiers âges du christianisme (ou de ce qu’on appellera plus tard le christianisme). Et il le fait en empruntant deux portes, comme il le dit, c’est-à-dire en suivant les pas de deux des plus grands témoins du christianisme naissant, Paul et Luc.
Encore une fois, je le dis et le répète pour ceux de mes lecteurs qui sont croyants, acceptons de bonne grâce que les Lettres de Paul, le livre des Actes des Apôtres et l’ensemble du Nouveau Testament puissent être lus et examinés autrement que d’une manière apologétique. Il sera même bon et profitable à plus d’un de lire des commentaires et des supputations autres que celles auxquelles on est habitué. Pour d’autres, il est vrai, les allégations faites par l’auteur du « Royaume » seront probablement perturbantes ou provoqueront une réaction de rejet.
Pour ce qui me concerne, j’ai apprécié d’être bousculé, malmené par le voyage entrepris en compagnie d’Emmanuel Carrère et par le regard peu orthodoxe qu’il porte sur ces deux grandes figures que sont Paul et Luc. Suivre les pas de ces derniers, c’est aussi (et surtout quand ils’agit de Luc), s’aventurer sur le terrain glissant des hypothèses. De Luc, on sait en vérité bien peu de choses. Mais Emmanuel Carrère choisit pourtant de s’attacher à sa personne et, du même coup, d’émettre nombres de suppositions. Le travail qu’il fait est à la fois travail d’exégète, d’historien et de romancier. Mais c’est avec sérieux qu’Emmanuel Carrère avance des hypothèses au sujet de Paul et surtout de Luc. Jamais elles ne sont gratuites ! Au contraire, il justifie soigneusement chacune d’elles et ne craint pas d ‘énoncer, si besoin est, les autres hypothèses possibles. « Paul était un génie, écrit-il, planant très loin au-dessus du commun des mortels, Luc un simple chroniqueur qui n’a jamais cherché à s’exempter du lot. » (p. 486). Face à la majesté et à la rudesse de Paul, Luc est décrit en effet comme l’homme de la conciliation, celui qui « pense que la vérité a toujours un pied dans le camp adverse. » (p. 466). Evidemment, personne ne sera contraint d’accepter béatement les portraits ainsi tracés par l’auteur, mais il faut admettre qu’ils sont toujours fondés et solidement étayés.
Et puis, Emanuel Carrère ne manque pas une occasion de rappeler au lecteur que c’est lui qui raconte et qu’il ne prétend nullement imposer sa lecture à qui que ce soit. Le recours fréquent à la première personne du singulier, au « je », a, paraît-il, agacé l’un ou l’autre critique, parmi lesquels Bernard Pivot, reprochant à l’auteur du « Royaume » le péché d’égoïsme. Mon Dieu ! Il me semble au contraire que c’est là une des grandes qualités de ce livre. Plutôt que de suivre la route tracée par nombre de romanciers écrivant des œuvres à fondement historique et qui rédigent soigneusement leur œuvre sans jamais user du « je », de peur de rappeler au lecteur que ce qu’il lit n’est rien d’autre qu’un regard singulier, celui d’un homme (ou d’une femme, car je pense, entre autres, à Marguerite Yourcenar écrivant « Mémoires d’Hadrien »), Emmanuel Carrère ne manque pas une occasion de dire et de répéter que c’est lui qui écrit, racontant volontiers des épisodes de sa vie et de son cheminement. C’est une des raisons qui me font dire que, décidément, « Le Royaume » est l’ouvrage d’un honnête homme.
Un honnête homme qui sait très bien, d’ailleurs, que ce qu’il raconte, que ce qu’il affirme, s’arrête précisément là où commence le mystère de la foi. Il a conscience, et il le dit, d’écrire le plus souvent, à la manière des « sages et des savants » dont Jésus recommandait de se méfier. Les dernières pages du « Royaume », cependant, nous font entrevoir autre chose, une autre réalité, celle qui demeurera toujours mystérieuse et qu’on trouve chez les « plus petits », en l’occurrence, pour Emmanuel Carrère, à l’Arche de Jean Vanier. « Ce livre que j’achève là, dit-il, je l’ai écrit de bonne foi, mais ce qu’il tente d’approcher est tellement plus grand que moi que cette bonne foi, je le sais, est dérisoire. Je l’ai écrit encombré de ce que je suis :un intelligent, un riche, un homme d’en haut :autant de handicaps pour entrer dans le Royaume. Quand même, j’ai essayé. » (p. 630).
Luc Schweitzer,sscc
20140907 –Cinéma
HIPPOCRATE
un film de Thomas Lilti.
Il y a de bonnes raisons pour que ce film sonne vrai, à commencer par la profession de son réalisateur, Thomas Lilti, lui-même médecin travaillant en interne dans un hôpital et connaissant donc son sujet sur le bout des doigts. Mais encore fallait-il être capable de faire un film qui se tienne, bien construit et bien dirigé, et c’est indéniablement le cas. Hormis quelques scènes outrées dont on aurait pu se passer, le film non seulement passionne et tient en haleine, mais rend parfaitement compte de la complexité de ce monde de l’hôpital.
Pour ce faire, Thomas Lilti s’attache à suivre les premiers pas de Benjamin (Vincent Lacoste), débarquant aux urgences d’un hôpital et, qui plus est, dans le service où travaille son propre père (Jacques Gamblin). Le rejoint bientôt un autre jeune médecin prénommé Abdel et arrivant d’Algérie (Reda Kateb). Entre les deux hommes se noue rapidement une relation faite à la fois de défiance et d’amitié.
Car, s’il y a bien des moments de détente et les farces de carabins auxquelles on est en droit de s’attendre, il y a surtout, dans ce film, beaucoup de tension et nombre de difficultés. Manque de personnel, manque de moyens, appareils en panne, solitude, détresse…Le constat est cruel et inquiétant. Quoi qu’on fasse (ou qu’on ne puisse pas faire, à cause d’une défaillance de matériel), quelles que soient les décisions prises, on risque de faire des erreurs…Que le médecin soit seul, qu’il se fasse aider par un confrère avenant, ou qu’il soit en conflit avec un autre service arrivé au chevet du malade plus tôt que lui, dans tous les cas les décisions peuvent être lourdes de conséquences, à la fois pour le malade bien sûr, mais aussi pour le médecin (qui sera ou non protégé par l’hôpital) et pour les familles qui, évidemment, veulent en savoir toujours davantage et posent des questions embarrassantes. Comme le dit Abdel à Benjamin, « médecin en hôpital, ce n’est pas un métier, c’est une espèce de malédiction »!
Mais, fort heureusement, le film de Thomas Lilti ne se cantonne pas uniquement au registre du constat négatif et inquiétant. Ce qui rassure, paradoxalement, malgré les défaillances humaines dont il est question et les petits arrangements de caste, c’est de voir à l’oeuvre un personnel dévoué, combatif (se mettant en grève quand c’est nécessaire, tout en continuant à travailler!), et, pour tout dire en une expression, forçant l’admiration. Le réalisateur sait aussi nous rendre sympathiques et admirables les visages de celles et ceux qui travaillent, dans de dures conditions et pour des salaires de misère, en hôpital.
Beaucoup de séries télévisées traitent du monde de l’hôpital (c’est presque devenu un genre à part entière), mais le font dans un registre plus ou moins fantaisiste. Ici, c’est autre chose:c’est un regard juste et précis. On aura grand intérêt à le découvrir, car il fera sans doute évoluer notre propre regard au sujet de ce monde complexe et, somme toute, méconnu de l’hôpital!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20140828 –Cinéma
PARTY GIRL
un film de Marie Amachoukeli,Claire Burger et Samuel Théis.
Tout est vrai dans ce film, qu’on se le dise! L’histoire s’inspire très largement d’une histoire réelle, les acteurs sont tous des comédiens non professionnels et plusieurs d’entre eux interprètent leurs propre histoire, les dialogues sont prononcés avec l’accent mosellan, tantôt en français tantôt en platt, les décors sont ceux du bassin houiller de Lorraine, entre France et Allemagne, du côté de Spicheren et Forbach…Tout est vrai, vous dis-je! Soit, mais l’authenticité au cinéma donne-t-elle forcément un gage de qualité? Non seulement je ne le crois pas, mais il me semble même, à force de voir des films, que ceux dont les scénarios sont inventés de toute pièce sonnent, en règle générale, plus vrais que ceux dont les scénarios s’inspirent, comme on dit, d’une histoire réelle.
Il y a cependant des exceptions et ce film, à mon avis, en est une, et de taille. Le trio de réalisateurs qui s’est lancé dans cette aventure a su donner du souffle, du rythme et de la passion à cette histoire en évitant presque toujours l’excès de sentimentalisme qui aurait pu la rendre indigeste.
Et puis, il faut le dire, les personnages dont il est ici question sont, malgré leurs défauts, si attachants qu’on se prend vite, dès les premières scènes, d’une véritable passion pour eux. Angélique, le personnage principal, surprend, agace, déstabilise et fascine. A 60 ans peut-être commence-t-elle à se fatiguer de son métier de danseuse de cabaret et pense-t-elle qu’il est grand temps d’en finir avec cette vie-là? Quoi qu’il en soit, quand Michel, son soupirant (lui-même mineur de fond à la retraite), lui propose le plus sérieusement du monde de l’épouser, elle a beau commencer par en rire, elle finit par se dire que ce n’est peut-être pas une mauvaise idée.
Elle l’avait affirmé pourtant, en parlant d’une de ses collègues, que les filles de cabaret, contrairement aux apparences, ne sont pas des filles faciles! Est-ce si simple, en effet, de passer presque d’un coup d’une vie trépidante et nocturne à une petite vie tranquille avec un retraité dans une petite maison avec un petit jardin et de petites occupations? Les quatre enfants d’Angélique, dont elle ne s’est guère occupée pourtant, la poussent à ce changement de vie. Mais vivre avec Michel, passer le reste de sa vie avec lui, était-ce une si bonne idée?
Etonnant film à qui a été décerné la Caméra d’Or au festival de Cannes, « Party Girl »donne à voir et à aimer des gens qu’on ne voit pas si souvent au cinéma, des gens simples, des gens de peu, et il le fait avec un indéniable talent.
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20140825 –Cinéma
LES COMBATTANTS
un film de Thomas Cailley.
Dérèglement climatique, menaces de pandémie, guerres, catastrophes nucléaires…A force de prédire des cataclysmes et de voir poindre les nuées sombres de l’Apocalypse, il est des esprits tourneboulés et des gens qui paraissent bizarres. Et « bizarre »est bien le qualificatif qu’emploie Arnaud (Kévin Azaïs) pour parler de Madeleine (Adèle Haenel), la jeune fille qu’il a croisée lors d’une démonstration militaire et avec qui il a dû s’empoigner à son corps défendant.
A la mort de leur père, son frère aîné et lui ont repris l’entreprise de menuiserie familiale et les voilà qui, précisément, sont engagés pour un travail par les parents de la jeune Madeleine. Bizarre jeune fille, en effet, qui s’entraîne à nager en portant un sac lesté de briques et qui avale sans broncher un poisson broyé au mixeur! C’est que, elle en a la certitude, « tout va bientôt péter »et il n’y a pas d’autre alternative que de se préparer au pire. Pas à la manière des Mormons, précise-t-elle, qui ne font que de reculer l’échéance en entreposant des ressources dans des abris, mais en s’entraînant sans compter afin de survivre quand surviendront les inéluctables fléaux.
Fasciné par Madeleine, Arnaud est prêt à tout pour ne plus la quitter, même à lâcher son frère pour accompagner la jeune fille à un stage commando organisé par l’armée. Mais jouer à la guéguerre n’est peut-être pas ce qui convient à une fille aussi rebelle et aussi indépendante que l’est Madeleine. Et encore moins à Arnaud. D’où une échappée, une fuite en territoire pas très hostile, mais où il va falloir en effet inventer des modes de survie. Et qui sait si ce n’est pas là aussi que se manifestera enfin non plus les instincts de survie, mais la plénitude de la vie (ou de deux vies qui s’accordent pour n’en faire qu’une)…
Ce premier film de Thomas Cailley intrigue et suscite irrésistiblement l’enthousiasme. A la fois comédie romantique et film d’aventures, son sujet, sa mise en scène et son ton pleins d’originalité le font constamment échapper au « déjà vu »! Malgré son sujet, c’est un film rempli d’humour et qui donne l’impression d’avoir été filmé comme un rêve éveillé. Quant aux deux acteurs principaux, ils méritent les plus grands éloges. Adèle Haenel, en particulier, fait preuve ici d’un immense talent:sa prestation fascine littéralement d’un bout à l’autre du film!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20140812 –Cinéma
WINTER SLEEP
un film de Nuri Bilge Ceylan.
Auréolé de la Palme d’Or qui lui a été décernée au festival de Cannes, voici donc ce film du turc Nuri Bilge Ceylan, sans conteste un des plus grands cinéastes d’aujourd’hui. Cette oeuvre d’une durée inhabituelle (3h16!) n’en tient pas moins le spectateur en haleine par son intensité, sa beauté, sa cruauté et la perfection de sa mise en scène.
Tout se déroule dans un paysage austère et beau de la Cappadoce, autour d’un village de maisons troglodytes, là où Aydin s’est retiré, après avoir mené une carrière de comédien (mais sans jamais s’abaisser à jouer dans des films de télévision, comme il l’affirme!), afin de de prendre la direction d’un hôtel. L’hiver arrive et les touristes se font rares. Comment donc s’occuper dans ce coin perdu de campagne presque dénué de distractions? Aydin passe une grande partie de son temps assis à son bureau et pianotant sur son ordinateur. Il rédige des articles pour une feuille de chou locale et s’est mis en tête de rédiger une histoire du théâtre turc.
Près de lui se tiennent des personnages, son chauffeur et homme à tout faire et, surtout, les deux femmes qui partagent sa vie. Sa soeur Necla s’est retirée là après son divorce, mais elle regrette déjà les splendeurs délaissées d’Istanbul et s’ennuie ferme! Elle passe son temps allongée sur un sofa, pétrie d’oisiveté près de son frère et commentant ses articles …Car, prétend-elle, elle n’est pas si oisive qu’elle en a l’air, sa tête fonctionne sans arrêt et elle ne se prive pas d’éreinter sans pitié les écrits d’Aydin. L’autre femme qui vit là, c’est l’épouse de celui-ci, Nihal, bien plus jeune que lui et qui, elle aussi, s’est cherchée une occupation pour agrémenter ses journées. D’autant plus que les relations entre mari et femme se sont fort distendues…Nihal essaie donc de combler le vide de ses journées en se livrant à une activité caritative, aidée et soutenue par des habitants du village dont l’instituteur.
Entre Aydin et les deux femmes, tout au long du film, la tension monte et les propos sont de plus en plus acerbes. Necla ne se prive pas de faire remarquer à son frère que ses articles, bien souvent, ne valent pas grand chose. Il a beau se pavaner en lisant une lettre d’une de ses lectrices, une lettre admirative mais surtout quémandeuse, cela ne change rien à l’inanité de ses propos, lui qui se mêle d’écrire même sur des sujets dont il ignore tout !
Mais c’est entre lui et son épouse Nihal que grandit surtout l’incompréhension. Des événements, qui pourraient paraître presque minimes, en sont les révélateurs. A commencer par le geste violent d’un gamin qui a jeté une pierre et cassé une vitre de la voiture d’Aydin. Ramené chez lui, l’enfant se trouve être le fils d’un locataire impécunieux de ce dernier. S’ensuit une altercation entre le père du briseur de vitre, le chauffeur d’Aydin et l’oncle du gamin. Et que fait Aydin pendant ce temps ? Il reste bien à l’écart, loin de la scène, comme un spectateur qui se mettrait tout au fond d’une salle de spectacle afin de n’être pas souillé par le moindre postillon venu de la scène. Lui qui se glorifie volontiers de sa carrière de comédien, le voilà métamorphosé en spectateur. Il n’est plus responsable de rien :si les huissiers sont intervenus chez le mauvais payeur, c’est un automatisme, il n’y est pour rien !
Mais Aydin est aussi et surtout jaloux de sa femme :il voit d’un mauvais œil ses activités caritatives et les liens qui se sont tissés avec l’instituteur et d’autres villageois. Et quand il décide de prendre les choses en main, quand il cherche à reprendre une place d’acteur, il s’y prend de la pire manière qui soit, provoquant la gêne, la peine, la colère de Nihal. Elle le lui dira, dans une scène d’une terrible intensité ! Son orgueil, sa morgue, sa propension à humilier les autres et à les mépriser…Nihal se libère du poids de ses rancoeurs en assenant à son mari ses quatre vérités !
Mais elle-même, si opposée de caractère à son mari, si touchante, si désireuse de faire le bien, elle, Nihal, qui a le cœur sur la main, elle qui ne supporte pas la souffrance des autres, comment s’y prendra-t-elle ? Comment fera-t-elle pour soulager la misère d’autrui ? Saura-t-elle faire le geste qui convient ? Saura-t-elle éviter les maladresses ?
Ce film certes très long, mais d’une force telle qu’on ne peut pas s’y ennuyer, s’inspire de récits de Tchekhov et semble poursuivre l’exploration entreprise jadis par Ingmar Bergman dans un film comme « Scènes de la vie conjugale ». Comme le grand cinéaste suédois, Ceylan expose sans pitié les atermoiements et les souffrances d’un couple en crise. Il le fait d’ailleurs d’une manière très théâtrale, le film se composant en grande partie de longues scènes très dialoguées, magnifiquement éclairées et parfois discrètement accompagnées par la mélodie d’une des plus belles sonates de Schubert. Un grand film et une Palme d’Or méritée.
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20140707 –Cinéma
JIMMY’S HALL
un film de Ken Loach.
Fidèle, contre vents et marées, à ses idéaux de gauche, Ken Loach nous est revenu, au dernier festival de Cannes, avec ce film qui fait, en quelque sorte, suite au « Vent se lève », sa Palme d’Or de 2006. Après avoir évoqué, dans ce film, la guerre d’indépendance irlandaise et la guerre civile qui lui succéda au début des années 1920, le cinéaste anglais se penche ici sur une période apparemment plus calme et plus paisible de l’histoire de l’Irlande, dix ans plus tard, au début des années 30.
C’est en 1932 exactement que revient dans son coin d’Irlande un nommé Jimmy Gralton, après un exil forcé d’une dizaine d’années aux Etats-Unis. Il n’a l’intention que de retrouver sa mère, peut-être aussi celle qu’il a aimée autrefois, et de mener une vie tranquille. Mais, dans cette campagne profonde de l’Irlande, beaucoup s’ennuient et sollicitent Jimmy afin qu’il rouvre la salle qu’il animait dans le passé et qui est à présent délabrée.
Après s’être fait quelque peu prier, Jimmy s’y résoudra. La salle, remise à neuf, servira aussi bien de lieu de rencontre, d’éducation, de sport que de salle à danser. Aussitôt, on s’y presse, qui pour parler des événements du monde et de l’Irlande, qui pour lire ou écouter des poèmes de Yeats, qui pour pratiquer la boxe ou d’autres activités. Et les soirs, il faut voir les foules qui s’y donnent rendez-vous, non seulement pour danser les danses locales, mais pour s’y déhancher au son des musiques de jazz que Jimmy n’a pas manqué de ramener de son exil à New-York.
Toute cette agitation, bien sûr, ne passe pas inaperçue et il y en a pour s’en inquiéter, à commencer par le Père Sheridan, le curé du lieu, et par les grands propriétaires terriens. Comment! Voilà des gens qui osent s’affranchir de l’autorité de l’Eglise! Comment! Voilà des gens qui ont l’audace de penser par eux-mêmes, de s’auto-éduquer et de revendiquer des droits! Comment! En voilà qui ont le culot de pratiquer des danses lascives au son d’une musique assourdissante! Au lieu des tristes mines qu’on voit à l’église, voilà les figures réjouies et les rires de ceux qui font la fête! Le contraste est saisissant en effet:d’un côté, le curé qui, du haut de sa chaire, fait régner la peur et menace les récalcitrants, allant même jusqu’à égrener leurs noms pour les désigner à la vindicte; de l’autre, des hommes et des femmes respirant l’air de la liberté, heureux d’échanger, de vivre, de fêter…
Ce tableau, qui pourrait paraître caricatural, Ken Loach et son scénariste ont su lui donner quelque nuance. Le Père Sheridan sait aussi, à l’occasion, reconnaître les qualités de son adversaire. Et surtout, il est accompagné d’un vicaire qu’on devine réticent et peu enclin à suivre tous les diktats du curé. Reste cependant un combat sans merci:l’Eglise et les riches, main dans la main, pour en finir, une fois pour toutes, avec ces « communistes »et avec ces « athées »!
Une des meilleures scènes du film nous montre l’audacieux Jimmy Gralton allant à la rencontre de son ennemi, le Père Sheridan, et dans le lieu même où ce dernier fait sentir le mieux son pouvoir:non seulement l’église mais, à l’intérieur de celle-ci, le confessionnal! Mais ce n’est pas pour confesser ses péchés que Jimmy s’y présente, c’est pour reprocher au curé son pharisaïsme!
N’a-t-il pas raison et ne devons-nous pas entendre, si nous sommes membres de l’Eglise, ce film comme une mise en garde? Gardons-nous bien de rêver à une Eglise puissante ou triomphante telle qu’elle sévissait il n’y a pas si longtemps en Irlande et ailleurs! Chassons toute nostalgie de nos coeurs et de nos pensées! Quand l’Eglise exerce trop de pouvoir, elle a vite fait d’être gangrenée par le pharisaïsme! Si Eglise il y a, que ce soit dans l’humilité, le service, la pauvreté et la joie.
Ce beau film de Ken Loach, injustement snobé au dernier festival de Cannes, nous y invite! Nous n’avons nul besoin de ministres tonitruant tristement dans leur chaire contre les soi-disant désordres du monde. Nous avons besoin de chrétiens courageux et joyeux allant à la rencontre de tous, y compris de ceux qu’on a vite fait de juger perdus! Jésus mangeait avec les pécheurs et on le lui reprochait. Le Père Sheridan, s’il n’avait pas été un ministre imbu de lui-même et sûr de son bon droit, s’il avait été un véritable disciple du Christ, serait allé manger, rire et même danser à la salle de Jimmy!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20160630 –Cinéma
LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA
un film de Isao Takahata.
Il n’en croit pas ses yeux, le pauvre coupeur de bambous qui trouve un soir, dans une pousse, une minuscule princesse. L’ayant recueillie et l’ayant montrée à sa femme, voilà que la princesse se change en un bambin affamé. Le couple, pressentant qu’il a affaire à un être promis à de grandes destinées, décide de l’élever. Des signes merveilleux ne tardent pas à survenir:la femme du coupeur de bambous se trouve tout à coup en capacité d’être elle-même la nourrice du bébé; l’enfant grandit à un rythme étonnant; le coupeur de bambous trouve dans une pousse un joli magot…De quoi tourner la tête même de l’homme le plus posé. Surnommée « Pousse de Bambou »par les galopins de ce coin de campagne, la fillette recueillie s’attache tout particulièrement à l’un d’eux et n’envisage rien d’autre que de rester dans ce lieu. Mais les événements ont fait chavirer l’esprit du coupeur de bambous:il décide d’emmener l’enfant à la capitale, de lui faire construire (grâce au trésor trouvé dans une pousse) une demeure luxueuse, de la faire éduquer selon les bonnes manières et de l’introduire dans la haute société. Un sage consulté lui donne alors le titre et le nom de princesse Kaguya.
Ainsi démarre ce conte aussi célèbre au Japon, paraît-il, que l’est chez nous l’histoire du Petit Chaperon Rouge. La jeune princesse ayant grandi et ayant la réputation d’être la plus belle jeune fille de la capitale, les prétendants bien sûr ne manquent pas. Le coupeur de bambous, son père adoptif, n’en demandait pas tant. Mais comment réagira Kaguya? Acceptera-t-elle de suivre sagement le chemin qu’on lui a tracé? Ne garde-t-elle pas la nostalgie de la vie simple qu’elle menait à la campagne? Et d’où vient-elle en vérité, cette princesse surgie comme par miracle dans une pousse de bambou?
En adaptant ce conte pour le studio Ghibli, le trop rare Isao Takahata nous offre une oeuvre d’une somptueuse beauté. Le style qu’il adopte ici est aux antipodes de celui de Hayao Miyazaki, l’autre grand réalisateur du mythique studio. Au lieu de la ligne claire et des couleurs vives dont use ce dernier, Takahata opte pour un dessin qui ressemble à une esquisse et à des tons d’aquarelle. Le résultat est fascinant. C’est comme si l’on voyait le film se dessiner sous nos yeux. C’est superbe.
Passionnant aussi est le « message »dont ce film est porteur. Dénonciation des ridicules de la haute société, des moeurs absurdes de ceux qui sont gonflés de leur orgueil de caste. Mise en garde aux parents pour qui l’éducation consiste à imposer ses rêves d’adulte à ses enfants, quitte à les conduire au désastre et à une irrépressible tristesse. Plus une petite touche de transcendance qui est peut-être le seul point faible de cette oeuvre:on aurait pu se passer, me semble-t-il, de l’arrivée des Sélénites (c’est-à-dire des habitants de la lune) voyageant sur un nuage et conduit par un Bouddha! Hormis cette scène (l’une des dernières du film) à la limite du grotesque, tout le reste est confondant d’intelligence et de beauté. Un grand film d’animation à découvrir sans tarder!
9/10
Luc Schweitzer,sscc
20140609 –Cinéma
BIRD PEOPLE
un film de Pascale Ferran.
En songeant à ce beau et étrange film de Pascale Ferran, ce qui me vient irrésistiblement à l’esprit, ce sont les romans du grand écrivain japonais Haruki Murakami. Comme l’auteur de « La Fin des Temps »ou de « 1Q84″, toujours prompt à faire surgir l’inattendu et le poétique du sein même de la banalité du quotidien et des vies les plus mornes, Pascale Ferran, dans son « Bird People », entraîne malicieusement et judicieusement le spectateur dans des contrées et sur des hauteurs qu’il ne prévoyait pas d’explorer.
Rien de moins poétique, en effet, semble-t-il, que le cadre et que les personnages choisis par la réalisatrice. Après s’être attardé sur les foules et sur quelques visages d’anonymes préoccupés, rêvant, se distrayant, allant à leurs occupations, la caméra se concentre sur deux d’entre eux:Gary (Josh Charles), un Américain en transit à Roissy et devant rapidement s’envoler pour Dubaï afin d’y conclure un important contrat, et Audrey (Anaïs Demoustier), étudiante travaillant comme femme de chambre dans l’hôtel même où réside Gary afin de financer ses études.
Banalité, disais-je, vies mornes, sans éclat…Sauf que survient l’inattendu, sauf que surgit un je ne sais quoi qui provoque de grands changements et de grandes prises de décision. Pour Gary, c’est en pleine nuit, alors que, dans sa chambre d’hôtel, il est assailli par de terribles crises d’angoisse, que vient inopinément la décision irrévocable:tout laisser, tout changer, tout abandonner de sa vie antérieure, donner sa démission, rompre avec sa compagne, tout recommencer! Par téléphones et par écrans interposés, il lâche tout, il abandonne le navire de sa vie puisque, il en est sûr, c’est un navire en perdition.
Pour Audrey, cela survient insidieusement, mais sans angoisse…Certes, il y a les questions que lui pose son père au téléphone et qui ont le don de l’agacer, certes il y a les exigences de ses employeurs qu’elle a bien envie d’envoyer paître…Certes, il y a eu aussi ce moineau qu’elle a aperçu, posé sur un rebord de fenêtre, et à qui elle a souri…Mais de là à tout quitter dans un envol, dans une escapade, dans une métamorphose comme celle qui s’empare d’elle, comme celle qui la fait s’élever à tire-d’aile, voilà bien ce à quoi personne ne pouvait s’attendre! Etonnant voyage qui lui fait rencontrer un cousin d’Haruki Murakami, mais peintre celui-là et qui s’empresse d’immortaliser la scène à coups d’encre de Chine.
Le voyage d’Audrey prend fin subitement alors que commence celui de Gary. Les deux personnages se croisent fugitivement. L’un a retrouvé son triste quotidien, l’autre s’en va, mais ont-ils vraiment pu se libérer durablement de l’aliénation du capitalisme contemporain? Rien n’est moins sûr…
Ce qui est sûr, par contre, c’est que Pascale Ferran, cinéaste rare (son film précédent date d’il y a huit ans!), a parfaitement réussi son retour avec ce film mêlant intelligemment le réalisme et le fantastique.
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20140601 –Cinéma
LES DRÔLES DE POISSONS-CHATS
un film de Claudia Sainte-Luce.
Hasard ou providence:chacun emploiera le mot qui lui convient. Ce qui est sûr, c’est que ce film explore un grand mystère, celui de la rencontre de deux êtres qui se reconnaissent, qui reconnaissent, sans qu’il soit nécessaire de faire de beaux discours, qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Ce n’est pas une simple amitié, c’est une adoption, c’est comme si ces deux êtres, ces deux femmes, découvraient, ébahies, qu’elles sont de la même famille, mère et fille, fille et mère.
Ce premier film de la mexicaine Claudia Sainte-Luce impressionne d’autant plus le spectateur qu’il s’agit manifestement du vécu de la réalisatrice. C’est sa propre histoire qu’elle met en scène, au point qu’elle n’a même pas éprouvé le besoin de changer les prénoms des protagonistes. Hospitalisée pour une crise d’appendicite, Claudia fait la connaissance de Martha, sa voisine de lit. Mais si Claudia est admise à l’hôpital pour une opération assez anodine, il n’en est pas de même pour Martha qui souffre, elle, d’une maladie très grave.
Entre les deux femmes naît donc le lien étrange et fort que j’ai évoqué plus haut. Pour Claudia, qui mène une vie morne et esseulée de démonstratrice en magasin, comme pour Martha, qui sait que ses jours sont comptés, cette rencontre change la vie. Claudia apprend aussi à connaître les quatre enfants de Martha, elle passe de plus en plus de temps avec eux, elle se change en soeur et en confidente. Chacun et chacune porte son lot d’épreuves et de souffrances, mais l’adoption de Claudia tend à transformer la peine en joie et la grisaille en lumière. Car Martha, malgré sa maladie, sait transmettre une belle leçon de vie.
En rendant hommage à Martha et à ses enfants, Claudia Sainte-Luce a réussi un film émouvant et beau, malgré son sujet, et sans jamais verser dans le piège du pathos. Quant au curieux titre du film, il trouve son explication toute simple au cours de ce récit!
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20140523 –Cinéma
DEUX JOURS,UNE NUIT
un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Deux jours et une nuit: c’est le temps qui est accordé à Sandra (Marion Cotillard) pour sauver son emploi au sein d’une entreprise de panneaux solaires. Deux jours et une nuit: c’est le nouvel ultimatum qu’a réussi à négocier Juliette, l’amie de Sandra, afin d’organiser un deuxième vote (après celui qui devait évincer cette dernière de son emploi). Crise oblige, les salariés sont mis au pied du mur et contraints à un choix cornélien:ou ils toucheront une prime de mille euros et Sandra sera licenciée ou ils renonceront à la prime et Sandra retrouvera son emploi.
On l’apprend rapidement, cette dernière vient à peine de se sortir d’une dépression (dont on ne connaît pas la cause), elle est encore fragile, elle absorbe sans arrêt des pilules, et il lui faut pourtant mener ce combat. Elle a besoin de ce travail, elle doit se battre pour le garder, nonobstant l’opinion cynique d’un patron qui juge que son absence forcée pour cause de maladie n’a causé aucun tort à l’entreprise. On peut se passer d’elle, juge-t-on en haut lieu, d’où ce chantage à la prime qui fait la part belle à l’inhumanité et au mépris.
Poussée par son amie Juliette et par son mari (Fabrizio Rongione), Sandra entreprend de visiter, un par un, chacun des salariés de l’entreprise afin de le convaincre de voter en sa faveur (et, du même coup, de renoncer à la prime, puisque c’est le choix qui leur est imposé!). Cela pourrait être vite lassant, d’autant plus qu’il faut que Sandra tienne à peu près le même discours à chacun des salariés. Mais, avec les Dardenne, pas de place au ronron ni à l’ennui! Chaque rencontre est certes ponctuée par ce même discours qui revient comme le refrain d’un chant fait d’espoir et de détresse, mais chaque rencontre est aussi le moment d’un mini suspens, de l’attente angoissée d’une réponse, d’une acceptation, d’un refus, d’un revirement, d’une hésitation…Avec Sandra, le spectateur espère, pleure, sourit, est pris à la gorge…
Sandra vacille, Sandra chute, Sandra se relève, Sandra espère…On vibre avec elle, on souffre avec elle, on suffoque et on avance avec elle. Ce qu’on l’oblige à faire est inhumain et injuste:si elle retrouve son emploi, que diront les employés qui auront voté pour la prime et qui, du coup, l’auront perdue? Les Dardenne se gardent de porter des jugements sur les personnes:ceux qui souhaitent garder la prime ont de bonnes raisons de faire ce choix. Chaque rencontre de Sandra avec un salarié nous laisse entrevoir les difficultés de vivre, voire les détresses, que connaissent les autres. Sandra se bat pour son emploi, mais la plupart des autres aussi sont obligés de se battre, qui pour payer des échéances, qui pour soutenir financièrement un enfant qui fait des études, etc. Ce ne sont pas les personnes qu’il faut condamner, mais un système inique qui les fait pencher dangereusement du côté de la dureté, voire de la violence.
Reste ce que les Dardenne essaient toujours de détecter, de déceler, de retrouver, même quand il nous décrivent les pires détresses et les pires injustices: la part d’humanité. Rester un être humain, garder ou retrouver sa dignité d’homme ou de femme, même quand on est broyé par un système qui n’a que mépris pour la personne. Où donc Sandra puise-t-elle sa force, elle qui apparaît par moments si fragile et si défaillante? Dans l’amitié, dans la solidarité et dans l’amour. Il y a la force insufflée par son amie Juliette et par les autres salariés qui se rangent de son côté. Et il y a la force insufflée par son mari, bel exemple d’un amour qui relève, qui soutient, qui partage chaque souffrance, qui donne à espérer contre toute espérance. L’humanité, la grandeur et la beauté de l’humain qui ensoleillent ce film pourtant douloureux, les voilà.
Une fois encore, Jean-Pierre et Luc Dardenne nous proposent un film écrit, mis en scène et réalisé avec un soin et un talent qui ne peuvent qu’emporter l’adhésion. Il n’y a pas eu la moindre fausse note, jusqu’à présent, dans leur filmographie. C’est assez rare pour être souligné. Quant à Marion Cotillard, malgré son statut de star, en grande actrice qu’elle est, elle a su parfaitement s’adapter à l’univers et au style des deux frères. On ne se lasse pas de la scruter, on ne se fatigue jamais d’admirer son jeu.
9,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20140505 –Cinéma
PAS SON GENRE
un film de Lucas Belvaux.
Non, il n’est pas question, dans ce film, d’une supposée « théorie du genre »! Beaucoup plus simplement, il s’agit d’un homme et d’une femme que tout oppose et qui donc, en toute logique, n’auraient jamais dû vivre une aventure commune
Lui, Clément, c’est un prof de philo, parisien jusqu’au bout des ongles, fréquentant le Café de Flore, tellement parisien que la traversée du périphérique équivaut à ses yeux à une mise en exil. Elle, c’est Jennifer (prononcez « Djennifer », s’il vous plaît!):elle habite Arras, élève seule un fils et travaille dans un salon de coiffure. Lui, pour ses loisirs, on l’imagine se rendant à l’opéra; elle, avec ses collègues coiffeuses, elle adore se produire sur une scène de karaoké. Lui, c’est un lecteur assidu de Kant ou de Dostoïevski et l’auteur d’un ouvrage de philosophie; elle, c’est une lectrice d’Anna Gavalda et de magazines people.
Tout les oppose, en effet, sauf une étrange attirance qui sera la grande affaire de ce film plein de charme et qui, malgré les apparences, ne manque pas de finesse. Cela débute par l’annonce d’une catastrophe:Clément apprend par un courrier non seulement qu’il est détaché pour un an à Arras, mais qu’il devra enseigner la philo à des élèves pour qui cette matière compte peu! En voilà une punition! Il faut pourtant s’y résoudre, comme il faut aussi, même quand on ne jure que par la philosophie, entrer de temps à autre dans un salon de coiffure pour s’y faire couper les cheveux!
C’est donc ainsi, tout bonnement, que se fait la rencontre entre ces deux-là. La suite, c’est une histoire d’amour dont on se demande à tout moment si elle pourra ou non perdurer. Entre la pétulante Jennifer, toute à son rêve de vivre un grand amour, et le pensif et secret Clément qui semble parfois aimer vraiment et d’autres fois jouer à aimer, y a-t-il une autre perspective qu’un piteux échec? Certes chacun fait des efforts:elle en lisant « L’Idiot »de Dostoïevski, lui en l’accompagnant au cinéma et au karaoké. Mais cela peut-il suffire? Clément a beau appliquer des préceptes de Kant au travail de Jennifer, on finit par avoir le sentiment que la « philosophie »de cette dernière vaut bien les références savantes du premier.
Certains considéreront peut-être ce film avec dédain, en l’accusant d’être farci de clichés…C’est vrai qu’il n’en manque pas, mais qu’importe quand on a affaire à une bonne mise en scène et à de vrais talents d’acteurs ! Loïc Corbery convient tout à fait au rôle de Clément. Mais il faut surtout encenser la performance d’Emilie Dequenne dans le rôle de Jennifer. C’est elle qui donne à ce film toute sa grâce et qui fait oublier les clichés. Après tout, les grandes comédies de l’âge d’or d’Hollywood n’étaient pas dépourvues, elles non plus, de clichés! Mais quand Lubitsch ou Hawks étaient à la manoeuvre et quand on voyait évoluer Gary Cooper ou Claudette Colbert, on oubliait tous les poncifs! Ici, la présence de d’Emilie Dequenne opère un miracle semblable!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20140428 –Cinéma
NIGHT MOVES
un film de Kelly Reichardt.
Il faut le dire et le répéter, il existe un cinéma indépendant aux Etats-Unis, un cinéma qui ne sacrifie pas aux modes, qui ne cherche à plaire ni par de l’esbroufe ni par des effets spéciaux à foison. Kelly Reichardt fait partie de ces cinéastes qui creusent leur sillon et marquent de leur empreinte chacun de leurs films. Après avoir évoqué la vie de colons traversant, en 1845, le désert de l’Oregon dans « La Dernière Piste », la réalisatrice s’empare d’un sujet bien contemporain dans ce nouvel opus, mais en restant fidèle à son style, un style qui ne cède jamais au sensationnalisme.
Ce que Kelly Reichardt s’attachait surtout à montrer dans « La Dernière Piste », c’était les gestes quotidiens, les tâches à accomplir et la monotonie des jours qui passent. Ici, alors qu’il est question d’un événement rare, la destruction d’un barrage hydroélectrique, elle choisit de ne montrer que l’avant et l’après de la catastrophe sans rien filmer ni de l’explosion ni de ses conséquences directes.
Ce qui intéresse la cinéaste, ce ne sont pas les scènes à sensation, mais les personnages, leur motivation et leur évolution. Dans « Night moves », nous avons affaire à un groupe de trois activistes écolos bien déterminés à employer les grands moyens pour se faire entendre. Ils fomentent donc un attentat visant un des barrages de l’Oregon. Pour parvenir à leurs fins, il leur faut un bateau bourré d’explosifs et des véhicules pour prendre la fuite. La réalisatrice suit de près les préparatifs, les tractations nécessaires pour acquérir ce dont ont besoin les personnages et ainsi nous les faisant découvrir avec de plus en plus de précision :Josh (Jesse Eisenberg), le plus introverti et le plus énigmatique du trio, Dena (Dakota Fanning) et Harmon (Peter Sarsgaard).
Leur forfait accompli, tous trois ont décidé de se séparer et de ne plus communiquer entre eux afin de ne pas attirer les soupçons. Mais sait-on d’avance ce que l’explosion d’un barrage peut occasionner, quels dommages, quels drames peuvent en découler ? Les trois terroristes écolos risquent fort de se trouver pris à leur propre piège et entraînés sur des chemins qu’ils n’imaginaient pas. Si Harmon semble rester déterminé et impavide, il n’en est pas de même pour Dena, déstabilisée par les conséquences tragiques de l’acte accompli. Quant à Josh, malgré son air impénétrable et son apparente froideur, la réalisatrice réussit à nous suggérer à quel point ce qui s’est passé le trouble de plus en plus, installe en lui la peur et lui fait commettre une nouvelle fois l’irréparable.
En fin de compte, une nouvelle fois, comme dans chacun de ses films, Kelly Reichardt, maîtrisant parfaitement l’art de la mise en scène, réussit à passionner le spectateur sans jamais lui imposer les scènes que beaucoup d’autres cinéastes considéreraient comme le fleuron obligatoire de leur film. Inutile de montrer l’explosion d’un barrage et des torrents submergeant les terres, il suffit de scruter les gestes et de sonder les visages, même les plus fermés comme celui de Josh, et l’on est captivé !
7,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20140414 –Cinéma
MY SWEET PEPPER LAND
un film de Hiner Saleem.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets:que l’on soit homme ou femme, au Kurdistan, quand vient l’âge de se marier, pas question de batifoler ni de contrevenir à l’honneur des familles, celles-ci se chargent de fournir la pièce manquante, si l’on peut dire. Baran fuit sa mère et la valse des prétendantes trouvées par cette dernière et, pour ce faire, décide de reprendre du service en tant que fonctionnaire de police. Quant à la belle Govend, malgré ses 27 ans, elle ne se décide pas à convoler:elle choisit plutôt de s’éloigner des siens et de continuer à exercer le métier qui la passionne, celui d’institutrice. Les voilà qui se retrouvent donc, tous deux, dans un coin perdu du Kurdistan, aux confins de l’Iran, de l’Irak et de la Turquie. Dans ce paysage de montagnes, à la fois superbe et effrayant de rudesse, règne Azzi Aga, un potentat local, organisateur des trafics les plus louches et dont personne n’ose contester l’autorité. Baran, lui, prend la décision de le défier et de rétablir l’ordre et la loi dans ces contrées perdues. L’affrontement aura lieu, non seulement entre Baran et le tyran Azzi, mais entre ce dernier et l’institutrice, car bien sûr entre les deux esseulés Baran et Govend naît et grandit une affinité qui ne tarde pas à engendrer les pires ragots.
Le réalisateur Hiner Saleem a choisi, on l’aura compris, de transposer au Kurdistan les codes et les thématiques du western. C’est tout juste si, au détour d’un chemin, l’on ne s’attend pas à voir surgir un cow-boy buriné qui aurait les traits de Gary Cooper ou de John Wayne! Mais non, on a bien affaire à des acteurs kurdes ou iraniens et ça fonctionne parfaitement. On est même subjugué, tout au long du film, par le talent du metteur en scène et par le jeu irréprochable des acteurs. Cela donne un film fascinant, captivant. De la violence, des tensions, il y en a, comme dans les meilleurs westerns. Mais il y a aussi quelques petites touches d’humour qui sont les bienvenues, ainsi que quelques séquences de pure grâce. Quand Govend joue d’un instrument à percussion qu’on appelle, paraît-il, un hang et qui produit les sons les plus harmonieux, c’est si beau, si merveilleux qu’on aimerait que cela ne s’arrête jamais!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20140410 –Cinéma
NOÉ
un film de Darren Aronofsky.
Je craignais le pire et je ne me suis pas trompé! Il faut dire que les récits bibliques agrémentés à la sauce hollywoodienne donnent rarement quelque chose de fameux. Ce film ne fait pas exception:ce n’est qu’un blockbuster sans intérêt!
Que reste-t-il du récit du Déluge tel qu’il est raconté dans la Bible? Pas grand chose, à vrai dire. Tout est passé à la moulinette du réalisateur afin de donner un spectacle naïf, absurde, ridicule. Les effets spéciaux n’y changent rien ou plutôt ne font qu’accentuer la sottise d’une intrigue tirée par les cheveux. Soyons juste, il y a bien quelques séquences réussies, mais la plupart sont ou laides, ou bâclées ou ratées. Les allusions à Adam et Eve sont d’une naïveté confondante. Le récit de la Création du Monde raconté par Noé et vu en accéléré est à la fois laid et bâclé. Tout le reste, ou presque, est à l’avenant, le pompon revenant à ces stupides et laides créatures appelées « veilleurs »si je ne me trompe et qui sortent de je ne sais où. A se tordre de rire!
Quant à Noé, le voilà transformé en un grotesque tyranneau qui découvre in extremis qu’il est aussi capable d’aimer. Que de bêtises! Il faudrait décerner au réalisateur la palme de l’adaptation biblique la plus raté qui soit! On ne serait pas loin de la vérité.
Quand je pense que Russell Crowe souhaitait montrer cet absurde pensum au Pape François, espérant avoir droit à sa bénédiction! Décidément, il y en a qui n’ont pas peur du ridicule!
1/10
Luc Schweitzer,sscc
20140407 –Cinéma
NEBRASKA
un film de Alexander Payne.
Rien ne l’en fera démordre: Woody Grant en est sûr, le courrier qu’il a reçu ne peut pas mentir, il a gagné un million de dollars à une loterie! Il en même tellement persuadé que, malgré son âge et ses infirmités, il entreprend, à plusieurs reprises, de faire à pied le chemin qui le sépare de Billings dans le Montana à Lincoln dans le Nebraska, soit un bon millier de kilomètres! La police, l’ayant trouvé, le ramène à la maison, mais il ne songe qu’à repartir. Et ni sa femme ni ses fils ne parviennent à le raisonner.
Woody Grant veut son million de dollars. En a-t-il besoin? Qu’importe! Il a décidé de se racheter une camionnette, lui à qui il est désormais interdit de conduire, et un compresseur pour remplacer celui qu’il a prêté jadis et qui ne lui a jamais été rendu. Quant au reliquat, eh bien ce sera pour laisser quelque chose à ses fils.
De guerre lasse, face à un père aussi obstiné, un des fils se décide à l’emmener jusqu’au Nebraska, en passant par Hawthorne où réside un des frères de Woody. L’on a affaire à un road-movie assez classique donc, mais magnifié par une superbe photographie en noir et blanc, par des acteurs et actrices au mieux de leur forme, et par un scénario malin, multipliant les trouvailles, mêlant intelligemment l’émotion, la peine, la colère et le rire.
Ce périple, qui fait se retrouver le père et le fils, mais aussi la femme de Woody qui vient les rejoindre en cours de route, les membres de la famille habitant la ville de Hawthorne, et plein d’autres individus fréquentés autrefois par le supposé millionnaire, ce périple réserve mille surprises, des plus savoureuses aux plus scandaleuses. Dès qu’il est question d’argent, et en l’occurrence de beaucoup d’argent, on peut être sûr que les rapaces ne sont pas loin, prêts à s’emparer d’une bonne partie du magot. Famille, amis, plus rien ne compte que de s’en mettre, si possible, plein les poches…
Bien sûr, au bout du compte, comme on a affaire à une triste arnaque, on risque fort de rester penaud! Pas tout le monde cependant, car ce périple, aussi farfelu qu’il paraisse, n’aura pas été inutile, loin de là. Il aura mis à nu le coeur de pas mal de gens, y compris celui des deux principaux protagonistes. Et le coeur de ces deux-là finit par révéler ce qu’il y a de plus beau en l’homme. Parmi ces oubliés de l’Amérique, il peut se cacher de pauvres mesquineries, mais aussi de grandes générosités. Et c’est bien ce qui l’emporte, au bout du film, quand l’émotion gagne aussi, irrésistiblement, le coeur du spectateur!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20140318 –Cinéma
SON ÉPOUSE
un film de Michel Spinosa.
Que le cinéma est exaltant quand un cinéaste de talent choisit de promener sa caméra sur des terres lointaines, de se confronter à la différence, de s’aventurer vers d’autres cultures ! L’Inde avait déjà été visitée par des cinéastes de grand renom comme Jean Renoir ou Roberto Rossellini :ils y avaient tourné des films passionnants, limités peut-être par leurs regards d’occidentaux, mais néanmoins captivants par ce qu’ils essayaient de révéler à propos de cet immense pays, de ses habitants, de ses mœurs. Le voyage en valait la peine, et c’est aussi ce qu’on se dit après avoir vu ce superbe film de Michel Spinosa.
La question se pose de manière aiguë pour Joseph (Yvan Attal) quand il apprend le décès de Catherine (Charlotte Gainsbourg), son épouse partie en Inde après une dure épreuve et, en fin de compte, retrouvée morte sur une plage près de Madras. A cela s’ajoute l’étrange, l’inouï :une jeune Indienne tamoule, Gracie, se dit possédée par un « pey », un esprit mauvais qui la tourmente et qui ne serait autre que celui de la Française défunte. « Chez vous, en France, explique une Indienne venue informer Joseph de ces faits, vous diriez de Gracie qu’elle est folle. Mais en Inde, on affirme qu’elle est possédée ! ».
Non sans avoir hésité, Joseph se résout à entreprendre ce voyage et à s’immerger dans cet autre monde, cette réalité si lointaine et si proche à la fois. Habilement, Michel Spinosa a su éviter l’exotisme à deux sous, les clichés que transmettent volontiers les occidentaux venus à la découverte du continent indien. L’exotisme est même considérablement tempéré parce que l’on s’immerge au sein d’une communauté catholique de Madras. On a affaire à des chrétiens qui, comme tous les chrétiens du monde, prient en usant des mêmes gestes et des mêmes formules. Mais on a affaire aussi, c’est vrai, à un christianisme teinté de couleur locale, de croyances et de rites auxquelles nous ne sommes guère habitués chez nous. Gracie est possédée par l’esprit de la défunte et rien ni personne ne l’en fera démordre. Les paroles de sagesse et de raison de Joseph, venu à sa rencontre, n’ont d’autre effet que de la mettre en rage. Et c’est un autre voyage que doit entreprendre ce dernier :un voyage intérieur, un voyage qui oblige à se déposséder de soi-même pour mieux appréhender les hantises et les souffrances de l’autre.
Plusieurs flashbacks interviennent au cours du film et nous font découvrir le voyage qu’avait entrepris Catherine :ses souffrances, ses tourments, le pourquoi de sa mort. En allant à Madras, en s’approchant de Gracie, c’est bien Catherine aussi que retrouve Joseph. Parviendra-t-il à délivrer la jeune Indienne possédée, à la libérer de l’esprit qui la tourmente ?
N’hésitons pas à accompagner Michel Spinosa et ses personnages, à entreprendre nous aussi ce voyage, le temps que dure ce film captivant. Nos esprits rationnels et cartésiens en seront peut-être quelque peu déstabilisés, mais c’est tant mieux !
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
LA COUR DE BABEL
un film de Julie Bertuccelli.
Venus des quatre coins du monde, de Roumanie, de Pologne, du Sri Lanka, de Chine, d’Egypte, du Sénégal, du Brésil, du Chili et de plusieurs autres pays encore, voici des adolescents de 11 à 16 ans, nouvellement arrivés en France et débarquant dans la classe d’intégration d’un collège du Xe arrondissement de Paris. Julie Bertuccelli les a suivis et filmés pendant toute une année scolaire, elle a planté sa caméra dans cette « cour de Babel » dont on peut dire qu’elle est l’opposée de la Tour du même nom. Au lieu de brouiller les langues et de signer ainsi l’échec du projet insensé de bâtir un édifice défiant le Ciel, il s’agit d’accueillir des élèves parlant des langues ô combien diverses et de leur donner le goût d’apprendre une langue commune, la langue de leur nouveau pays, la France. Ce faisant, ces jeunes construisent leur intégration et leur avenir.
La réalisatrice s’est contentée, si l’on peut dire, de scruter les visages et de faire entendre les paroles de ceux qui sont directement concernés par le devenir de ces adolescents :eux-mêmes bien sûr, l’enseignante Brigitte Cervoni et quelques parents. Pas d’autre regard, pas de points de vue extérieurs, pas de réflexions de spécialistes, et c’est tant mieux. Par petites touches, l’on en découvre de plus en plus sur chacun de ces élèves, sur leur passé et leur présent, sur leurs peurs et leurs espoirs, leurs joies et leurs tristesses. Malgré leur jeune âge, plus d’un parmi eux a déjà traversé de dures épreuves et plus d’un, au détour d’une phrase, révèle ou laisse entendre dans quelle précarité il vit encore. Certains sont porteurs de grands rêves, celui d’être un virtuose du violoncelle ou celui d’être un médecin, mais d’autres savent bien que pèsent sur eux la menace d’un retour au pays, d’un mariage forcée voire d’une excision.
Les mots qui résonnent, tout au long du film, de manière explicite ou non, sont ceux de notre devise républicaine. Ici une maman affirme à l’enseignante qu’elle est venue en France dans l’espoir d’être une femme libre. Là on découvre que l’école s’efforce d’offrir à chacun les mêmes chances :cela ne va pas de soi, sans doute, mais il y a bien une forme d’égalité dans le traitement réservé à chacun. A l’une des élèves qui s’insurge, estimant que, quand on est noir, on n’a pas droit aux mêmes chances que les autres, Brigitte Cervoni explique patiemment qu’il n’en est rien et que les décisions prises ne se fondent jamais ni sur l’origine ni sur la couleur de la peau.
Quant à la fraternité, on la voit se construire, au fil du temps, de manière presque palpable. Les différences ne sont jamais gommées et elles donnent lieu à de savoureux débats. Ainsi lorsqu’il est question des religions :telle jeune fille explique que sa mère s’est convertie de l’Islam au Christianisme, tel garçon venu du Maroc brandit fièrement un Coran…Pourtant, rien ne peut freiner la croissance de la fraternité :lorsqu’en cours d’année une élève annonce son soudain départ, c’est un déchirement. Et quand arrivent la fin d’année scolaire et l’éparpillement de tout ce petit monde, que d’émotions et que de larmes ! D’autant plus que pour Brigitte Cervoni aussi, une page se tourne :c’est sa dernière classe, à la rentrée prochaine elle changera de poste.
Il faut saluer, pour finir, le travail remarquable de cette dernière :on est très favorablement impressionné, tout au long du film, par sa patience et par son sens de la pédagogie. Et il faut saluer l’initiative de Julie Bertuccelli :son documentaire est une formidable invitation à l’accueil et à la fraternité. « C’est comme si on était tous des frères et des sœurs et qu’on se séparait pour de bon, explique un des élèves à la fin du film. J’oublierai pas cette année. Jamais. » Et nous non plus, spectateurs, nous n’oublierons pas les craintes et les espoirs, les larmes et les sourires de ces adolescents.
8,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20140306 –Littérature
Bonjour à tous! Ce n’est pas de cinéma dont il sera ici question,mais de littérature. Ayant lu ces derniers temps ‘Ceux de 14′ de Maurice Genevoix, j’ai été si bouleversé que j’en ai fait ce petit compte-rendu. Bon carême.
CEUX DE 14
un livre de Maurice Genevoix.
J’ai déjà lu beaucoup d’écrits et de récits concernant la Grande Guerre, mais, curieusement, je n’avais pas encore lu l’un des ouvrages les plus réputés, celui de Maurice Genevoix. Cette lacune est à présent réparée. Et quelle lacune c’était! Car ‘Ceux de 14′est sans conteste un livre de premier ordre, un des témoignages les plus forts et les plus poignants jamais écrits sur la guerre de 14.
Genevoix n’y fait quasiment pas de littérature. On a le sentiment, en lisant cet ouvrage, qu’il a été rédigé dans le feu de l’action, au moment même où les faits sont racontés. C’est écrit à la manière d’un journal, sans fioritures et sans hypocrisie, sans même dissimuler les ordres invraisemblables que donnent parfois les gradés! Quant aux dialogues, ils donnent l’impression d’avoir été pris sur le vif tant ils sonnent vrais ! C’est tout juste si l’on n’entend pas, quelque part dans sa tête, les accents des différents protagonistes, ceux des soldats des quatre coins de la France mêlés aux accents des villageois de la Meuse.
L’ouvrage est divisé en quatre parties:« Sous Verdun », « Nuits de guerre », « La Boue »et « Les Eparges ». Les trois premières parties décrivent tantôt les faits d’armes, tantôt l’ennui dans les tranchées et dans la boue, tantôt les moments de répit et de repos que s’accordaient les poilus en allant dans les villages d’alentour. Ils y étaient en général assez bien accueillis, trop même par certains profiteurs de guerre qui n’hésitaient pas à leur vendre à des prix prohibitifs des denrées alimentaires ou de l’eau-de-vie. Heureusement qu’à la bonne saison il y avait moyen de se procurer sans un sou de pleines poignées de quetsches ! La quatrième partie (« Les Eparges ») est de loin la plus terrifiante:Genevoix y raconte l’horreur des combats avec un tel réalisme, un tel souci du détail, qu’on en reste effaré. Pendant des jours et des nuits, sans discontinuer, le champ de bataille des Eparges a été labouré par les bombes; pas un espace qui ait été épargné. Des soldats morts par dizaines, par centaines, certains pulvérisés, déchiquetés…On se demande comment Genevoix et quelques autres ont pu en réchapper. Ces pages sont ahurissantes, mais il faut les lire pour sentir ne serait-ce qu’un tout petit peu l’épreuve inimaginable subie par les poilus.
On ne peut lire un tel livre sans être remué jusqu’aux entrailles et sans éprouver une détestation radicale de la guerre. Il me semble qu’un téléfilm dont le scénario s’inspire des écrits de Maurice Genevoix sera diffusé en automne à la télévision, pour le centenaire de la Grande Guerre. Je doute que ce film puisse rendre compte de manière totalement satisfaisante de la puissance atroce de ce livre. Mais peut-être cela donnera-t-il l’idée à l’un ou à l’autre d’en entreprendre la lecture :c’est un moyen sûr et bouleversant de rendre hommage à ceux qui ont versé leur sang dans les tranchées de Verdun.
Luc Schweitzer,sscc
20140218 –Cinéma
LES GRANDES ONDES (à l’Ouest!)
un film de Lionel Baier.
Avril 1974. Deux journalistes suisses sont envoyés au Portugal afin d’enquêter sur des réalisations effectuées grâce à l’entraide entre les deux pays. Accompagnés de Bob, le preneur de son, ils sillonnent le pays en combi VW. Il y a certes une tension palpable entre les deux journalistes, Julie la féministe et Cauvin le baroudeur souffrant de pertes de mémoire, mais le ton est vite donné:nous sommes dans une comédie et les situations cocasses ne vont pas manquer. Avec l’aide de Pelé, un jeune portugais qui rêve de rencontrer Marcel Pagnol, nos reporters interrogent les gens du cru. « Ah!, leur dit-on, merci à la France, à l’Allemagne, à l’Angleterre, pour la construction de notre belle école! »–« Et la Suisse?, demandent nos journalistes, quel est l’apport de la Suisse? »Eh! oui, que peut bien avoir fait la Suisse, sinon ce qui décore la façade du beau bâtiment…? (Je vous laisse deviner de quoi il s’agit ou, mieux encore, le découvrir en allant voir le film!).
Tout va se corser davantage lorsque nos reporters apprennent incidemment que le pays qui les accueille est entré en révolution! Et le pire, c’est que l’information leur est fournie par une équipe de la radio belge! Mais quelle révolution! La révolution des oeillets! Chasser la dictature, entrer en démocratie sans effusion de sang, quelle belle leçon, et non pas seulement pour les Suisses! Voilà donc notre équipe de journalistes emportée dans le vent de la grande histoire! Eux qui étaient venus pour vanter l’aide de leur riche pays au Portugal défavorisé!…Ils découvrent un pays qui n’a besoin ni des Suisses ni des Belges ni des Français pour en finir avec un dictateur!
A la fois drôle, cocasse, plein d’enseignements et très inventif (il y a même une séquence filmée à la manière d’une comédie musicale), ce film est un vrai régal, aussi délicieux que le chocolat (suisse bien sûr…). Il serait dommage de le manquer!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20140217 –Cinéma
IDA
un film de Pawel Pawlikowski.
Tout commence avec la représentation du Sacré-Coeur:après l’avoir repeinte, Anna et les autres novices portent la statue du Christ et la déposent sur son piédestal. Représentation du Sacré-Coeur qui réapparaîtra, un peu plus tard, sous la forme d’une image pieuse. Le Christ montrant son Coeur, c’est à lui qu’Anna a voué sa vie, au point qu’elle s’apprête à s’engager définitivement dans la vie religieuse. Mais a-t-elle vraiment eu le choix, elle qui est orpheline et qui a passé la majeure partie de sa vie au couvent? Ne faut-il pas un peu se frotter au monde avant que de prononcer ses voeux de religieuse? C’est avec sagacité que la Mère supérieure enjoint donc à Anna de rendre visite au seul membre de sa famille encore en vie, sa tante Wanda.
Nous assistons alors à la rencontre de deux femmes aux destins radicalement opposés:Anna la novice fait la connaissance de celle qu’on a surnommée « Wanda la Rouge », une femme qui a servi le régime communiste polonais des années 50 en tant que juge et qui, on le comprend d’après son surnom, ne l’a pas fait avec mollesse! Mais Anna apprend surtout de la bouche de sa tante qu’en réalité son prénom est Ida et qu’elle est juive. Le film prend dès lors l’allure d’une quête des origines et d’une enquête, car Ida veut savoir pourquoi ses parents sont morts et ce qu’il est advenu de leurs dépouilles.
Les deux femmes en recherche de vérité se heurteront cependant à bien des obstacles car, dans la Pologne profonde des années 60, on ne se livre guère:on se mure dans le mutisme, on veut faire croire qu’on ne sait rien…Il faut beaucoup d’obstination pour ébranler les murs de silence et de médiocrité édifiés par les uns et les autres et pour enfin entrevoir la vérité dans toute sa laideur. Pour Ida, ce voyage est une mise à l’épreuve:restera-t-il quelque chose de sa foi et de sa vocation? Retournera-t-elle au couvent pour y prononcer ses voeux? Car elle est non seulement confrontée à la terrible réalité de ce qu’il est advenu de ses parents, elle découvre non seulement son identité juive, mais elle perçoit aussi ce que pourrait être sa vie ailleurs qu’au couvent, avec ce garçon qu’elle rencontre par exemple et qui lui avoue son trouble:« Tu ne sais pas l’effet que tu produis… ». Wanda aussi la houspille:« Ton Christ, lui dit-elle, il est allé à la rencontre de gens comme moi!… ». Oui, ce Christ qu’elle a porté sur ses épaules au début du film, ce Christ montrant son Coeur, il est celui qui n’a pas craint de choquer en mangeant à la table des pécheurs ou en accueillant l’hommage d’une prostituée!
Avec ce long-métrage filmé à l’ancienne, en noir et blanc et dans un format qui n’est quasiment plus utilisé de nos jours, Pawel Pawlikowski nous donne une oeuvre passionnante, troublante, grise et belle. Mystérieuse, lumineuse, tantôt hésitante tantôt déterminée, Ida, la « nonne juive », fascine, intrigue et interroge…
9,5/10
Luc Schweitzer,sscc
20140124 –Cinéma
LE VENT SE LÈVE
un film de Hayao Miyazaki.
Pour ce qui sera vraisemblablement son chant du cygne (le maître japonais ayant dit et redit qu’il signait là son dernier long-métrage), Hayao Miyazaki s’inscrit à la fois dans la continuité de ce qu’il a déjà créé et dans une certaine rupture. Continuité parce qu’on retrouve ici quelques-unes des obsessions ou quelques-uns des leitmotivs qui ont agrémenté une grande partie de son œuvre, à commencer par la fascination pour les engins volants et pour tout ce qui vole :cela nous a valu nombre de scènes inoubliables depuis « Nausicaä » jusqu’au dragon du « Voyage de Chihiro » en passant « Kiki la petite sorcière », « Le Château dans le Ciel » et « Porco Rosso ». Mais une autre obsession, beaucoup plus sombre et beaucoup moins poétique, glisse également son épouvante dans ce film ultime :celle des catastrophes et des destructions, que ce soit du fait de la nature (un séisme) ou du fait de l’homme (la guerre). Rupture aussi, disais-je, parce que, pour une fois, Miyazaki n’a pas éprouvé le besoin de recourir aux fantasmagories (en dehors de quelques scènes de rêves) ni aux créatures ni aux divinités dont il a peuplé d’autres de ses films.
En effet, au lieu de puiser son inspiration dans des récits fantastiques ou dans des mythologies, Miyazaki s’est emparé de l’histoire et du destin d’un personnage réel, de l’ingénieur Jiro Horikoshi à qui l’on doit l’invention du chasseur Zero de sinistre mémoire, un avion qui fit des ravages durant la deuxième guerre mondiale. Comment ?, s’étonnera-t-on, après avoir exprimé toute sa vie sa détestation de la guerre, Miyazaki, au soir de son existence, serait-il devenu un affreux belliciste ? Bien sûr que non ! Une telle interprétation du « Vent se lève » serait totalement fallacieuse. Au contraire, ce film indique clairement que la guerre est la pire des folies et que l’emploi du chasseur Zero pour provoquer des carnages s’apparente au détournement d’un rêve que l’on transforme en cauchemar.
On craindra peut-être aussi de perdre énormément sur le plan de la poésie :l’évocation de l’histoire du Japon plutôt que le recours aux récits fantastiques ne rend-il pas le film pesant et sans grâce ? Mais sur ce plan-là aussi, l’appréhension, si elle existe, a vite fait de s’envoler pour laisser place à l’émerveillement. La poésie est présente, plus que jamais, elle se glisse dans la vie, dans le quotidien, dans l’environnement, dans la nature, elle est partout, offrant toute une palette de nuances, du plus clair au plus sombre. Elle est à rechercher, en premier lieu, dans tout ce qui se réfère au titre du film, lui-même emprunté au vers d’un poème de Paul Valéry :« Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Et le vent, en effet, est partout :du vent léger qui fait se reconnaître et se rejoindre ceux qui s’aiment en emportant de l’un à l’autre un chapeau, un parasol ou un avion de papier au vent fou qui attise l’incendie ravageant une ville déjà détruite par un séisme, en passant par une autre sorte de vent, celui de l’histoire, qui, comme je l’ai déjà dit, corrompt les rêves afin de les changer en cauchemars.
« Il faut tenter de vivre », aller jusqu’au bout de ses rêves :que ce soit le rêve d’Icare ou le rêve d’aimer, de persévérer dans l’amour malgré la maladie qui ronge la bien-aimée. Jiro Horikoshi qui, à cause de sa myopie, ne peut lui-même être un aviateur, n’en concevra pas moins , à l’exemple de son maître italien Caproni, les meilleurs avions. Et il tentera aussi d’aller jusqu’au bout de l’amour qui le lie à une jeune fille rencontrée lors d’un tremblement de terre. Vivre ses rêves, oui, au risque de les voir emmener où l’on ne veut pas. Vivre son rêve d’aimer, même quand l’amour est compromis par des fragilités.
« Le Vent se lève » ressemble bien à un testament :tour à tour ample, confondant de beauté, puissant, doux, lumineux, bouleversant, sombre, triste…Il y a tout cela, et bien plus encore, dans cet ultime chef d’oeuvre du génial Hayao Miyazaki.
9/10
Luc Schweitzer,sscc
20140113 –Cinéma
PHILOMENA
un film de Stephen Frears.
En 2001, la sortie sur les écrans du film de Peter Mullan, « The Magdalene Sisters », nous avait fait découvrir avec consternation et révolte le traitement réservé aux filles « fautives »dans l’Irlande des années 50:enfermées au couvent, gardées par de redoutables religieuses sûres de leur bon droit, elles étaient exploitées éhontément, condamnées à trimer et trimer encore pour le supposé rachat de leur péché.
Sans doute fallait-il un film comme celui de Peter Mullan, un film à charge, un film sans trop de nuances, pour révéler ce scandale. Aujourd’hui cependant, la parution de « Philomena »de Stephen Frears, film qui n’est pas sans rappeler par son thème celui de Peter Mullan, adopte un ton très différent, plus nuancé et plus apaisé, sans pour autant gommer, bien entendu, les exactions commises par des religieuses à l’encontre des filles soi-disant perdues qui leur étaient livrées comme des proies.
Tirée d’une histoire vraie, voici donc le portrait de Philomena Lee et sa quête éperdue pour retrouver le fils qu’elle a mis au monde dans un couvent alors qu’elle n’était qu’une toute jeune fille et qui lui a été enlevé par les religieuses pour être vendu à un couple d’américains en recherche d’adoption. Cinquante ans après les faits, alors qu’il ne se passe pas un jour sans qu’elle ne songe à son fils, Philomena fait la rencontre de Martin Sixsmith, un ex-journaliste de la BBC, qui s’intéresse à son histoire et avec l’aide de qui elle va entreprendre de retrouver son fils perdu.
Le couple qui se forme alors pourrait facilement tomber dans la caricature. Mais Stephen Frears a su habilement tirer parti des différences de ses deux protagonistes sans jamais forcer le trait. Non seulement cela fonctionne admirablement, mais on va de séduction en séduction. Quand Martin Sixsmith, le journaliste qui ne croit pas en Dieu, nous pousse à l’indignation, Philomena qui, malgré les épreuves, n’a jamais perdu sa foi chrétienne, donne l’exemple d’un coeur qui ne veut céder ni à la vengeance ni à la haine.
C’est d’autant plus surprenant qu’on se rend compte, au cours du film, que, si les religieuses des années 50 se servaient des filles qui leur étaient confiées d’une manière totalement indigne et scandaleuse, celles d’aujourd’hui ne sont pas, elles non plus, exemptes de tout reproche, loin s’en faut! On ne se débarrasse pas si facilement des pharisaïsmes! Et comme il n’y a rien de plus difficile que de faire repentance, on préfère dissimuler, brûler, effacer, faire silence, faire semblant d’ignorer…
On sort de ce film en étant outré par ces hypocrisies sans aucun doute, mais aussi et surtout bouleversé, ému, touché au plus profond par le personnage à la fois simple et hors du commun qu’est Philomena (merveilleusement interprétée par Judi Dench). Une femme qui, malgré les injustices et les blessures, garde sa dignité et donne l’exemple d’une foi chrétienne agissante, sans faux-semblant, capable de la parole la plus belle et la plus étonnante qui soit, la parole de réconciliation. C’est beau, tout simplement!
8/10
Luc Schweitzer,sscc
20140106 –Cinéma
NYMPHOMANIAC,VOL. 1
un film de Lars Von Trier.
Chaque nouveau film de Lars Von Trier apporte son lot de surprise, si, si! Et la première des surprises, c’est qu’il lui soit possible d’aller encore plus loin dans les registres du ridicule et de la bêtise qu’il ne l’a fait jusqu’ici. Pourtant, dans ces domaines, notre Danois est d’une inventivité sans bornes! Déjà, quand il nous infligeait « Breaking the waves », il nous fourguait un scénario d’une rare stupidité: une fille qui, pour le salut de son homme, couchait avec tous les travailleurs d’une plate-forme pétrolière, il fallait l’oser! Mais la crétinerie ne fait pas peur à notre orgueilleux cinéaste, et il nous l’a prouvé, film après film, jusqu’à nous écoeurer avec le nihilisme répugnant de « Mélancholia » érigé au rang de soi-disant chef d’oeuvre du septième art! Nihilisme encore et toujours car, en somme, c’est aussi une forme de nihilisme que la nymphomanie dont il s’empare à présent.
Mais le rusé Danois a sa petite idée en tête: tout se déroulera sous la forme d’une confession. Joe, l’héroïne nymphomane, est retrouvée gisante par un certain Seligman qui s’empresse de la recueillir et de lui faire raconter son histoire. Elle ne se fait pas trop prier, la bougresse…Mais attention, attention: j’ai employé tout à l’heure le mot qu’il ne fallait pas, le mot « confession ». Car Seligman prend bien soin de préciser qu’il n’est pas un homme religieux. Et Lars Von Trier prend bien soin, quant à lui, d’évacuer vite fait la notion de péché. Alors…Alors Joe fait quand même une confession et Seligman se comporte tout du long comme celui qui donne sans compter des absolutions à tout ce qui lui est raconté.
Cela étant posé, il n’y a plus qu’à s’en mettre plein les mirettes! Allons-y de bon coeur avec le récit de toutes les frasques de notre nymphomane! Pas d’interdit: montrons-la même en train de copuler pendant l’agonie de son père, pourquoi pas? Mais il reste tout de même, pour briser un peu la monotonie de tant de turpitudes, à imaginer quelques analogies. On imagine comment le père Lars s’est creusé le ciboulot…Eurêka, s’est-il écrié. Et de foncer tête baissée dans l’analogie la plus bête qui soit: la pêche à la mouche! La nymphomane cueille les hommes comme on pêche du poisson: c’est fort, ça! Mais le meilleur est toujours pour la fin:« voyons, s’est demandé le père Lars, quelle transgression pourrais-je imaginer? »–« Eurêka, s’est-il écrié à nouveau, prenons ce qu’il y a de plus pur et de divin sur la terre: les polyphonies de Jean-Sébastien Bach! »Quelle audace! Comparer les frasques de Joe à la musique du cantor de Leipzig! Heureusement que le ridicule ne tue pas, comme on dit. Mais Lars Von Trier est tellement fort dans ce domaine, si fort qu’on pourrait rassembler sa filmographie entière sous un seul titre, emprunté, en le détournant, à un fameux ouvrage du XIXe siècle: « Du ridicule considéré comme l’un des Beaux-Arts »!
Lamentable, tristounet, faussement provocateur, ennuyeux à mourir, insupportable comme la musique tonitruante qui donne envie de fuir dès le début du film! Oh! la bêtise crasse et supine, comme disaient mes professeurs de collège et de lycée. A quelles autres audaces ridicules doit-on encore s’attendre? Car le pire, c’est que ce film est en deux volets! Aurai-je le courage d’en voir le deuxième volume?: that is the question!
0/10
Luc Schweitzer,sscc